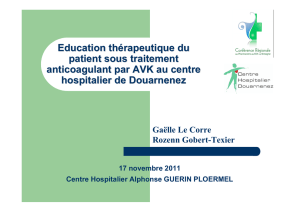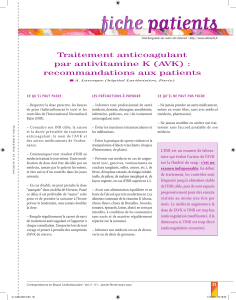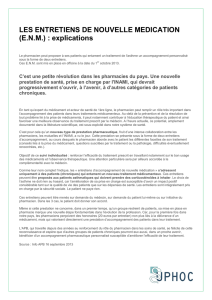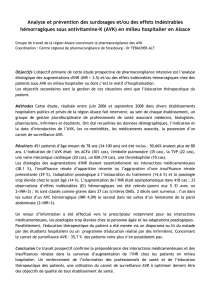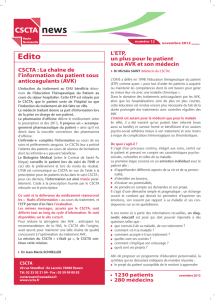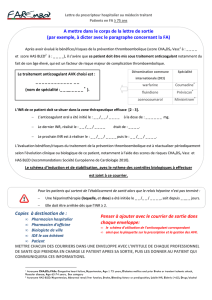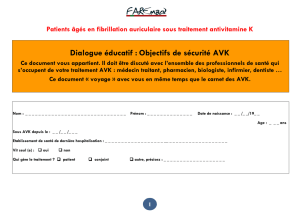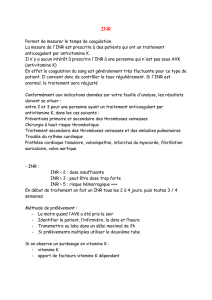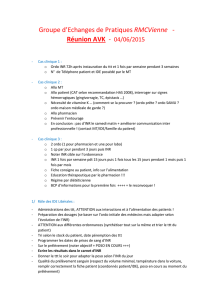Les entretiens AVK: bilan d`étape

Actualités pharmaceutiques
Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř33
Mots clés - anticoagulant oral; dispensation; entretien pharmaceutique; iatrogénie; INR; observance
Keywords - compliance; dispensing; iatrogenesis; INR; oral anticoagulant; pharmaceutical interview
prévention
pratique
© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS
http://dx.doi.org/10.1016/j.actpha.2014.06.007
Les entretiens AVK: bilan d’étape
Les entretiens pharmaceutiques des patients sous antivitamine K (AVK), instaurés en 2013,
visent à favoriser le bon usage des anticoagulants oraux afin de lutter contre les accidents
iatrogéniques. Cedispositif, basé sur la continuité, suppose une prise en charge globale
et une méthodologie précise afin que sa qualité et son efficacité soient garanties.
AVK interviews: interim assessment. Pharmaceutical interviews with patients taking
antivitamin K (AVK), set up in 2013, aim to encourage the correct use of oral anticoagulants
in order to prevent iatrogenic accidents. This scheme, based on continuity, requires global
care and a precise methodology in order to assure its quality and efficacy.
Instaurés depuis un peu plus d’un
an dans les officines [1], les
entretiens pharmaceutiques des
patients sous antivitamine K (AVK)
suscitent beaucoup d’espoir dans
la profession, notamment vis-à-vis
des nouveaux modes de rémunéra-
tions.
Ils sont mis en œuvre alors que la
iatrogénie se rattachant aux anti-
coagulants oraux est très impor-
tante, avec environ 5000 décès et
100000 hospitalisations par an.
Dans une démarche d’amélioration
des pratiques officinales, un certain
nombre de points se révèlent indis-
pensables au bon suivi des patients
sous AVK.
Un défi pour les
pharmaciens d’officine
Les anticoagulants représentent la
classe des molécules le plus sou-
vent impliquées dans la iatrogénie,
notamment chez le patient de plus
de 70ans. L’impact des entretiens
pharmaceutiques des patients sous
AVK sera donc évalué à la lumière
de ces données aisément quanti-
fiables dans des études épidémio-
logiques. En cas de résultats
positifs, à savoir une diminution glo-
bale de la iatrogénie, il sera possible
d’envisager un élargissement et une
accélération du suivi généralisé des
patients atteints de pathologies
chroniques en instaurant en France,
comme c’est déjà le cas au Québec
ou en Suisse, une revue de médica-
tion pluriannuelle ou un suivi d’ad-
hésion aux traitements.
Une nouvelle démarche
La profession a, pour relever ce défi,
suivi en un minimum de temps de
nombreuses formations, dans le
cadre du développement profes-
sionnel continu (DPC) notamment,
ce qui démontre son implication
dans de tels dispositifs.
Pour compléter ces formations,
l’Assurance maladie a, de son côté,
mis en place un suivi unique par
internet, permettant une gestion
assez simple des patients. Les for-
mulaires et informations sont ainsi
accessibles, dans un espace pro-
fessionnel, sur le site dédié ameli.fr.
Ce support web est complété par
l’envoi d’une documentation écrite
comportant une notice explicative
ainsi qu’un questionnaire regrou-
pant les items importants devant
être abordés lors des entretiens
pharmaceutiques. Cequestion-
naire, qui doit être rempli par les
pharmaciens lors des entretiens
successifs, atteste in fine de leur
réalisation effective. Il peut être assi-
milé, a priori, plus à un interrogatoire
qu’à un formulaire de suivi de
patients. Aussi, il s’agit, pour le
pharmacien, de le réinterpréter et de
l’intégrer à une démarche de suivi
en fonction des thématiques abor-
dées.
Le rôle du pharmacien
Jusqu’à présent, les patients sous
AVK étaient suivis principalement
lors des dispensations d’ordon-
nances à l’occasion desquelles le
pharmacien se devait d’observer
une démarche méthodologique.
Les entretiens pharmaceutiques
s’inscrivent dans cette continuité.
Ilconvient ainsi, dans un premier
temps, d’adapter son exercice offi-
cinal à ce double dispositif, en dis-
tinguant ce qui fait partie du suivi
général (la dispensation) et du suivi
particulier (l’entretien).
En pratique, il incombe au titulaire
de désigner une personne dédiée
ou bien d’assurer une implication de
l’ensemble des pharmaciens de
l’offici ne.
Plusieurs types d’organisations
peuvent être envisagés. Il est ainsi
possible de fixer des rendez-vous
aux patients à dates précises afin
d’organiser l’emploi du temps du
© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS
© 2014 Published by Elsevier Masson SAS
Yves MICHIELSa,*
Maître de conférences
associé en pharmacie
clinique
François PILLONb
Pharmacologue
Dorian HENNEQUINc
Étudiant en 6e année
depharmacie
*Auteur correspondant.
Adresse e-mail :
yves.michiels@u-bourgogne.fr
(Y. Michiels).
aFaculté de pharmacie,
7 boulevard Jeanne-d’Arc,
21079 Dijon, France
b17 bd de Brosses,
21000Dijon, France
cUFR Sciences
pharmaceutiques et
biologiques, Université
de Bourgogne, 7 bd
Jeanne-d’Arc, BP87900,
21079 Dijon cedex, France

Actualités pharmaceutiques
Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř
34
pratique
prévention
personnel de l’officine, en choisis-
sant des moments de moindre fré-
quentation, le matin à l’ouverture
par exemple. Une carte de rendez-
vous peut être élaborée à cette fin.
Les entretiens AVK,
première étape
Si nous souhaitons que ces entre-
tiens deviennent de véritables
compléments à la dispensation,
celle-ci doit intégrer au quotidien
des éléments clés s’inscrivant dans
un véritable plan de gestion de
risque. Une dispensation “type”
peut ainsi être décrite à partir des
éléments habituels en la possession
du pharmacien, à savoir l’historique
médicamenteux et les informations
échangées avec le patient.
L’historique
médicamenteux
Élément de base de la carte Vitale
ou du logiciel officinal, l’historique
médicamenteux doit être consulté
à chaque dispensation
et permettre au phar-
macien de relever les
points essentiels s’y
rattachant:
Ř introduction d’un
nouveau médicament;
Ř médicament prescrit anté-
rieurement;
Ř arrêt d’un médicament;
Ř changement de dosage ou de
posologie;
Ř renouvellement simple du traite-
ment;
Ř introduction d’un traitement aigu;
Ř substitution générique;
Ř automédication.
Ces derniers peuvent être analysés
ensuite avec le patient afin d’être
confirmés (possible erreur de pres-
cription…) et de comprendre le
contexte thérapeutique.
Le dialogue pharmacien/
patient
Un dialogue peut s’établir entre le
pharmacien et son patient au sein
de la dispensation afin de mettre en
relief à la fois les éléments contenus
dans l’analyse de l’historique, mais
également des renseignements
complémentaires.
Les informations recueillies doivent
au final permettre au pharmacien de
constituer un véritable dossier
patient regroupant l’ensemble des
données indispensables au bon
déroulement des entretiens. Celles-
ci peuvent évoluer au cours du
temps, ce qui nécessite des adap-
tations de comportement. Enfin, les
différents points évoqués lors de la
dispensation peuvent être validés
dans le questionnaire de l’Assu-
rance maladie avant même le début
des entretiens, ce qui en allégera le
déroulement.
Comment se passe
le traitement?
La gestion du traitement au quoti-
dien doit être analysée et réévaluée
lors des deux ou trois entretiens
annuels.
F Iatrogénie: le pharmacien doit
demander au patient s’il a détecté
des saignements ou d’autres évé-
nements indésirables, et évaluer
leur intensité, notamment en ce qui
concerne les incidents hémor-
ragiques qui nécessitent une réo-
rientation médicale.
F Observance: élément central de
la réussite ou de l’échec du traite-
ment, l’observance peut être appré-
ciée en analysant certains points – le
patient vient-il à date régulière, fait-
il ses analyses biologiques à date
fixe (en fonction des recommanda-
tions médicales)? –, susceptibles
de mettre au jour des difficultés de
suivi.
F Modalité d’administration: le
pharmacien doit évaluer si le patient
a bien compris le calendrier de prise
(prise fractionnée), respecte le
schéma posologique qui peut être
complexe (1; ½; ¾ par exemple) et
arrive à bien “casser” ses comprimés.
En effet, une variation de plus de 5%
de la dose journalière peut modifier
l’INR (International normalized ratio).
Les changements de posologie, qui
interviennent en moyenne deux à trois
fois par an, constituent également des
moments à risques, qui demandent
au pharmacien de s’assurer que le
patient comprend bien les modalités
de l’administration et les résultats de
son INR.
Comment vous
portez-vous?
Ce point concerne la partie propre-
ment thérapeutique de la prise en
charge. En dehors d’aspects parti-
culiers, comme les facteurs de
comorbidités présents chez de tels
patients (hypertension artérielle,
diabète, dyslipidémies…), le phar-
macien peut se concentrer plus
spécifiquement sur les AVK et tout
d’abord sur l’INR.
L’INR est le véritable
témoin au long cours du
traitement AVK. Il per-
met tout autant de
contrôler la bonne
observance du traitement et du suivi
biologique que de déterminer le pro-
fil du patient.
L’INR est dit “stable” si le sujet ne
présente pas plus de deux valeurs en
dehors de l’intervalle thérapeutique
dans les six mois et “instable” en pré-
sence de plus de deux valeurs en
dehors de l’intervalle thérapeutique
dans les six mois. Cecritère de sta-
bilité est important. Desvaleurs
situées régulièrement en dehors de
l’intervalle thérapeutique accroissent
le risque, soit de majoration de la
iatrogénie, soit de survenue de
thrombus. Le pharmacien doit
inclure, lors des dispensations suc-
cessives, cette demande d’informa-
tions sous forme de questions
simples: quelle est la dernière valeur
connue de votre INR? Quelle est la
date de vos prochaines analyses?
La gestion du traitement au quotidien
doitêtre analysée et réévaluée lors des deux
ou trois entretiens annuels

Actualités pharmaceutiques
Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř35
prévention
pratique
Avez-vous pris d’autres
médicaments
oudescompléments
alimentaires?
La prise de certains médicaments
d’automédication ou de complé-
ments alimentaires est susceptible
de modifier les valeurs d’INR (anti-
inflammatoires non stéroïdiens,
millepertuis, oméga3, Ginkgo
biloba…).
Les entretiens AVK,
seconde étape
Afin de mener efficacement des
entretiens pharmaceutiques, le
pharmacien doit au préalable se
constituer un dossier patient (papier
ou électronique) regroupant l’en-
semble des informations perti-
nentes pour le bon suivi de son
patient sous anticoagulant.
La fiche de “présentation
patient“
La fiche de “présentation patient“
doit répertorier:
Ř les mesures anthropométriques
(âge, sexe, poids);
Ř les principales valeurs biolo-
giques(clairance de la créatinine,
taux de cholestérol, glycémie…);
Ř les antécédents pathologiques
connus (accident vasculaire céré-
bral, infarctus du myocarde, can-
cer…);
Ř les habitudes et l’hygiène de vie
(alimentation, activité phy-
sique…);
Ř l’historique médicamenteux des
trois derniers mois;
Ř un graphique représentant l’évo-
lution de l’INR, réalisé sur trois à
six mois.
Le pharmacien peut ainsi, tout au
long des entretiens, détecter les
situations à risques. À titre
d’exemple, une diminution de l’acti-
vité physique augmentera l’INR à
posologie constante du fait de la
diminution du métabolisme des AVK
(moindre flux sanguin disponible
pour le métabolisme hépatique).
L’autre point important est l’établis-
sement d’un tableau annuel de
posologie, permettant au pharma-
cien d’apprécier le profil, stable ou
non, de son patient (tableau1).
Cette fiche de présentation devra
être consultée à chaque début d’en-
tretien et sera réactualisée si néces-
saire afin de disposer des derniers
éléments connus et de mieux
apprécier d’éventuelles variations.
La lettre aux
professionnels de santé
Ces entretiens constituent une
réelle occasion de faire progresser
les relations avec les autres profes-
sionnels de santé (médecin traitant,
spécialistes…). Il serait souhaitable,
comme le suggère la Convention
pharmaceutique d’avril 2012 [2] de
les réaliser dans un cadre précis en
élaborant une lettre type que le
pharmacien enverra au médecin
traitant après accord de son patient.
Cette lettre devra inclure les princi-
pales caractéristiques des entre-
tiens abordés avec le patient, à
savoir:
Ř le but du traitement AVK;
Ř le plan de posologie;
Ř le suivi de l’INR;
Ř les effets indésirables et les situa-
tions à risques constatés;
Ř les règles hygiéno-diététiques;
Ř l’automédication…
Cet élément de liaison ou de trans-
mission est important car il doit ser-
vir de support d’information,
notamment pour expliciter le plus
clairement possible le rôle et les
compétences des pharmaciens,
tout en dissipant certaines craintes
émises par d’autres professionnels
de santé.
Les outils
informationnels
Afin de compléter efficacement le
dossier patient, le pharmacien doit
disposer d’outils lui servant de sup-
port informationnel tout au long des
entretiens. De cette façon, il peut
rendre son patient plus autonome.
F Le carnet de surveillance, qui
doit être remis lors d’une dispensa-
tion ou du premier entretien, permet
au patient d’inscrire les résultats de
ses INR ou de consulter des infor-
mations générales sur son traite-
ment.
F Le tableau des aliments conte-
nant de la vitamine K (figure1) doit
permettre au patient de mieux appré-
cier les quantités de vitamine K pré-
sentes dans son régime habituel.
F Les fiches posologiques
hebdo madaires des AVK (figure2)
peuvent aider le patient à mieux se
repérer dans la préparation de ses
doses, notamment en cas de poso-
logie fractionnée.
F Les photos des principaux pro-
duits d’automédication contre-
indiqués avec les AVK peuvent
aider le patient à reconnaître plus
facilement les médicaments à évi-
ter.
F Certaines informations géné-
rales doivent être communiquées
concernant l’oubli de comprimés,
les signes d’alertes d’hémorragie,
les conduites à tenir, etc., afin de
permettre au patient de mieux gérer
au quotidien son traitement et de pré-
venir toute iatrogénie potentielle.
Seule une minorité des personnes
placées sous AVK ont reçu, dans les
Tableau1. Posologies des antivitamines K usuelles au cours de l’année.
Date 1erfévrier 2014 1ermars 2014 1eravril 2014 1ermai 2014
Posologie
Coumadine®
4mg 3mg
= changement de
posologie

Actualités pharmaceutiques
Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř
36
pratique
prévention
hôpitaux, les réseaux de soins ou au
cours d’une séance d’éducation
thérapeutique du patient (ETP), une
information complète et actualisée
sur les anticoagulants.
Ces outils “de base” s’intègrent par-
faitement dans des entretiens à
visée informationnelle, lorsque le
patient manque de repères dans
son traitement par méconnaissance
ou oubli simple (personnes âgées).
Leur utilisation permet donc au
pharmacien d’apprécier le niveau
de connaissances de son patient
(acquis, partiellement acquis, non
acquis).
La résolution
decertaines situations
àrisques
Dans certaines situations particulière-
ment à risques, l’information ne suffit
plus en tant que telle pour résoudre les
problèmes évoqués avec le patient
lors des entretiens pharmaceutiques.
Ces derniers doivent intégrer alors
davantage d’aspects cliniques et moti-
vationnels, permettant au pharmacien
de prévenir ces situations. Ce dernier
doit alors mener une mini-enquête
précise
pour comprendre, par exemple,
certains écarts de valeurs d’INR
(encadré 1) ou encore orienter rapide-
ment son patient vers le médecin en cas
d’apparition de symptômes nouveaux
(telle une hémorragie soudaine).
D
ansde telles situations, le pharma-
cien doit rechercher un facteur tempo-
raire pouvant expliquer la situation
(figure3).
Il convient de transmettre toute
information significative au médecin
traitant sous une forme écrite afin de
formaliser les faits. Ceci est impor-
tant car, bien évidemment, la situa-
tion clinique étant modifiée, le
prescripteur pourra être amené à
réévaluer la posologie habituelle du
Figure1. Liste non exhaustive des aliments pouvant faire varier l’INR (International normalized ratio).
© Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO)

Actualités pharmaceutiques
Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř37
prévention
pratique
patient. Cenouveau dosage sera tran-
sitoire si un facteur dit “temporaire” est
identifié, telles une variation quanti-
tative et qualitative du mode d’ali-
mentation. À l’inverse, un facteur dit
“non temporaire”, comme une
immobilisation prolongée ou une
diminution de la fonction rénale,
engendrera une modification plus
longue, voire définitive de la poso-
logie.
Autour de l’entretien
pharmaceutique
D’autres questions peuvent se
poser lors de l’élaboration ou de la
tenue des entretiens.
Le temps de l’entretien
Le temps consacré à la réalisation des
entretiens est propre à chacun. Néan-
moins, ils ne doivent être ni trop longs,
ni trop exhaustifs car la capacité
d’acquisi tion de connaissances du
patient n’est pas infinie. Aussi, il peut
être conseillé de se fixer une limite,
20minutes pouvant représenter un
standard (tableau2). L’entretien pourra
être complété à l’occasion des diverses
dispensations ou par une mini-évalua-
tion de la situation ou des connais-
sances (une à deux questions
maximum).
Un entretien programmé
ou ponctuel?
Pour percevoir la rémunération liée à
la tenue des entretiens pharmaceu-
tiques, le pharmacien doit en réaliser
au minimum deux par an. Après un
recrutement actif parmi les patients
sous AVK, il s’avère judicieux de fixer
à l’avance la première rencontre afin
d’aborder sereinement la structure
globale d’un tel dispositif qui doit
s’inscrire dans un suivi pluriannuel.
En revanche, il peut être intéressant
de réaliser un entretien “express”
face à une situation nécessitant une
prise de décision rapide (orientation
médicale). Cette intervention fait par-
tie intégrante des entretiens car elle
nécessite une analyse de la situation
du patient selon les éléments métho-
dologiques préala blement définis.
À propos de la mesure
ou de l’automesure
de l’INR
L’INR est le test biologique qui permet
la surveillance du traitement anti-
coagulant par AVK. Ils’effectue dans
un laboratoire d’analyses médicales.
En France, la commercialisation des
appareils d’automesure d’INR est
Figure2. Fiche posologique.
© Y. Michiels, D. Hennequin
Lors d’un entretien avec une patiente dont
l’INR (International normalized ratio) est
habituellement équilibré, celle-ci a men-
tionné souffrir de gingivorragies fréquentes
depuis quelques jours. À l’aide d’un ques-
tionnaire adapté, il a été mis en relief
qu’une modification abrupte des habitudes
alimentaires, avec une diminution de la
consommation en légumes, remplacés par
des féculents à l’entrée de l’hiver, pouvait
en être la cause. Nous avons alors proposé
à la patiente de réaliser, dès le lendemain
matin, un INR dans son laboratoire d’ana-
lyses médicales, ce dont il a été fait part au
médecin généraliste. Quelques jours plus
tard, elle est revenue à l’officine afin de faire
un nouveau point sur sa situation : la poso-
logie de son traitement antivitamine K avait
été modifiée, suite aux résultats de l’INR.
M. Cusin, pharmacien titulaire, Fleurville (71)
Encadré 1. Situations à risques : témoignage d’un pharmacien
 6
6
1
/
6
100%