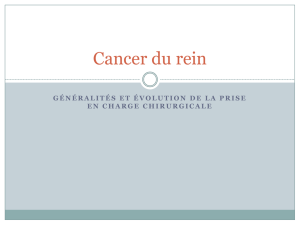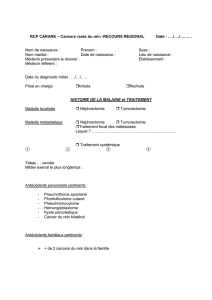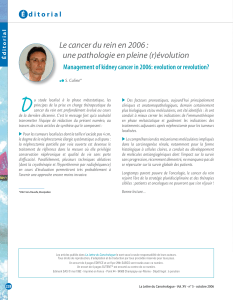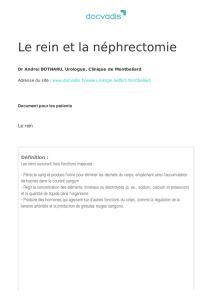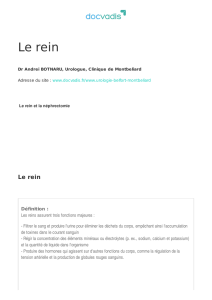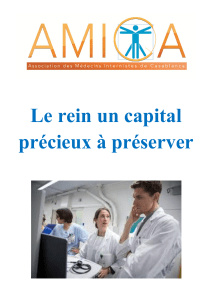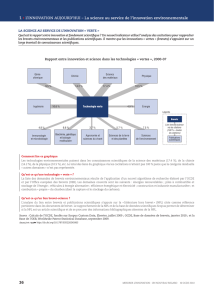LA NEPHRECTOMIE PARTIELLE LAPAROSCOPIQUE (REVUE

INTRODUCTION
La confirmation soutenue par la littérature de
l’équivalence des résultats oncologiques entre chirurgie
de préservation néphronique et chirurgie radicale pour
les tumeurs de petite taille a ouvert une nouvelle aire
dans la pathologie tumorale rénale. Cette nouvelle
réalité a favorisé le développement de techniques
devant permettre, par leur caractère « mini invasif »,
une réduction notable de la morbidité liée à l’acte
chirurgical. Dans cette optique, la laparoscopie a connu
ces dix dernières années un essor considérable. Les
résultats carcinologiques très encourageants de la
néphrectomie partielle laparoscopique (NPL) ainsi que
la maîtrise de la technique chirurgicale par ces équipes
tendent à élargir le champ des indications aux tumeurs
rénales malignes de plus en plus volumineuses. Aussi,
le développement parallèle de techniques d’exploration
rénale per-laparoscopique (échographie), de nouvelles
formes d’énergie et d’agents pharmacologiques
-6-
LA NEPHRECTOMIE PARTIELLE LAPAROSCOPIQUE
(REVUE BIBLIOGRAPHIQUE)
J.E. EL AMMARI, S. MELLAS, M.J. EL FASSI, M.H. FARIH
Service d’Urologie, Hôpital El Ghassani, CHU Hassan II, Fès, Maroc
RESUME
La confirmation par la littérature des résultats carcinologiques
de la chirurgie conservatrice au moins comparables à ceux
de la chirurgie radicale en ce qui concerne les tumeurs
rénales de petite taille, a ouvert la voie au développement
de techniques qui devront permettre par leur caractère mini-
invasif de réduire la morbidité liée à l’acte chirurgical. Dans
cette optique, la laparoscopie a connu ces dix dernières
années un essor considérable. La néphrectomie partielle
laparoscopique (NPL) a alors émergé comme une technique
chirurgicale de préservation néphronique fiable et
reproductible entre les mains des équipes expérimentées.
Utilisée au début pour des pathologies bénignes puis pour
des tumeurs malignes de petite taille périphériques et
exophytiques, la maîtrise de la technique chirurgicale a
permis d’élargir les indications à des tumeurs plus
volumineuses (T1b) et de localisation plus complexe avec
des résultats carcinologiques comparables à la voie ouverte.
L’utilisation de nouvelles formes d’énergie et de produits
pharmacologiques hémostatiques a contribué de façon
considérable à réduire la morbidité de cette technique
chirurgicale qui rejoint celle de la voie ouverte tout en gardant
les avantages du choix laparoscopique. La NPL paraît donc
une technique d’avenir, et le nombre croissant de publications
la concernant au cours de cette dernière décennie tendent
à la simplifier et contribuent à sa standardisation et sa plus
large diffusion.
Mots clés : néphrectomie partielle ; laparoscopie ; tumeur
rénale
Correspondance : Dr. J.E. EL AMMARI,1596, 4ème tranche,
Hay oued Fès, Fès, Maroc. e-mail : ammarijalal@yahoo.fr
ABSTRACT
LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY (LITERATURE
REVIEW)
The confirmation by the literature of the carcinological results
of the nephron sparing surgery at least comparable with
those of the radical surgery as regards small renal tumours,
have favoured developing techniques permiting by their low
invasive character, to reduce considerably morbidity related
to the surgical act. Accordingly, the laparoscopy made these
ten last years considerable great strides. Laparoscopic partial
nephrectomy then emerged like a reliable and reproducible
surgical nephron sparing technique with experienced teams.
Used at the beginning for benign pathologies then for small
peripheral and exophytic malignant tumours, the control of
the surgical technique made it possible to widen the
indications to a larger and more complex localization tumours
with comparable carcinological results with the open surgery.
The use of the new types of energy and haemostatic
pharmacological products contributed considerably to reduce
the morbidity of this surgical technique which joined that of
open way the while keeping the advantages of the laparoscopic
choice. Laparoscopic partial nephrectomy thus appears a
technique of a future, and the growing number of publications
relating to it during this last decade tend to simplify it and
contribute consequently to its standardization and its largest
diffusion.
Key words : partial nephrectomy ; laparoscopy ; renal tumour
MISE
AU POINT
J Maroc Urol 2007 ; 7 : 6-16

-7-
hémostatiques permettent de mieux contrôler le geste
opératoire et d’en limiter les complications. Le nombre
croissant de publications concernant la NPL au cours
de cette dernière décennie tendent à simplifier la
technique chirurgicale et contribuent par conséquent
à sa standardisation et sa plus large diffusion.
INDICATIONS DE LA NPL
1. Indications de la néphrectomie partielle (NP)
La NP est indiquée en général chez tout patient risquant
de devenir anéphrique suite à une néphrectomie totale
avec comme conséquence un recourt immédiat à la
dialyse [1, 2]. Ces indications peuvent être
schématiquement réparties en deux groupes : indications
dans la pathologie cancéreuse du rein, et indications
dans la pathologie bénigne et intermédiaire.
1.1 Indications dans la pathologie cancéreuse du rein
Peuvent être classées en trois catégories :
• Indications absolues :
* Tumeurs rénales bilatérales synchrones : nécessitant
la réalisation d’une néphrectomie partielle bilatérale
quand c’est possible, en commençant par le côté où
la tumeur est moins évoluée et se prêtant bien à cette
chirurgie. Quand la tumeur est trop volumineuse d’un
côté, ou en présence de facteurs anatomiques
indiquant la néphrectomie radicale, cette dernière
est réalisée en différé après un premier temps de
néphrectomie partielle controlatérale. Novick [2]
justifie cette chronologie par l’éventuelle survenue
d’une nécrose tubulaire suite à l’hémodialyse
postopératoire après néphrectomie partielle qui impose
souvent de reréfléchir l’attitude radicale pour le côté
controlatéral.
* Tumeurs sur rein unique fonctionnel ou anatomique.
* Chez l’insuffisant rénal.
• Indications relatives : intéressent
- Les patients avec une tumeur rénale unilatérale, le
rein controlatéral fonctionnant normalement. Mais la
fonction de ce dernier risque d’être altérée par une
pathologie sous jacente tels un calcul rénal, une
pyélonéphrite chronique, une sténose de l’artère
rénale, un reflux vésico-urétéral, ou une maladie
systémique tel un diabète ou une néphrosclérose.
Chez ces patients, le risque et le bénéfice doivent
être considérés en fonction de l’âge, de l’état général,
des facteurs de co-morbidité, le risque de progression
de la maladie et la possibilité que ces conditions
peuvent altérer la fonction rénale.
- Les formes héréditaires du cancer du rein : maladie
de Von Hippel-Lindau, sclérose tubéreuse de
Bourneville, syndrome de Birt-Hogg-Dube et
léiomyomatose cutanée familiale. Dans ce contexte,
les formes bilatérales sont fréquentes, et la
prédisposition génétique rend le risque de récidive
au niveau du parenchyme restant après néphrectomie
partielle toujours présent. D’où l’intérêt de préserver
le maximum de capital néphronique.
• Indications électives :
* Tumeurs inférieures ou égales à 4 cm de diamètre
avec un rein controlatéral normal : l’absence de
différence significative en terme de résultats
carcinologiques et de survie entre la NP et la chirurgie
radicale, fait que la chirurgie conservatrice est une
indication idéale pour les petites tumeurs, uniques et
franchement localisées, d’autant plus que la NP permet
de mieux préserver la fonction rénale [2]. D’abord
recommandée dans les tumeurs inférieures ou égales
à 4 cm de localisation corticale à développement
exophytique avec rein controlatéral sain, les indications
se sont actuellement élargies –pour les équipes
entraînées– aux tumeurs de localisation centrale et
hilaire avec des résultats comparables aux tumeurs
de localisation périphérique [3, 4].
* Tumeurs de plus de 4 cm et de moins de 7 cm dans
leur plus grande dimension limitées au rein (T1b) :
constituent la perspective actuelle de la NP. Certaines
études comparant cette dernière à la chirurgie radicale
ne trouvent pas de différence en terme de taux de
récidive locale ou à distance, ni en terme de durée
moyenne de survie entre les deux types de chirurgie
[1]. Une autre étude retrouve une incidence de
métastases moindre avec la NP qu’avec la
néphrectomie totale [1].
1.2 Indications dans la pathologie bénigne et
intermédiaire :
• Pathologies bénignes : constituaient le sujet des
premières publications de la NP et de la NPL [1, 5, 6],
il s’agissait de :
- Tumeurs bénignes solides
- Kystes simples du rein.
- Pathologie congénitale : une néphrectomie polaire
supérieure laparoscopique bilatérale en un temps a
été rapportée par Pages et coll. pour une duplicité
urétérale complète avec abouchement ectopique des
uretères chez une patiente de 49 ans [7]. Sydorak et
coll. [8] ont rapporté dernièrement une série de 7
enfants âgés de 5 à 15 mois ayant subi une NPL pour
urétérocèle (5 patients), reflux vésico-urétéral sévère
(1 patient) et ectopie urétérale (1 patient) avec de très
bons résultats fonctionnels et esthétiques.
- Hydrocalice et lithiases récidivantes sur un calice mal
drainé.
• Pathologie intermédiaire : il s’agit essentiellement
de kystes atypiques du rein (stades 2 à 3 de la
classification de Bosniak). Une évaluation du kyste
sous vision laparoscopique, son aspiration pour examen
cytologique, et des biopsies de sa paroi avec examen
extemporané sont faites avant une éventuelle NPL [9].
J.E. EL AMMARI et coll.La néphrectomie partielle laparoscopique

-8-
2. Indications de la technique laparoscopique
Les indications de la NPL sont celles de la NP à ciel
ouvert. En effet, Il s’agit d’un choix technique qui
dépend de l’équipement et surtout de l’expérience de
l’opérateur. La NPL quand il y a indication, permet de
bénéficier de l’intérêt de la chirurgie de préservation
nephronique en terme de gain de la fonction rénale,
et des avantages de la chirurgie laparoscopique, à
savoir un moindre recours postopératoire aux
narcotiques, un séjour hospitalier plus court, et un
retour plus rapide à l’activité habituelle sans surajout
de morbidité pour les équipes entraînées [10, 11].
CONTRE-INDICATIONS DE LA NPL
Les contre-indications peuvent être divisées en deux
catégories [12] :
1. Contre-indications relatives
Dépendent de l’expérience de l’opérateur :
- Les antécédents multiples de chirurgie abdominale
par le risque d’adhérence.
- L’obésité (IMC > 30).
- Les tumeurs de plus de 4 cm (en dehors des cas
d’exérèse de nécessité sur rein unique qui sont discutés
au cas par cas).
- La localisation médiorénale.
2. Contre-indications absolues
Sont les mêmes que pour toutes les interventions par
voie coelioscopique à savoir :
- Les coagulopathies incontrôlables.
- L’insuffisance respiratoire obstructive sévère.
- Antécédent d’anévrysme cérébral.
Albqami N. et coll. [1] notent qu’il n’y a aucune contre-
indication absolue de la NPL par rapport à la chirurgie
radicale laparoscopique, et que l’obésité n’est pas un
facteur de morbidité surajouté dans ce type de chirurgie.
L’ANESTHESIE DANS LA NPL
Comme toute intervention laparoscopique, la NPL est
réalisée sous anesthésie générale avec intubation
trachéale, curarisation et ventilation artificielle. Cette
intervention n’est pas très douloureuse et les doses
d’analgésiques administrées sont modestes. En cas
d’intervention par voie rétropéritonéale, l’insufflation
de gaz carbonique (CO2) dans l’espace rétropéritonéal
expose à un risque d’acidose respiratoire car il existe
une diffusion importante du CO2 de l’espace
rétropéritonéal vers le sang. Ce qui nécessite l’adaptation
de la ventilation artificielle en augmentant parfois de
100 à 150% le volume expiré par minute.
TECHNIQUES CHIRURGICALES DE LA NPL
Winfield et al. avaient rapporté la première série de
NPL (6 patients) en 1993. Peu après, Gill et coll. ont
décrit la première NPL par voie rétropéritonéale [13].
Depuis, des séries de plus en plus considérables (500
NPL constituent la série de Haber et Gill [10]) sont
publiées. La NPL connaît actuellement une évolution
rapide grâce au développement de moyens techniques
dont le but est de répondre aux principaux défis de
cette chirurgie que représentent les marges de résection
(de point de vue oncologique), l’hémostase, et la
restauration de l’étanchéité de la voie excrétrice quand
celle-ci est ouverte. Les techniques présentées par les
différents auteurs visent à reproduire les principes de
la NP par voie ouverte (NPO). Deux approches ont été
décrites, la première par voie transpéritonéale et la
seconde par voie rétropéritonéale.
1. Préparation du patient
Une cystoscopie permet de monter une sonde urétérale
externe 5Fr dont l’extrémité supérieure ouverte est
placée dans le bassinet et l’extrémité externe est
raccordée à une tubulure stérile permettant d’injecter
par voie rétrograde en per-opératoire du bleu de
méthylène dilué [10].
2. Voie d’abord
• Choix de la voie d’abord
Les patients candidats à une NPL doivent avoir au
préalable une tomodensitométrie (TDM) hélicoïdale
avec des coupes de 3 mm et reconstitution
tridimensionnelle. Cette TDM permet d’avoir des
informations sur la taille de la tumeur, sa localisation,
son extension parenchymateuse, ses rapports avec les
cavités pyélo-calicielles, et sur la vascularisation rénale
détaillée (nombre des vaisseaux, leur localisation,
d’éventuelles anomalies, et les rapports dans l’espace
entre artères et veines). Le choix de la voie d’abord,
s’il s’agit d’une question de préférence pour certains
auteurs [12], est essentiellement dicté par la localisation
et la complexité technique de la masse tumorale pour
d’autres [10, 14, 15]. Pour les tumeurs antérieures,
antéro-latérales et latérales, la voie transpéritonéale est
préférable. Pour les tumeurs postérieures, postéro-
latérales et postéro-médianes, l’approche doit être
rétropéritonéale.
• Avantages et inconvénients de chaque voie d’abord
Chaque voie présente des avantages et des inconvénients
(tableau I).
J Maroc Urol 2007 ; 7 : 6-16

-9-
2.1. Approche transpéritonéale
Nous avons considéré comme technique de NPL de
référence celle décrite par Gill et coll. [10, 14]. Des
particularités techniques décrites par d’autres auteurs
seront notées et référencées au fur et à mesure ou
mentionnées en tant que notes techniques.
Installation du patient : le patient est installé en position
latérale de 45° à 60°, table cassée. Cette position doit
permettre d'effacer du champ opératoire les organes
digestifs après qu'ils aient été décollés.
L’intervention comporte les étapes suivantes :
- Création du pneumopéritoine par une aiguille de
Veress ou de Palmer.
- Quatre ou cinq trocarts sont mis en place selon les
opérateurs.
- Le trocart de l’optique est introduit en premier à
travers une incision sous ombilicale. Une optique de
30° est utilisée pour une meilleure vision à différents
angles.
- Deux autres trocarts de 5 mm sont mis en place au
niveau de la ligne axillaire moyenne sous contrôle
optique.
- Le côlon est mobilisé et récliné.
- Un trocart de 10 mm est mis en place au niveau de
la ligne axillaire antérieure.
- L’uretère et la veine génitale sont identifiés et rétractés
latéralement.
- Dissection du rein le long de la face antérieure du
muscle psoas jusqu’à ce que la veine rénale soit
visualisée.
- Les vaisseaux du rein sont disséqués en bloc au niveau
du hile.
- Le rein est mobilisé et dégraissé en dedans du fascia
de Gérota tout en maintenant la graisse péritumorale.
- Une sonde d’échographie laparoscopique flexible
avec doppler couleur introduite à travers le trocart
de 10/12 mm, permet de délimiter la tumeur, évaluer
son extension parenchymateuse, étudier ses rapports
avec les cavités excrétrices, et assurer par conséquence
une marge de section parenchymateuse correcte (de
0,5 cm environ).
- Injection intraveineuse de 12,5 g de mannitol 30
minutes avant le clampage des vaisseaux.
- Les vaisseaux du hile sont alors clampés en bloc par
une pince de Satinsky laparoscopique tout en prenant
le soin de ne pas prendre l’uretère. D’autres auteurs
préfèrent les clamps bulldog laparoscopiques pour
une meilleure mobilité et manoeuvrabilité [2].
- Quand la durée prévue de l’ischémie chaude excède
30 minutes, une hypothermie rénale doit être établie
grâce à un endosac de type « Endocath II-bag »
introduit par le trocart de 12 mm et placé autour du
rein mobilisé. 600 à 750 ml de glace fondue y est
injectée rapidement.
- La tumeur est excisée par un bistouri froid
laparoscopique dans un champ presque exsangue.
La section est développée préférentiellement en se
dirigeant de la ligne médiane vers la latérale.
- Des biopsies ciblées du lit tumoral doivent être
effectuées en cas de doute sur les marges chirurgicales
et la section, et envoyées pour examen anatomo-
pathologique extemporané.
- L’étanchéité de la voie excrétrice est vérifiée et
confirmée par l’injection répétée par voie rétrograde
du bleu de méthylène dilué. Quand elle est ouverte,
elle est suturée au vicryl rapide 2-0 aiguille CT-1.
- Des fils repères au 1-0 polyglatin à aiguille GS-25
sont mis au niveau du parenchyme rénal.
- Un tissu biologique hémostatique à base de gelatin-
matrix-thrombin (FloSeal) est appliqué sur la tranche
de section rénale en dessous de la mèche de Surgicel.
- Trois à cinq sutures arrêtées sont placées à travers des
mèches de Surgicel prépréparées qui sont positionnées
au dessus de la tranche de section rénale. Des clips
résorbables de type Hem-o-lok sécurisent les sutures
évitant leur dénouement.
- Un autre clip Hem-o-lok est appliqué sur la suture
de rapprochement des deux tranches rénales, visant
à effacer la concavité du lit tumoral et comprimer le
rein.
- La suture est ensuite fortement attachée à travers une
mèche maintenant une bonne compression du
parenchyme rénal.
Tableau I. Avantages et inconvénients de chaque voie d’abord
Avantages
- Elimination des risques
inhérents à
l'établissement du
pneumopéritoine et des
trocarts.
- Réduction du temps
opératoire en évitant le
temps de libération des
organes digestifs.
- Suppression de l'iléus
post-opératoire.
- Conversion facile lors
de l'abord de la loge
rénale si nécessaire.
- Espace de travail large
- Maniement de
l'endosac plus facile
- La résorption du CO2
est moins importante.
Voie rétropéritonéale
Voie transpéritonéale
Inconvénients
- L'espace de travail est limité.
- Le maniement de l'endosac
est difficile.
- L'exérèse du rein en cas de
néphrectomie nécessite
d'agrandir un des sites de
trocart en position
inesthétique.
- La résorption du CO2 est
plus importante qu'au cours
de la voie transpéritonéale.
- Présence de risques
inhérents à l'établissement
du pneumopéritoine et des
trocarts.
- Temps opératoire plus
important en rapport avec
la libération des organes
digestifs.
- Iléus post-opératoire plus
manifeste.
- Conversion plus difficile lors
de l'abord de la loge rénale
si nécessaire.
J.E. EL AMMARI et coll.La néphrectomie partielle laparoscopique

-10-
- La pince de Satinsky est déclampée et n’est retirée
que lorsque l’hémostase est confirmée.
- 12,5 g de Mannitol et 10 à 20 mg de furosémide sont
administrés par voie intraveineuse juste avant le
déclampage.
- La pièce tumorale est mise dans l’endosac (EndoCatch),
puis retirée.
- La cavité abdominale est réinspectée 5 à 10 minutes
après l’évacuation du pneumopéritoine.
- Un drain est laissé chez les patients dont la voie
excrétrice était ouverte.
2.2. Approche rétropéritonéale [10, 16]
Depuis la première néphrectomie par voie
laparoscopique rétropéritonéale réalisée par Gaur en
1993, les premiers temps de cette voie sont bien codifiés.
Installation du patient : le patient est installé en position
de lombotomie avec un billot fortement cassé,
permettant d’ouvrir la loge lombaire ; les jambes et les
cuisses sont fléchies d’environ 20°. Les jambes étant
placées au niveau de la partie avant des appui-jambes.
Les repères osseux sont représentés par le rebord costal
vers le haut et la crête iliaque vers le bas.
Le nombre de trocarts est variable selon les opérateurs,
de 3 à 5 trocarts. Sera décrite la technique utilisant 5
trocarts, 2 pour les instruments de l’opérateur, 2 pour
ceux de l’aide et 1 pour l’optique. Ces 4 trocarts
«opérateurs» se rapprochant des 4 mains existant dans
la chirurgie à ciel ouvert.
La position des trocarts est marquée sur la peau avant
badigeonnage : 2 trocarts (un de 10 mm et l’autre de
12 mm) au niveau de la ligne axillaire postérieure pour
les instruments de l’opérateur (un sous la côte et un
au-dessus de la crête iliaque), 2 trocarts de 5 mm au
niveau de la ligne axillaire antérieure pour les
instruments de l’aide (un en avant de la côte et un au
niveau de la crête iliaque) et un trocart de 10 mm au
niveau de la ligne axillaire moyenne au-dessus de la
crête iliaque pour l’optique. Les trocarts sont éloignés
le plus possible les uns des autres.
Une incision de 2 cm sous-costale sur la ligne axillaire
postérieure permet d’ouvrir les muscles de la paroi
abdominale, jusqu’au niveau de la loge lombaire. Le
fait de glisser sous la face postérieure de la douzième
côte indique que l’on se trouve dans le bon plan de
dissection. Le rétropéritoine est abordé à l’aide d’un
doigt qui repousse le péritoine en avant pour libérer
les zones correspondant à l’emplacement des trocarts.
La mise en place des trocarts peut se faire sous contrôle
digital ou sous contrôle optique. Un doigtier protège
l’index de l’opérateur pendant la mise en place des
trocarts sous contrôle digital.
Le trocart de 12 mm est mis en place au niveau de
l’incision initiale. Ce trocart doit être entouré d’un
système d’étanchéité qui prévient la fuite de gaz et la
création de lésion cutanée durant la procédure. Le
trocart de l’optique ne doit pas être placé trop près de
la crête iliaque qui pourra alors limiter sa mobilité.
Après placement des trocarts, l’artère et la veine rénales
sont disséquées individuellement pour faciliter la mise
en place de clamps Bulldog laparoscopiques : 2 clamps
pour l’artère et 1 clamp pour la veine. Le reste de
l’intervention respecte les mêmes étapes que pour la
voie transpéritonéale. Le clamp bulldog de la veine
rénale est enlevé en premier, puis celui de l’artère. Un
drain de « Penrose » est laissé quand la voie excrétrice
a été ouverte.
2.3. Autres techniques opératoires (hybrides)
• La NPL manu-assistée (hand-assisted LPN) [1, 17]
Le patient est installé en décubitus latéral légèrement
incliné de 45 à 60°. L’intervention commence par une
incision pararectale. Une dissection soigneuse sépare
la paroi postéro-latérale de l’abdomen du péritoine qui
ne doit pas être ouvert. Un Lap-disk est inséré et la
main est introduite dans l’espace rétropéritonéal.
Successivement, un trocart de 12 mm puis de 5 mm
sont insérés sous contrôle manuel. Le fascia de Gérota
est ouvert et disséqué autour du rein tout en préservant
la graisse qui coiffe la tumeur. Les vaisseaux rénaux
sont ensuite isolés. Les étapes suivantes sont les mêmes
que pour la NPL pure.
Pietrow et coll. [1] recommandent cette technique pour
les chirurgiens débutants du fait de sa facilité et la
manœuvrabilité qu’elle permet. La morbidité, les
complications et les marges chirurgicales sont
comparables à celles de la NPL pure [1]. Cependant,
cette technique nécessite une large incision pour pouvoir
introduire la main de l’opérateur, qui est source de
morbidité ajoutée à la procédure.
• La NPL assistée par robot (Robotic-assisted LPN)
[1, 18]
Cette technique qui utilise le « daVinci telerobotic
surgical system » mime de façon parfaite les différentes
étapes et principes de la NPL conventionnelle et de la
NPO. Phillips et coll. [1] ainsi que Gettman et coll.
[18] ont conclu que c’est une technique fiable et
reproductible. Cependant la moyenne du temps
opératoire, des pertes sanguines, de l’ischémie chaude
ou froide ainsi que la durée de séjour hospitalier sont
comparables à celles de la NPL pure. Aucun avantage
effectif n’est noté en faveur de la NPL assistée par robot
[1].
2.4. Notes techniques
• L’hémostase dans la NPL
- L’utilisation de la « gelatin matrix thrombine sealant
(FloSeal) » avant la fermeture du lit tumoral sur mèche
de surgicel diminue de façon considérable le
J Maroc Urol 2007 ; 7 : 6-16
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%