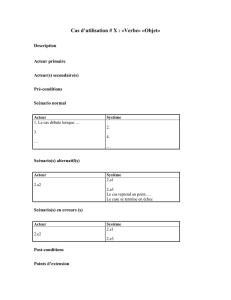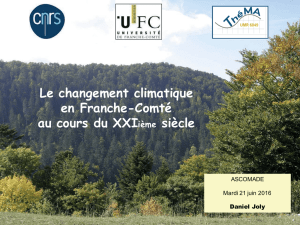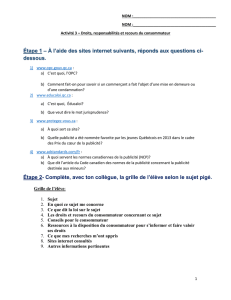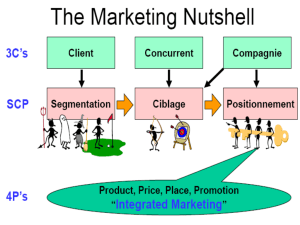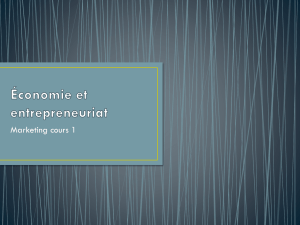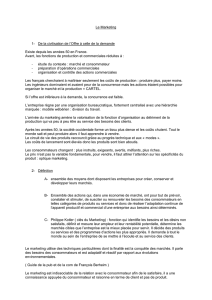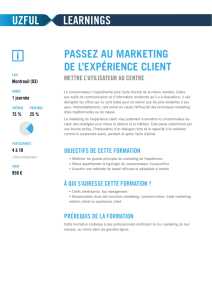PROSPECTIVE ET MARKETING Définition : rappel (différence entre

Luc Boyer ; Novembre 2012
PROSPECTIVE ET MARKETING
Définition : rappel (différence entre prévision et prospective)
La prospective est une certaine vision de l’avenir ; elle se distingue de la
prévision par de nombreux points.
La prévision se situe dans un horizon relativement connu avec des
caractéristiques assez bien appréhendées ; en général, la prévision prolonge
des tendances ou les inverse… mais pratiquement dans tous les cas , part de
notre connaissance du passé, du présent, des informations qu’on peut acquérir
sur un avenir pas trop lointain pour décrire les caractéristiques d’un futur
proche avec une marge d’erreur ou d’incertitude relativement faible.
La prévision est pour l’essentiel une prolongation de tendances –le trend- avec
plus ou moins d’inflexion.
Exemple : le PIB devrait se situer en 2013 entre zéro et un pour cent de
croissance, en France. Pour faire une telle prévision, on partira de la croissance
du 2° semestre 2012 (aujourd’hui pratiquement connu à 0,1 % près) et on
évalue les facteurs qui pourraient, à court terme, modifier le taux de croissance
actuel. Par exemple, pour qu’il y ait plus de croissance en 2013, il faudrait une
augmentation sensible des investissements (publiques ou d’entreprise), une
confiance dans l’avenir des citoyens/consommateurs qui entrainerait la
croissance, un environnement européen ou mondial porteur … autant de
conditions qui semblent loin d’être réunies. On peut, en conséquence,
« prévoir »une croissance très faible ou nulle (voir même une récession, cad
par exemple deux trimestres de croissance négative) Sachant, par ailleurs qu’en
dessous de 1 à 1,5 % de croissance du PIB, le taux de chômage a toutes les
chances d’augmenter, on peut « prévoir » un chômage en hausse l’année
prochaine.

La prévision peut se mettre en équation, en formules mathématiques, comme
c’est le cas pour la prévision des ventes à court ou moyen terme.
Il y a fort longtemps, les pétrochimistes mondiaux m’avaient demandé de
construire un modèle prévisionnel -à 2/3 ans- des ventes des grands polymères
plastiques, comme le PVC, le polyéthylène, le polypropylène … J’ai
classiquement utilisé deux approches complémentaires :
-Par l’amont, en faisant l’inventaire du potentiel de production des « steam
crackers » et autres colonnes de distillation capables de transformer les
monomères en polymères , véritables matières premières de l’industrie des
plastiques , des peintures et autres produits intermédiaires
-Par l’aval : il nous faut estimer la demande en produits finis. Par exemple
sachant que 5 à 10 % des matières plastiques sont utilisés dans le bâtiment ou
les travaux publics, il nous faudra estimer la prévision de construction de
logements.
Croisant l’offre et la demande, nous aurons la possibilité de proposer une
estimation (fourchette) qui sera notre meilleure prévision.
Ce travail trouve tout son sens dans une vision de court ou moyen terme parce
que la part d’inconnu reste relativement faible : le calcul des probabilités
pouvant apporter une aide précieuse pour appréhender le futur proche (j’ai eu
l’occasion, jeune ingénieur, de suivre - pour le compte d’une grande firme
nationale – la formation délivrée par l’Institut de Statistiques, formation
excellente, basique dont les effets demeurent longtemps après)
Le prolongement de tendances trouve ses limites au fur et à mesure qu’on
s’éloigne du moment présent. Tout se passe comme si un mur se dressait par
exemple au-delà de deux ou trois ans et que divers facteurs –exogènes ou
endogènes à la firme- difficilement prévisibles ou contrôlables, seraient en
mesure de venir perturber la réalisation des projets.
Prospective et Marketing
Cette dimension prospective va s’appliquer différemment suivant les groupes
de produits ou services qu’on étudie :

-quelques mois pour des produits de consommation courante
-quelques années pour des produits d’investissement (produits bruns ou
blancs, par exemple)
Prenons, à titre d’exemple, un cas extrême :
Comme responsable de la Marine nationale, on vous demande de définir les
caractéristiques d’un porte-avions en vue de sa construction.
La durée de vie d’un porte avions est évidemment variable mais atteint
normalement une cinquantaine d’années. Pendant sa vie, cet engin va subir de
nombreuses modifications ou adaptations (ex : remplacer la propulsion
classique par une propulsion nucléaire) Mais quelles seront les conditions de
combat ou d’engagement de cette flotte particulière à horizon aussi lointain
que ces 50 ans ?
Nous ne sommes plus dans le domaine de la prévision (le nombre d’inconnus
dépasse largement le nombre d’équations possibles) : nous rentrons dans le
champ de la Prospective ou, comme diraient les américains : What if… ?
Quand on ne peut plus prolonger les tendances (aussi vrai en géopolitique que
dans les actes de la vie courante) Il se trouve que les pionniers ont été les
militaires américains (department of defense ) en matière de prospective
appliquée. Certains experts prétendent même que cette discipline a largement
favorisé le maintien de la paix dans la période si tendue de la guerre froide.
Diverses méthodologies ont été ou sont pratiquées : la plus couramment
utilisée est celle des scénarios : un scénario est en quelque sorte une
hypothèse, une supposition, la description possible d’un avenir. Les
responsables vont être appelés à choisir et/ou construire soit un ou des
scénarios les plus probables soit ceux qu’ils souhaitent voir se réaliser. Le futur
n’est jamais totalement écrit : il se construit en partie. Suivant le scénario
choisi, l’action devra être plus ou moins forte pour que le « possible »
devienne « probable » On va s’efforcer d’agir sur les divers acteurs et
l’environnement tant en ce qui concerne les facteurs déterminants (ceux qui
caractérisent le scénario) que les facteurs discriminants (ceux qi le différencie
des autres scénarios)

Le problème central est de s’efforcer de prendre barre sur l’environnement.
Pour ce faire, on va s’efforcer d’agir sur les facteurs externes, sur les parties
prenantes. Il y aura lieu de s’appuyer au mieux sur les alliés(en ramenant les
neutres dans le camp des alliés) et de neutraliser ou d’isoler les adversaires
irréductibles. Une bonne méthode classique est de dresser une liste de
l’ensemble de ces parties prenantes et d’analyser leur comportement.
Nous constatons que nous passons sans vraiment de solution de continuité de
la prévision à la prospective mais les méthodes utilisées dans l’une ou l’autre
des disciplines ne seront pas les mêmes.
La prévision est modélisable, du domaine de l’analyse .La prospective est pour
une part du domaine de l’imagination voire de l’irrationnel (nous sommes dans
l’inconnu et un Jules Verne sera au moins aussi efficace qu’un prix Nobel de
mathématiques) Les arts (peinture, musique, poésie…) sont aussi utiles, sinon
plus, que les sciences exactes.
Aux deux niveaux que nous venons d’analyser-prévision et prospective –
correspondent les deux niveaux du marketing :
-un marketing de court terme, opérationnel au service de la vente et plus
précisément du commercial, fournissant méthodes, outils, informations pour
aider à la réalisation des prévisions de vente, ciblant les clients ou les
prospects, revisitant à la marge les attributs du produit ou du service. ..
-un marketing appelé souvent stratégique (c’est pour certains, la version
« noble » du marketing) qui va s’intéresser au moyen ou long terme en
s’efforçant de déceler les besoins, les motivations, les mouvements en
profondeur de la Société en particulier l’évolution les comportements du
client/consommateur. Cette deuxième approche d’identifier, en anticipant, les
produits ou services à imaginer pour le futur : la voiture électrique, la maison
écologiquement équilibrée, la formation le long de la vie, le service à la
personne… sont, entre autres, quelques-uns de ces exemples de champ de
développement d’un marketing stratégique. L’analyse de la valeur viendra
utilement compléter la réflexion marketing.
Notons que des mouvements contestataires plus ou moins issus du courant
écologique réfutent ce rôle « noble » du marketing. A leurs yeux, le marketing

n’est là que pour aider à imposer aux consommateurs les produits de
l’entreprise, que ceux-ci correspondent ou non à leurs besoins.
Regardons, à l’aide d’une étude réalisée il y a 3 ou 4 ans et dont nous venons
de (re)valider les résultats, les scénarios prospectifs de la communication et du
marketing.
Description des scenarii
Les mutations externes
Préambule
Il nous a apparu important de dresser un panorama synthétique des grandes tendances en matière
de communication et du marketing. Ces tendances ne sont plus des signaux faibles. Elles sont
mesurables, observables et déjà bien installées dans notre quotidien. Elles bouleversent le monde du
markeying en lui imposant de nouvelles normes, une remise en question de ses connaissances sur le
consommateur, de nouveaux outils et de nouveaux usages dont on ne perçoit que très
imparfaitement les implications futures.
Nous en avons distingué douze qui ont émergé des entretiens que nous avons menés avec nos
experts et de notre revue de la littérature. Ces douze tendances sont des tendances
consensuelles. Les acteurs interrogés s’accordent à dire de façon presque certaine qu’elles
sont installées sur le marché de façon durable.
Les tendances consensuelles
Tendance 1 Le crowd sourcing et l’innovation ouverte
La première tendance est l’importance prise par les contenus générés par le consommateur. Que ce
soit son activité sur les forums, les billets postés, les évaluations, le consommateur parle, juge
l’entreprise et participe, de plus en plus, à la co-création des stratégies marketing et des campagnes
publicitaires. Le crowd sourcing qui regroupe ces activités est un néologisme inventé par les deux
rédacteurs en chef du magazine Wired1. Le crowd sourcing est une technique d’externalisation de la
production photographique, des idées, de la créativité mais cette externalisation ne repose pas sur la
mobilisation des compétences de professionnels mais de celles de la foule, de millions d’internautes
1 C’est dans un article de Wired de juin 1996 que Jeff Howe et Mark Robinson ont lancé le concept de crowd
sourcing.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%