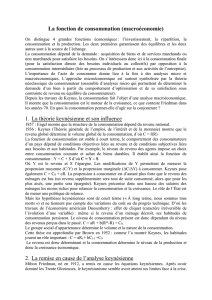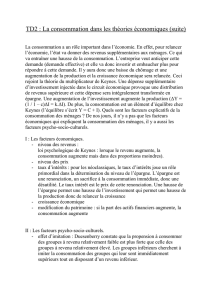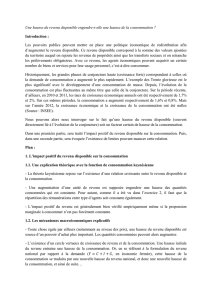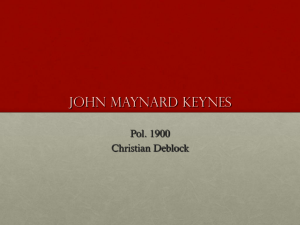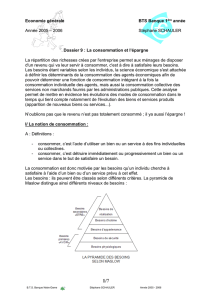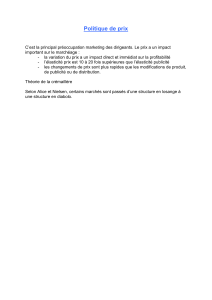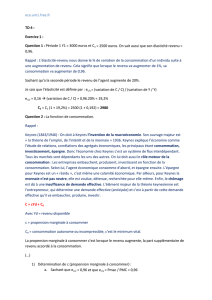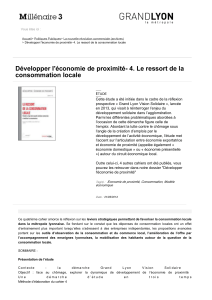3 : les élasticités a) les déterminants de la consommation La

Fin du chapitre 4 – la consommation
Concepts clés : élasticité, revenu réel et nominal, loi d’Engel, effet Veblen, cycle de vie, loi
psychologique fondamentale, propensions, revenu permanent, hypothèse du cycle de vie.
La séance s’achèvera par un certain nombre d’exercices portant sur la consommation, avec corrigés
inclus}
3 : les élasticités
a) les déterminants de la consommation
La consommation des ménages dépend de deux types de critères : des critères
purement économiques (prix, revenu…), mais aussi des critères d’ordre
psychosociologique, culturel, etc.
* les déterminants économiques de la consommation :
-le prix : a priori, la consommation (et plus largement la demande) varie en sens inverse
du prix ; quand le prix augmente, la demande baisse, et vice-versa (la demande est une
fonction décroissante du prix). Mais la manière dont réagit la demande à une hausse ou à
une baisse de prix peut être extrêmement variable ! Il faut introduire ici l’outil des
élasticités : d’une manière générale, quand une variable quelconque X peut avoir une
influence quelconque sur une autre variable Y, on peut toujours calculer l’élasticité de Y
par rapport à X (on dit aussi : l’élasticité X de Y), c'est-à-dire la manière dont se comporte
Y suite à une variation de X.
La formule est : variation en % de Y / variation en % de X
Exemple : en septembre 2006, le CNAM (ici, c’est X) augmente ses tarifs de 15% (je
rigole !), comment la demande d’inscription (ici, c’est Y) au CNAM réagit-elle ?
Admettons que cette demande ne diminue que de 5%.
L’élasticité sera de : -5%/15% = -1/3
Dans les relations entre prix et demande, on observe en gros 3 types de résultats en
matière d’élasticité :

+ Soit la demande réagit vivement à une hausse des prix : la baisse de la demande sera
proportionnelle, voire plus que proportionnelle, à la hausse du prix. Cela peut se produire
par exemple dans un secteur où la concurrence est très forte, et pour un produit qui peut
être facilement remplacé par un autre (facilement substituable), ou qui n’est pas
indispensable. Dans ce cas, l’élasticité-prix de la demande sera inférieure ou égale à -1.
++ Soit la demande réagit peu, voire pas du tout, à une hausse des prix : la baisse de la
demande sera faible ou nulle. Cette situation concerne des produits indispensables et peu
substituables (pétrole, timbre poste, Cnam dans mon exemple ci-dessus), ou qui entraînent
une accoutumance forte (alcool, tabac, drogues, Cnam encore ?), ou certains produits de
luxe, ou, à l’opposé, des biens ou services dont le prix apparaît comme étant indolore
(pain, sel, journal…).
Dans ce cas, l’élasticité-prix de la demande sera comprise entre -1 et 0
+++ soit (cas plus rare), la demande varie dans le même sens que le prix : le prix
augmente, et la demande suit : cas de certains produits de luxe ou de mode, ou de certains
actifs (actions, immobilier, œuvres d’art…) ; ou alors, le prix baisse, ce qui fait baisser la
demande : ce dernier cas peut illustrer que l’on appelle l’effet VEBLEN ou effet de
snobisme. Quand un bien ou service se démocratise, une fraction des consommateurs de
ce bien ou service s’en détourne. L’exemple type est le tennis : dans les années 1980, le
tennis s’est « démocratisé » et le nombre de pratiquants a grimpé en flèche ; de ce fait,
certains anciens joueurs ont délaissé le tennis et se sont tournés vers le golf (si le golf est
un sport, alors, la pétanque, c’est un sport de combat…. Avis personnel). Donc, dans ce
cas, l’élasticité-prix de la demande sera positive.
Donc, la hausse ou la baisse (mais beaucoup plus rare) du prix influence la
consommation dans la mesure où le pouvoir d’achat baisse (ou augmente). En effet, la
hausse des prix réduit le revenu réel de l’individu, même si son revenu nominal (celui
qu’il constate sur sa feuille de salaire, par exemple) reste identique. Le revenu réel
détermine réellement (d’où son nom) la quantité de biens et services que mon revenu
nominal me permet d’acquérir, compte tenu de l’inflation (inflation : hausse du niveau
général des prix) : le revenu réel reflète donc le pouvoir d’achat.

Par ailleurs, l’inflation peut décourager l’épargne, et accroître la propension à
consommer, ce qui peut paraître a priori paradoxal…
- le rôle des revenus dans la consommation : le revenu détermine le pouvoir d’achat des
consommateurs, il a donc une importance cruciale dans la consommation finale des
ménages ; Il s’agit du revenu disponible, c’est-à-dire celui qui reste à la disposition de
l’individu. On voit immédiatement que tous les éléments qui affecteront en amont – en
positif ou négatif – le revenu disponible des ménages aura, en fin de compte, un
impact sur la consommation : partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise entre
profits et salaires, politique publique en matière de prélèvements obligatoires,
importance des transferts sociaux positifs (prestations sociales) notamment. Mais le
pouvoir de consommer des ménages sera également influencé par d’autres critères en
aval de la distribution des revenus, par exemple le taux d’intérêt qui déterminera le
niveau de la consommation à crédit…
Si l’on se concentre sur le revenu, on observe que le montant de ce revenu
détermine quantitativement la consommation – ma consommation augmente avec mon
pouvoir d’achat - mais aussi qualitativement (la nature et la quintessence des biens et
services achetés se modifie quand mon revenu augmente). Ce phénomène a été observé il
y a fort longtemps par un économiste du XIX° siècle, ENGEL. Il observe les changements
dans la consommation ouvrière quand le revenu augmente. Il note que la hausse du revenu
entraîne :
- une baisse de la part du budget consacré à l’alimentation
- une part constante du budget consacré à l’habillement et au logement
- une part croissante du budget destiné aux transports, aux loisirs, à la culture, à la
santé…
L’analyse d’ENGEL explique pour partie la hausse du secteur des services dans les
pays développés : le niveau de vie de la population dans ces pays s’élève depuis la
Révolution industrielle, ce qui aboutit à une consommation croissante de services, alors
que la part du budget consacré à l’alimentation devient minoritaire dans l’affectation des
dépenses ; ainsi, en 1856, à Paris, 70,7% du budget ouvrier est consacré au dépenses
alimentaires, 15,2% à l’habitation, 0,6% à la santé ; en 1979, ces parts sont respectivement
de 28,6%, 24,5% et 6,3% ( Economie et statistiques, n°103).

La loi d’Engel nous permet de revenir à l’élasticité de la demande, cette fois par
rapport au revenu (variation en % de la demande/variation en % du revenu) ; elle est
toujours supérieure ou égale à zéro pour les grandes catégories de biens et services. Si la
loi d’Engel est vérifiée :
- l’élasticité revenu de la demande de biens alimentaires est comprise entre 0 et 1
- celle de la demande de logement/habillement est égale à 1
- celle de la demande de loisirs, santé, transports, etc. est supérieure à 1.
[ Illustration :
Année 1 Année 2
Revenu consommé : 1000 Revenu consommé : 1400
Dépenses alimentaires : 300 Dépenses alimentaires : 360
Dépenses en logement habillement : 500 Dépenses en logement habillement : 700
Dépenses en santé, loisirs, transports… : 200 Dépenses en santé, loisirs, transports : 340
1) vérifions la loi d’Engel
- les dépenses alimentaires représentent 30% du total l’année 1, 25,7% l’année 2
- la part des dépenses de logement/habillement est stable : 50%
- la part des dépenses de santé, loisirs… passe de 20% à 24,3%
Donc la loi d’Engel est vérifiée
2) vérifions cette loi à travers les élasticités de la demande /revenu :
- l’élasticité/revenu de la consommation alimentaire : 20%/40% = 0,5
[(360-300)/300=20%, [(1400-1000)/1000 = 40%)
- l’élasticité/revenu des dépenses de logement habillement : 50%/50% = 1
- l’élasticité/revenu des dépenses de loisirs, santé… : 70%/40% > 1
Donc, on vérifie ce qui a été dit précédemment.]
[Attention : ne pas confondre élasticité revenu de la
demande, et propension marginale à consommer…Dans le
premier cas, on utilise des taux de variation, dans le
second cas, on soustrait des valeurs absolues (C2-C1)]
Les disparités au niveau de la consommation épousent les inégalités de revenus :

Ainsi, le tableau ci-dessous nous montre les coefficients budgétaires des ménages dans
deux PCS pour l’année 1995 :
Ensemble des PCS Cadres ouvriers
Alimentation 18,2 14,2 20,2
Habillement 4,9 5,2 4,9
Habitation 27,9 27,7 30,1
Transport 12,8 11,8 7,6
Culture et loisirs 6,6 6,5 7,6
Santé et hygiène 6,3 5 6
Divers (restauration,
hôtellerie, assurance-
vie…)
23,3 29,6 16,6
- le rôle des politiques économiques dans la consommation : on l’a souligné plus haut,
je le rappelle pour mémoire : politique fiscale, politique de redistribution, politique
monétaire (action sur les taux d’intérêt), politique salariale, incitations diverses
(primes de rentrée scolaire), etc.
- le comportement du consommateur : la microéconomie, à la suite des travaux de
l’école néoclassique, considère que le consommateur est un agent économique
rationnel, qui effectue des calculs pour maximiser sa satisfaction sous contrainte de
budget. Ce point sera longuement développé dans le paragraphe 3 qui suit. (Chapitre
4, A), 3 :)
**les déterminants psychosociologiques, culturels, et autres, de la consommation
La consommation n’est pas seulement un acte économique, elle a aussi une dimension
sociale. Double dimension d’un bien ou d’un service consommé : fonction d’usage mais
aussi fonction symbolique. Il suffit de penser aux comportements de consommation dans
le domaine du vêtement ou de l’automobile. On peut détailler un certain nombre
d’éléments d’ordre psychosociologique ou culturel, qui expliquent une part des
différences constatées en matière de consommation.
- consommer pour s’intégrer : certains individus groupes sociaux servent de leaders
(vedettes, sportifs, jeunes,…) et les autres groupes tentent de les imiter dans leur
comportement de consommation. DUESENBERRY montre par ailleurs que les classes
populaires imitent parfois le comportement de consommation des classes aisées (ce
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%