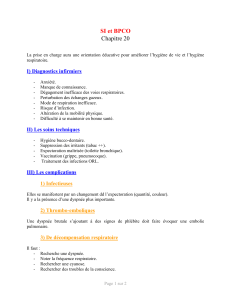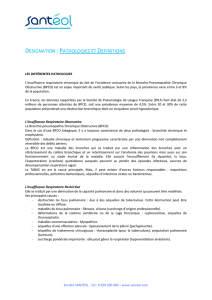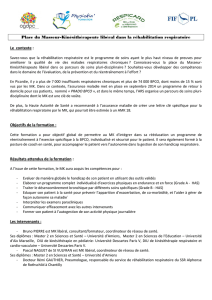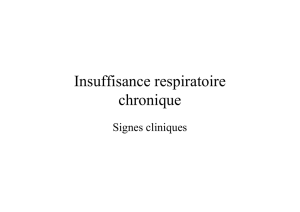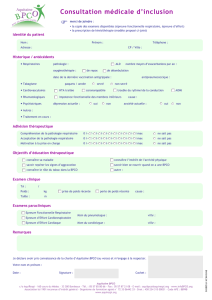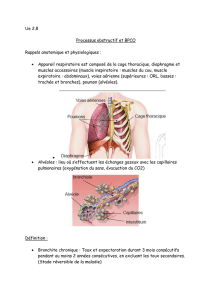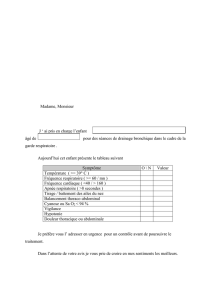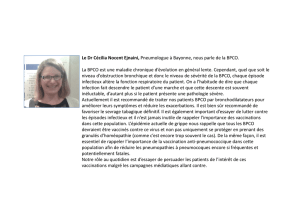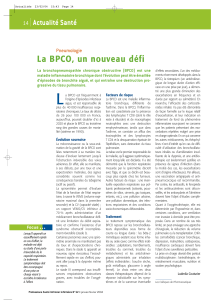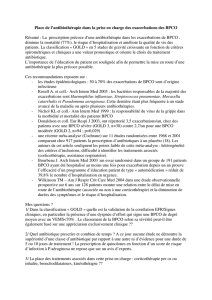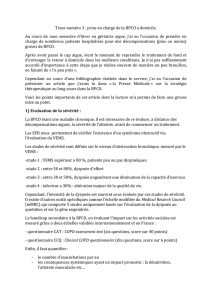Bonne lecture - Etudiant

109
DOSSIER
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016
SOMMAIRE
109
Pneumopathies
aiguës
communautaires
111
Bronchites aiguës
Exacerbations
de BPCO
112
Bronchiolite
du nourrisson
Dyspnées de l’enfant
113
Personne âgée
Grippe, cause d’IRA
à tout âge
INFECTIONS RESPIRATOIRES
BASSES
P a r Johanna Claustre1-3,
Christophe Pison1, 3, 4
1. Université Grenoble-
Alpes.
2. Réanimation médicale,
pôle urgences et
médecine aiguë, CHU,
38043 Grenoble Cedex 9.
3. Clinique universitaire
de pneumologie, pôle
thorax et vaisseaux, CHU,
38043 Grenoble Cedex 9.
4. Laboratoire de bio-
énergétique fondamentale
et appliquée,
Inserm U1055, 38400
Saint-Martin d’Hères.
Les infections respiratoires basses forment un
groupe hétérogène constitué des bronchites
aiguës, des exacerbations de bronchopneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) d’origine
infectieuse et des pneumopathies aiguës commu-
nautaires (PAC). Elles sont dues à des pathogènes
qui diffèrent suivant les âges de la vie. Gravité et
pronostic de ces affections sont très divers selon
l’agent causal et le terrain sur lequel elles sur-
viennent. Elles sont une source de morbidité et
de mortalité importantes. Ainsi, les antibiotiques
dans les indications « respiratoires » génèrent un
coût de santé publique majeur, puisqu’on estime
qu’ils représentent 75 % de la prescription globale
de ces médicaments, alors que la plupart de ces
pathologies sont d’origine virale. Le médecin
généraliste, qui assure la prise en charge de 96 à
98 % des infections respiratoires, a pour mission
d’évaluer chaque situation clinique, d’identifi er
celles qui relèvent d’une antibiothérapie et
d’orienter les patients les plus sévères ou les plus
fragiles vers une hospitalisation.
PNEUMOPATHIES AIGUËS
COMMUNAUTAIRES
Avec environ 500 000 cas par an en France, les PAC
sont la première cause d’insuffi sance respiratoire
aiguë d’origine infectieuse. La mortalité liée à ces
infections est de 15 %.1 Le tabagisme actif multiplie
environ par 2 leur risque de survenue.2 La prise
en charge doit donc être bien codifi ée, l’objectif
étant pour le médecin généraliste d’initier rapi-
dement une antibiothérapie adaptée à l’écologie
bactérienne et d’hospitaliser les patients qui en
ont besoin.
Le germe le plus souvent en cause est Strepto-
coccus pneumoniæ (30-50 % des cas) typiquement
responsable de pneumopathies franches lobaires
aiguës (fi g. 1 et 2). Les seconds pourvoyeurs de
PAC sont les germes atypiques : Mycoplasma
pneumoniæ, Chlamydia pneumoniæ (fi g. 3) et Legio-
nella pneumophila. Cette écologie est un peu modi-
fi ée s’il s’agit d’une surinfection bactérienne d’une
grippe, où les responsables sont Streptococcus
500 000 pneumonies aiguës par an en France.
Virus de la grippe
!109!_MG955_DOS-claustre.indd 109 04/02/2016 16:20
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
110 111
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016
Infections respiratoires basses
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus
infl uenzæ et les streptocoques du groupe A.
Aucun signe clinique, radiologique ou biolo-
gique n’a de valeur discriminante suffi sante pour
identifi er le micro-organisme. Certains éléments
orientent néanmoins la suspicion (encadré 1).
En l’absence de signe de gravité, il n’y a pas lieu de
rechercher systématiquement le germe.3 L’antibio-
thérapie doit être précoce en raison de la gravité
potentielle des pneumopathies à pneumocoque.
Le traitement de 1re intention repose sur une
mono-antibiothérapie par amoxicilline (1 g x 3/j
pendant 7 à 14 jours) ciblant le pneumocoque,
en l’absence de suspicion d’infection à bactéries
atypiques. En cas d’échec à 48 heures, on doit lui
substituer un macrolide (roxythromycine 150 mg
x 2/j pendant 7 à 14 jours) ou la pristinamycine
(1 g, 3 x/j, 7 à 14 jours) afi n de couvrir les germes
intracellulaires. Les fl uoroquinolones antipneu-
mococciques sont de plus en plus abandonnées
du fait de la pression de sélection et des résis-
tances qu’elles engendrent. En cas de surinfection
d’une grippe, c’est l’association amoxicilline-acide
clavulanique qui est recommandée.
Les facteurs de risque de complication sont
de 2 types : en rapport avec le terrain et liés à la
sévérité de la PAC (encadré 2).3 De nombreux
scores pronostiques identifi ant les patients les
plus fragiles font décider d’une hospitalisation
(score de Fine, CURB-65, CRB-65…).
Parmi toutes ces aides à la décision, le CRB-65
est le plus simple à retenir et à utiliser (tableau 1).
Toutefois, aucun de ces outils n’est assez pertinent
pour remplacer le sens clinique et ne peut donc
être interprété seul.
En dehors d’un contexte réanimatoire, le choix
de l’antibiothérapie pour les PAC avec critères de
gravité fait appel aux mêmes classes thérapeu-
tiques. Ainsi, en cas de comorbidités ou chez le
sujet âgé (hors institution) sans signe de gravité,
l’association amoxicilline-acide clavulanique est
recommandée en premier choix, selon l’Afssaps,
la Société de pathologie infectieuse de langue
française (Spilf) et la Société de pneumologie de
langue française (SPLF).4
Enfi n, chez le patient tabagique actif, la décou-
verte d’une PAC doit être l’occasion de dépister
une BPCO et un cancer bronchopulmonaire, sur-
tout si une opacité radiologique persiste malgré le
traitement antibiotique. Il est également licite de
rechercher une immunodépression liée au VIH.
En effet, la fréquence des PAC est très élevée dans
la population séropositive, même en l’absence
d’immunodépression sévère (CD4 > 500/mm3).
1. Éléments d’orientation diagnostique
En faveur du pneumocoque
– agent le plus fréquent chez le sujet ≥ 40 ans et/ou avec comorbidité(s) ;
– début brutal ; fi èvre élevée dès le premier jour ;
– malaise général ; point douloureux thoracique ;
– opacité alvéolaire systématisée ;
– hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
En faveur des bactéries « atypiques »
– contexte épidémique (notamment pour Mycoplasma pneumoniæ) ;
– début progressif en 2 à 3 jours.
En faveur d’une légionellose
– contexte épidémique ou « situation à risque » (voyage, thermes,
exposition à de l’eau en aérosol contaminée…) ;
– comorbidité(s) fréquente(s) ;
– tableau évocateur (1/3 des cas) avec pneumonie d’allure sévère, début
progressif, sans signe ORL, pouls dissocié, atteinte souvent bilatérale ;
– signes extrathoraciques : digestifs (douleurs abdominales, vomissements,
diarrhée), neurologiques (troubles de la conscience, céphalées, myalgies) ;
– échec des bêtalactamines actives sur le pneumocoque.
Fig. 1 – Pneumopathie à pneumocoque : opacité franche
aiguë du lobe supérieur droit avec bronchogramme aérique.
Fig. 2 – Opacité systématisée au lobe inférieur droit. A : face ; B : profil.
A B
!109!_MG955_DOS-claustre.indd 110 04/02/2016 16:20
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
110 111
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016
Les germes les plus fréquemment retrouvés sont
alors Streptococcus pneumoniæ et Haemophilus
infl uenzæ.5
BRONCHITES AIGUËS
Elles sont extrêmement fréquentes (10 millions
de cas/an en France), mais rarement à l’origine
d’insuffi sance respiratoire aiguë chez l’enfant
ou l’adulte sain. Liées à une infl ammation des
bronches proximales, elles s’accompagnent d’une
hypersécrétion de mucus. La toux en général mar-
quée (sèche initialement, volontiers nocturne,
quinteuse douloureuse, devenant productive au
bout de quelques jours) contraste avec la pauvreté
de l’examen clinique (quelques ronchi à l’auscul-
tation). Aucun traitement n’est recommandé en
dehors d’une bonne hydratation, notamment chez
les patients fragilisés (les antitussifs peuvent aggra-
ver l’encombrement et induire une somnolence).
Elles ne requièrent le plus souvent pas d’anti-
biothérapie puisqu’elles sont en grande majorité
d’origine virale.1 En cas de comorbidités sévères,
telles que l’insuffi sance cardiaque chronique, le
diabète insulinodépendant, ou un antécédent
d’AVC avec séquelles, le risque de complications
(surinfections, décompensation cardiaque, deshy-
dratation…) est sérieux. Ces patients doivent donc
être étroitement surveillés, pour ne pas retarder
la mise en route d’une antibiothérapie en cas de
surinfection bactérienne.3
EXACERBATIONS DE BPCO
Chaque année, elles sont responsables de 69 000 à
112 000 hospitalisations, occasionnant une mor-
bidité et des coûts importants. Les exacerbations
d’origine infectieuse ont un caractère saisonnier :
leur prédominance hivernale est nette. Il en est
de même pour les décès secondaires à la BPCO,
survenant en particulier lors des fortes épidémies
grippales.6
Les germes les plus fréquemment en cause sont
Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus infl uenzæ
et Moraxella catharralis. Principaux virus : rhino-
virus et métapneumovirus.
Mais toutes les exacerbations de BPCO ne sont pas
d’origine infectieuse, et l’antibiothérapie ne doit
donc pas être systématique. Elle est fondée sur des
critères d’infection (majoration de la dyspnée, de
la purulence – verdâtre franche – et du volume des
crachats) et sur la sévérité de la maladie, estimée
en situation stable par la mesure du VEMS et/ou
par la sévérité de la dyspnée.
Les indications de l’antibiothérapie ainsi que
les molécules et posologies recommandées sont
résumées dans les tableaux 2 et 3.4 Les fl uoroqui-
nolones et la télythromycine ne doivent plus être
utilisées en 1re intention. Un échec thérapeutique
impose d’éliminer une atteinte parenchymateuse
par la radiographie de thorax et de rechercher
une infection à Pseudomonas æruginosa en cas de
BPCO évoluée.
Outre l’antibiothérapie, d’autres mesures sont
conseillées : arrêt du tabac, bronchodilatateur
par voie inhalée, courte corticothérapie per os
Fig. 3 – Pneumopathie aiguë à
Mycoplasma pneumoniæ
.
SCORE CRB-65
Critères Conduite à tenir
CConfusion 0 critère Traitement ambulatoire possible
RFréquence respiratoire ≥ 30/min 1 critère Évaluation à l’hôpital
BPression artérielle systolique < 90 mmHg
ou
pression artérielle diastolique ≤ 60 mmHg
65 Âge* ≥ 65 ans
« C » pour confusion, « R » pour respiratoire, « B » pour
blood pressure
et « 65 » pour 65 ans
* Plus que l’âge civil, l’âge physiologique, notamment chez les patients sans comorbidité, est à prendre
en compte.
TABLEAU 1
Liés au terrain
– Âge > 65 ans
– BPCO, asthme
– Insuffi sance cardiaque, diabète
– Hospitalisation dans les dernières
années
– Prise de corticoïdes au long cours,
immunodépression
– Traitement antibiotique dans
le mois précédent
– Pathologie maligne évolutive
– Insuffi sance rénale ou hépatique
chronique
– Atteinte des fonctions supérieures
– Conditions socioéconomiques
défavorables, isolement
Liés à la gravité de la PAC
– Sensation de malaise
– Absence de signe d’atteinte ORL
– Confusion, troubles de vigilance
– Pouls >100 batt/min
– Température > 38 °C
– Fréquence respiratoire > 30/min
– Pression artérielle < 90/60 mmHg
– Échec d’une antibiothérapie
préalable
– Pneumonie d’inhalation
2. Facteurs de risque de complications des PAC
A B
!109!_MG955_DOS-claustre.indd 111 04/02/2016 16:20
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
112 113
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016
Infections respiratoires basses
si bronchospasme, kinésithérapie respiratoire,
contre-indication des antitussifs.
La prévention des exacerbations d’origine in-
fectieuse repose sur la vaccination antigrippale
annuelle et antipneumococcique. Actuellement,
le schéma vaccinal recommandé pour les patients
atteints de BPCO et plus largement pour tous les
insuffi sants respiratoires, consiste en une injec-
tion de vaccin conjugué 13-valent Prevenar suivi
8 semaines plus tard par le vaccin non conjugué
23-valent Pneumo 23 afi n de protéger contre le
maximum de sérotypes.7
BRONCHIOLITE DU NOURRISSON
C’est la première cause de détresse respiratoire
d’origine infectieuse à cet âge. Prédominant l’hiver,
elle affecte 460 000 bébés par an, principalement
entre 2 et 8 mois. Favorisée par la promiscuité, elle
est le plus souvent due au virus respiratoire syncy-
tial humain (VRS), de transmission interhumaine.
Le diagnostic est clinique et ne requiert aucun
examen biologique ni radiologique. Le tableau ty-
pique est celui d’une dyspnée expiratoire siffl ante
avec toux, parfois fébrile, généralement précé-
dée d’une rhinopharyngite. L’auscultation trouve
des râles sibilants et/ou crépitants bilatéraux ; la
recherche d’une hépatomégalie est indispensable
pour éliminer une insuffi sance cardiaque.
La prise en charge est uniquement sympto-
matique et repose notamment sur les désob-
structions rhinopharyngées pluriquotidiennes, au
sérum physiologique (pas de respiration buccale
lors des 1ers mois de vie), l’hydratation et le frac-
tionnement de l’alimentation (moitié des rations
2 fois plus souvent, les épaissir est inutile). Les
corticoïdes (inhalés ou per os) et les bronchodila-
tateurs n’ont aucune indication dans une 1re bron-
chiolite typique. La kinésithérapie respiratoire
est sans effet sur la durée d’hospitalisation, son
indication en médecine ambulatoire est débattue.
Les facteurs de risque de forme sévère sont :
un âge inférieur à 12 semaines, un antécédent de
prématurité, une pathologie cardiovasculaire, une
immunodépression. Certains critères imposent
une hospitalisation : nourrisson de moins de
6 semaines (moins de 3 mois d’âge corrigé pour
les prématurés de moins de 32 SA) ; polypnées,
apnées ; signes de lutte intense ; troubles de la
conscience ; cyanose, saturation capillaire < 94 % ;
troubles alimentaires ; diffi cultés psychosociales
ou d’accès aux soins.
DYSPNÉES DE L’ENFANT
Les infections des voies aériennes supérieures,
et en particulier l’épiglottite, peuvent aussi être
responsables d’insuffi sance respiratoire aiguë
potentiellement létale et doivent être reconnues
précocement. Cette infection, historiquement
causée par Hæmophilus infl uenzæ de type b est
devenue rarissime depuis la généralisation de la
vaccination. Le tableau clinique débute souvent
par des maux de gorge très fébriles.
La dyspnée inspiratoire peut s’installer très
rapidement après les premiers signes, le plus
PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES DANS LES EXACERBATIONS
DE BPCO
Stade clinique de gravité
de la BPCO évalué en dehors
de toute exacerbation
Indications
à l’antibiothérapie
Choix
de l’antibiothérapie
En l’absence d’EFR
connus
Absence de dyspnée
Résultats EFR
VEMS > 50 % Pas d’antibiotique
Dyspnée d’effort VEMS < 50 % Antibiothérapie seulement
si expectoration
franchement purulente
verdâtre
Amoxicilline ou céfuroxime-
axétil ou cefpodoxime-proxétil
ou céfotiam-hexétil* ou
macrolide ou pristinamycine
ou télithromycine**
Dyspnée au
moindre effort ou
dyspnée de repos
VMS < 30 % Antibiothérapie systématique
+ recherche des autres
causes d’exacerbation
de la dyspnée
Amoxicilline-acide
clavulanique ou C3G injectable
(céfotaxime ou ceftriaxone)
ou FQAP (lévofl oxacine)***
* L’émergence de souches sécrétrices de bêtalactamases dans la communauté devrait faire limiter leur
utilisation. Remarque : compte tenu des études, aucune hiérarchisation des molécules dans chaque groupe.
** Utilisable si les autres antibiotiques proposés ne peuvent être prescrits (risque plus élevé d’effets
indésirables graves).
*** Pas si le patient en a déjà pris une dans les 3 derniers mois. Prudence chez le sujet âgé.
PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES DANS LES EXACERBATIONS
DE BPCO
TABLEAU 2
ANTIBIOTIQUES : MOLÉCULES ET POSOLOGIES
Antibiotiques Posologies*
Pénicillines A
. amoxicilline PO
. amoxicilline-acide clavulanique PO
1 g x 3/j
1 g x 3/j
Céphalosporine de 2e génération orale
. céfuroxime-axétil PO 250 mg x 2/j
Céphalosporines de 3e génération orales
. cefpodoxime-proxétil PO
. céfotiam-hexétil PO
200 mg x 2/j
400 mg x 2/j
Céphalosporines de 3e génération injectables
. ceftriaxone IV/IM/SC
. céfotaxime IV
1 à 2 g/j - 5 jours
1 à 2 g x 3/j
Synergistine
. Pristinamycine PO 1 g x 3/j pendant les repas - 4 jours
Kétolide
. télithromycine PO 800 mg/j - 5 jours
Macrolides
. azithromycine PO
. érythromycine IV
. clarithromycine PO (standard)
. clarithromycine PO (libération prolongée)
. josamycine PO
. roxithromycine PO
. spiramycine IV
500 mg le 1er jour, puis 250 mg les 4 jours
suivants, 5 j
1 g x 3 à 4/j ; PO : 1 g x 3/j
500 mg x 2/j
1 g/j - 5 jours
1 g x 2/j
150 mg x 2/j
1,5 MUI x 3/j ; PO : 6 à 9 MUI/j en 2 ou 3 prises
FQAP
. lévofl oxacine** PO
. moxifl oxacine*** PO
500 mg x 1/j 7 à 10 jours
400 mg x 1/j 5 à 10 jours
* Durée : 7 à 14 jours (sauf si précisée) ; ** Pas de fl uoroquinolone si le patient en a déjà pris une dans les
3 derniers mois ;*** Lorsque aucun autre antibiotique ne peut être utilisé.
TABLEAU 3
!109!_MG955_DOS-claustre.indd 112 04/02/2016 16:20
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
112 113
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016
souvent en moins de 12 heures, elle s’accompagne
d’une grande anxiété et d’une impossibilité à dé-
glutir ou à s’allonger. En cas de dyspnée intense,
le risque d’arrêt respiratoire est majeur, et le jeune
patient doit être adressé en urgence vers un centre
compétent avant toute évaluation diagnostique.8
Cause plus fréquente, la laryngite sous-glot-
tique est d’origine virale et survient habituelle-
ment entre 6 mois et 3 ans au décours d’une rhino-
pharyngite banale ; elle se caractérise par une
dyspnée inspiratoire aiguë avec toux rauque. En
l’absence de signes de gravité, la prise en charge
est ambulatoire : corticothérapie per os (1 mg/kg
de dexaméthasone ou 20 gouttes/kg/j de bétamé-
thasone) en 1 prise pendant 48 heures. Dans le
cas contraire, des nébulisations d’adrénaline et de
corticoïdes sont proposées en milieu hospitalier.
Toute dyspnée laryngée avant l’âge de 6 mois doit
faire éliminer un angiome sous-glottique ou une
sténose laryngée par une endoscopie.
Enfi n, l’inhalation de corps étranger (dyspnée
aux 2 temps) peut aussi provoquer une insuffi sance
respiratoire aiguë dans la population infantile.
Elle est responsable de surinfections bronchiques
ou pulmonaires récidivantes. Au moindre doute,
une radiographie pulmonaire doit être réalisée.
SUJET ÂGÉ : TRÈS EXPOSÉ
Les causes d’insuffi sance respiratoire aiguë (IRA)
d’origine infectieuse sont multiples. Au-delà de
65 ans, la fréquence et la gravité des pneumo-
pathies augmentent (encadré 3). Cliniquement, la
fi èvre (souvent moins élevée que chez l’adulte plus
jeune, par exemple 38 °C) est parfois absente mais
la tachypnée, elle, quasi constante. Cela s’accom-
pagne parfois de douleur, toux, encombrement
bronchique, qui orientent évidemment le diagnos-
tic, mais au moins aussi souvent de signes extra-
thoraciques, tels que confusion mentale, troubles
de l’équilibre avec ou sans chute, signes digestifs
(anorexie, vomissements, douleurs abdominales),
ou enfi n décompensation d’une comorbidité, no-
tamment cardiaque, pouvant égarer le diagnostic.
À l’auscultation, les anomalies presque toujours
unilatérales (râles crépitants), mais pas constantes,
ont une bonne valeur prédictive positive.
Selon l’Afssaps, la Spilf et la SPLF, un âge > 65 ans
avec au moins un facteur de risque mais aussi une
hypoxie aiguë (encadré 2) font adresser le patient
à l’hôpital.
L’écologie microbienne des infections commu-
nautaires est la même que dans la population
générale et l’antibiothérapie recommandée est
identique. En revanche, en présence de troubles
de la déglutition, les pneumopathies dites d’inha-
lation sont extrêmement fréquentes. Les micro-
organismes en cause sont alors les bacilles gram
négatifs et anaérobies de la sphère oro-pharyngée
et l’amoxicilline-acide clavulanique est préconisée.3
Le traitement symptomatique repose sur une
bonne hydratation et sur la kinésithérapie respi-
ratoire en cas d’encombrement. Pas d’antitussifs
ni de mucolytiques. Chez certains patients, une
toux sèche post-infectieuse invalidante, voire
insomniante, peut perdurer plusieurs semaines.
Une corticothérapie inhalée, voire générale en
cure courte, permet souvent de faire régresser les
symptômes. En cas d’hypoxie persistante, malgré
la résolution de l’infection, il faut évoquer une
décompensation cardiaque ou une pathologie
thrombo-embolique. En l’absence d’explication,
le patient âgé peut être orienté vers un pneumo-
logue pour investigation et éventuelle oxygéno-
thérapie.
Enfi n, une IRA fébrile peut être le mode de pré-
sentation de différentes pathologies extrapulmo-
naires, en particulier l’insuffi sance ventriculaire
gauche, décompensée par une infection quelle
qu’elle soit. L’examen clinique ainsi que le dosage
du BNP ou du NT-proBNP orientent vers l’un ou
l’autre de ces diagnostics.
GRIPPE, EN CAUSE À TOUT ÂGE
La grippe due aux orthomyxovirus infl uenzæ est
responsable d’épidémies annuelles hivernales,
voire de pandémies. Elle peut être à l’origine de
pneumopathies virales, de surinfections respi-
ratoires bactériennes et parfois de myocardites.
Chaque année en France et en dehors des grandes
pandémies comme celle de 2015, on estime que la
grippe touche 5 à 7 millions de personnes (soit 5 à
10 % des adultes et 20 à 30 % des enfants), et est
3 . Plus de pneumonies chez le sujet âgé ?
– Modifi cation de structure du parenchyme pulmonaire (moindre
élasticité).
– Diminution de force et augmentation de la charge de travail des muscles
thoraciques.
– Grande prévalence des troubles intermittents de déglutition d’origine
neurologique.
– Fréquence des RGO (de liquides non acides, donc non bactéricides) et
des phénomènes d’inhalation.
– Diminution du fl ux salivaire, mauvaise hygiène dentaire, modifi cation
de la fl ore oropharyngée et baisse de la clairance mucociliaire trachéale.
– Altération des réponses immunitaires locales de l’épithélium bronchique
et des parois alvéolaires.
– Immunosénescence physiologique aggravée par la fréquente dénutrition
protéino-énergétique et les comorbidités, notamment infl ammatoires
et infectieuses.
– Pathologies bronchopulmonaires préexistantes (BPCO, emphysème,
asthme, séquelles tuberculeuses).
– Vie en institution favorisant les épidémies.
– Utilisation (trop ?) fréquente d’antibiotiques avec colonisation par des
bactéries résistantes.
!109!_MG955_DOS-claustre.indd 113 04/02/2016 16:20
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE
 6
6
1
/
6
100%