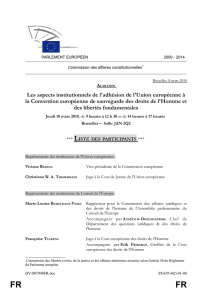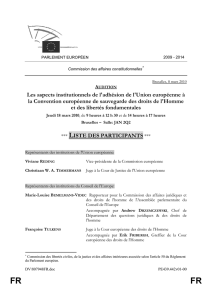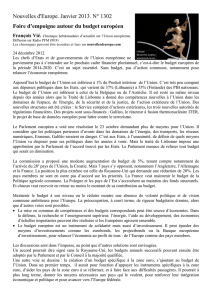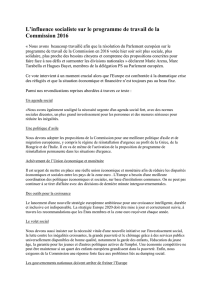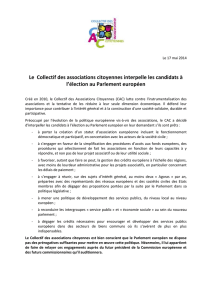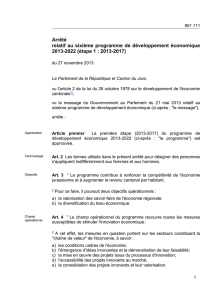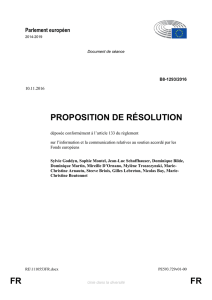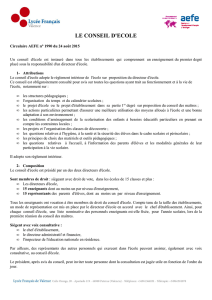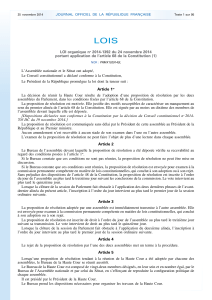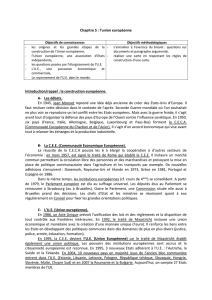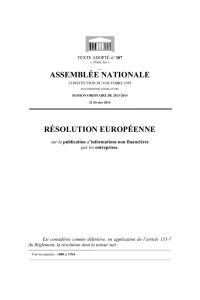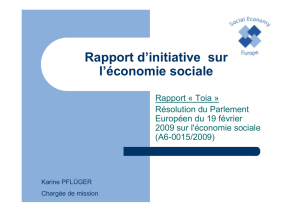L`Assemblée nationale et les avis du Conseil d

1
L’Assemblée nationale et les avis du Conseil d’Etat
*****
Assemblée nationale
Vendredi 25 novembre 2016
*****
Conclusions de Jean-Marc Sauvé1,
vice-président du Conseil d’Etat
Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les députés,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de conclure ce colloque consacré aux avis du Conseil d’Etat et je suis
surtout très reconnaissant à l’Assemblée nationale d’avoir pris l’initiative de cette utile
manifestation qui a permis un fructueux dialogue. Pour le profane, le thème de nos échanges
peut apparaître limité, voire marginal ou même obscur. Il est au contraire majeur, car, selon le
mot de mon éminent prédécesseur, Marceau Long, il est probable que, sans cette fonction, le
Conseil d’Etat ne serait plus le Conseil d’Etat2.
Par l’exercice de sa mission consultative et l’émission de ses avis, le Conseil d’Etat se
trouve en effet associé au processus d’élaboration des normes et de la première d’entre elles,
la loi3. Il a même pu, selon l’expression d’un autre illustre prédécesseur, Laferrière, être vu
comme un « assistant du législateur »4, si ce n’est même comme un « co-auteur » des projets
de loi5. Car, si « le Parlement vote la loi » 6, il peut compter dans ce processus complexe sur le
Conseil d’Etat qui, en vertu de l’article L. 112-1 du code de justice administrative « participe
à la confection des lois »7. Laferrière parlait d’ailleurs, dans son discours d’installation à la
vice-présidence le 28 janvier 1885, de « l’honneur de collaborer à la préparation des lois ».
Cet honneur, le Conseil d’Etat l’assume depuis plus de deux siècles8, dans le prolongement de
1 Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-
président du Conseil d’Etat.
2 Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra et F. Rolin, Les grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz, 2ème édition, 2002,
p. VII.
3 Article 39 de la Constitution, alinéa 2 : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées ».
4 E. Laferrière, cité dans G. Braibant, « Le rôle du Conseil d’Etat dans l’élaboration du droit », Mélanges René
Chapus, éd. Montchrestien, 1992, p. 95.
5 H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’Etat », RFDA 2009, p. 895.
6 Article 24 de la Constitution, alinéa 1.
7 Article L. 112-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-387 du 7
mai 2000 procédant à la codification des dispositions relatives à la justice administrative.
8 Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII : « Sous la direction des consuls, un Conseil d’Etat est
chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui
s’élèvent en matière administrative. »

2
ce que faisait déjà, selon des modalités différentes, le Conseil du Roi. Pourtant, comme le
soulignait Guy Braibant, « des deux fonctions du Conseil d’Etat – conseiller et juger –, c’est
la seconde qui est la plus connue (…) »9. Si le secret qui a traditionnellement entouré la
fonction consultative du Conseil d’Etat a largement contribué à sa méconnaissance10, les
changements de nos institutions ont aussi pesé, à raison de l’influence qu’exercent sur cette
fonction les modalités de l’organisation politique et parlementaire11. Mais le fait que les
fluctuations de l’histoire aient pu, à certaines époques ou sous certains régimes, amoindrir,
voire faire presque disparaître, la fonction consultative du Conseil d’Etat en matière
législative, ne remet pas en cause l’importance de cette mission dans le processus de
fabrication de la norme aujourd’hui. Il n’appartient pas, bien sûr, au Conseil d’Etat de se
substituer à la volonté du peuple français exprimée par le Parlement et le Gouvernement mais,
par sa mission consultative, le Conseil d’Etat participe utilement au processus législatif et à sa
qualité. Son rôle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux prérogatives du Parlement et
du pouvoir exécutif. Tout au contraire, le Conseil d’Etat aspire à permettre à ces deux
pouvoirs – en fait, aux représentants du peuple français – d’assurer de manière informée et
juridiquement rigoureuse les missions constitutionnelles qui sont les leurs.
*
* *
I. « A la frontière de la consultation et de la décision »12, les avis du Conseil
d’Etat contribuent à l’élaboration de la norme en assurant une meilleure
information du Gouvernement et du Parlement (A) et la régularité juridique
des textes (B).
A. Le Conseil d’Etat participe par son rôle consultatif à la « confection des lois »,
mais il le fait au service de la volonté politique exprimée par les représentants du
peuple français.
1. La fonction consultative du Conseil d’Etat a été historiquement la première. Après
avoir presque disparu en matière législative sous la IIIème République13, l’ordonnance du 31
juillet 194514 a rendu obligatoire la consultation du Conseil d’Etat sur les projets de loi et la
Constitution du 4 octobre 1958 a consacré cette fonction au niveau constitutionnel. Le Conseil
d’Etat doit ainsi être saisi, avant leur délibération en Conseil des ministres, sur les projets de
texte relevant du domaine de la loi qui sont élaborés à l’initiative du Gouvernement15. Ce rôle
est un élément important du processus d’élaboration des textes législatifs que le terme de
« consultation » ne doit pas conduire à minorer. Car le Conseil émet un avis qui porte un
regard global sur la qualité de la norme16, bien au-delà du seul contrôle de sa régularité
9 G. Braibant, op. cit. note 4, p. 91.
10 G. Braibant, op. cit. note 4, p. 94.
11 G. Braibant, op. cit. note 4, p. 92.
12 M. Long, « Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision », RFDA, 1992, p.
787.
13 G. Braibant, op. cit. note 4, p. 93.
14 Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’Etat.
15 Projets de loi (article 39, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et article L. 112-1, alinéa 1er du code
de justice administrative) et projets d’ordonnance (article 38, alinéa 2, et article 74-1, alinéa 2, de la Constitution
du 4 octobre 1958).
16 J. Chevallier, « Le Conseil d’Etat, au cœur de l’Etat », Pouvoirs, n° 123, 2007, p. 10.

3
formelle ou juridique, et il propose en outre une véritable réécriture du texte afin d’assurer la
cohérence et l’efficacité des projets qui lui sont soumis. Sans être des décisions, compte tenu
de ce que le Gouvernement peut ne pas les suivre17, les avis émis dans ce cadre vont au-delà
d’une simple consultation informative18.
2. Animé de cette même volonté d’informer et d’éclairer, par le truchement du
Gouvernement, les membres du Parlement, le Conseil d’Etat agit aussi comme un « bureau
d’études juridiques »19. Il peut ainsi être saisi par les membres du Gouvernement au sujet de
« difficultés qui s’élèvent en matière administrative »20 ou si certaines questions soulèvent des
débats dans l’opinion publique21 ou suscitent, en amont de l’élaboration d’une réforme, des
questions de principe qui doivent préalablement être tranchées. A la demande du
Gouvernement, le Conseil peut aussi rédiger des études sur des sujets d’intérêt public. La
dernière étude commandée au Conseil d’Etat, et adoptée le 25 février 2016, a concerné
l’alerte éthique22, son étendue et ses limites, tout comme la protection des lanceurs d’alerte.
Mais il a aussi traité de nombreux autres sujets, comme la transposition des directives de
l’Union européenne23 ou la possibilité de prohiber le voile intégral dans l’espace public24. A la
demande des commissions des affaires européennes des deux assemblées, il a également été
conduit en 2011 à adopter une étude sur le parquet européen25. De sa propre initiative, le
Conseil d’Etat rédige aussi chaque année une étude sur un thème général et formule, à cette
occasion, des recommandations. Celle de cette année a porté, on le sait, sur la simplification et
la qualité du droit. Enfin, il peut « appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes
d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, qui lui paraissent conformes à l’intérêt
général »26.
Le Conseil d’Etat fournit ainsi aux pouvoirs publics chargés de l’élaboration des lois,
une information précise, sincère et complète pour leur permettre de mener à bien leurs
missions. Bien plus qu’un simple organisme consultatif, il participe à la « fabrication » de la
loi, dès lors que ses avis sont le plus souvent suivis, en dépit de leur caractère non
17 S’il est vrai que s’agissant des projets de loi, le Gouvernement n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil
d’Etat, il s’expose, le cas échéant, à la censure du Conseil Constitutionnel et des juridictions suprêmes françaises
en cas de méconnaissance des engagements européens ou internationaux de la France, sans compter
d’éventuelles censures des cours de Luxembourg ou de Strasbourg. Le Gouvernement peut, après l’avis du
Conseil d’Etat, modifier le contenu des projets de loi ou proposer une autre rédaction, à condition toutefois que
les questions qu’elle pose aient toutes été soumises au Conseil d’Etat lors de sa consultation (CC, 3 avril 2003,
« Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants du Parlement européen ainsi qu’à
l’aide publique aux partis politiques », n° 2003-468 DC). L’omission de la consultation du Conseil d’Etat
lorsqu’elle est obligatoire constitue une illégalité (CE, 28 décembre 2009, Syndicat de la magistrature, n°
312314), que le juge doit au besoin soulever d’office (CE, 17 juillet 2013, Syndicat national des professionnels
de santé au travail et autres, n° 358109).
18 M. Long, op. cit. note 12, p. 787.
19 D. Chabanol, Code de justice administrative, 7ème édition, commentaire de l’article L.112-2, p. 36.
20 Article L. 112-2 du code de justice administrative.
21 Par exemple, en 2015, le Conseil d’Etat a été consulté par le Gouvernement sur la conformité à la Constitution
du dispositif prévoyant la création d’un fichier judiciaire des auteurs d’infractions en matière de terrorisme.
22 Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, Etude adoptée le 25 février 2016. D’autres études ont porté
récemment sur les meilleures méthodes pour transposer les directives de l’Union européenne (en 2007 et en
2015) ou encore sur les possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public (en
2010).
23 Etudes réalisées en 2007 et 2015.
24 « Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral », adoptée par l’Assemblée
générale plénière du Conseil d’Etat le 25 mars 2010.
25 « Réflexions sur l’institution d’un parquet européen », étude adoptée par l’Assemblée générale plénière du
Conseil d’Etat le 24 février 2011.
26 Article L. 112-3 du code de justice administrative.

4
contraignant27, et que le Gouvernement ne peut proposer une nouvelle rédaction des projets de
loi qu’à la condition que les questions soulevées par son texte aient toutes été soumises au
Conseil d’Etat lors de sa consultation28. Le Conseil constitutionnel donne d’ailleurs de cette
condition une interprétation plus stricte que le Conseil d’Etat lui-même, lorsque celui-ci
contrôle la régularité de procédures de consultation29.
B. Le Conseil d’Etat veille par ses avis à la qualité rédactionnelle et à la régularité
juridique de la norme, ainsi qu’à son « opportunité administrative »30.
1. En premier lieu, il appartient au Conseil d’Etat de vérifier que le texte qui lui est
soumis, en particulier, d’un projet de loi n’est entaché d’aucune ambiguïté sérieuse et ne
méconnaît ni le principe de « clarté de la loi », ni les objectifs à valeur constitutionnelle
« d’accessibilité et d’intelligibilité » de la loi31. Soucieux de garantir la stabilité et la sécurité
juridiques, le Conseil d’Etat veille par conséquent à la clarté et à la précision des termes
employés et il s’attache à déceler les sources d’ambigüité qui pourraient faire naître ensuite
des difficultés d’interprétation susceptibles de nourrir des difficultés d’application ou des
contentieux. Ce n’est pas un mince enjeu que de travailler à la rédaction de textes brefs,
généraux et prescriptifs, plutôt que de normes bavardes, techniques ou floues.
2. Mais le contrôle de qualité ne se limite pas à celui de la correction formelle des
projets de texte. Le Conseil d’Etat veille aussi, et de plus en plus, à la régularité juridique des
projets qui lui sont soumis. La tâche incombant au Gouvernement et au législateur s’est en
effet complexifiée, à mesure que les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes
devenaient plus contraignantes. Alors que, dans la tradition française issue de la Révolution,
la loi, expression de la volonté générale, est incontestable et que, par conséquent, rien ne peut
contraindre le législateur, le récent et spectaculaire essor du contrôle juridictionnel de la loi a
compliqué et fragilisé son travail. Les lois peuvent désormais faire l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité, en particulier depuis la décision du Conseil constitutionnel Liberté
d’association de 197132 qui a intégré dans le bloc de constitutionnalité le préambule de la
Constitution et, par conséquent, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ce
contrôle s’est amplifié avec les révisions constitutionnelles de 197433 et 200834 qui ont ouvert
le prétoire du Conseil constitutionnel, sous certaines conditions, aux parlementaires, puis à
tout justiciable. Les lois peuvent aussi être contestées devant les juridictions ordinaires au
regard des traités internationaux35 et du droit dérivé de l’Union européenne36. Ce double
27 H. Hoepffner, op. cit. note 5, p. 895.
28 CC, 3 avril 2003, « Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants du Parlement
européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques », n° 2003-468 DC.
29 CE Ass., 23 octobre 1998, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques assimilés (UFFA-CFDT), n°
169797.
30 M. Long, op. cit. note 12, p. 787.
31 CC, 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption
de la partie législative de certains codes, n° 99-421, cons. 13.
32 CC, 16 juillet 1971, Loi complétant les articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, n° 71-44 DC.
33 Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution.
34 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
35 Article 55 de la Constitution. CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. 190, n° 108243 ; Cass. ch. mixte, 24 mai
1975, Administration des douanes et Société des cafés Jacques Vabre ; Cons. Constitutionnel, 15 janvier 1975,
Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 74-54 DC.
36 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64 ; CE, 24 septembre 1990, Boisdet, n° 58657 ; CE Ass., 28
février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, n° 56776 et 56777.

5
contrôle a renforcé la fonction consultative du Conseil d’Etat qui offre une expertise utile afin
de s’assurer de la régularité juridique des projets de texte et de les sécuriser au regard des
normes supra-législatives. Car le contrôle de constitutionnalité est en France rigoureux au
regard de ce qui s’observe dans de nombreux pays comparables. De même, l’interprétation
que donnent de l’article 55 de la Constitution les juges français est particulièrement
contraignante, notamment en termes de droit comparé, les juridictions administratives et
judiciaires écartant sans faiblesse toute loi – ou décret – incompatible avec un engagement
européen ou international, y compris lorsqu’elle est postérieure à ces engagements37.
Le contrôle en amont de la régularité juridique des projets de loi, qui était à l’origine
cantonné à la vérification du partage de compétence entre la loi et le règlement, a par
conséquent pris une importance majeure. Le Conseil d’Etat se garde cependant de sacrifier à
une sorte de principe de précaution juridique et il ne donne un avis défavorable à un projet
que s’il existe un doute véritablement sérieux, compte tenu notamment de la jurisprudence,
existante ou normalement prévisible, sur la constitutionnalité ou la conventionalité d’un texte.
S’il s’impose de motiver ses désaccords avec le projet qui lui est soumis, il s’attache aussi à
exposer les raisons d’un avis favorable, lorsqu’il apparaît clair que la disposition en cause fera
l’objet d’une contestation devant les juridictions nationales, en particulier le Conseil
constitutionnel, ou devant les juridictions européennes.
3. Enfin, si le Conseil d’Etat s’abstient de se prononcer sur les choix politiques qui ont
présidé à l’élaboration d’un projet de loi, il en vérifie néanmoins « l’opportunité
administrative »38. A ce titre, il s’assure, d’une part, que le texte proposé est utile et
nécessaire39 au regard des objectifs poursuivis et il contrôle son insertion dans
l’environnement juridique existant40. Le cas échéant, il demande au Gouvernement de
compléter son texte ou procède lui-même aux ajustements nécessaires. Il s’assure aussi que
l’application du texte proposé ne comporte pas des risques excessifs pour la sécurité juridique.
D’autre part, le Conseil d’Etat examine les conditions de mise en œuvre des textes et il
s’interroge sur la pertinence et l’efficience des moyens juridiques proposés au regard des buts
poursuivis et de la capacité des services administratifs à appliquer les dispositions qui lui sont
soumises.
Si le Conseil d’Etat n’est donc pas le « co-auteur » qu’il a pu revendiquer d’être pour
les décrets en Conseil d’Etat41, il est incontestablement un rouage essentiel du processus
d’élaboration des projets de loi et, bien sûr, des ordonnances et des principaux décrets42. Ce
faisant, il contribue à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit en éclairant les
termes du débat et en permettant d’identifier, en amont, les difficultés susceptibles de se
poser.
II. Afin de mieux répondre aux attentes des citoyens, la fonction consultative du
Conseil d’Etat a été récemment enrichie.
37 Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Administration des douanes et Société des cafés Jacques Vabre et CE Ass., 20
octobre 1989, Nicolo, Rec. 190, n° 108243.
38 M. Long, op. cit. note 12, p. 787.
39 Par exemple, saisi du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans le domaine
de la prévention des risques, le Conseil d’Etat a proposé l’abrogation de plusieurs dispositions qui étaient
redondantes avec les dispositions générales du code de l’environnement (Rapport public 2016, Activité
juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, p.214).
40 M. Long, « Mon expérience de la fonction consultative du Conseil d’Etat », RDP, n° 5/6, 1998, p. 1427.
41 CE Assemblée, 9 juin 1978, SCI 61-67 boulevard Arago, Rec. 237.
42 M. Long, op. cit. note 12, p. 787.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%