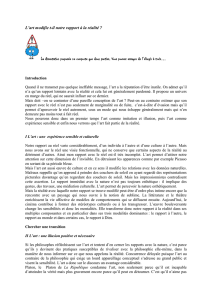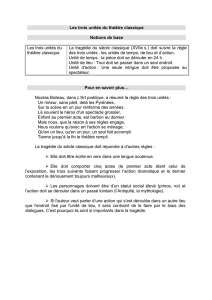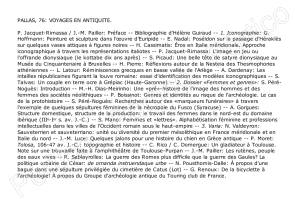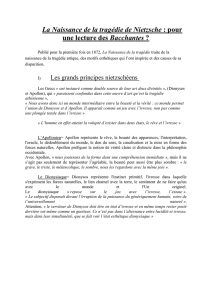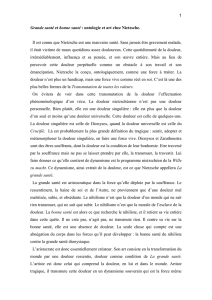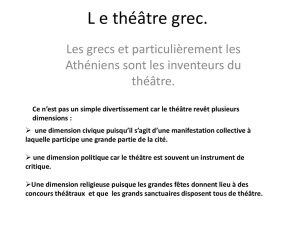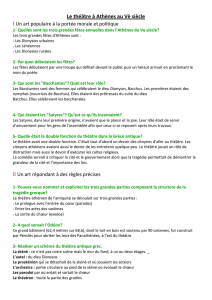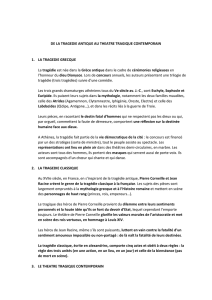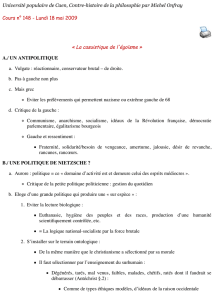La philosophie de Nietzsche - Université populaire de Marseille

Université populaire du Théâtre Toursky — Cours de philosophie par Annick Stevens
La philosophie de Nietzsche
(2e séance : 9 octobre 2013)
Chap. 2 : La figure de Dionysos dans La Naissance de la tragédie
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la connaissance érudite de l’Antiquité était à son sommet, culminant avec
les découvertes archéologiques et linguistiques, les éditions scientifiques des textes, la passion de l’histoire, de la
littérature et de l’art grecs. Dans La Naissance de la tragédie, Nietzsche énonce une thèse à contre-courant de cette
érudition et provoque une polémique entre philologues, les uns le soutenant, les autres le rejetant violemment.
Cette thèse est que l’art grec ne devait pas sa principale inspiration à une conception de la beauté tout entière
fondée sur l’équilibre tranquille et majestueux, correspondant à la puissance de la raison et à la sublimation des
émotions, mais qu’au contraire cette mesure et cet ordre ne furent que des réactions visant à juguler le véritable
élan de toutes les expressions du génie grec, un élan ravageur qui aurait détruit la civilisation s’il n’avait été ainsi
atténué. Ce que révèlent, en effet, les mythes anciens dont s’inspirent les tragédies, c’est le goût pour la cruauté,
l’horreur, la fatalité incompréhensible qui s’acharne sur des êtres humains, aussi bien innocents que coupables.
Que l’on songe à la malédiction des Atrides, au châtiment de Prométhée, à l’accumulation de souffrances
imposées aux descendants d’Œdipe... Ce goût de l’horrible fut, selon Nietzsche, le signe de la plus grande santé
de ce peuple, et sa recherche de beauté l’antidote nécessaire pour ne pas sombrer totalement dans la destruction.
Après un moment d’équilibre entre les deux tendances opposées, le déclin artistique commença dès le IVe siècle
avant notre ère par la domination de l’optimisme et de la fausse sérénité apportés par la logique explicative. La
tragédie a atteint la perfection chez Eschyle (525-456) et Sophocle (495-405), quand elle a réussi à exprimer en
même temps la fragilité de la vie humaine par rapport à tout ce qui la dépasse et échappe totalement à son
contrôle, et néanmoins le désir d’avoir une action volontaire, capable de construire une grandeur humaine en
dépit de toutes les forces aveugles, et capable de créer de la beauté. Elle a été détruite par Euripide (480-406),
parce que celui-ci a voulu recouvrir l’énigme de la souffrance inéluctable sous des explications dialectiques et des
dénouements heureux par interventions divines.
Parmi toutes les expressions artistiques, c’est la tragédie qui illustre le mieux la nécessité, pour atteindre la plus
haute forme de l’art, d’affirmer avec la même force les deux principes opposés, que Nietzsche appela l’apollinien
et le dionysiaque. Apollon était le dieu du soleil, des arts, de la médecine, de la divination ; c’est dans son
sanctuaire à Delphes qu’étaient gravées les maximes anciennes « Rien de trop » et « Connais-toi toi-même », qui
associaient au dieu l’exigence de mesure et de rationalité. Sur le fronton du temple de Zeus à Olympie, Apollon
se dresse au milieu d’une bataille extrêmement violente dans laquelle des Centaures tentent d’enlever des jeunes
femmes, et il étend sereinement le bras au-dessus de la mêlée, le visage figé dans la beauté impassible typique de
la statuaire classique. Dionysos ne jouit pas d’une place aussi ancienne au panthéon des Olympiens. Originaire
du Moyen-Orient, il est intégré à l’histoire des Olympiens comme fils de Zeus et d’une princesse thébaine,
Sémélé, qui fut foudroyée par Héra, de sorte que l’enfant termina sa gestation dans la cuisse de son père. Son
culte était composé de Mystères et de transes extatiques obtenues par le vin, la musique et la danse. Il est souvent
représenté dans une nature luxuriante, accompagné de satyres ou silènes, et associé à une sexualité débridée.
Cependant, l’union avec la nature n’a rien d’idyllique, à l’inverse de ce qu’ont représenté les Renaissants puis les
Romantiques ; elle intègre tout ce qui, dans le culte de Dionysos, était cruel et sanglant, souffrance et plaisir
confondus. Ainsi, dans la tragédie d’Euripide Les Bacchantes, le jeune roi de Thèbes qui s’oppose à Dionysos est
déchiqueté par sa propre mère, égarée par le dieu et devenue une Ménade comme toutes les autres femmes de la
cité. Celles-ci, se fondant dans la nature sauvage du Mont Cithéron, font jaillir de la terre des sources de lait et de
miel, allaitent des faons et des louveteaux, puis tout aussi bien, sur un ordre du dieu, chassent et lacèrent les
animaux.

2
Il était déjà reconnu par les antiquisants que la tragédie devait son apparition aux dithyrambes, des chants
composés en l’honneur des dieux et en particulier en l’honneur de Dionysos, accompagnés de musique et
éventuellement de chorégraphies simples. Reprenant cette observation, Nietzsche ajoute que la musique a
précédé les textes, comme c’est le cas aussi dans la chanson populaire, et que c’est la musique qui constitue
l’élément dionysiaque de la tragédie. En effet, seule la musique est capable d’évoquer le caractère énigmatique,
violent, douloureux, incompréhensible de la vie, par une expression directe des émotions, antérieure aux mots, à
la pensée et à toute représentation. La musique, pour être fidèle à sa nature propre, ne doit être ni une recherche
de la beauté ni une imitation de phénomènes observés. La musique descriptive est une imitation des
phénomènes, alors que la musique dionysiaque est « miroir du vouloir universel » (§17). Nietzsche admire
Schopenhauer pour avoir déjà affirmé que la musique, seule de tous les arts, révèle directement la volonté, c’est-
à-dire la chose en soi ou l’élément métaphysique du monde, par opposition à l’élément physique constitué par les
phénomènes.
L’opposition schopenhaurienne entre phénomène et volonté lui semble correspondre aussi à l’opposition entre
les attributs respectifs des deux dieux : Apollon est le dieu de l’individuation, c’est-à-dire de la séparation, de la
définition, de l’identité, de la conscience, tandis que Dionysos est le dieu de la perte de l’individuation en même
temps que de toutes les limites, de la transe où l’individu perd la conscience de soi et ne fait plus qu’un avec le
tout. L’art dionysiaque doit opérer une telle fusion, une telle indistinction entre l’objectif et le subjectif, grâce au
fait que l’artiste se dépouille de sa volonté individuelle pour se faire le médium d’une expression originaire
indifférenciée. Nietzsche estime à cette époque que la musique de Wagner est dionysiaque en ce qu’elle permet
cette communication directe que ne permet plus la parole, elle transmet les émotions en-deçà de l’exprimable, et
c’est pourquoi elle est le seul art qui peut encore produire du nouveau malgré une langue usée ; c’est pourquoi
aussi les œuvres de Wagner ne doivent pas être lues : les émotions s’y expriment d’abord et le mieux par la
musique, ensuite par le geste, enfin, d’une manière affaiblie, par les paroles.
A côté de cela, l’élément apollinien dans la tragédie concerne la « belle apparence », celle qui nous fait imaginer
des formes parfaites, en particulier dans les rêves. C’est elle qui donne son langage à la tragédie, à la fois ses
images et son expression poétique, qui sont comme des symboles exprimables des forces dionysiaques. Il n’est
pas naturel, quand on est en proie à une émotion extrême, de l’exprimer par des phrases sublimes ; c’est
précisément là le rôle transfigurateur de l’art, dont le but est l’expression même, la création d’une belle forme qui
ne doit pas être fidèle à la réalité ; il recherche un certain type de beauté qui n’existe pas ailleurs. Ainsi, la tragédie
grecque s’adressait à la fois aux émotions les plus profondes et les plus inexprimables, et aux émotions
transfigurées par la culture, sublimées par l’esthétique d’une civilisation1. « Ainsi l’apollinien nous arrache à
l’universalité dionysiaque et détourne notre extase sur les individus : car c’est à eux qu’il enchaîne notre
compassion, c’est par eux qu’il satisfait notre sens du beau qui brûle du désir de formes grandes et sublimes.
Faisant passer sous nos yeux des images vivantes, il nous incite à saisir intellectuellement le principe de cette vie
qui est en elles. Grâce au poids extraordinaire qui est celui de l’image et du concept, de l’enseignement moral, de
l’émotion que provoque la pitié, l’apollinien arrache l’homme à cet anéantissement de soi propre à l’orgiasme et,
en lui dissimulant l’universalité du phénomène dionysiaque, lui donne l’illusion qu’il ne voit qu’une image
particulière du monde (par exemple Tristan et Isolde) dont, par la musique, il devrait obtenir une vision encore
meilleure, plus intérieure. »2.
La thèse philosophique correspondante
1 La Naissance de la tragédie, § 21. Toutes les citations de cette œuvre sont issues de la traduction de Ph. Lacoue-
Labarthe pour l’édition Gallimard, Folio Essais.
2 Id., p. 125. Voir aussi p. 128 la conclusion sur l’inséparabilité d’Apollon et de Dionysos.

3
S’il n’y avait que l’expression dionysiaque, on ne pourrait pas supporter de continuer à vivre, on ne pourrait pas
aimer la vie. C’est par son mélange d’apollinien et de dionysiaque que l’art permet de lutter contre le dégoût de
l’insignifiance de la vie, d’éviter de tomber dans « la négation bouddhique du vouloir ». Pour celui qui a compris
l’absurdité de l’être, et qui ne peut plus se voiler de l’illusion, l’art est guérisseur (comme l’est Apollon) et sauve
en transformant l’horreur et l’absurdité en images sublimes. C’est alors qu’on peut tout vouloir et tout affirmer :
« Tout ce qui existe est juste et injuste, et dans les deux cas également justifié » ; autrement dit, tout ce qui, du
point de vue d’un individu, est estimé juste ou injuste par projection du point de vue humain, n’est ni l’un ni
l’autre du point de vue du tout mais seulement est, comme une simple affirmation sans jugement. Nietzsche
s’oppose ainsi au privilège accordé selon lui par Anaximandre (philosophie présocratique du VIe siècle avant
notre ère) à l’immobilité du fond commun de toutes choses par opposition à l’injustice du devenir : « Ce dont la
génération procède pour les choses qui sont, est aussi ce vers quoi elles retournent sous l’effet de la corruption,
selon la nécessité ; car elles se rendent mutuellement justice et réparent leurs injustices selon l’ordre du temps ». Ce fragment est
compris généralement comme une métaphore ou une analogie avec la justice dans les relations humaines, pour
exprimer que tout ce qui apparaît dans l’univers se détache d’un tout indifférencié, y réalisant ainsi une sorte
d’emprunt qu’il lui faut ensuite rendre une fois son temps de vie écoulé. Ainsi, l’injustice serait l’individuation et
la différenciation, tandis que la justice serait le retour au tout et à l’indifférencié. Cependant, dans La philosophie à
l’époque tragique des Grecs, Nietzsche l’interprète comme si le philosophe y exprimait une préférence pour
l’immuabilité de l’apeiron (« l’indéterminé ») par rapport au devenir des figures temporaires qui sont produites à
partir de lui et ensuite y retournent. Le devenir serait injustice, alors que chez Héraclite il est accepté comme une
nécessité totalement innocente, comme l’atteste son fameux fragment : « Le temps (Aïôn) est un enfant qui joue
avec des pions : royauté de l’enfant ». Nietzsche le commente ainsi : « Seul en ce monde, le jeu de l’artiste et de
l’enfant connaît un devenir et une mort, bâtit et détruit, sans aucune imputation morale, au sein d’une innocence
éternellement intacte. Ainsi, comme l’enfant et l’artiste, joue le feu éternellement vivant, ainsi construit-il et
détruit-il, en toute innocence... et ce jeu, c’est l’Aïôn jouant avec lui-même. [...] Une telle vision esthétique du
monde ne peut être que le fait de l’homme qui a appris, au contact de l’artiste et en voyant naître une œuvre
d’art, comment le combat de la pluralité peut néanmoins receler une loi et une justice, comment l’artiste est à la
fois contemplatif et actif à l’égard de son œuvre, comment nécessité et jeu, conflit et harmonie doivent s’allier
pour produire une œuvre d’art. Qui ira alors exiger qu’une telle philosophie nous donne en plus une morale et
son indispensable impératif « Tu dois ! » Et qui ira jusqu’à faire à Héraclite le reproche de cette absence de
morale ! L’homme jusque dans ses fibres les plus intimes, est tout entier nécessité et absolue « non-liberté » — si
l’on entend par liberté l’exigence extravagante de pouvoir changer sa nature selon son caprice, comme un
vêtement, prétention que toute philosophie digne de ce nom a jusqu’ici repoussée avec l’ironie requise. »3.
Puisque la question de la liberté et du déterminisme, question philosophique par excellence, reviendra
régulièrement dans l’œuvre nietzschéenne, avec toujours plus de précision, il est important de noter déjà que la
liberté humaine est refusée seulement si on la définit comme la possibilité de dépasser notre nature biologique,
par exemple en nous promettant une autre vie après la mort terrestre, comme le font la plupart des religions, ou
en la concevant comme une instance indépendante de tous les instincts et capable de les dominer, comme le font
la plupart des morales.
Estimer ainsi que le monde ne possède aucune signification, aucune justification, pas même moyennant une
« ruse de la raison » qui préparerait un bien là où nous voyons un mal, comprendre qu’il n’est rien en dehors d’un
devenir aveugle qui broie ses propres créations, c’est bien là une vision pessimiste que revendique Nietzsche, par
opposition aux conceptions optimistes qui veulent voir une tendance au meilleur, une providence ou du moins
une explication du mal par le bien. Cependant, ce pessimisme n’est pas né de la faiblesse et ne débouche pas sur
3 La philosophie à l’époque tragique des Grecs, Œuvres complètes, Gallimard, tome 1, vol. 2, p. 236-237.

4
l’apathie ; il encourage à une création assumant sa propre mortalité. « Sans doute nous faut-il reconnaître que
tout ce qui voit le jour doit nécessairement s’apprêter à décliner et périr dans la souffrance ; sans doute sommes-
nous contraints de plonger notre regard dans les terreurs de l’existence individuelle — mais non pour en rester
figés d’horreur : une consolation métaphysique nous arrache, momentanément, au tourbillon des formes
changeantes. Pour de brefs instants, nous sommes réellement l’être originel lui-même, nous ressentons son
incoercible désir, et son plaisir d’exister ; les luttes et les tourments, l’anéantissement des phénomènes, tout cela
nous paraît soudain nécessaire, étant donné la surabondance des innombrables formes d’existence qui se
pressent et se précipitent vers la vie, la fécondité débordante du vouloir universel ; l’aiguillon furieux de ces
tourments nous transperce dans le temps même où nous ne faisons pour ainsi dire plus qu’un avec
l’incommensurable et originel plaisir d’exister et où, ravis dans l’extase dionysiaque, nous pressentons
l’indestructible éternité de ce plaisir ; — où, nonobstant terreur et pitié, nous connaissons la félicité de vivre, non
pas comme individus, mais en tant que ce vivant unique qui engendre et procrée, et dans l’orgasme duquel nous
nous confondons. »4.
Il y a ainsi, dans l’art en général et dans la tragédie en particulier, une consolation métaphysique, c’est-à-dire une
quête de sens au-delà de la simple vie biologique ; la consolation réside dans la conscience que la vie est
indestructible, en dépit de tous ses aspects contradictoires et de ses changements incessants. On peut parler
d’une métaphysique de l’art dont le principe est que « l’existence et le monde n’apparaissent justifiés qu’en tant que
phénomène esthétique »5, au sens où le plaisir esthétique n’est tiré d’aucune valeur extérieure à lui, ni morale, ni
intellectuelle, ni sublime. En effet, le plaisir esthétique peut naître directement du laid, du dissonnant, de
l’effroyable, sans qu’on doive passer par la médiation du soulagement et de la sublimation. C’est pourquoi, même
« le pire des mondes » est justifié par la musique et par le mythe tragique. Cependant, il ne suffirait pas pour nous
donner envie de vivre, et pour cette raison il doit être contre-balancé en proportions égales par l’élément
esthétique apollinien, c’est-à-dire l’une des « innombrables illusions de la belle apparence ».
C’est pourquoi aussi la mort de la tragédie coïncide avec le socratisme et son exigence de rationalité et de
maîtrise opposées aux instincts et aux élans naturels. Cependant, Socrate a aussi été un créateur, celui d’une autre
consolation contre le pessimisme, qui est la figure de l’homme théorique. La science, dans son désir insatiable de
dévoiler les illusions pour atteindre la vérité, est le sommet de l’illusion métaphysique, par sa croyance qu’elle
peut atteindre le plus profond de l’être et même le corriger (§ 15). Mais comme rien n’est simple et univalent, il
faut ajouter que cet instinct scientifique, qui s’est répandu mondialement depuis Socrate, a peut-être sauvé
l’humanité en la détournant de ses instincts d’auto-destruction. En effet, la sérénité de l’homme théorique lui
vient d’une consolation toute terrestre, de son propre deus ex machina, « le dieu des machines et des creusets,
c’est-à-dire les forces des esprits de la nature révélées par la connaissance et mises au service de l’égoïsme
supérieur, — de telle sorte qu’elle croit le savoir capable de corriger le monde et la science de guider la vie, et
qu’elle est effectivement en mesure d’enfermer l’individu dans un cercle très étroit de problèmes qu’il peut
résoudre, d’où il lui est possible de dire en toute sérénité à la vie : « Je veux bien de toi ; tu es digne d’être
connue. » » 6. Une part de l’humanité a trouvé son salut dans l’effet rassurant du positivisme, dans le refus de voir
que quelque chose nécessairement nous échappe et ne peut être maîtrisé, par lequel les savants bornés se
détournent de l’abîme qui est au fond d’eux.
La conception théorique et la conception tragique du monde sont donc deux formes antagonistes créées par les
hommes pour survivre. Nietzsche est à cette époque convaincu que la conception tragique renaîtra lorsque la
science aura atteint ses limites et que sa prétention à la validité universelle sera anéantie. À cette science limitée, il
4 La Naissance de la tragédie, § 17, p. 101.
5 Id., § 24, p. 135.
6 Id., § 17, p. 106-107.

5
oppose le mythe, au sens des récits légendaires racontés par les tragédies, car « le mythe est un exemple d’une
généralité et d’une vérité capables d’ouvrir sur l’infini ». Ce jugement rejoint celui d’Aristote, selon lequel la
poésie narrative est plus philosophique que l’histoire, car elle raconte non pas ce qui est arrivé mais tout ce qui
peut arriver, de sorte qu’en représentant un cas particulier possible, elle atteint l’universel (Poétique, chap. 9). Les
personnages d’une bonne tragédie doivent être très peu individués ; ils représentent des types de caractères,
d’actions ou de victimes. C’est une autre généralité que celle de la science : elle ne dit pas que, par nécessité
causale, de ceci résultera toujours cela ; elle montre plutôt tout ce qui peut résulter des différentes sortes
d’actions et d’attitudes humaines, et tire comme seule règle générale le fait que l’homme ne peut pas en avoir une
complète connaissance. C’est pourquoi Nietzsche estime que Kant et Schopenhauer ont remporté une grande
victoire philosophique sur l’illusion scientifique d’après laquelle il suffit de connaître les phénomènes pour
connaître l’être.
Il y a donc deux sortes de consolation devant l’étrangeté effrayante du monde : une scientifique et une
métaphysique ou tragique ou dionysiaque. Bien loin derrière elles, on peut encore citer une consolation artistique
au sens ordinaire, qui consiste simplement à se réfugier dans la consommation de spectacles, à se laisser divertir,
endormir ou étourdir.
Quelques années plus tard, Nietzsche contestera l’importance qu’il accordait à la musique : dans Humain, trop
humain il refuse de privilégier l’expression musicale par rapport aux autres expressions : « La musique n’est pas en
soi et pour soi tellement significative de notre être intime, si profondément émouvante, qu’elle pût passer pour le
langage immédiat du sentiment ; mais son antique association avec la poésie a mis tant de symbolisme dans le
mouvement rythmique, dans la force et la faiblesse du son, que nous avons maintenant l’illusion qu’elle parle
directement à l’être intime et provienne de l’être intime. [...] En soi, aucune musique n’est profonde ni
significative, elle ne parle point de « volonté », de « chose en soi » ; c’est là chose que l’intellect ne pouvait
s’imaginer qu’en un siècle qui avait conquis pour le symbolisme musical tout le domaine de la vie intérieure. »7
Rétrospectivement, Nietzsche regrettera encore le langage « schopenhauerien et kantien » qu’il a utilisé pour
développer des idées qui n’avaient rien à voir avec ces philosophies, comme il l’explique dans l’avant-propos
rédigé pour la 2e édition de La Naissance de la tragédie en 1886, qui s’intitule « Essai d’autocritique ». Il y souligne
cependant aussi tout ce qui, de ces premières affirmations, allait l’accompagner durant toute son œuvre. Par
exemple, en présentant une interprétation strictement esthétique et d’aucune manière morale de la tragédie, et
malgré l’absence de toute référence explicite au christianisme, il estime avoir déjà eu l’intuition que celui-ci était
l’antithèse de la conception dionysiaque du monde, un pessimisme moralisateur fondé sur l’incapacité
d’apprécier la vie. « C’est donc contre la morale que dans ce livre problématique s’était jadis tourné mon instinct,
un instinct qui intercédait en faveur de la vie et s’inventa par principe une contre-doctrine et une contre-
évaluation de la vie, purement artistique, anti-chrétienne. Mais comment la nommer ? En philologue, en homme du
langage, je la baptisai non sans quelque liberté — mais qui saurait au juste le nom de l’antéchrist ? — du nom
d’un dieu grec : je l’appelai dionysiaque. »8
Enfin, dans l’une de ses dernières œuvres, le Crépuscule des idoles, il revient une dernière fois sur ce que serait un
art dionysiaque approprié à la modernité. Il s’agit d’une création par laquelle nous disons oui à la réalité de la
manière la plus féconde, sans aucune passivité, en sélectionnant, en renforçant, en corrigeant la réalité sous les formes
artistiques9. Le dionysisme est ainsi renforcé par la théorie de la volonté de puissance, car la surabondance, la
plénitude, l’ivresse éprouvée à certains moments par les natures fortes rendent possible la transfiguration des
choses jusqu’à leur état le plus parfait, qui coïncide avec le sentiment qu’a l’artiste de sa propre puissance et
7 Humain, trop humain, § 215.
8 La Naissance de la tragédie. Avant-propos, § 6, p. 18.
9 Crépuscule des idoles, « La « raison » dans la philosophie », § 6.
 6
6
1
/
6
100%