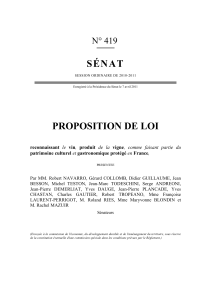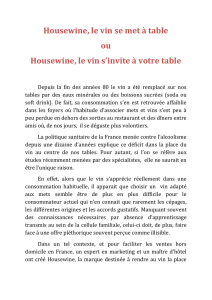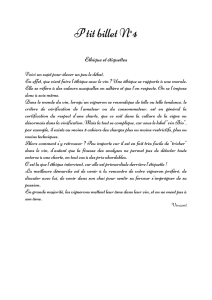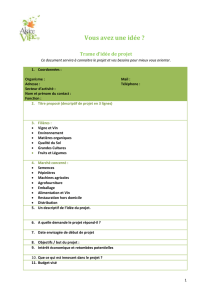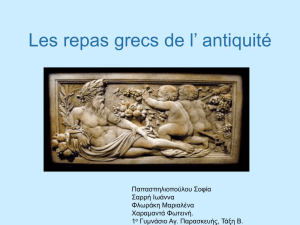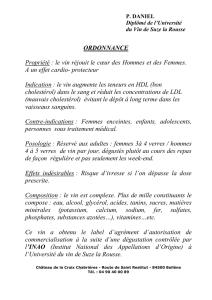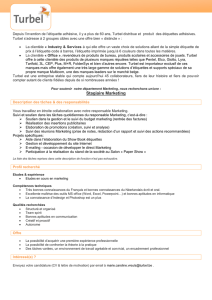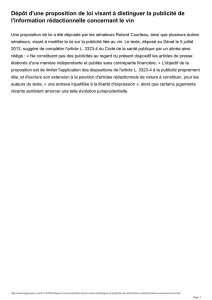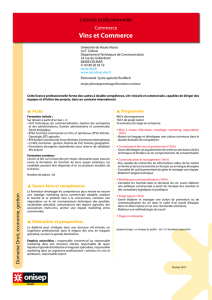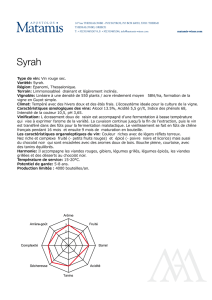L`étiquette, cet unique moyen de communication - FMA

VI - N° 48 - Vendredi 28 novembre 2014 - page 21LE PAYSAN DU HAUT-RHIN
Conférence Université de Haute-Alsace
VITICULTURE
L’étiquette, cet unique moyen
de communication
Avec l’interdiction de la
publicité sur le vin, le
packaging devient finale-
ment le seul moyen de
communication du vin.
L’étiquette sur la bouteille
occupe donc une place
centrale pour comprendre
le vin.
n
La première des cinq conférences,
proposées notamment par la faculté
de marketing et d’agrosciences de
l’Université de Haute-Alsace, avait
pour thème « Les enjeux du packaging
et de l’étiquetage pour le marketing
des vins de qualité ». Le conférencier
François Bobrie est expert européen
en marketing des indications géogra-
phiques. Contrairement aux autres
produits de l’agroalimentaire, dans le
packaging du vin, l’étiquette devient
pratiquement le seul moyen de com-
munication, et ce d’autant que la
publicité est interdite pour le vin.
« C’est par l’étiquette que se fait la
communication et la compréhension
du vin. On aurait donc tort de sous-
estimer son importance ». Surtout
en linéaire de supermarché, où le
consommateur ne dispose que de
quelques secondes pour sa lecture.
Mais il faut cependant considérer que
celui-ci se rend régulièrement devant
le linéaire et que par ailleurs, les éti-
quettes sont appelées à être reprises
par le magasin pour ses supports de
communication sur papier, lors des
foires aux vins par exemple ou par
internet pour le drive. L’étiquette va
donc être dupliquée dans les médias,
sur internet, par les mobiles, sur face-
book, etc. « Les médias internet ne
vont qu’accroître l’importance du pac-
kaging, dont l’étiquette est le pivot
de la politique de commercialisation ».
En résumé, l’étiquette n’est certaine-
ment pas un aspect de la gestion d’un
domaine viticole à négliger.
Contrairement à une idée reçue dans
le monde vigneron, une étiquette,
même avec des tailles de typogra-
phie et un contenu très réglementés,
offre de grandes opportunités de
communication : l’ensemble (formes,
couleurs, illustrations, style typogra-
phique) va organiser un véritable
récit sur le contenu de la bouteille.
Sur écran, smartphone, papier ou
internet, elle véhicule donc une foule
d’informations. Sans compter qu’il est
possible d’y ajouter une contre-éti-
quette, un macaron, une collerette. Et
à la grande différence d’un spot publi-
citaire, le récit de l’étiquette présente
la particularité d’être organisé par son
lecteur : « Tandis que la publicité agit
sur l’esprit de façon assaillante, l’éti-
quette met en situation de consomma-
tion ». Sur une bouteille, l’œil se porte
à n’importe quel endroit et c’est le
cerveau qui reconstitue le message. À
la lecture de ce message, le cerveau
se pose des questions : qui raconte le
récit ? De quoi parle-t-on ? Est-ce à ma
portée socio-culturelle ? Qui a fait ce
vin et pourquoi ?
L’étiquette répond à ces questions en
mettant en scène l’énonciateur, en
l’occurrence l’auteur du vin. « Vin qui
est le personnage principal du récit,
souligne François Bobrie. Il va falloir
lui donner une personnalité, le faire
vivre comme un personnage ». Cette
personnalité du vin peut être liée prin-
cipalement soit à la vigne, soit à son
élaboration, « mais le récit doit établir
un équilibre entre viticulture et élabo-
ration ». « La difficulté pour le marké-
teur, le concepteur de l’étiquette, est
de ne pas nier l’un ou l’autre ». Il doit
également tenir compte de l’envi-
ronnement socio-culturel de celui qui
reçoit ce message. Quel dialogue faut-
il établir ? Dans quel style ? Est-ce un
connaisseur en vin ?
La question de l’énonciateur
Certains énonciateurs font le choix de
statut fort, c’est-à-dire une mise en
avant de l’auteur du vin. D’autres, le
choix de statuts faibles, où l’auteur
s’efface devant d’autres données
telles la cuvée, la région, la parcelle, le
cépage… Dans ce cas, « le propriétaire
du domaine se met en retrait et met en
avant sa création ». « Il y a des options,
elles sont libres, et c’est bien le viticul-
teur qui décide ce qui doit être mis en
avant. En général, le marketing ne fait
que confirmer le choix du vigneron ».
En Alsace, il y a des cas fréquents où
l’on a un énonciateur à deux visages,
avec la mise en avant du domaine
et de l’entreprise, c’est-à-dire de la
viticulture et du savoir-faire, observe
François Bobrie.
Le vin, ce héros de l’étiquette
Entrons à présent dans le corps du
récit. Quel que soit l’énonciateur,
à statut fort ou faible, le vin est en
réalité le vrai héros de l’étiquette. Le
récit privilégie une raison majeure de
la qualité du vin. Tous les vins parlent
d’une localisation mais ce n’est pas
suffisant. Le cépage, unique ou en
assemblage, renseigne également sur
l’élaboration du vin. Mais pour com-
pléter la description de la personna-
lité, on peut également renseigner sur
la méthode de vinification, la garde :
« Sur lie, en fût, méthode tradition-
nelle… » Cependant, une d’étiquette
ne doit pas se limiter à raconter une
seule caractéristique, par exemple
l’origine du terroir. Il y a toujours de
multiples caractéristiques racontées,
avec certaines plus ou moins mises en
valeur.
« Le grade du parcellaire est cependant
ressenti comme source de qualité ». En
étudiant les étiquettes du top 100 du
magazine Wine Spectator entre 2009
et 2013, François Bobrie observe que
80 % des étiquettes de vins primés
privilégient l’origine. « L’idée selon
laquelle les vins du nouveau monde
misent sur l’identité du cépage est
donc fausse ».
Pour quel lecteur ?
Selon François Bobrie, une étiquette
se conçoit toujours en fonction d’un
lecteur pré-supposé. Il faut donc seg-
menter, connaître la mentalité cultu-
relle du futur consommateur pour
concevoir l’étiquette, le message, en
fonction de celui-ci. Il y a deux manières
de dialoguer : soit convaincre par l’ac-
cumulation des preuves, soit séduire
par les évocations du vin. S’adresser
en quelque sorte à la raison ou aux
sentiments. Certains vont donc appo-
ser des signes de qualité qui pour le
vin, sont cumulatifs (accumulation
de preuves). Tandis que le message
de séduction mettra par exemple en
avant de la joie de vivre, l’euphorie,
le partage, la fête… pour donner
envie de boire. Ce qui cependant, ne
suppose pas de gommer ce qui est
sérieux, précise François Bobrie.
Le conférencier a argumenté
son exposé avec une multitudes
d’exemples, d’innombrables éti-
quettes. Son auditoire composé d’une
centaine d’étudiants principalement,
et de vignerons, l’a questionné sur
les contre-étiquettes. « Le problème,
c’est d’être complémentaire, elle ne
se conçoivent donc qu’en respec-
tant l’équilibre avec l’énoncé sur
l’étiquette. L’idée du contenu est de
surenchérir sans être ennuyeux sur la
compréhension du vin ». Une question
plus générale avait trait à la ringardise
supposée d’étiquettes françaises :
Pour François Bobrie, les Français sont
très en pointe. Par contre, les étran-
gers refont leurs étiquettes tous les
deux-trois ans.
DL
Laurent Grimal, à gauche, président de la faculté de marketing et agro-sciences de Colmar, et François Bobrie,
le conférencier, expert en packaging. DL
François Bobrie a donné les clefs de lecture et de conception des étiquettes. Ici les étiquettes conçues chez GRAI-imprimeur
à Colmar. Grai - imprimeur Etiquettes
Trois autres conférences à venir
La faculté de marketing et d’agrosciences, le laboratoire vigne, biotechnologie et envi-
ronnement de Colmar, le service universitaire de l’action culturelle de l’université de
Haute-Alsace et le Civa proposent un cycle de conférences :
- le triomphe des vins de terroir au XX
e
siècle. Histoire de la construction et de la promo-
tion des AOC en Bourgogne, par Olivier Jacquet, historien, ingénieur de recherches à la
Chaire Unesco « culture et traditions du vin » de l’université de Bourgogne.
- Histoire du vignoble d’Alsace par Claude Muller, professeur à l’université de Stras-
bourg, directeur de l’institut d’Histoire d’Alsace, Jeudi 8 janvier 2015 à 18 h 30. Ces
deux conférences ont lieu à l’amphithéâtre - biopôle - bâtiment pôle agronomie -
33 rue de Herrlisheim à Colmar.
- Recherches scientifiques et construction politique des marchés : l’exemple de l’écono-
mie vitivinicole dans l’Union européenne par Antoine Roger, professeur de sciences
politiques à Sciences Po Bordeaux, membre du centre Émile Durkheim (UMR 5116)
et de l’institut universitaire de France. Jeudi 15 janvier à 18 h 30 à la Maison des vins
d’Alsace - 12 avenue de la Foire aux Vins à Colmar.
.vin : la secrétaire d’État au numérique
pour une réforme de la gouvernance
d’Internet
La secrétaire d’État au numérique, Axelle Lemaire, estime nécessaire
une réforme de la gouvernance d’Internet, a-t-elle déclaré à
l’assemblée générale de la Confédération des AOC viticoles (Cnaoc),
le 25 novembre. En effet, dans le système actuel, les noms de
domaine d’Internet comme les « .vin » et « .wine » risquent d’être
utilisés sans protection des appellations, ce qui donnerait des noms
comme « www.champagne.wine ou www.cotesdurhone.vin », qui
seraient vendus aux plus offrants. « Le vin est l’exemple type qui
illustre la nécessité de modifier les règles de gouvernance d’Internet »,
pour des raisons économiques (60 % du commerce extérieur
agroalimentaire), culturelles et de défense du consommateur (risque
tromperie sur le produit). Le vin est en pointe dans ce combat, a-t-elle
salué, mais de nombreux secteurs sont dans le même cas, avec le
risque de voir arriver des « .cheese », « .musique », « .sport ». La
secrétaire d’État a rappelé un précédent fâcheux : la ville marocaine
de Tata a perdu le bénéfice de l’utilisation de son nom, au profit
d’une grande entreprise qui a acheté le nom de domaine. Le « Nous
avons à protéger notre façon de vivre et notre savoir-faire », a résumé
Bernard Farges, président de la Cnaoc.
EN BREF...
1
/
1
100%