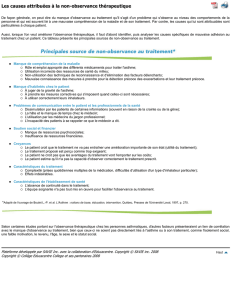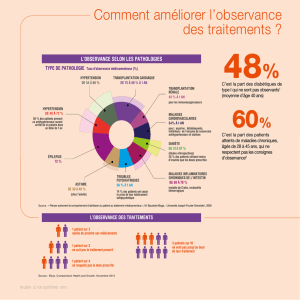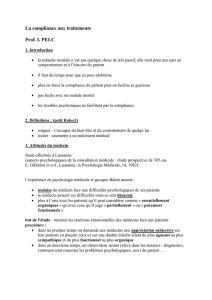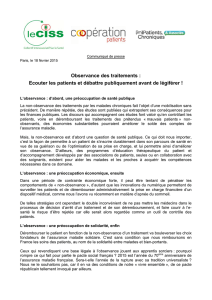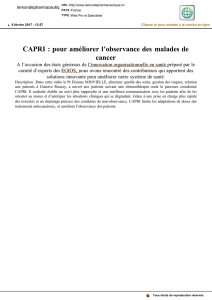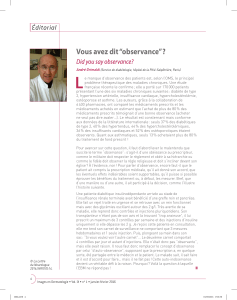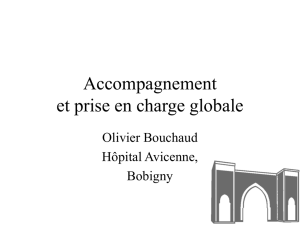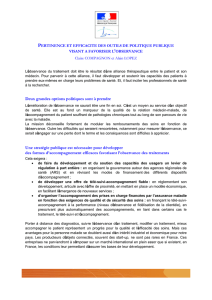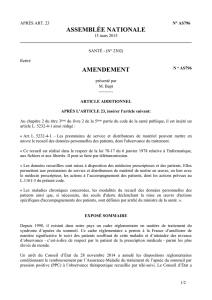Approche sociale et contextuelle de l`observance

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
8
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Contextes de la pratique
Approche sociale et contextuelle
de l’observance
●M. Morin*
LA NON-OBSERVANCE COMME TALON D’ACHILLE
DES PRISES EN CHARGE THÉRAPEUTIQUES
Peu après l’avènement dans le champ du
sida des multithérapies combinant l’action
des inhibiteurs de protéase et celle de deux
ou trois antirétroviraux, l’importance de
l’observance dans le traitement et la prise en
charge thérapeutique de l’infection par le
VIH a été dramatiquement posée, avec plu-
sieurs arguments particulièrement percu-
tants :
✔Seule une observance stricte ou excellente
permet d’obtenir les bénéfices attendus
d’une trithérapie, ou plus généralement
d’une multithérapie, c’est-à-dire d’avoir, de
façon durable, une charge plasmatique
(ARN-VIH) non détectable (< 200 ou
50 copies/ml), ainsi qu’une restauration
immunitaire.
La non-observance peut provoquer l’échec
thérapeutique à court terme et, menace plus
insidieuse, peut empêcher le succès des
changements de traitement par la produc-
tion de résistances croisées à l’intérieur
d’une même classe médicamenteuse, voire
entre classes. Elle constitue de surcroît un
danger de santé publique, des souches
virales devenues résistantes pouvant être
transmises par des personnes atteintes.
Cette ferme analyse prospective, qui s’est
formulée dans la plupart des recommanda-
tions d’experts à partir de 1997, s’est assez
vite heurtée à deux constats inquiétants :
✔L’expérience acquise dans d’autres patho-
logies montre que la non-observance appa-
raît d’autant plus que le traitement prescrit
s’étend sur une durée longue, qu’il est com-
plexe, qu’il impose un nombre quotidien
élevé de comprimés ou de gélules à prendre
dans des conditions très spécifiques et astrei-
gnantes, qu’il interfère avec les habitudes ou
contraintes de la vie quotidienne ou profes-
sionnelle, qu’il produit des effets secondaires
pénibles pour le patient et n’est pas associé
de manière visible à la disparition de symp-
tômes. Or, ces caractéristiques sont encore,
malheureusement, fondamentalement asso-
ciées aux multithérapies avec inhibiteurs de
protéase. Autrement dit, les nouveaux trai-
tements de l’infection à VIH cumulent la plu-
part des facteurs favorisant les risques de
non-observance.
✔Les premières et encore rares études empi-
riques de suivi des trithérapies sur des
cohortes de patients VIH ont relevé, comme
dans le cas de la cohorte française APROCO[1],
que 25 à 30 % des patients reconnaissaient
ne pas avoir pris la totalité des doses pres-
crites d’antiprotéases lors de la semaine
ayant précédé les visites de suivi à un et
quatre mois après la première prescription
incluant ce type de molécule (1). Plus géné-
ralement, les études qualitatives et quantita-
tives ont convergé pour montrer combien
l’exigence d’une observance parfaite sur le
long terme des traitements existants parais-
sait illusoire et irréaliste.
Le contraste est donc fort entre les exigences
des stratégies thérapeutiques recomman-
dées et les informations dont on dispose
concernant le comportement de nombreuses
personnes atteintes. On ne peut pourtant ni
renoncer aux règles d’application des pres-
criptions dont on sait que leur transgression
“ne pardonne pas” (2), ni avoir une attitude
d’autruche ou de déni face aux informations
des chercheurs de sciences sociales qui relè-
vent des probabilités importantes de non-
observance. Ce problème difficile a engen-
dré de multiples polémiques (3, 4), qui s’es-
soufflent suffisamment depuis quelque
temps pour qu’on puisse commencer à le
recadrer autour de quelques propositions et
programmes de travail, dont le but est de
rapprocher les besoins ou critères de la
recherche et les demandes de la clinique[2]. À
la base de cette perspective, une hypothèse
de travail simple : le social et le psychosocial
sont des composantes incontournables du
pronostic et d’une gestion adaptée de la thé-
rapeutique de l’infection à VIH.
INTÉRÊT ET INSUFFISANCES DES APPROCHES
PRÉDICTIVES DE L’OBSERVANCE
Face aux risques de non-respect des traite-
ments par les patients VIH, une première
réaction, largement compatible avec des
stratégies courantes en pratique médicale,
consiste depuis longtemps à mettre en place
un dispositif de contrôle relativement coerci-
tif qui allie un travail de prédiction sélective
des capacités et des incapacités des patients
à se soumettre (to comply) aux consignes des
experts médicaux, et un effort de contrôle et
de suivi, d’orientation paternaliste, des
patients jugés capables de suivre le traite-
ment. Cette approche “prédictive” (5) s’ap-
puie sur un certain nombre de présupposés
ou de croyances, qui paraissent confirmés
par des expériences ou des anecdotes en
forme de prophéties autovérifiées. Elles
reprennent la tradition des théories impli-
*Laboratoire de psychologie sociale, université
de Provence & unité INSERM U379, Marseille.
[1] La cohorte APROCO (Antiprotéase Cohorte), initiée en mai 1997 et dont le promoteur est l’Agence
nationale de recherche sur le sida (ANRS), est une recherche prospective multicentrique (47 centres
impliqués). Ses investigateurs principaux sont les Prs C. Leport et F Raffi. En janvier 1999, elle avait
recruté 1 258 patients.
[2] L’ANRS a ainsi récemment mis en place une Action coordonnée (AC18.2) intitulée “Contextes théra-
peutiques et prise en charge”, regroupant des cliniciens et des chercheurs de sciences sociales. La
recherche appliquée sur les problèmes de non-observance a été retenue comme un des axes prioritaires
qui devraient être pris en compte dans les travaux concernant les stratégies thérapeutiques. Cette ligne
est présente dans les appels d’offres adressés aux laboratoires de sciences sociales depuis 1999. Il est
cependant trop tôt pour évaluer l’apport de cette stimulation volontariste qui, malheureusement, peine
en France à mobiliser sur une durée longue des équipes de recherche.

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
9
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Contextes de la pratique
cites du mauvais patient ou du malade
“récalcitrant”, bien rodée ou lissée dans la
confrontation ancienne à d’autres maladies
comme la tuberculose ou le diabète (6). Éthi-
quement critiquable et critiquée pour ses
conséquences virtuellement discriminantes,
elle a néanmoins l’intérêt de se prêter à des
mises à l’épreuve empiriques, où son aspect
pragmatique peut paraître pertinent. Par
exemple, elle appelle à un inventaire patient
et laborieux des indices qui peuvent laisser
prévoir un patient indocile ou non com-
pliant. Le sexe, l’âge, la personnalité, le reve-
nu, etc., sont ainsi mis en relation avec des
indicateurs de l’observance, opérationnali-
sée comme une quantité ou comme le degré
selon lequel un patient suit un traitement
prescrit. De fait, certaines recherches mon-
trent que la non-observance est plus souvent
associée à un âge jeune, au sexe masculin, à
un statut socio-économique bas, à une
consommation d’alcool ou de drogue, au
stress ou à des tendances dépressives (7).
Mais on relève aussi des résultats non consis-
tants dans d’autres études, voire traduisant
des corrélations opposées (8, 9). Tout cela
commence à prendre sens dès lors qu’on
prend en compte des variables situation-
nelles et contextuelles. Ainsi, on va relever
dans une recherche nord-américaine, contre
des tendances majoritairement relevées dans
les revues de travaux, que les femmes sont
moins observantes que les hommes, man-
quant davantage de doses et de visites. On va
alors redécouvrir, si l’on s’en donne la peine,
que ce comportement statistiquement
déviant n’est pas seulement lié au sexe ou au
genre, mais aussi aux conditions de vie fami-
liale et à des problèmes de garde d’enfant. La
mise en place d’un service d’aide fera miracu-
leusement disparaître l’effet “genre” dans la
variation du comportement, ou plutôt, il res-
tituera la complexité “sociale” de la différence
des sexes dans la régulation des conduites de
soin (10). Le même constat peut être fait dans
les recherches sur l’impact des types de per-
sonnalités sur l’observance. On relève bien
quelques différences interindividuelles fon-
dées sur des traits de personnalité, mais les
relations prévues des traits de personnalités
aux comportements de santé et de maladie
sont peu consistants et varient selon les
études et les outils de mesure (11). Comme le
proposent Moatti et Spire (5), l’approche pré-
dictive s’enferme donc dans une quête de
relations “pseudo-causales unidirection-
nelles” et exclut la possibilité que le même
individu puisse produire des comportements
qui varient en fonction de ses interactions
avec l’environnement et des contextes dans
lesquels il doit réaliser ses actes.
L’insuffisance de la démarche apparaît tout
particulièrement quand on se préoccupe de
la prescription des multithérapies à des
patients catégorisés par des traits de margi-
nalité ou de déviance sociale. C’est le cas,
notamment, des utilisateurs de drogues illi-
cites infectés par le VIH, dont on sait qu’ils
constituent une part très importante de la
population atteinte dans des pays comme la
France. Selon la définition de la déontologie
professionnelle et de la loi, les utilisateurs de
drogue infectés par le VIH relèvent du même
droit aux soins que tout autre groupe, et ce
droit n’est remis en cause par aucun profes-
sionnel de santé. En pratique, pourtant, une
anticipation de non-observance est commu-
nément formulée à l’égard de ces patients ;
l’accès aux trithérapies et à certains traite-
ments longs et difficiles est (était ?) ainsi
généralement plus différé que pour d’autres
groupes. L’analyse empirique de terrain
montre cependant que, passé les étapes
retardées de leur entrée en traitement, les
utilisateurs de drogue peuvent être tout
aussi observants que les autres patients,
comme le montrent les résultats d’une
cohorte suisse (8). Cette même cohorte mon-
trait que les anciens utilisateurs de drogue et
ceux qui recevaient un traitement de substi-
tution étaient plus observants que les toxico-
manes restés actifs. C’est cette volonté de
mettre à l’épreuve les stéréotypes qu’on
retrouve dans la cohorte française MANIF[3].
Les résultats montrent, en effet, que l’éti-
quette “toxicomane” ou utilisateur de
drogue ne renvoie ni à un type spécifique de
comportement de mauvais suivi de traite-
ment, ni à des caractéristiques homogènes
qui définiraient les toxicomanes comme grou-
pe social autonome. La non-observance prend
forme dans un ensemble de facteurs, parmi
lesquels l’âge, la consommation d’alcool, les
événements de vie, l’entrée ou non dans un
programme de substitution jouent un rôle de
détermination très important, sans que leur
effet soit mécaniste (12).
POUR UNE APPROCHE SOCIALE
ET CONTEXTUELLE DE LA NON-OBSERVANCE
Malgré la demande compréhensible des pra-
ticiens de disposer d’outils de contrôle, de
mesure et de prévision des comportements
des patients qu’ils engagent dans un traite-
ment long et incertain, il paraît aujourd’hui
souhaitable de déplacer le souci de contrôle
vers un effort d’analyse et de compréhension
de la genèse et des conditions de modifica-
tion des phénomènes de non-observance.
Cette orientation peut aujourd’hui s’ap-
puyer sur un certain nombre de proposi-
tions :
●L’observance est un phénomène complexe,
qui relève d’une analyse des pratiques
sociales et de l’action. L’observance, c’est
d’abord ce que font des individus en relation
à un certain nombre de normes, de
contraintes et de représentations. Comme
dans le travail qui a été mené sur les
conduites à risque dans le champ de la pré-
vention (13), on doit et on peut s’attaquer
“aux problèmes–symptômes” que sont les
écarts aux prescriptions médicales, en inter-
rogeant et en mettant en relation les diffé-
rents niveaux de la pratique sociale :
– le niveau individuel dans lequel se vit l’expé-
rience de la maladie et se réalisent des actes
qui prennent sens pour la personne (14) ;
– le niveau interindividuel et interactionnel
sur lequel se négocient des attentes et des
demandes entre la personne atteinte et le
médecin, mais aussi entre le malade et les
non-malades dans l’entourage, que le
“patient” perçoit comme des “référents” ou
des “soutiens” importants pour lui ;
– le niveau institutionnel, qui définit des
règles et des interdits dans les organisations
(hôpitaux, administrations, réseau dans
lequel est éventuellement intégré le cabinet
de ville des médecins traitants, associations
de malades) ; le patient doit intégrer ces
règles selon des contrats de communication
qui sont parfois explicites, mais souvent
implicites ;
[3] MANIF (Marseille, Nice, Ile-de-France) est une
cohorte multicentrique initiée en juillet 1995,
et dont les promoteurs sont l’ANRS, l’ECS
SIDACTION et le Conseil général des Bouches-
du-Rhône. Elle a inclus 467 patients VIH, toxico-
manes actifs, ex-usagers de drogue et toxico-
manes suivant un traitement de substitution.

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
10
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Contextes de la pratique
– le niveau sociétal, qui combine les modèles
culturels, scientifiques et idéologiques aux-
quels la personne atteinte s’identifie. C’est à
ce niveau que circulent, se transforment et
se mélangent les représentations sociales,
les croyances des non-médecins, celles des
experts et celles des vulgarisateurs. Ces
croyances, qui se structurent autour de
quelques principes noyaux auxquels les
groupes sociaux sont solidement attachés,
sont largement partagées, et fonctionnent
souvent comme des guides d’action, invi-
sibles pour les professionnels, en général
largement décalées des connaissances et des
recommandations des experts. Ainsi,
pour la toxicité représentée des
médicaments, comme le montrent
certaines enquêtes d’opinion organi-
sées par les “Baromètres-Santé”, on
croira volontiers qu’il est dangereux
de dépasser les doses prescrites, mais
on admettra sans difficulté que dimi-
nuer des doses ne requiert pas l’avis
d’un médecin. Ou bien on trouvera
“normal” d’arrêter un traitement dès
que des symptômes disparaissent et
plutôt anormal de prendre un médi-
cament si l’on ne perçoit aucun symp-
tôme de maladie (15).
Les actes d’observance et de non-
observance sont à la fois des causes
et des résultats. L’intérêt des cohortes qui
intègrent des dispositifs d’évaluation bio-
psycho-sociaux et médicaux, comme la
cohorte APROCO déjà évoquée, est de mon-
trer qu’il est possible de contribuer à un tra-
vail d’élucidation des impacts de variations
comportementales dans le suivi des traite-
ments, tout en cherchant à comprendre
pourquoi et comment certains observent du
mieux qu’ils peuvent les recommandations,
et d’autres non. Ainsi, on a observé
qu’après 4 mois de traitement (M4), les
déclarations de non-observance sont signi-
ficativement associées à un échec virolo-
gique, mais on a également noté que ceux
qui sont en échec avaient initialement des
attitudes négatives ou sceptiques concer-
nant l’efficacité thérapeutique des inhibi-
teurs de protéase (16, 17). Cela illustre et
renforce l’hypothèse selon laquelle les com-
portements de non-observance ne sont pas
nécessairement de simples actes de déso-
béissance, d’oubli, d’incompétence ou d’ir-
responsabilité du malade. Ils peuvent expri-
mer une cohérence entre les croyances et
les pratiques des sujets. De manière provo-
catrice, du reste, certains psychologues de
la santé ont forgé la notion de “non-obser-
vance intelligente” ou de “non-compliance
rationnelle” (18, 19), voulant décrire par là
le fait que les patients peuvent parfois avoir
de bonnes raisons de ne pas se plier aux ins-
tructions qui leur sont données par les
médecins, ce qui pourrait être le cas dans
certaines prises en charge thérapeutiques, y
compris du VIH.
L’observance est un phénomène dynamique
dont la manifestation observée peut être
considérée comme une résultante, mais
aussi comme une étape dans un laps de
temps prolongé qui est celui de l’histoire
des personnes atteintes confrontées à une
offre de soin. C’est un ensemble de com-
portements organisés et construits à travers
des apprentissages sociaux, des événements
et des ajustements à ces événements. Elle
n’est pas formée une fois pour toutes et de
manière définitive pour les personnes
atteintes, de telle sorte qu’on serait fatale-
ment observant ou non observant, comme
blanc ou noir. Ainsi, une analyse des don-
nées de la cohorte APROCO montre une
intéressante variation du premier mois de
traitement au quatrième mois : 9,4 % des
patients sont et restent non observants de
manière consistante, tandis que 61,9 % res-
tent solidement observants. Mais 11,7 %
des sujets, non observants à M1, sont deve-
nus observants à M4, et 17 % des obser-
vants à M1 (17, 20) sont non observants à
M4 (20). Ainsi, les mesures d’observance,
toujours méthodologiquement difficiles à
assurer, mais tout à fait contrôlables dans
les limites de normes professionnelles clai-
rement identifiées[4], ne doivent pas être
utilisées comme des valeurs absolues et
définitives. Ce sont des indicateurs de posi-
tion dans un continuum qui va d’un non-
respect total (très rare) des prescriptions et
du contrat thérapeutique jusqu’à un res-
pect strict, total et permanent. Ces deux
positions extrêmes, sinon extrémistes, sont
relativement peu fréquentes, ce qui renvoie
à une question médicale encore
irrésolue pour les traitements du
sida : si l’on accepte l’idée d’une
échelle d’observance (une sorte
de thermomètre) ancrée sur le
pourcentage de médicaments
effectivement pris par le patient,
“combien” d’observance est-elle
nécessaire au succès thérapeu-
tique ? 100 % ? C’est irréaliste.
Alors, 90 % ? 80 % ? 70 % ? À moins
que la question ne soit : “combien”
de non-observance est-elle nécessaire
à l’échec thérapeutique (5) ?
La non-observance est un phéno-
mène social et multifactoriel. Toute
analyse ou observation qui parvient à
isoler, contrôler et mettre en avant le rôle
d’un facteur (qu’il soit biologique, psycholo-
gique ou sociologique) sans le replacer dans
la globalité d’un processus induit une réduc-
tion illusoire des facteurs explicatifs, sans
portée durable pour une intervention modi-
ficatrice. Il faut cependant, selon nous,
maintenir une logique de recherche de
déterminants selon les techniques d’une
épidémiologie socio-comportementale qui
n’est pas nécessairement réductrice et fer-
mée. Elle peut, en effet, contribuer de
manière irremplaçable à la lutte contre les
idées reçues. Elle peut fournir non seule-
ment des résultats descriptifs validés, mais
aussi des hypothèses d’action, qu’on peut
ensuite mettre à l’épreuve dans une straté-
[4] Cf. l’article de M. Souville dans le prochain
numéro.
© Séverine Zampieri

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
11
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Contextes de la pratique
gie d’essai comparatif. Ainsi, la relative tri-
vialité des données qui ont associé la pau-
vreté aux difficultés de suivi des traitements
a permis d’attirer l’attention sur les facteurs
contextuels que sont les modes et les condi-
tions de vie. Le récent intérêt que l’on accor-
de aux situations de précarité n’est pas
qu’effet de mode ou démagogie paternaliste.
C’est le début de la construction d’outils
d’analyse capables de rendre opérationnel-
lement et conceptuellement plus intelli-
gibles les embarras des praticiens confrontés
dans leurs consultations aux signes non maî-
trisés d’une vulnérabilité sociale, que la gra-
tuité des soins et la performance des médi-
caments ne suffisent pas à contrôler. On
commence donc à pouvoir explorer des ter-
rains d’observation, d’analyse et d’action
qui, pour être d’accès difficile, représentent
actuellement des enjeux essentiels pour la
connaissance et l’intervention contrôlée
dans le champ de l’observance. Les modes et
les conditions de vie sont bien des cadres
déterminants pour l’actualisation des pra-
tiques de santé. Les premières et très rares
recherches pionnières engagées pour décri-
re et évaluer l’observance de patients en
situation de grande précarité ont déjà
ouvert la voie (21, 22). Elles suggèrent que
les traitements complexes de l’infection à
VIH peuvent aujourd’hui être appliqués et
adaptés à des situations sociales de soin par-
ticulièrement difficiles, avec une efficacité
qui peut être satisfaisante si des dispositifs
de soutien spécifiques sont mis en place, qui
prennent en compte davantage les percep-
tions et représentations des personnes
concernées. Elles appellent aussi à un ren-
forcement des approches multiméthodolo-
giques. Celles-ci devraient combiner davan-
tage des essais d’enquêtes randomisées et
des études qualitatives centrées sur la dyna-
mique des représentations et des interac-
tions des personnes atteintes, en relation
avec les différents sites environnementaux
dans lesquels elles sont amenées à vivre avec
leur traitement.
CONCLUSION
Ainsi, à la tentation des approches prédic-
tives, il faut sans doute substituer une
approche relationnelle fondée sur le projet
d’une prise en charge contextualisée selon
l’expérience subjective et sociale des per-
sonnes atteintes et non selon les canons et
règles trop abstraits de l’organisation du tra-
vail médical. J.P. Moatti (5) parle d’une
approche “empathique” pour désigner cette
stratégie d’écoute pragmatique du clinicien
qui tente de se mettre à la place du patient
avant d’ordonner le programme et le suivi
des traitements. Il s’agit, en effet, d’activer,
d’une manière ou d’une autre, un renverse-
ment de perspective dans le débat de la non-
observance. Du point de vue du chercheur et
du clinicien, la non-observance est surtout un
problème technique et médical irritant, un
obstacle et un risque qu’il faut contrôler ou
réduire. Du point de vue de la personne en
traitement, l’observance est une contrainte
de vie avec laquelle il faut composer. Dans le
cadre de la cohorte APROCO, le suivi qualita-
tif par entretiens sociologiques que J. Pierret
réalise en parallèle aux mesures biopsychoso-
ciales périodiques du protocole de la cohorte
montre bien que, du point de vue des
patients de la cohorte, contrairement à ce
que l’on postule souvent, ce n’est pas néces-
sairement la pénibilité ou la complexité phy-
sique ou cognitive de l’absorption des nom-
breux médicaments prescrits qui préoccu-
pent. C’est plutôt la difficulté d’intégrer le
traitement dans la vie quotidienne et les
situations de travail ou familiales. C’est la
gestion d’une identité sociale plus ou moins
vulnérabilisée selon le cadre de vie des per-
sonnes en traitement (23).
L’évolution de perspective que les sciences
sociales de la santé encouragent actuellement
se situe ainsi dans la ligne d’un renforcement
de l’autonomie, de la responsabilité et du
pouvoir des “patients”, dont on voudrait ren-
forcer le rôle d’“acteur” (empowerment). Ce
projet ne vise pas à remplacer une coercition
paternaliste par une démagogie maternaliste
illusoire. Il ne peut s’agir de renoncer au prin-
cipe d’autorité et d’expertise médicale en
déléguant aveuglément aux personnes en
traitement le choix de suivre ou non les
consignes qui leur sont données. Il s’agit sur-
tout de mettre en place des dispositifs d’aide
individualisée et de négociation-évaluation
périodique des traitements, en intégrant
l’idée, largement promue par les associa-
tions, que suivre un traitement, c’est aussi
vivre avec une maladie. Ces orientations
n’ont pas émergé brutalement, et elles pren-
nent place dans la tradition des médecines
dites “centrées sur le patient” (24). Plusieurs
phénomènes spécifiques peuvent renforcer
aujourd’hui ce mouvement :
✔Dans des pays comme la France, de nom-
breux professionnels de santé, formés par
l’expérience du sida aux dimensions sociales
de la maladie, ainsi que des associations de
malades sont engagés dans des recherches et
des actions concernées par l’observance des
traitements du VIH. La plupart témoignent
d’une sensibilité importante aux problèmes
humains et psychologiques posés par les thé-
rapies modernes, qui doivent se gérer en-
dehors du cadre contrôlable du système hos-
pitalier (25).
✔Les sciences sociales disposent maintenant
d’outils et de ressources qui prétendent légi-
timement à une amélioration de l’observan-
ce conciliant des objectifs d’efficacité théra-
peutique et de qualité de vie des patients.
Ces ressources sont nombreuses en ce qui
concerne les outils facilitant l’observance,
qui prennent la forme d’aides à la mémoire
ou d’aides à la résolution de problèmes. Les
plus pertinentes sont articulées dans des
programmes d’éducation à la santé qui
ciblent non seulement le patient lui-même
mais les équipes de soin appelées à interve-
nir dans le suivi du patient. Le suivi de trai-
tements aussi complexes que les multithéra-
pies antirétrovirales ne se réduit pas, en
effet, à la relation centrale médecin-patient.
Il peut mobiliser notamment infirmières,
pharmaciens, travailleurs sociaux et nutri-
tionnistes, et il est essentiel que ces diffé-
rents acteurs soient engagés de manière
cohérente dans le travail de suivi (10).
✔La promotion d’un esprit de conseil et
d’écoute dans les situations difficiles consti-
tue une aide utile dans la mise en place du
traitement et dans la régulation du suivi.
Repenser l’observance dans les moments de
décision, c’est donc introduire la possibilité
de moments de counselling (26, 27, 28). C’est
aussi, par exemple, remplacer une tentation
d’exclusion, rationnellement justifiable,
par un travail préalable d’intervention sur
les conditions de vie jugées nécessaires à un
suivi du traitement (6). C’est encore l’adap-
tation aux problèmes de traitement du
VIH, et de l’expérience acquise avec les
“contrats thérapeutiques” dans la prise en
charge d’autres situations de soin comme
le diabète ou le suivi des transplantations
d’organe (29, 30).■

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
12
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Contextes de la pratique
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Moatti JP, Souville M. L’observance des thé-
rapeutiques antirétrovirales de l’infection à
VIH : 1998 ou l’année de la prise de conscience.
La Lettre de l’Infectiologue 1999 ; XIV : 44-7.
2. Altice FL, Friendland GH. The era of adhe-
rence to HIV therapy. Ann Intern Med 1998 ;
129 : 503-5.
3. Trostle JA. Medical compliance as an ideology.
Soc Sci Med 1998 ; 27, 12 : 1299-308.
4. Giami A. La compliance des patients en
questions. Psychologues et Psychologies 1997 ;
139 : 17-9.
5. Moatti JP, Spire B. Living with HIV/AIDS and
adherence to antiretroviral treatments. In :
Moatti JP, Souteyrand Y, Prieur A, Sandfort T,
Aggleton P (eds.) AIDS in Europe, new chal-
lenges for the social sciences. London :
Routledge, 2000 : 57-73.
6. Lerner BH, Gulick RM, Neveloff ND.
Rethinking non-adherence : historical perspec-
tives on triple-drug therapy for HIV disease.
Ann Intern Med 1998 ; 129 : 573-8.
7. Mehta S, Moore R, Graham MMH. Potential
factors affecting adherence with HIV therapy.
AIDS 1997 ; 11 : 1663-70.
8. Broers B, Morabia A, Hirshel B. A cohort
study of drug users compliance with zidovu-
dine treatment. Arch Intern Med 1994 ; 154 :
1121-7.
9. Singh N et al. Determinants of compliance
with antiretroviral therapy in patients with HIV.
AIDS Care 1996 ; 8, 3 : 261-9.
10. Chesney M, Morin M, Sherr L. Adherence
to HIV combination therapy. Soc Sci Med 2000 ;
50, 11 : 1599-605.
11. Becker MH. Patient adherence to prescri-
bed therapies. Med Care 1985 ; 23 : 539-55.
12. Moatti JP, Carrieri MP, Spire B, Gastaut JA,
Cassuto JP, Moreau J. Adherence to HAART in
French HIV-infected injecting drug users : the
contribution of buprenorphine drug mainte-
nance treatment. AIDS 2000 ; 14 : 151-5.
13. Paicheler G. Understanding risk manage-
ment : towards an integration of individual,
interactive and social levels. In : Moatti JP,
Souteyrand Y, Prieur A, Sandfort T, Aggleton P
(eds.). AIDS in Europe, new challenges for
the social sciences, London : Routledge, 2000 :
247-59.
14. Radley A. Making sense of illness, London :
Sage, 1995.
15. Baudier F, Dressen C, Alias F. Baromètre
Santé 92 : enquête annuelle sur la santé des
Français. Paris, Comité Français d’Éducation
pour la Santé, 1994.
16. Souville M, Leport C, Raffi F, Chene G,
Morin M, Moatti JP, & the ANRS-EP11 APROCO
Study Group. Factors associated with short-
term adherence to protease inhibitors therapy
(PIT) in a French cohort (communication orale).
Biopsychosocial aspects of HIV infection - 4th
International Conference, Ottawa, Canada,
July 15-18 1999.
17. Souville M, Morin M, Leport C, Raffi F,
Cailleton V, Chêne G, Pierret J, Moatti JP, & the
ANRS-EP11 APROCO Study Group. Treatment
perceptions, illness behaviours and non-adhe-
rence in HIV infection : longitudinal study in
the French cohort APROCO (communication
orale). XIIIth European Conference of Health
Psychology Association, Firenze, Italy, 1-3
October 1999.
18. Ley P. Improving patients’ understanding,
recall, satisfaction and compliance. In :
A. Broome (Ed.). Health Psychology. London,
Chapman.
19. Ogden J. Health Psychology. Buckingham,
the Open University Press 1996.
20. Souville M, Morin M. Observance théra-
peutique et VIH/sida : un point rapide sur les
recherches en France. InfoTraitements 1999 ;
64-65 : 4-8.
21. Bangsberg DR, Hecht FM, Charlebois ED,
Zolopa AR, Holodniy M, Sheiner L, Bamberger
JD, Chesney MA, Moss A. Adherence to protea-
se inhibitors, HIV-1 viral load, and development
of drug resistance in an indigent population.
AIDS 2000 ; 14 : 357-66.
22. Lang JM, De Truchis P, Lionard F, Lancrenon
S, Katlama C, Depina T, Croix P, Bideault H.
Observance des traitements dans l’infection à
VIH parmi les populations multivulnérables,
IPPOTHES. Paris, 2000.
23. Pierret J, and the APROCO Group. The qua-
lity of life of HIV-positive persons treated with
a protease inhibitor. Third European
Conference on the Methods and Results of
Social and Behavioral Research on AIDS.
Amsterdam, 13-16 février 2000.
24. Stewart M, Belle Brown J, Weston WW,
McWhinney, McWilliam, Freeman TR. Patient-
centered medicine. London : Sage, 1995.
25. Moulin P, Doré V, Souteyrand Y, Morin M.
Enquête nationale sur les recherches et actions
concernant l’observance des traitements dans
le cadre de l’infection à VIH. Third European
Conference on the Methods and Results of
Social and Behavioral Research on AIDS.
Amsterdam, 13-16 février 2000.
26. Tourrette-Turgis C. Guide du counselling,
infection à VIH et trithérapies. Neuilly-sur-
Seine : Laboratoire Roche, 1997.
27. Tourrette-Turgis C. Études anglo-saxonnes.
Info Traitements 1999 ; 64 : 8-11.
28. Bentz C, Pradier C, Tourette-Turgis M,
Rebillon M, Morin M, Souville M, Moatti JP.
Stratégies d’accompagnement à l’observance
thérapeutique du CHU de Nice. 4eConférence
internationale sur la prise en charge extra-hos-
pitalière et communautaire des personnes
vivant avec le VIH-sida. Paris, 7 décembre 1999.
29. Pucheu S. À l’hôpital : évaluer et accompa-
gner l’observance thérapeutique, Le Journal
des Psychologues 1999 ; 166 : 44-7.
30. Pucheu S. Le contrat thérapeutique avec
les diabétiques : quand observance rime avec
confiance. Réseaux Diabète, mars 2000, 15-17.
Les articles publiés dans “
Le Courrier de l’Observance thérapeutique”
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© octobre 2000 - Da Te Be Éditions - SR Teleperformance Média Santé
Imprimé en France - Differdange S.A. - 95110 Sannois - Dépôt légal 4etrimestre 2000
1
/
5
100%