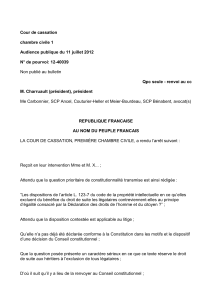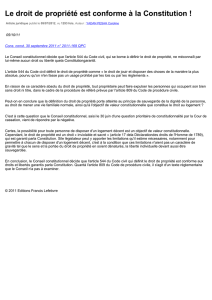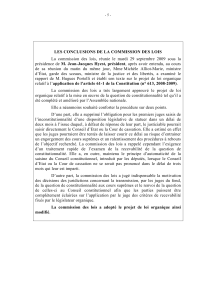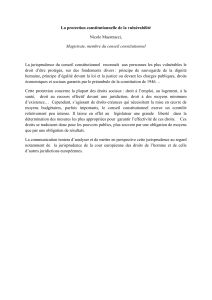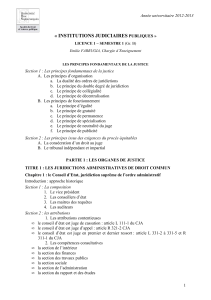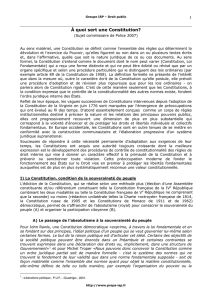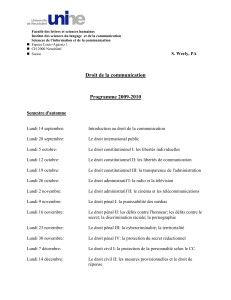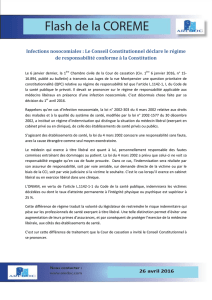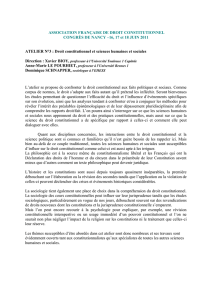FASCICULE DU SEMINAIRE DE DROIT DES

1"
"
THEMES-FASCICULE DU
SEMINAIRE DE DROIT DES
LIBERTES FONDAMENTALES
2015-2016
Justin C. KISSANGOULA

2"
"
SOMMAIRE
1- METHODES DE LECTURE DES DECISIONS JURIDICTIONNELLES
2- LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES LIBERTES FONDAMENTALES : LA QPC
3- LE DROIT A LA VIE
4- LA PROTECTION DU CORPS HUMAIN
5- LE DROIT A LA SANTE : CONSTITUTION ET SANTE
6- LE DROIT A UNE VIE PRIVEE ET FAMILIALE
7- LE DROIT A LA SURÊTE I : LES CONTRÔLES D’IDENTITE
8- LE DROIT A LA SURÊTE II : LA GARDE A VUE (GAV)
9- LE DROIT A LA SURÊTE III : L’HISTOIRE DU DROIT DE L’HOSPITALISATION SANS
CONSENTEMENT
10- LE DROIT A LA SURÊTE IV : L’ETAT D’URGENCE
11- LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR
12- LE DROIT DES ETRANGERS I : LA POLICE DES ETRANGERS
13- LE DROIT DES ETRANGERS II : LE DROIT DES SALARIES SANS PAPIERS
14- LE DROIT DES ETRANGERS III : LES DROITS SOCIAUX DES ETRANGERS
15- LA LIBERTE D’EXPRESSION RELIGIEUSE ET LA LAÏCITE
16- SIGNES VESTIMENTAIRES ET RELIGIEUX
17- LA JURISPRUDENCE SUR LE BURKINI
18- LA LIBERTE D’EXPRESSION ET LES DISCOURS DE HAINE
19- LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
20- LE DROIT A DES ELECTIONS LIBRES
21- LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
22- LA LIBERTE DE REUNION, DE MANIFESTATION ET D’ASSOCIATION
23- LE DROIT A LA MORT
BONNE LECTURE, BON COURAGE ET SURTOUT,
REUSSITE AU BOUT !!!!!!!!!

3"
"
Les outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation
Par Alain Lacabarats, Conseiller à la Cour de cassation, Directeur du service de documentation et d'études
Recueil Dalloz, 2007, p. 889
Un article récent soulignait la « perplexité » que pouvait susciter la première lecture d'un arrêt de la Cour de cassation
(Deumier, RTD civ. 2006. 510). Comment, en effet, apprécier la portée d'une décision dont le contenu se résume, en cas de
cassation au visa des textes applicables, à l'affirmation d'un principe et de ses conséquences juridiques pour l'affaire
considérée, en cas de rejet à un bref exposé des faits suivi d'une réfutation souvent lapidaire des moyens de cassation ?
La question de l'importance juridique d'un arrêt de la Cour de cassation n'est pas dénuée d'intérêt dans un système qui produit
chaque année plus de 20 000 décisions. Si, pour les parties, la solution donnée à leur litige est l'essentiel, en revanche toutes
ces décisions ne présentent pas, pour la communauté des juristes, la même valeur doctrinale. La perplexité évoquée est en
outre parfaitement compréhensible, au regard de la surinformation résultant du développement des bases de données
informatiques. Celles-ci, par la diffusion uniforme de toutes les décisions de la Cour de cassation, perturbent les messages
jurisprudentiels et se montrent « réfractaires à (leur) hiérarchisation » (Canivet et Molfessis, La politique jurisprudentielle,
Mélanges en l'honneur de J. Boré, Dalloz, 2007, p. 95).
L'analyse explicative et critique de la jurisprudence incombe au premier chef à la doctrine universitaire dont l'une des
missions consiste en « l'élaboration d'une vision synthétique et ordonnée de l'ordre juridique qui permette d'en comprendre
les mécanismes fondamentaux et les finalités » (Aubert, Introduction au droit, Armand Colin, n° 182).
Encore faut-il, pour la réalisation de cet objectif, que les données analysées soient dépourvues d'ambiguïté. Or, l'examen des
notes de jurisprudence montre qu'un décryptage des décisions est parfois nécessaire (Libchaber, Autopsie d'une position
jurisprudentielle nouvellement établie, RTD civ. 2002. 604) et que le style des arrêts de la Cour de cassation est de nature à
provoquer des incertitudes ou erreurs d'interprétation, tout au moins pour ceux qui ont oublié ou ignorent la technique du
pourvoi en cassation et les limites assignées à l'office du juge de cassation.
Au-delà d'un enseignement dédié à l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation préconisé par certains auteurs (Ghestin,
L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation, D. 2004. Chron. 2239) et du rappel des spécificités de cette technique, si
déroutante pour les non initiés, de prise de décision (Weber, La portée des arrêts de cassation, Les Annonces de la Seine, 3
avr. 2006 ; Bénabent, Doctrine ou Dallas, D. 2005. Point de vue. 852), la Cour de cassation cherche à contribuer elle-même à
une meilleur compréhension de la portée normative de ses décisions, soit par des éléments extrinsèques (I), soit par les
mentions de ses décisions (II).
I - Depuis plusieurs années, la Cour de cassation a développé une politique de « promotion » de ses arrêts (Libchaber, op.
cit., p. 605) sous différentes formes :
- Outre les publications traditionnelles faites aux Bulletins civil et criminel, la Cour publie, sur son site internet, les arrêts
qu'elle juge particulièrement importants, soit au regard de la question de droit posée, soit en raison de leur impact pour
l'opinion publique, cette publication étant fréquemment accompagnée de divers éléments d'information de nature à éclairer la
portée des décisions : le rapport du conseiller rapporteur, qui contient l'ensemble des données de droit nécessaires à la
solution du pourvoi ; l'avis de l'avocat général.
- La Cour recourt aussi de plus en plus fréquemment à la publication, sur le site internet et au Bulletin d'information de la
Cour de cassation (BICC), de communiqués destinés à situer l'arrêt commenté dans un ensemble jurisprudentiel et à en
préciser les conséquences (Deumier, Les communiqués de la Cour de cassation : d'une source d'information à une source
d'interprétation, RTD civ. 2006. 510 ; voir, à titre d'exemple, le communiqué sous un arrêt de la Chambre commerciale du 3
oct. 2006, paru au BICC du 1er févr. 2007, n° 81, qui souligne que cet arrêt « résout diverses questions de principe liées au
recouvrement des impôts »).
- La Cour publie également un Bulletin trimestriel de droit du travail qui comporte des commentaires, rédigés par les
membres de la cellule sociale du service de documentation et d'études, des arrêts rendus par la Chambre sociale.
- Enfin le rapport annuel comporte une sélection des décisions saillantes rendues au cours de l'année écoulée, sous forme de
notices de présentation rappelant généralement la question posée, les éventuels précédents et l'apport de ces décisions au droit
positif.
II - Indépendamment de ces éléments d'information extrinsèques, qui ne sont pas systématiques, et des affaires orientées en
non-admission en application de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire pour irrecevabilité manifeste ou

4"
"
absence de moyen sérieux de cassation, l'analyste ne doit pas négliger les mentions portées sur les arrêts eux-mêmes car il
peut y trouver, soit par la formation qui a rendu la décision, soit par l'étendue de la diffusion décidée par la Cour, des clés
d'appréciation de leur degré d'intérêt juridique.
Il est certain que les arrêts prononcés en Assemblée plénière de Cour ou en Chambre mixte sont ceux qui « contribuent le
plus à l'édification de la jurisprudence » et sont appelés, quel qu'en soit l'objet, « à un grand retentissement » (Droit et
pratique de la cassation en matière civile, Litec, n° 653), dès lors qu'ils ont pour finalité de résoudre des questions juridiques
de principe ou controversées.
Mais, il ne faut pas oublier la hiérarchie des formations des Chambres de la Cour, dont les arrêts précisent, en leur première
page, s'ils ont été délibéré en formation plénière de chambre (FP), en formation de section (FS) ou en formation restreinte (F),
selon un degré décroissant de complexité ou d'importance de l'affaire, la dernière formation étant réservée aux pourvois dont
la solution s'impose de manière évidente.
La question d'une éventuelle publication de l'arrêt et de l'étendue de celle-ci est appréciée par la formation qui prononce
l'arrêt, à l'issue de son délibéré (Droit et pratique de la procédure civile, Litec, n° 819).
Cette question pourrait apparaître surprenante à l'époque de la diffusion quasi-généralisée de la jurisprudence par les bases de
données. En réalité, le développement des systèmes informatiques de diffusion du droit lui a redonné une importance toute
particulière compte tenu de la nécessité de discriminer, dans la masse d'informations disponibles, celles qui contribuent
utilement à l'élaboration du droit.
La décision de publication est prise en fonction de l'intérêt normatif de la décision, cet intérêt étant notamment attaché :
- à la décision qui précise la portée d'une règle de droit ;
- à celle qui amorce ou consacre une jurisprudence nouvelle ;
- à celle qui infléchit ou modifie une solution ancienne ;
- à celle qui rappelle des principes acquis, afin qu'ils ne soient pas perdus de vue ou pour montrer l'attachement de la Cour à
des solutions controversées (sur ces critères de publications : Perdriau, Les publications de la Cour de cassation, Gaz. Pal., 1-
4 janv. 2003, p. 2).
La décision de publication se traduit par la mention sur la première page de l'arrêt de la lettre P. L'arrêt est alors publié au
Bulletin civil ou criminel, avec un sommaire rédigé par un magistrat de la Chambre et un titrage élaboré par le service de
documentation et d'études qui permet d'insérer la décision dans la nomenclature des arrêts de la Cour. Pour en faciliter
l'exploitation, le service de documentation et d'études y ajoute, s'il y a lieu, des rapprochements avec des arrêts antérieurs.
Les arrêts publiés au Bulletin sont aussi mentionnés au BICC (lettre B) avec, en principe, les seuls titres et sommaires (sauf
pour les décisions de l'Assemblée plénière et de la Chambre mixte ou pour les demandes d'avis, publiées intégralement avec
les travaux préparatoires), pour être portés le plus rapidement possible à la connaissance de l'ensemble des magistrats et des
abonnés.
Les arrêts P+B peuvent également être assortis de la lettre R, ce qui signifie qu'ils sont destinés à être mentionnés dans la
partie du Rapport annuel retraçant les principaux arrêts de la période passée, selon les modalités déjà indiquées.
Enfin l'arrêt P+B+R est parfois diffusé sur le site internet de la Cour de cassation (lettre I), lorsque cette décision est attendue
du public ou des médias et est susceptible d'attirer leur attention. Il convient de souligner que les arrêts de l'Assemblée
plénière et des Chambres mixtes, de même que les avis de la Cour, y sont systématiquement publiés.
S'il existe ainsi une gradation des publications, il ne faudrait pas croire pour autant que les arrêts non publiés restent « secrets
». Assortis de la lettre D, ils font au contraire l'objet d'une large diffusion puisqu'ils sont mis à la disposition des abonnés du
fonds de concours de la Cour de cassation et alimentent le site internet Legifrance, celui-ci ouvrant au public l'accès à
l'ensemble des arrêts de la Cour rendus depuis 1990, outre les arrêts publiés aux bulletins depuis 1960.
Les modalités de rédaction des arrêts de la Cour de cassation font l'objet de critiques anciennes et réitérées (Touffait et Tunc,
Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTD civ. 1974. 487
; Gjidara, La motivation des décisions de justice : impératifs anciens et exigences nouvelles, LPA, 26 mai 2004, p. 20),
critiques fondées en particulier sur la nécessité d'expliciter davantage les principes posés et les justifications des choix opérés
par la Cour.
En réalité, la concision des arrêts de la Cour de cassation est liée essentiellement à sa mission de contrôle juridique des

5"
"
décisions attaquées, excluant une nouvelle appréciation des faits du litige.
Si la remise en cause de cette technique n'apparaît pas à l'ordre du jour des projets de la Cour, sa volonté de mieux faire
connaître la jurisprudence ressort manifestement des moyens mis en oeuvre pour en assurer la compréhension.
Mais, comme l'a écrit Monsieur Lesueur de Givry (La diffusion de la jurisprudence, mission de service public, Rapport
annuel 2003 de la Cour de cassation, p. 280 ), il faut élaborer une « doctrine du bon emploi de l'abondance ».
A cet égard, la consécration de la diffusion de la jurisprudence comme mission de service public par le décret du 7 août 2002
a certes permis à tous les citoyens intéressés de consulter gratuitement la jurisprudence, notamment celle de la Cour de
cassation, mais sans fournir toutes les clés de lecture de ses arrêts, les seules indications extrinsèques communiquées au
public étant, en l'état, la mention d'une éventuelle publication au bulletin, les titres et sommaires de l'arrêt, lorsqu'il est publié,
et les textes cités.
La prévisibilité et l'accessibilité du droit étant l'une des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne de droits de l'homme, le mouvement de clarification
entrepris doit nécessairement poursuivre ses effets.
LA HIERARCHISATION DES ARRËTS DE LA COUR DE CASSATION (P. B. R. I.)
Les mentions « P.B.R.I » permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Elles définissent la nature de la
publication, qui est décidée par les magistrats de la chambre à l’issue du délibéré.
« P » désigne, selon le cas, les arrêts publiés au Bulletin des arrêts des chambres civiles ou au Bulletin des arrêts de la
chambre criminelle.
« B » désigne les arrêts publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC).
« R » désigne les arrêts analysés au rapport annuel de la Cour de cassation.
« I » désigne les arrêts diffusés sur le site internet de la Cour de cassation.
Ces différents supports de publications peuvent se combiner, un arrêt pouvant être qualifié, par exemple, « P+B »,
« P+B+R » ou encore « P+B+R+I », selon l’importance que la chambre lui accorde.
Les arrêts « D » font l’objet d’une diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le site
intranet de la Cour (non public). Ils sont également accessibles via le site Legifrance.gouv. fr sous la mention « inédits ».
Selon la complexité des pourvois, les formations des chambres diffèrent. Elles sont signalées par les lettres :
• FP : formation plénière de chambre,
• FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres),
• F ou FR : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
1
/
241
100%