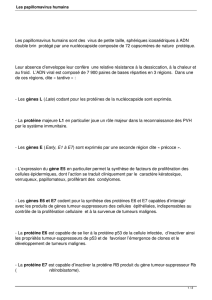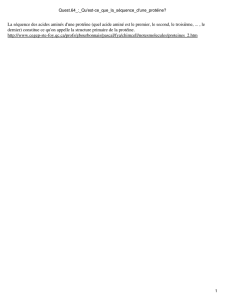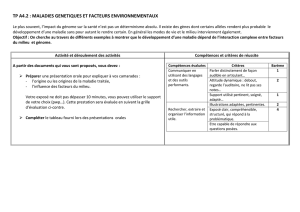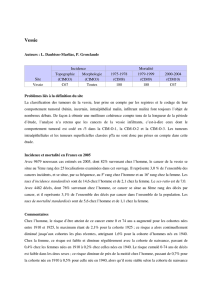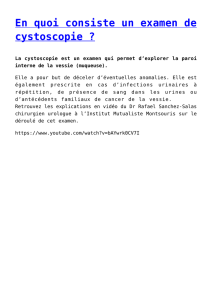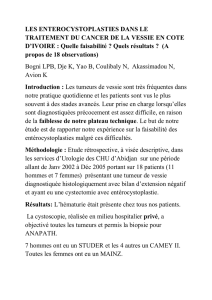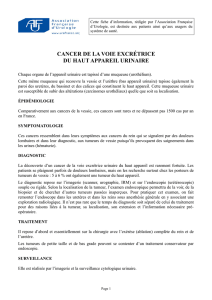Marqueurs moléculaires du cancer infiltrant de la vessie

1057
Malgré les progrès dans les techniques chirurgicales et
l’avènement de protocoles de chimiothérapie systémique
démontrant une efficacité réelle, près de la moitié des
patients traités pour cancer infiltrant de la vessie meurent
de leur cancer souvent en quelques années seulement. Les
paramètres cliniques existants ne permettent pas d’identi-
fier avec assurance les patients qui ont été guéris par une
c h i r u rgie radicale de ceux qui pourraient bénéficier de trai-
tement adjuvant. De la même manière il n’existe aucun
moyen de prédire la réponse à la radiothérapie ou à la chi-
miothérapie néoadjuvante ou adjuvante sur la base des
seuls critères pathologiques. Il y a donc un besoin réel de
méthodes plus sophistiquées qui permettent de mieux éva-
luer le potentiel biologique de tumeurs individuelles afin
d’ajuster le traitement le plus approprié pour un patient
d o n n é .
Les progrès dans notre compréhension des mécanismes
moléculaires impliqués dans la cancérogenèse offrent des
opportunités réelles de caractériser les cancers à un niveau
moléculaire, par delà l’aspect histologique. Les progrès
technologiques permettent également des analyses extrê-
mement sophistiquées et à haut débit à partir d’échantillons
cliniques rendant ainsi possible le rêve d’obtenir une signa-
ture moléculaire qui puisse identifier des cancers en appa-
rence semblables à l’histologie mais distincts dans leur évo-
lution clinique. L’objectif du présent chapitre est de revoir
les progrès qui ont été faits dans l’analyse moléculaire des
tumeurs vésicales, de déterminer l’état actuel de leur utilité
clinique et de tracer des jalons qui nous croyons permet-
tront de mener à l’élaboration de tests cliniquement utiles
qui pourront guider la prise en charge des patients atteints
de cancer infiltrant de la vessie. Le succès de cette approche
doit passer impérativement par une concertation clinique et
une synergie étroite entre les spécialistes des laboratoires,
les médecins cliniciens traitants et les experts en bio-statis-
tique. Nous espérons donc que cette revue et perspective
saura susciter l’intérêt des cliniciens.
La définition d’un marqueur tumoral est un paramètre
moléculaire sur le tissu tumoral ou dans les liquides bio-
logiques tels que le sang ou l’urine et qui puisse avoir une
utilité clinique diagnostique ou pronostique de l’évolution
de la maladie.
L’étude de marqueurs tumoraux du cancer vésical a débu-
té il y a un peu plus de vingt ans par l’analyse de l’ex-
pression des antigènes du groupe sanguin à l’aide d’une
méthode d’adhérence de globules rouges de types san-
guins différents sur les coupes tumorales. Dans les années
80, l’utilisation de la technique des hybridomes pour pro-
duire des anticorps monoclonaux spécifiques a donné lieu
à l’identification d’une gamme d’antigènes nouveaux qui
ont été testés pour leur valeur diagnostique ou pronos-
tique. Plusieurs de ces antigènes ont été par la suite recon-
nus comme des épitopes de groupes sanguins et ont donné
des réactifs plus pratiques pour l’analyse histologique.
D’autres antigènes du type mucine ou récepteur de surfa-
ce ont été utilisés pour des tests diagnostiques du cancer
vésical [26, 87]. La technique des anticorps monoclonaux
a également permis d’identifier un marqueur pronostique
du cancer infiltrant de la vessie, le T138, mais son utilité
a été limitée par le fait que l’antigène ne peut être détecté
que sur des coupes de tissu congelé [27, 113].
La découverte des oncogènes, également au début des
années 80, a suscité beaucoup d’enthousiasme et l’espoir
d’avoir enfin identifié la cause moléculaire du cancer.
Bien que le premier oncogène décrit, l’oncogène H-ras,
ait été d’abord étudié dans une lignée de cancer de la ves-
sie, aucune utilité pronostique dans les cancers infiltrants
n’a pu à ce jour être montrée. La recherche sur les onco-
gènes a permis d’identifier un ensemble de systèmes de
signalisation intracellulaire en réponse à des récepteurs de
surface et de mieux comprendre la complexité des méca-
nismes régissant l’interaction entre la cellule cancéreuse
et son environnement.
II. BREF HISTORIQUE
I. INTRODUCTION
CHAPITRE VI.
Marqueurs moléculaires du cancer infiltrant
de la vessie
JÉRÔME RIGAUD1, RABI TIGUERT2, YVES FRADET2
1 Clinique Urologique, CHU de Nantes, France
2 Centre de recherche L’Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec, Canada
Progrès en Urologie (2002), 12, N°5, 1057-1083

En parallèle, les recherches en cytogénétique avaient
identifié des pertes chromosomiques fréquentes dans les
tumeurs solides et notamment les cancers de la vessie.
L’arrivée de techniques moléculaires permettant d’étudier
les délétions génétiques sur des échantillons tumoraux par
comparaison aux cellules normales du même individu a
propulsé la recherche de gènes suppresseurs des tumeurs
au tout premier plan. Plutôt que l’acquisition ou la surex-
pression d’oncogènes, la perte de l’activité de gènes sup-
presseurs de la réplication cellulaire est devenue l’hypo-
thèse primordiale de la cause des cancers, en particulier,
les cancers solides dont celui de la vessie. Cette recherche
a donné lieu à l’identification successive de gènes impli-
qués dans différentes étapes du contrôle de la division cel-
lulaire qui au fur et à mesure de leur découverte ont été à
tour de rôle évalués pour leur potentiel prédictif de la pro-
gression des cancers vésicaux. Les recherches molécu-
laires ont également identifié un ensemble de systèmes
responsables de l’adhésion intercellulaire et de l’interac-
tion entre la cellule cancéreuse et la matrice extracellulai-
re qui sont modulés par l’état cancéreux et fournissent
d’autres marqueurs tumoraux potentiels. L’hypothèse que
les cellules tumorales survivent en stimulant la formation
de nouveaux vaisseaux pour les nourrir a donné lieu à une
intense recherche sur les facteurs d’angiogenèse et les fac-
teurs inhibiteurs de cette angiogenèse. Ce domaine de
recherche extrêmement prolifique a permis d’identifier
encore une autre avenue complexe qui puisse fournir des
marqueurs pronostiques et également des avenues théra-
peutiques. À cette enseigne l’analyse de marqueurs type
cyclooxygenase (Cox-1 et 2) pourra éventuellement servir
les mêmes fins.
Le tableau 1 résume très simplement l’ensemble des types
de marqueurs tissulaires et des marqueurs sanguins qui
ont été étudiés dans le cancer de la vessie et que nous
reverrons brièvement dans ce chapitre. De loin, les plus
étudiés sont les marqueurs du cycle cellulaire et leur
contrepartie dans la mort cellulaire. Il devient évident que
le comportement individuel des tumeurs est la résultante
d’un ensemble de systèmes complexes. Les méthodes
modernes de génomique et protéomique nous font miroi-
ter la possibilité de vraiment déterminer la signature
moléculaire des cellules cancéreuses en intégrant l’en-
semble de cette information. Ces possibilités ainsi que les
limites des études faites jusqu’à maintenant doivent sti-
muler une coordination des cliniciens pour la réalisation
de banques tissulaires importantes obtenues dans un cadre
de traitement clinique assez uniformisé et avec une
rigueur dans le suivi clinique. La technique de “tissue-
arrays” ou puce tissulaire va permettre l’étude à haut débit
de milliers d’échantillons avec les marqueurs ou gammes
de marqueurs jugés les plus prometteurs.
Tableau 1: Liste des différents marqueurs tumoraux tissulaires
et sanguins analysés dans le cancer infiltrant de la vessie
MARQUEURS TISSULAIRES
Cycle Cellulaire
p53
Cycline E
p21
p27
Rétinoblastome (Rb)
Murine double minute 2 (mdm2)
Apoptose
Bcl-2/bax
Fas/Fas Ligand
Prolifération cellulaire
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA)
Ki-67
Facteurs de croissance
Récepteur à l’Epidermal growth factor (EGF-R)
Epidermal growth factor (EGF)
Transforming growth factor alpha (TGF-α)
Transforming growth factor beta (TGF-ß)
Angiogénèse
Densité des micro-vaisseaux (DMV)
Basic fibroblast growth factor (bFGF)
Vascular endothelial growth factor (VEGF)
Thrombospondine-1
Adhésion cellulaire et matrice extra-cellulaire
E-Cadhérine
Intégrine
Matrice métalloprotéinase (MMP)
Cyclooxygénase
Cox-1
Cox-2
MARQUEURS SANGUINS
Protéines sériques
Laminine
Fas Ligand
Transforming growth factor beta (TGF-ß)
Cytokératine 18
E-Cadhérine soluble
Cellules circulantes par RT-PCR des gènes
Cytokératine 20
Uroplakine II
Récepteur à l’Epidermal growth factor (EGF-R)
1058

Quelques études récentes suggèrent également que la
détection de certaines protéines dans le sérum et surtout la
détection de cellules cancéreuses circulantes en utilisant
les techniques de biologie moléculaire pourraient devenir
un marqueur pronostique extrêmement utile pour évaluer
les patients ayant une maladie microscopique résiduelle et
voire même monitorer la réponse au traitement de chi-
miothérapie.
Le cancer se définit par une prolifération incontrôlée de
cellules qui dans leur anarchie deviennent de plus en plus
envahissantes au point de détruire l’équilibre cellulaire de
l’hôte et éventuellement entraîner sa mort. Ce comporte-
ment des cellules cancéreuses est le résultat d’une instabi-
lité génétique qui entraîne l’expression non coordonnée
d’un nombre de gènes impliqués dans la reproduction cel-
lulaire et dans l’interaction de cette cellule avec les autres
cellules ou le tissu environnant. Ainsi, la cellule cancé-
reuse a perdu à des degrés divers la capacité de répondre
aux facteurs inhibiteurs qui normalement règlent le taux
de prolifération et le degré de différenciation des cellules.
La compréhension des mécanismes qui contrôlent la
reproduction cellulaire et des anomalies caractérisant
l’état cancéreux a donc fait l’objet de recherches intenses
qui ont permis de lever le voile sur un ensemble de sen-
tiers moléculaires extrêmement complexes qui n’étaient
pas suspectés il y a à peine une décennie.
Les premières observations sont d’abord venues par
l’identification de la protéine p53 à l’aide d’anticorps
polyclonaux et monoclonaux. Au tout début les chercheurs
croyaient que la surexpression de cette protéine était le fait
d’un oncogène hyper-activé. Cependant, les recherches
ultérieures ont déterminé que cette surexpression protéique
était due à des mutations du gène p53 entraînant la pro-
duction d’une protéine anormale à demi-vie plus longue.
La protéine p53 a été rapidement identifiée comme un élé-
ment clé dans les perturbations cancéreuses et a été même
appelée “le gardien du génome”. À l’état normal, cette
protéine semble avoir la capacité d’induire l’arrêt du cycle
cellulaire en cas de dommages de l’ADN. En parallèle, les
recherches sur le rétinoblastome ont identifié un autre gène
suppresseur appelé Rb qui s’est aussi avéré au centre du
contrôle du cycle cellulaire. Les recherches sur les gènes
suppresseurs ont permis d’identifier un ensemble d’autres
protéines inhibitrices dénommées par leur taille moléculai-
re, p15, p16, p27, p21 et p19. L’ensemble de ces protéines
inhibe des kinases dépendantes des cyclines (CDK4,
CDK6 et CDK2) qui lorsque liées aux cyclines (cycline D,
cycline E ou cycline A) activent ces dernières. Ces pro-
téines jouent donc le rôle de frein à différents niveaux du
cycle cellulaire (Figure 1).
La figure 2 démontre schématiquement les différentes
phases du cycle cellulaire. La phase G1 qui représente la
phase de repos après la division peut être activée par le
facteur E2F. Ce facteur est libéré lorsque la protéine Rb
(rétinoblastome) est phosphorylée par l’action de la cycli-
ne D complexée à la kinase CDK4 ou CDK6. La cycline
D est activée directement par des facteurs mitogènes qui
stimulent la cellule à se diviser. Ces facteurs mitogènes
proviennent de l’environnement et peuvent représenter
différents facteurs de croissance ou d’autres types de
signaux intercellulaires. Les protéines p15 et p16 peuvent
inhiber l’activation de la cycline D et réprimer la stimula-
tion mitogénique.
Lorsque la cellule est stimulée par le facteur E2F elle
passe un point de restriction et stimule la cycline E à
enclencher la synthèse d’ADN qui mènera au doublement
des chromosomes en phase G2 et à la mitose en phase M.
La cycline A agit un peu plus loin dans la phase de syn-
thèse pour entretenir ce cycle. La cycline E et la cycline A
sont chacune inhibées par la protéine p27 et la protéine
p 2 1 . Cette dernière est stimulée par la protéine p53
lorsque cette protéine est activée soit par un dommage
dans l’ADN ou encore par un oncogène appelé MDM2. À
l’état normal donc la cellule ne sera stimulée à la division
que par des mitogènes et la cycline E ne sera activée
qu’après la mise en route du cycle cellulaire par le gène
Rb. Cependant, les cellules cancéreuses deviennent indé-
pendantes des facteurs de croissance extracellulaires et on
croit que ceci est dû à l’activation spontanée de la cycline
E et/ou cycline A directement ou par perte d’inhibition
par les protéines p27 ou p21. Le gène p53, lorsque activé
par un bris de l’ADN, va enclencher les gènes de l’apop-
tose ou de la mort cellulaire qui est un phénomène de
contrôle naturel dans l’équilibre des cellules.
Devant cette complexité du mécanisme de régulation de la
division cellulaire il est clair que des anomalies à plu-
III. CYCLE CELLULAIRE
Il y a donc eu des progrès énormes au cours des vingt
dernières années qui ont été guidés principalement
par l’avènement de nouvelles techniques perfor-
mantes. Bien que les recherches jusqu’à maintenant
ont permis d’accumuler une quantité importante
d’information sur les molécules exprimées dans les
cancers infiltrants de la vessie, elles ont permis de
réaliser également l’importance d’études cliniques
impliquant un très grand nombre de patients très
bien caractérisés et les besoins urgents de collabora-
tions multicentriques. Cet élément sera le fer de
lance de tout progrès ultérieur au-delà des avancées
technologiques.
1059

1060
Figue 1: Schéma des protéines régulatrices du cycle de division cellulaire
(→stimule, inhibe, Rb: Rétinoblastome, Cyc: Cycline, CDK: Kinase dépendante des cyclines, TGFβ: Transforming growth fac -
tor β, MDM2: Murine double minute 2)
Figure 2: Implication des différentes cyclines dans le cycle cellulaire
(→stimule, inhibe, Rb: Rétinoblastome)

sieurs niveaux peuvent entraîner une prolifération anor-
male. Il est aussi évident qu’une anomalie à un endroit de
la chaîne peut entraîner une surexpression compensatrice
à d’autres niveaux selon une logique de cybernétique cel-
lulaire. Le cancer infiltrant de la vessie qui est générale-
ment de haut grade est constitué de cellules dont l’insta-
bilité génétique est extrême puisqu’elles sont fréquem-
ment monstrueuses, aneuploïdes et très malignes. Il
devient donc plus difficile d’identifier les anomalies
moléculaires qui sont à l’origine de ce comportement plu-
tôt que le résultat de cette anarchie. Les études faites jus-
qu’à maintenant ont porté sur un ou quelques marqueurs
moléculaires individuels. Il n’est pas surprenant devant
cette complexité que ces études n’aient pas donné de
résultats probants. Par contre, les avancées technolo-
giques plus récentes vont permettre d’évaluer en même
temps la perturbation de l’ensemble de ces mécanismes
moléculaires de façon à obtenir une image plus représen-
tative de l’état de cette cellule. On peut donc espérer que
ces signatures moléculaires seront des outils plus puis-
sants pour distinguer des cellules au comportement biolo-
gique différent. Les études portant sur un ou plusieurs des
marqueurs du cycle cellulaire nous permettent néanmoins
d’identifier les marqueurs les plus souvent anormaux dans
le cancer infiltrant de la vessie.
1. P53
La valeur prédictive de l’expression de la protéine p53 sur
l’évolution du cancer de la vessie a fait l’objet de très
nombreux travaux aux résultats parfois contradictoires
(Tableau 2). Plusieurs éléments peuvent expliquer ces dif-
férences. La protéine p53 détectée en immunohistochimie
est une protéine mutée plus stable et ayant une demi-vie
plus longue que la protéine “sauvage”. Cependant toutes
les mutations n’aboutissent pas à une stabilisation de la
protéine. Par exemple, les mutations non-sens se tradui-
ront souvent par une absence de la protéine, sachant aussi
que toutes les mutations de la protéine p53 ne sont pas
détectables par cette technique et par le même anticorps
[40]. Lors des études immunohistochimiques, le marqua-
ge positif de la protéine p53 est le témoin le plus souvent
d’une protéine mutée donc inactive, mais la protéine p53
peut aussi être non détectée lors d’étude immunohistolo-
gique (donc à priori normale) mais être en fait inactive car
elle a perdu ses capacités fonctionnelles. Enfin la protéine
p53 peut aussi être détectable dû à une sur-expression
normale en réponse à des interactions des autres protéines
du cycle cellulaire [105]. Il existe aussi des variations des
protocoles d’immunohistochimie entre les équipes: utili-
sation de tissu fixé dans du formol ou du liquide de Bouin
voire de tissu congelé, type d’anticorps différents pour la
réaction, démasquage ou non des antigènes à l’aide d’un
four micro-ondes, seuil de positivité du marquage diffé-
rent [3]. Le Bladder Cancer Marker Network, a réalisé
une étude sur la variabilité de l’expression de la protéine
p53 par immunohistochimie entre différents laboratoires.
La concordance a été très forte pour les cas franchement
positifs ou négatifs, par contre il a existé une zone grise
entre 1 % et 20 % où la variabilité inter-laboratoires a été
très importante (Figure 3) [84]. Ces différences dans les
cas frontières peuvent aussi expliquer les discordances
entre les différentes études. Cependant les analyses immu-
nohistochimiques restent tout de même hautement sen-
sibles et spécifiques bien qu’un besoin de standardisation
soit nécessaire afin de comparer les résultats des diffé-
rentes études [120].
Schmitz-Dräger [120] a réalisé une revue de la littérature
reprenant 138 études, comprenant 3764 patients, ayant
analysé la valeur pronostique de la protéine p53 par étude
immunohistochimique dans le cancer de la vessie. La sur-
expression de la protéine p53 a été notée dans 36 % des
cas en moyenne (3 à 78 %) dans le cancer superficiel, et
dans 29 à 77 % des cas dans le cancer infiltrant.
Cependant, il y a un grand nombre de variations entre les
différentes séries en ce qui concerne l’anticorps utilisé
(les clones DO-7 et PAb 1801 étant les plus utilisés) ou la
valeur seuil de positivité de la réaction (Tableau 2). Dans
la majorité des études incluant tous les stades du cancer de
la vessie, la sur-expression de la protéine p53 semble être
corrélée au stade pathologique et/ou au grade histologique
[22, 36, 49, 75, 76, 93, 104, 140].
1061
Figure 3 : Variabilité du résultat immunohistochimique de
l’expression de la protéine p53 réalisée par 5 différents labo -
ratoires du Bladder Cancer Marker Network sur 50 tumeurs
(10 de chaque institution). Pour chaque tumeur, 2 lames ont
été envoyées à chaque laboratoire pour une coloration et une
lecture puis elles ont été randomisées parmi les laboratoires
pour une seconde lecture. Le pourcentage de concordance
entre les deux lectures a été rapporté en fonction de l’expres -
sion de la protéine p53 (reproduit avec la permission de
l’American Association for Cancer Research) [84].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%