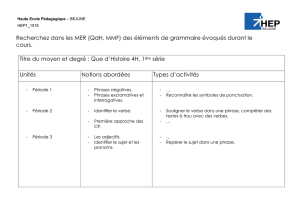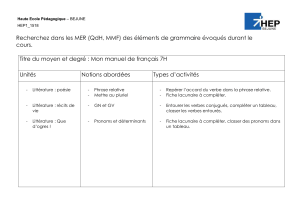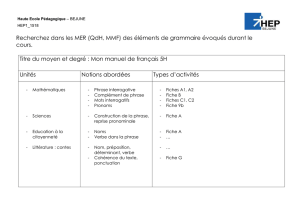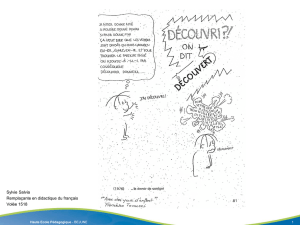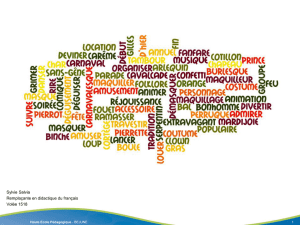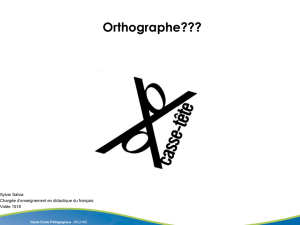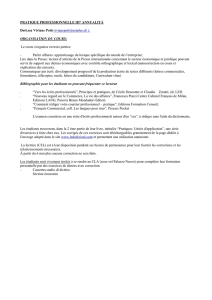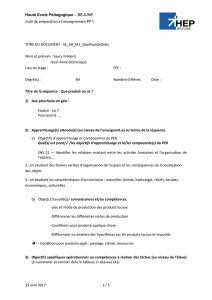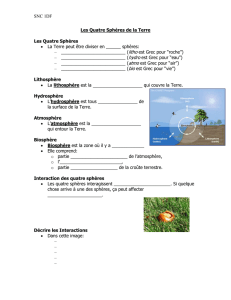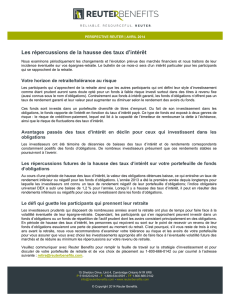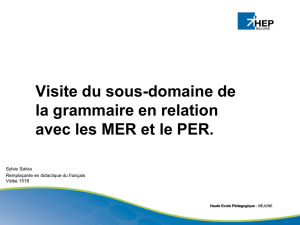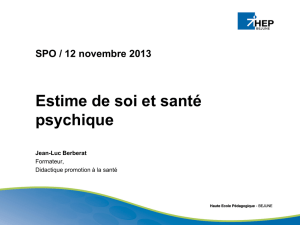Rxx - HEP

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Volée 1518
Yves Reuter : les mondes de l'écrit
"La culture de l'écrit pour aider à penser, pas juste pour normer !"
Yves Reuter s'intéresse au phénomène d'enseignement-apprentissage à partir
des contenus à enseigner. "Je n'ai ni vérité ni conseils à donner, à chacun de
s'emparer des travaux des chercheurs en fonction de ce qu'ils y trouvent". Les
chercheurs servent à construire, reconstruire, explorer des possibles en
cherchant les intérêts et les limites...
"Faire en sorte que les portes des univers de l'écrit s'ouvrent le plus possible
au maximum d'élèves" : c'est le titre qu'il a voulu donner à son intervention. Il
cherche ainsi à s'éloigner des titres polysémiques : "qu'est-ce que la maîtrise
de la langue, la lecture, l'écriture ?". Il brocarde même les formules chères au
GFEN, comme "prendre du pouvoir sur l'écrit", au nom du fait, justement, de la
difficulté à poser des définitions précises sur un concept aussi complexe...
"L'Histoire nous montre que l'écrit peut être autant un outil de pouvoir sur le
peuple qu'un outil au service de la démocratie...". Il met en garde sur le risque
de leurre, lorsqu'on est sur des objectifs trop vagues.
Comment désigner l'ensemble de contenus auxquels on cherche à faire
référence ? Le mot "littéracie", qu'on peut traduire en français comme
"culture écrite", porte la trace d'une différence fondamentale entre l'oral et
l'écrit, comme l'a montré Goody. Entrer dans la culture écrite, c'est changer
de manière de penser, de mettre à distance, avec des impacts sur les
organisations sociales, comme l'est l'ordre juridique ou l'ordre scolaire. Fixer les
énoncés, c'est pouvoir prendre sur eux une distance analytique.
Mais dans une société, les différents sphères sociales utilisent l'écrit de
manières différentes. Ces "univers de l'écrit" sont parfois composés d'objets
très
différents : livres, magazines, inventaires... Les pratiques qu'ils développent
sont définies par des conditions d'exercice : n'importe qui n'accède pas à
chaque type d'écrit. Contrairement à ce que pensent les cognitivistes, on ne
lit pas de la même manière selon les finalités qu'on donne à la lecture
examens, loisirs, travail... D'autre part, les écrits existent dans leurs relations, et
peuvent être plus ou moins présents, selon les époques et les usages. Enfin,
quelles que soient les cultures, la connaissance est toujours imparfaite, à
poursuivre : ce n'est pas parce que l'écrit offre des possibilités que les gens
s'en emparent.
Les univers étant multiples. "Comme le montrent les sociolinguistes, on se
retrouve en insécurité lorsqu'on change de registre. Un grand lecteur
d'Heidegger peut être en difficulté pour remplir un constat ou un manuel
d'objet technologique" s'amuse Yves Reuter.
Quelles incidences dans les rapports entre écrit et école ?
Ce qui est visé à l'école est d'entrer dans des cultures de l'écrits, pas
seulement des techniques ou des codes. Il faut donc "faire comprendre" les
composantes structurelles de l'écrit, à partir d'opérations fondamentales :
fixer, abstraire le flux des discours des interactions verbales, rendre visible ce

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Volée 1518
qui est masqué dans l'oral. Ces spécificités vont déplacer des objets
fondamentaux, et c'est ce qui permet de penser différemment, et donc
conserver à l'identique, accumuler, reproduire, analyser avec le temps du
contrôle, en manipulant les unités, les variations formelles...
L'école ne peut donc viser l'apprentissage et la maitrise de toute la culture
écrite pour tous. C'est ce qui explique l'existence de filières, de voies de
formation différentes. L'école ne peut pas viser directement l'apprentissage et
la maîtrise des différentes sphères de l'écrit, parce que la société différencie
la famille, l'école et les milieux professionnels. On n'apprend plus "sur le tas",
mais on apprend certaines choses avant d'entrer dans les sphères
professionnelles. L'Ecole cherche donc à travailler dans un "univers de l'écrit"
spécifique, l'appropriation des cultures écrites scolaires. Il ne s'agit pas
d'apprendre à lire, mais apprendre à lire certaines choses dans
certaines situations, grâce à des formes pédagogiques. Selon les
pédagogies, les univers de l'écrit sont différents, au sein même d'une
institution qui influence les choix des contenus et la forme des pratiques.
Quelles conséquences pour la classe ?
La conséquence majeure est que si des difficultés sont en difficulté, ils ne le
sont pas face à la lecture "en général", mais face aux univers scolaires. Cette
différence exclut tout déterminisme, et redonne toute sa place à l'école,
pourvu qu'on luindonne les moyens de fonctionner, et ouvre plusieurs pistes
d'intervention. Certaines élèves peuvent "sembler en difficulté", mais ne le
sont pas : ils s'ajustent au fonctionnement qu'ils rencontrent. A l'extrême, on
pourrait voir des élèves lisant correctement avant d'entrer au CP se remettre
à anonner lorsqu'ils pensent que "c'est comme ça qu'on lit à l'école".
La première piste d'intervention concerne la hiérarchisation des contenus :
"on privilégie à l'heure actuelle les codes, les techniques et les normes, au
détriment du cadre même dans lequel ils prennent sens. Si le cadre d'accueil
n'est pas construit, à quoi servent les techniques ?"
Ce qui caractérise les relations entre les contenus du "français", c'est le
morcellement, là où il faut installer de la "conscience disciplinaire". Lorsque les
enfants disent "on a fait un contrôle" sans savoir "un contrôle de quoi ?", on
perçoit comment les élèves reconstruisent,ou non, les disciplines. Pour les
élèves, on fait "la lecture", "l'orthographe", "la conjugaison", "la poésie", "la
grammaire", tout ça sans articulation. Rien ne fonctionne en interaction. Il y a
certes quelques explications à aller chercher dans les outils et les pratiques.
Pour Reuter, il n'est pas rare de voir des cahiers et des classeurs qui en portent
la trace, dans leur grande diversité.
Plus généralement, la part de l'écrit dans les disciplines peut être pensée
comme secondaire, comme si une grande part des savoirs n'étaient pas des
savoirs langagiers. Pour une bonne partie des élèves, les matières scientifiques
rendent la place de l'écrit second.
Il est donc intéressant de réfléchir sur les moyens d'acquérir la culture écrite et
ses outils. Il semble donc nécessaire au didacticien de mettre en place des
situations moins opaques, où on sache davantage ce qui est en jeu. Quand

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Volée 1518
on décortique les textes littéraires, quel est l'enjeu ? L'extrait de texte,
l'ouvrage, l'auteur ? S'agit-il de développer des connaissances, des "rapports
à..." ou des procédés d'analyse ?
Nombre d'élèves ne comprennent pas que la dissertation ne sert pas à
exprimer son opinion. Jean-François Haltet parlait déjà dans les années 80
des "malentendus" communicationnels dans la rédaction : contrairement à
ce que pense l'élève, le prof ne s'intéresse pas à ses vacances ou à sa
dernière sortie, mais à la manière dont c'est exprimé dans la copie... Lorsque
l'élève s'en rend compte, ça peut être violent... On demande à l'élève
d'habiter des univers auxquels il n'a pas participé : on lui donne, et il faut qu'il
rentrer dedans. Pourtant, n'importe qui a besoin d'être aidé à entrer dans un
nouvel univers.
On peut discuter de l'intérêt des dictées, mais globalement, un élève peut
faire des dictées toute sa scolarité en ayant la même note sans rien savoir de
ce sur quoi on a progressé, ni où sont les difficultés. "Lorsqu'on donne à lire des
documents tellement aseptisés que les élèves pensent que Rabelais peut être
ennuyeux, peut-être est-il nécessaire de réfléchir à des univers plus sollicitants,
comme l'est la culture de l'écrit, en ouvrant à la prise de distance, à la
confrontation des points de vue". Ainsi, les élèves sont persuadés qu'il n'y a
qu'une norme orthographique, alors qu'on sait que la variabilité de l'écrit est
grande. "Si je pense qu'il faut passer par des normes, il ne faut pas s'opposer à
la prise en compte du réel. Cela ne veut pas dire renoncer à enseigner
l'orthographe, mais les mettre dans une autre position par rapport à cet
enseignement."
L'intérêt de la culture de l'écrit est de penser en terme de problème qu'on va
chercher à résoudre. Derrière le terme qui est devenu tarte à la crème, force
est de constater que l'enseignement des normes est largement dominant.
Que fait-on de la culture des élèves au sein de la culture scolaire ? Est-ce un
handicap ou une ressource ? "Là encore, selon les types de pédagogies que
je vois fonctionner, les clivages sont forts : quand les élèves disent "à quoi ça
me sert d'apprendre ça ?", la question est souvent digne".
Quel expérience réelle leur permettent de réaliser que l'exercice de la
citoyenneté ou du pouvoir de l'écrit ne sont pas renvoyées à plus tard, mais
liées à des actions qu'on mène ici et maintenant, même si cela doit être
progressif et autoriser les cheminements différenciés, sauf à se rassurer
derrière la fiction d'une appropriation commune.
"C'est donc autour des fonctionnements institutionnels scolaires qu'on peut
faire reculer le côté menaçant de l'écrit, qui a un rôle central dans les
évaluations, dans le contrôle social. Quand on reçoit des mots de l'école, à
travers les bulletins scolaires, mieux vaut être familier de l'école..."
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2011/GFENAid2009Reuter.aspx
1
/
3
100%