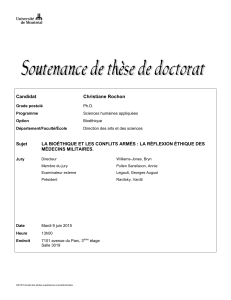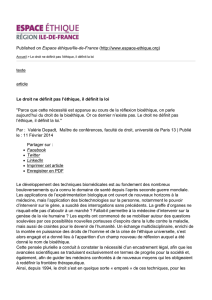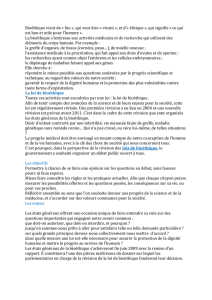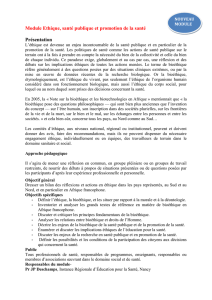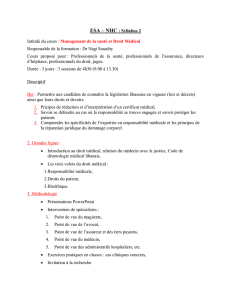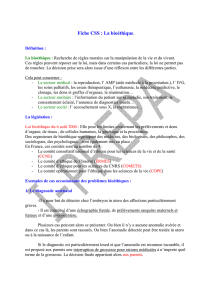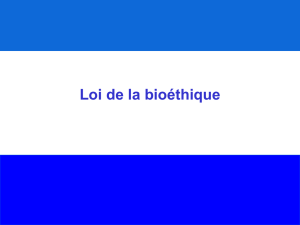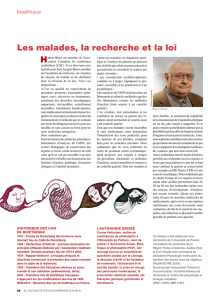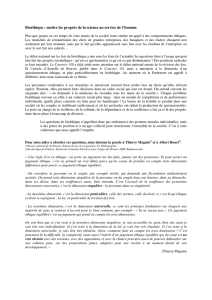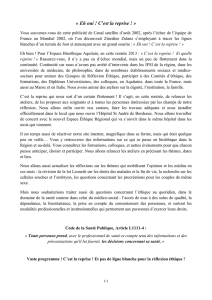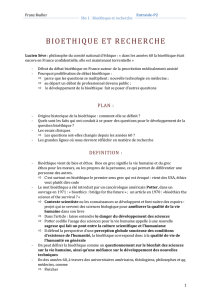Article pour la revue Éthique publique

20 février 2006
1
Les discours religieux dans l’espace public de la bioéthique
1
Introduction
L’insertion des discours religieux dans l’(es) espace(s) public(s) des sociétés modernes
tardives est une question résolument complexe, c’est un truisme de l’affirmer. Après une
période où, en raison d’une affiliation à des théories strictes de la sécularisation, il était
virtuellement impensable de se pencher sur ces enjeux, on constate maintenant un tournant
dans la production intellectuelle, laquelle cherche à penser les modalités d’insertion de
discours religieux dans la vie publique des sociétés plurielles, démocratiques et
sécularisées
2
. L’éloignement de la période des théologies de la mort de Dieu instaure peut-
être un climat plus serein pour penser ces enjeux
3
; à moins que ce ne soit la résurgence des
fondamentalismes religieux, venant toucher le cœur même des sociétés occidentales, qui
rend cette réflexion urgente.
S’il est vrai que la séparation de l’État et des Églises résulte, en Occident, d’un lent
processus de différenciation amorcé dès l’Antiquité
4
, la séparation juridico-politique
occidentale entre la religion et le politique n’entraîne pas automatiquement le divorce entre
la religion et la culture. De manière plus précise, certains secteurs de la vie des sociétés de
la modernité tardive peuvent être traversés par des enjeux religieux substantiels ou, à un
niveau formel, par des enjeux épistémiques rendus manifestes, par exemple, par la
réflexion sur le rôle que peuvent jouer les discours religieux dans des débats publics
5
. C’est
ainsi que, dans les dernières années, des théologien(ne)s contemporain(e)s, venant tout
aussi bien des États-Unis que de la francophonie, ont proposé de penser le rôle des discours
religieux en bioéthique.
Je veux dans cet article analyser ces contributions théologiques en montrant qu’elles
présupposent que l’espace de discussion que constitue la bioéthique est un espace public.
Plusieurs questions se posent ici en regard de la problématique que je viens d’esquisser.
Peut-on considérer que les discussions bioéthiques se déroulent dans un espace que l’on
peut qualifier de public ? Cette analyse permet-elle de dégager les conditions auxquelles
1
La recherche et la rédaction de cet article ont été rendues possibles par une subvention du CRSH. Je
remercie mon assistant, Samuel Lajoie, pour le travail réalisé.
2
Quelques auteurs parlent de post-sécularité pour rendre compte de ce tournant : Habermas, Peter Berger.
3
Harvey G. Cox, The Secular City. Secularization and Urbanization in Theological Perspective, New York,
Macmillna, 1965, 276 p.; Gabriel Vahanian, The Death of God. The Culture of our post-Christian Era, New
York, G. Braziller, 1967, 253 p.
4
Julien Bauer, Politique et religion, Paris, Presses universitaires de France, (coll. Que sais-je ?, 3467), 1999,
p. 13-39.
5
Par discours religieux, j’entends tout discours qui s’appuie sur des références provenant d’une tradition
religieuse. Il existe plusieurs types de discours selon la réflexivité qui les structurent. Les discours les plus
proches de l’expérience communautaire de foi (ceux des croyants qua croyants) seront ici nommés discours
croyants. Les discours prenant une distance réflexive par rapport à l’expérience de foi seront nommés
discours magistériels lorsqu’ils émaneront d’une instance régulatrice doctrinale interne à une Église (comme
le magistère catholique, les évêques ou les membres d’une hiérarchie ecclésiastique). Les discours
théologiques, quant à eux, participent d’une réflexivité en regard de l’expérience croyante et émanent de
lieux non liés aux instances régulatrices doctrinales internes. Ce sont, par exemple, les discours de
théologiens universitaires se prononçant sur des enjeux de la vie ecclésiale ou de la vie sociale plus large.

20 février 2006
2
les discours religieux peuvent (doivent ?) se soumettre pour entrer de plain-pied dans ces
discussions ? Que disent ces discours sur la possibilité (ou non) des discours religieux dans
l’espace public bioéthique et, en cas positif, sur les justifications et les modalités d’insertion
? Ces quelques questions reposent sur l’hypothèse qu’un modèle d’articulation entre
religion et raison publique est à l’œuvre dans le champ de la bioéthique occidentale. C’est
ce que je tenterai de cerner dans cet article.
1. Courte problématique
Gilbert Hottois définit ainsi la bioéthique. Elle « couvre un ensemble de recherches, de
discours et de pratiques, généralement pluridisciplinaires et pluralistes, ayant pour objet de
clarifier et, si possible, de résoudre des questions à portée éthique suscitées par la R&D
[sic] biomédicale et biotechnologique au sein de sociétés caractérisées à des degrés divers
comme étant individualistes, multiculturelles et évolutives
6
». La définition de Hottois
pourrait être complétée en mentionnant que ces enjeux éthiques sont suscités par l’irruption
de la technoscience dans le domaine du soin et dans celui de la définition des buts et
objectifs des systèmes de santé et de leur administration.
Ce projet bioéthique, qui a émergé en Occident depuis quarante ans, fait fonds sur quelques
caractéristiques principales qui font consensus parmi ses analystes
7
. J’en retiens trois qui
se rapportent directement à mon propos. Premièrement, la bioéthique est séculière, ce qui
implique une mise à distance de tout fondement religieux de la pensée bioéthique, et ce en
vue d’une coopération en vue de la résolution de problèmes. Née dans le monde de la
sécularisation occidentale, la bioéthique est tributaire du climat intellectuel et épistémique
de son temps. Si, au départ, c’est le processus de sécularisation occidentale qui justifiait la
sécularité de la bioéthique
8
, maintenant c’est la pluralité idéologique et morale qui devient
l’argument fort en sa faveur. La sécularité de la discipline aurait donc comme conséquence
de clore a priori l’accès des discours religieux aux délibérations, ce qui aurait comme
inconvénient, selon les critiques, de formaliser (ou procéduraliser) la bioéthique et, par
conséquent, de ne pas honorer les traditions morales exhibant des contenus substantiels
9
.
Une telle interprétation restrictive serait jugée par trop abusive si l’on tient compte d’autres
caractéristiques du projet bioéthique occidental.
Le second caractère que je retiens, celui de l’interdisciplinarité, ouvre la porte à l’insertion
potentielle des discours réflexifs en bioéthique. Par l’interdisciplinarité on désigne le fait
que plusieurs disciplines du savoir sont convoquées à la réflexion bioéthique (philosophie,
droit, anthropologie, théologie, sciences biomédicales, psychologie, etc.). Se penchant sur
6
Gilbert Hottois, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004, p. 22.
7
Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, Montréal, Fides, 1999, p. 114-120; Hubert Doucet, Au
pays de la bioéthique, Genève, Labor et Fides, 1996, p. 48-59; David Roy et al, La bioéthique, ses fondements
et ses controverses, Montréal, ERPI, 1995, p.28-63; Kevin Wm Wildes, « Religion in Bioethics : A Rebirth
», Christian Bioethics, vol. 8, n° 2, 2002, p. 163-174. Je suis ici la présentation que fait Durand de ces
caractéristiques.
8
Carla Messikomer, Renée Fox, Judith Swazey, « The Presence and Influence of Religion in American
Bioethics », Perspectives in Biology and Medicine, vol. 44, n° 4, 2001, p. 492-493.
9
H. Tristam Engelhardt Jr, The Foundations of Christian Bioethics, Lisse NL, Swets & Zeitlinger Publishers,
2000, p. 5 et p. 75ss. L’auteur poursuit sa critique en indiquant qu’il n’y a pas une, mais bien une pluralité
d’éthiques séculières.

20 février 2006
3
les pratiques du soin, de la recherche biomédicale et de la santé publique, la réflexion
bioéthique ne peut faire l’économie de perspectives qui peuvent contribuer à une meilleure
compréhension des enjeux éthiques soulevés par la scientifisation et la technologisation
qui marque le prendre-soin en Occident. À ce titre, les discours religieux réflexifs (et leurs
énonciateurs) peuvent entrer dans les débats et discussions.
Enfin, le troisième caractère de la bioéthique – la globalité
10
– souligne que les dimensions
pertinentes de la vie individuelle et collective, et non seulement celles relevant de l’aspect
médical du soin ou de la recherche, soient intégrées dans une démarche délibérative
concrète pour une situation particulière ou, encore, dans une discussion pratique entre
disciplines au sein de comités.
Il s’ensuit que, de la tension inhérente et constitutive du projet bioéthique, s’instaure un
espace potentiel d’insertion des discours religieux en bioéthique. Cette insertion peut se
faire à deux niveaux. À un premier niveau, la théologie peut participer, en tant que
discipline réflexive, aux discussions sur les enjeux épistémologiques du projet bioéthique
– qui ont cours dans les milieux académiques de la bioéthique – alors que, à un second
niveau, formulé sous la guise du discours croyant, le discours religieux peut être intégré
dans un processus de délibération sur une situation particulière. À ce titre, il faut remarquer
que ledit espace ne serait pas celui d’une bioéthique confessionnelle, mais plutôt d’une
bioéthique ouverte à l’apport des discours religieux
11
.
2. La bioéthique comme espace public ?
Peut-on analyser le projet et les institutions de la bioéthique occidentale à partir du concept
d’espace public ? Pour ce faire, il faut qu’on y retrouve les caractéristiques de ce que l’on
désigne par le concept d’espace public. Pour ma part, je définit, de manière minimale,
l’espace public comme un espace non étatique, non-marchand et méta-communautaire
structuré selon deux lignes de force : la première est celle de la rationalité
communicationnelle; la seconde est celle de la reconnaissance. Cette définition
préliminaire appelle quelques précisions
12
. Je les ferai en me référant aux travaux du
10
La globalité implique que la bioéthique s’intéresse à la personne entière et à la personne insérée dans des
réseaux de relations de proximité (famille, milieu de vie) ou de relations impersonnelles (institution, travail,
structures sociales). Cette caractéristique de la globalité cherche à contrer les tendances de
« compartimentalisation » d’un patient (ou d’un sujet de recherche) à partir des spécialités médicales et à
prendre en compte que le patient est aussi un citoyen. En somme une approche globale considère à la fois la
personne comme un tout et comme insérée dans un ensemble de réseaux relationnels.
11
Depuis quelques années des propositions qui se présentent sous la guise d’une réflexion bioéthique
chrétienne émergent tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Il faut questionner cette appellation qui, on le
constate, néglige la dimension intrinsèquement séculière du projet bioéthique. C’est pourquoi il faut réserver
le mot bioéthique, et c’est ce que je ferai ici, au projet séculier, non confessionnel. Pour des exemples de
discours « bioéthique » chrétien voir la revue Christian Bioethics; Engelhardt, op. cit.; Elio Sgreccia, Manuel
de bioéthique. Les fondements de l’éthique biomédicale, Paris, Edifa, 2004, 868 p.; voir également les
discours magistériels récents sur les enjeux bioéthiques, notamment ceux émanant de l’Académie Pontificale
pour la Vie.
12
Cette définition diffère de celle de Ch. Taylor pour qui la sphère publique est un espace où « la société en
arrive à un esprit commun (a common mind), hors de la médiation de la sphère politique et par un discours
rationnel situé hors du pouvoir, mais qui n’en est pas moins normatif pour le pouvoir » (ma traduction),
Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, Durham, Duke University Press, 2004, p. 91. C’est au chapitre

20 février 2006
4
philosophe Jürgen Habermas et de la politologue Nancy Fraser sur le concept d’espace
public.
Les travaux de Habermas sur l’espace public des sociétés occidentales montrent l’évolution
du concept et de son institutionnalisation. De l’espace public bourgeois constitué
d’hommes lettrés ayant une certaine indépendance financière réunis en associations ou en
clubs étudié au début de sa carrière
13
, Habermas discute maintenant des espaces publics
spécialisés, lesquels reflètent la plurivocité constitutive de la société civile dans les
démocraties contemporaines
14
. Dès la fin des années 1980, Nancy Fraser critiquait une
forme de paralogisme chez Habermas qui, selon elle, faisait de la description de l’espace
public bourgeois de la « modernité inaugurale
15
» une norme pour sa conceptualisation de
l’éthique de la discussion
16
. Elle vise notamment la conception rationaliste de la publicité
qui masque, à son insu, des intérêts de domination économique et sexuelle
17
. Fraser
propose alors de repenser l’espace public sur le mode de la pluralité en pointant vers le fait
qu’il existe des « contre-publics subalternes
18
», c’est-à-dire des espaces alternatifs
constitués par les groupes exclus de l’espace public bourgeois. Fraser les décrits selon les
caractéristiques suivantes : 1) ce sont des espaces de repli et de regroupement; 2) qui
constituent un terrain d’essai pour des activités dirigées vers d’éventuels publics plus
larges. Ces traits contradictoires sont paradoxalement émancipateurs si, selon Fraser, on
les fait jouer selon un rapport dialectique
19
. Ce qui importe pour mon propos est que la
critique de Fraser ouvre la porte à une conception de l’espace public non homogène et non
homogénéisant.
Habermas, qui connaît les travaux de Fraser, semble répondre à cette critique en proposant
le concept d’espace public spécialisé
20
.
Disons d’abord que l’espace public – au sens générique – est conçu par Habermas comme
un réseau communicationnel (p. 387) qui fait le pont entre le complexe monde vécu/société
civile et le système politique. Lieu de prise de parole à partir de « la pratique quotidienne
de la communication (…) à la portée de tous
21
» (p. 387), l’espace public incarne trois
de la reconnaissance, qui (de manière surprenante pour ses lecteurs assidus) n’est pas abordée par Taylor,
que nos définitions diffèrent.
13
Jürgen Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société
bourgeoise, Paris, Payot, 1978, 324 p. La version originale allemande est parue en 1962.
14
Jürgen Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, p. 386-414.
L’expression « espaces publics spécialisés » apparaît à la p. 391.
15
J’emprunte l’expression à Jacques Beauchemin, La société des identités. Éthique et politique dans le monde
contemporain, Montréal, Athéna éditions, 2004, p. 41.
16
Nancy Fraser, « Repenser l’espace public : une contribution à la critique de la démocratie réellement
existante », dans E. Renault, Y. Sintomer (dirs), Où en est la théorie critique ?, Paris, Éditions La Découverte,
2003, p. 103-134.
17
Fraser, op. cit., p 112.
18
Fraser, op. cit., p. 118-123.
19
Fraser, op. cit., p.120.
20
Je me réfère ici à Habermas, Droit et démocratie. Il s’agit de la section III du chapitre 8 intitulée « Le rôle
de la société civile et de l’espace public politique ».
21
C’est Habermas qui souligne. Ce que Habermas désigne par cette expression ne sont pas d’abord les
moyens de diffusion de l’information. Il identifie plutôt la capacité de toute personne d’argumenter lors d’une
discussion. L’espace public n’est pas d’abord définit par les médiations techniques que sont les mass medias;

20 février 2006
5
fonctions : 1) identifier les problèmes concrets, vécus par les individus et les collectivités,
qui ne peuvent être réglés que par le système politique; 2) amorcer une thématisation de
ces problèmes par une explicitation argumentée et collective de leurs tenants et
aboutissants; 3) exercer un contrôle vigilant du traitement de ces problèmes par le système
politique (p. 386-387). Ces fonctions génériques supposent que l’espace public repose sur
une forme communicationnelle de rationalité, c’est-à-dire que l’identification, la
thématisation et la vigilance quant au traitement politique des problèmes se réalise par le
médium du langage et selon les canons de l’éthique de la discussion
22
.
Habermas va plus loin dans sa conception en précisant que cet espace public est composé
d’espaces publics spécialisés. C’est en quelque sorte sa réponse à la critique de Nancy
Fraser. Tout en conservant les caractéristiques génériques de l’espace public, un espace
public généralisé a une visée partielle. La spécialisation de l’espace public réfère à la
thématisation de problèmes spécifiques vécus par des segments de la société civile
23
. S’il
est vrai que les problèmes thématisés par la discussion publique sont « les reflets d’une
pression exercée par la souffrance sociale se traduisant dans le miroir des expériences
personnelles de la vie » (p. 392) – ces expériences résultant de « l’assimilation privée des
problèmes sociaux qui ont une résonance biographique » (p. 393) –, alors les espaces public
spécialisés peuvent être compris comme ceux qui sont constitués par une similitude des
problèmes évoqués. Un espace public spécialisé résulte donc du rassemblement de
personnes concernées, du point de vue de leur biographies respectives passées (mais aussi
à venir…), par un enjeu social particulier.
La spécialisation peut alors prendre la forme d’une subdivision interne de l’espace public
générique, opérée à partir d’un critère intimement lié à un problème particulier. Il ne s’agit
pas d’une communautarisation de l’espace public pour autant. N. Fraser indique bien que
la publicité n’est pas la communauté; que la publicité peut être le lieu « où se forment et
s’expriment les identités sociales
24
». En effet, si la communauté suppose une forme de
il s’agit bien d’un « lieu » d’usage public de la raison, lieu où les médias peuvent jouer un rôle d’adjuvant
dans la diffusion des informations. Ils ne pourront jamais épuiser, à eux seuls, ce qu’est l’espace public.
22
Sur la normativité du langage et sur les caractéristiques de l’éthique de la discussion, on consultera avec
profit Jürgen Habermas, De l’éthique de la discussion, Paris, Flammarion, 1992; voir également Yves Cusset,
Habermas. L’espoir de la discussion, Paris, Michalon, 2001, 123 p. On pourrait s’étonner de l’absence
d’instance de décision dans la définition fonctionnelle que présente Habermas. S’agit-il réellement d’un
espace public si le politique et les institutions qui l’incarnent (dans ce cas-ci les institutions démocratiques)
n’y sont pas inclus ? En fait, l’espace public dont Habermas discute est celui qui est lié aux institutions de
pouvoir, mais qui ne s’y réduit pas. L’espace public est le lieu où, par l’usage public de la raison, sont mis à
l’épreuve des différents arguments qui sous-tendent les normes, ces dernières étant ensuite l’objet d’une
décision politique d’application. Pour Habermas, l’espace public est fortement lié à ce que l’on nomme
aujourd’hui la société civile et qui ne s’identifie ni au marché, ni à l’État. Il s’agit du lieu de formation de
l’opinion publique avant d’être un espace de décision, voire d’application d’une décision.
23
Habermas définit la société civile comme « formé[e] par ces groupements et ces associations non étatiques
et non économiques à base bénévole qui rattachent les structures communicationnelles de l’espace public à
la composante « société » du monde vécu (…) [D]e tels tissus associatifs (…) forment tout de même le
substrat organisationnel de ce public général, pour ainsi dire issu de la sphère privée, constitué de citoyens
qui cherchent à donner des interprétations publiques à leurs expériences et à leurs intérêts sociaux et qui
exercent une influence sur la formation institutionnalisées de l’opinion et de la volonté », Droit et démocratie,
p. 394.
24
Fraser, op. cit., p. 121.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%