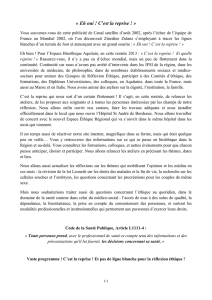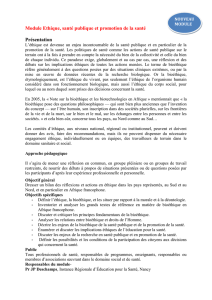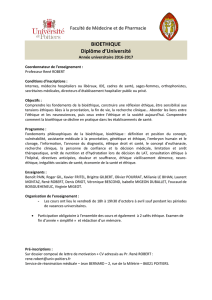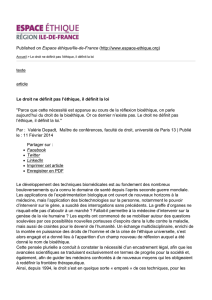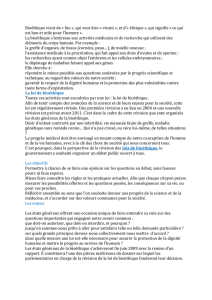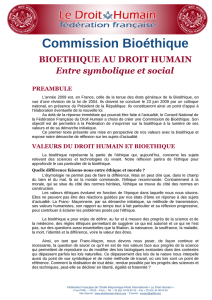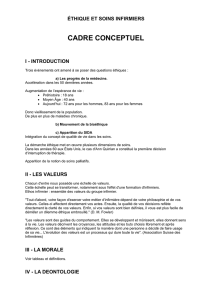Bioéthique : mettre les progrès de la science au service de l`homme

Bioéthique : mettre les progrès de la science au service de l’homme
Plus que jamais en ces temps de crise monte de la société toute entière un appel à des comportements éthiques.
Les modalités de rémunération des chefs de grandes entreprises, des banquiers et des traders choquent non
seulement par leur montant, mais par le fait qu’elles apparaissent sans lien avec les résultats de l’entreprise ou
avec le sort fait aux salariés…
Le débat national sur les lois de bioéthique a mis sous les feux de l’actualité les questions liées à l’usage qui peut
être fait des progrès scientifiques : qu’est-ce qui humanise et qu’est-ce qui déshumanise ? Des positions radicales
se font entendre. Le Courrier 150 a déjà attiré notre attention sur le débat national autour de la révision des lois.
Et l’article d’Armelle de Bouvet, publié dans le Courrier 151 nous a introduits à la démarche d’un
questionnement éthique, et plus particulièrement en bioéthique. Au moment où le Parlement est appelé à
délibérer, nous nous saisissons de ce thème.
Les personnes confrontées à ces situations se retrouvent souvent bien seules face au choix qu’elles doivent
opérer. Pourtant, elles prennent leurs décisions dans un cadre social qui leur est donné. On entend souvent les
soignants dire : « on demande à la médecine de résoudre tous les maux de la société ». Chaque problème
bioéthique renvoie en effet à un contexte social plus large : dans un monde de compétition et de performance
individuelle, quelle place concrète est faite pour les handicapés ? La baisse de la fertilité se produit dans une
société où les couples se stabilisent tardivement et où les pesticides ont réduit la production de spermatozoïdes.
La prise en charge de la vieillesse, de la solitude, de la dépendance et de la souffrance a fait ça et là des progrès,
mais laisse place à beaucoup de désarroi…
Les questions de bioéthique n’appellent donc pas seulement à des postures morales individuelles, mais
à des prises de position et à un agir collectif pour transformer l’ensemble de la société. C’est à cette
cohérence que nous appelle l’enquête.
Pour nous aider à aborder ces questions, nous laissons la parole à Thierry Magnin
1)
et à Albert Rouet
2)
.
1)Vicaire général de St Etienne. Extrait de La vie en question. Cf. bibliographie
2)Archevêque de Poitiers. Extrait de l’émission Parole à notre évêque du 20 mars 2009, Radioaccords.
« Une règle d’or en éthique : on porte un jugement sur des faits, jamais sur des personnes. Et pour porter un
jugement éthique, c’est en général un vrai débat parce qu’on essaie de prendre en compte trois dimensions
différentes pour porter ce jugement éthique équilibré.
- On considère la personne ou le couple, par exemple stérile, qui demande une fécondation médicalement
assistée. On prend cette dimension singulière de la personne ou du couple dans son histoire, dans sa démarche,
dans ses désirs, dans ses souffrances aussi, bien entendu. C’est l’accueil de la souffrance des personnes
directement concernées, c’est la dimension singulière : la personne dans sa singularité.
- La deuxième dimension, c’est la dimension particulière, celle des normes, celle du droit, et c’est là qu’éthique
et droit se rejoignent : la loi, en particulier la révision des lois.
- La troisième dimension, c’est la dimension universelle, ce sont les principes fondateurs sur lesquels une
majorité de gens se mettent d’accord pour le bien commun, par exemple : « Tu ne tueras pas ». Un jugement
éthique équilibré c’est un jugement qui prend en compte les trois dimensions.
On voit bien que si j’en reste à la première dimension singulière, je vais accueillir les gens, bien sûr, mais je
vais être très individualiste. Si j’en reste à la dimension de la loi, je vais être très légaliste. Si j’en reste à la
dimension universelle, je vais être très idéaliste. Alors, comment tenir en compte les trois dimensions ? C’est
justement là la difficulté, la complexité, mais aussi l’intérêt d’un jugement éthique équilibré qui du coup est un
vrai chemin avec des tensions, avec des oppositions et avec la chance peut-être aussi de pouvoir déboucher sur
une solution juste, sur des propositions justes, adaptées pour une société à un moment donné de son
développement. »
(Thierry Magnin)

« La question qui se pose est la prise en compte de la complexité de ce qui est humain. On ne peut pas avoir une
morale tellement claire, tellement évidente, tellement impérative qu’aucune exception ne serait jamais possible,
qu’il n’y aurait qu’à appliquer des décisions prises par des instances morales.
Déjà Saint Thomas d’Aquin écrivait que « la première instance morale de l’homme est la conscience éclairée,
c’est-à-dire l’homme qui est informé ». Ce problème est tellement grave qu’une morale qui voudrait répondre à
toutes les questions deviendrait immorale, parce qu’elle empêcherait les sujets libres de prendre leurs propres
décisions. Cette question est évidemment à la source d’autres problèmes […]
Dans toutes ces questions, il y va de la vie des hommes. Le véritable problème est : qu’est-ce qui fait vivre ?
Qu’est-ce qui met debout ? Qu’est-ce qui rend responsable de son existence ? Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas d’exigence à poser, mais pas sous forme manichéenne du tout noir tout blanc, du permis et du défendu.
Regardons l’Evangile. Le Christ dit au paralysé : « Lève- toi et marche ! » Imaginons que l’homme lui
réponde : « Je suis bien couché, je n’ai pas envie de me lever ». Le Christ ne va quand même pas détruire son
grabat. Si cet homme ne se met pas debout, il ne pourra pas être guéri. Nos paroles mettent-elles les gens
debout ? Sont-elles des paroles de vie ? Voilà pourquoi dans nos paroles, il faut toujours se repositionner par
rapport à la vie des gens, par rapport au sursaut évangélique. »
(Mgr. Albert Rouet)
Un témoignage parmi d’autres
Valérie, assistante de recherche dans un service de cancérologie
« J’ai 32 ans, je suis ingénieur en génie biologique. Il y a trois ans, je me suis spécialisée dans la recherche
clinique en oncologie. Ma profession : c’est assistante de recherche clinique, un bien grand titre qui veut
simplement dire que je gère des protocoles de développement de nouveaux médicaments pour l’industrie
pharmaceutique avec les médecins oncologues. Ce métier implique non seulement une réflexion scientifique
avec les médecins, mais également un énorme potentiel dans les relations humaines. Depuis deux ans, je
m’occupe de patients atteints de cancer. Cela fait cinq ans que je côtoie ces malades : auparavant j’étais bénévole
à la Ligue contre le cancer. Depuis un an, je travaille en cancérologie du poumon. Cette nouvelle discipline a
provoqué un choc dans ma vie : la confrontation à la mort, au décès plus ou moins rapide de ces patients que l’on
suit quasi au jour le jour, dans le cadre des essais thérapeutiques.
Mon métier c’est à la fois l’espoir de nouveaux traitements mais également une rencontre avec le patient, avec
l’être humain. Dès la première rencontre « les dés sont jetés », notre relation prend un sens particulier : elle sera
peut-être uniquement médicale ou prendra peut-être un caractère plus intime, c’est le patient qui choisit et moi je
m’adapte. Un réel climat de confiance s’installe j’ai un rôle privilégié : ni infirmière ni médecin, je m’occupe du
malade et je fais au mieux pour que ce nouveau médicament lui soit bénéfique. Je ne suis pas dans l’acte médical
« physique », ne réalisant pas de prise de sang ni d’examen ; je suis dans l’acte médical « scientifique ». Je suis
là pour écouter ce que le malade a à me dire : avant d’être un malade c’est un être humain qui a son histoire et
nous allons faire un « bout de chemin » ensemble, motivés tous deux par la recherche et les « promesses » de ce
nouveau médicament.
Notre relation est rythmée par les scanners et les examens cliniques demandés par le protocole et gérés par les
infirmières et les médecins. Au bout du compte, ces résultats d’examens décident si le patient poursuit le
traitement dans le protocole ou non. Si la maladie progresse, il nous faut changer de médicament. En d’autres
termes ce sont les résultats d’examens qui décident de la suite de notre relation : je reste aux côtés du patient ou
je dois lui consacrer moins de temps pour m’occuper d’autres qui continuent ce protocole.
Même si nous progressons pour que ces patients vivent mieux et plus longtemps, cette relation est
malheureusement rythmée par les décès. Face à l’indifférence apparente de mes collègues, j’ai tiré la sonnette
d’alarme en fin d’année car si nous faisons le maximum pour « nous protéger », il n’empêche que nous sommes
confrontés à la mort qui crée dans nos équipes des « dommages collatéraux » importants. Pas de la même
manière que pour des deuils personnels, c’est différent. On se pose des milliards de question : pourquoi la vie est
parfois si injuste ? Pourquoi la mort ici et maintenant ? Cela pourrait être mon père, ma mère ou un de mes
proches… Inévitablement cela nous renvoie à nos deuils personnels… Psychologiquement on n’en sort pas
indemne.

Depuis novembre, nous nous réunissons régulièrement en « groupe de parole » avec la psychologue du service.
Elle nous écoute et nous donne des pistes d’action. Ce travail est réellement fructueux et nous permet
« d’avancer » :
- Mieux connaître notre métier et mieux nous présenter au regard des patients.
- Affronter les situations difficiles plutôt que d’adopter la « politique de l’autruche ». En particulier, lorsque le
décès du patient s’annonce imminent. Accepter que le patient en soins palliatifs ait envie de vivre et
l’accompagner jusqu’au bout.
Ce métier reste difficile moralement : confrontation à la mort, pression de l’industrie pharmaceutique… Mais je
vis une aventure humaine et scientifique exceptionnelle. J’ai rencontré des personnes qui m’ont beaucoup
touchée et certaines me « touchent » encore. Longue vie à elles ! »
1
/
3
100%