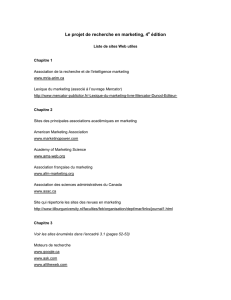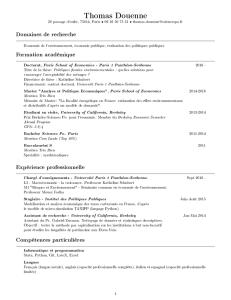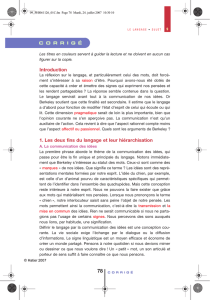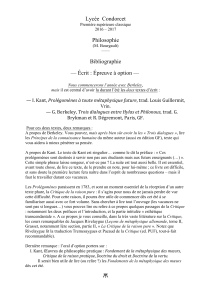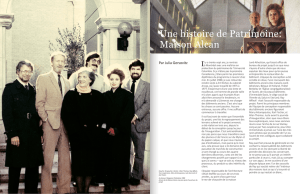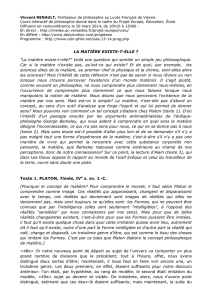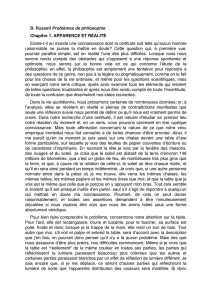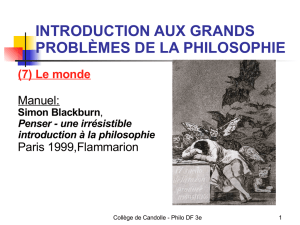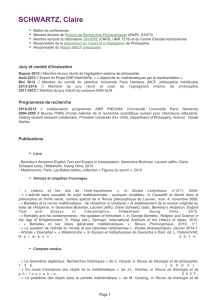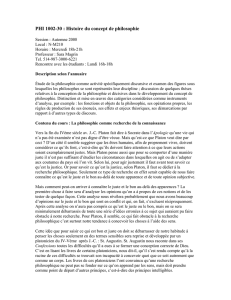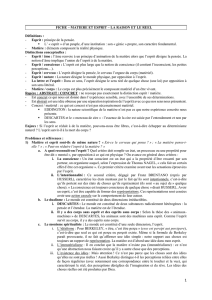Bref avertissement

1
Bref avertissement. Ces propos préliminaires à nos réunions sur Berkeley ont été tenus
sans qu’intervienne aucun surmoi académique, c’était une manière simple d’amorcer notre
virage vers la pensée de Berkeley, entre nous, amicalement. Réf. : Œuvres I, II, III, (PUF).
**
Bien que je sois persuadé que chacun aborde les œuvres des philosophes selon son
idiosyncrasie intellectuelle, il me semble pourtant que l’on pourrait faire une exception pour
Berkeley, quiconque me semble-t-il, a lu ou lira Berkeley dirait ce que je vais dire. Berkeley
est en effet d’une simplicité biblique, ce qui ne signifie pas – pas plus d’ailleurs que la
simplicité biblique – qu’il emporte aisément l’assentiment. Mais au moins, mais peut-être est-
ce là une illusion ?, on n’est pas embarrassé pour dire sa philosophie (ce qui n’est pas le cas
de tous les philosophes): il condamne d’ailleurs lui-même l’ambiguïté comme un stratagème
derrière lequel s’abritent ceux qu’il appelle les petits philosophes (Alciphron : « posséder un
caractère ambigu semble être le plus sûr moyen de gagner lauriers et estime dans le monde
savant, eu égard à sa structure actuelle » p. 373). Il déteste « les philosophes impénétrables,
insondables, conformes au goût du jour » (p. 373). Reproche qu’il transfère aux théoriciens
des fluxions : ils charment aussi par des notions ténébreuses. Bref Berkeley a une thèse (il en
déploie toutes les conséquences) et il la défend clairement, en donnant la parole à ceux que sa
thèse (il en est bien conscient) ne peut que choquer, ou paraître drôle, bizarre etc.
Et pourtant lui-même se fait passer contre les philosophes et les scientifiques, pour le
représentant du sens commun (sans ce que le sens commun certes ait eu voix au chapitre). Il y
a chez cet évêque de l’Eglise anglicane, instruit de toutes les nouveautés intellectuelles de son
temps (cf. sa polémique avec Newton – mais il devait être difficile au XVIII siècle pour un
homme cultivé, britannique qui plus est, d’ignorer Newton !), mais héritier aussi d’une solide
connaissance de la pensée des Anciens (cf. La Siris, un régal d’érudition raisonnée, orientée, -
dans sa dernière partie) une forme d’anti-intellectualisme ou d’anti-modernisme, Il est le
tenant de la Tradition mais qui au nom de cette défense de la tradition développe des thèses
originales et qui anticipent des positions en somme que le dogmatisme athée ou matérialiste
qu’il pourfend ne peut atteindre. Peut-être est-il aussi emblématique d’une certaine culture
britannique ou de ce qu’elle deviendra ( ?) : une extravagance qui sied au conservateur cultivé
(cf. Chesterton).
La consigne de Berkeley pourrait être : ne faites confiance qu’à ce que vous percevez,
ne fléchissez pas dans vos créances en faveur d’hypothèses ou d’opinions qui prétendent vous
faire admettre comme certain ce qui ne peut pas, par vous, faire l’objet d’une perception ni
être raisonnablement tiré d’une réflexion sur la nature même du perçu. C’est un appel à ne
promouvoir comme principe ontologique que la certitude que je puis avoir en tant que
subjectivité percevante, sentante. « J’en appelle à l’expérience de chacun... » répète-t-il
(Nouvelle Théorie de la vision p. 222) ou encore « j’en appelle à l’expérience de tout lecteur
réfléchi... » (L’Analyste § 275 p. 275). C’est le refus d’une pensée qui couperait les amarres
avec le vécu. En ce sens on peut dire qu’il y a chez Berkeley dans le style de son époque et de
son individualité du phénoménologique. Plus que Merleau-Ponty il pourrait dire : la
phénoménologie c’est d’abord le désaveu de la science.
Qu’existe-t-il en effet pour chacun d’entre nous si on réfléchit honnêtement en écartant
ce que l’on a appris et qui ne correspond à aucune expérience subjective personnelle ? Il
existe nous-mêmes en tant qu’être pensant ou percevant, c’est tout un - et le flux de nos
sensations, de nos impressions etc. qui présente bien des régularités - ce flux est ce que
Berkeley nomme flux des idées. [Digression : il faudrait approfondir l’idée de flux chez
Berkeley et la mettre en relation avec la critique de la théorie des fluxions : question 13 « la
quantité géométrique a-t-elle des parties coexistantes ? et toute quantité n’est-elle pas dans

2
un flux tout comme le temps et le mouvement » - et ceci serait à relier avec sa critique du
temps, de l’espace, du mouvement, de la vitesse absolus. Hoc opus, hic labor]
Si on écarte toute foi, toute hypothèse nous entraînant à poser l’existence de réalités
qu’on ne vit pas, qui ne correspondent à aucun vécu, ne restent que deux sortes d’êtres :
des esprits (les nôtres)
et les idées que nous avons plus que nous ne les sommes.
[Addendum : La seule voie d’accès à l’être est dans ces deux réalités éprouvées. Tout
ce qui n’est pas perçu et tout ce qui n’est pas connaissance immédiate de cette réalité que nous
sommes et qui est esprit percevant n’ont aucune valeur ontologique. Tombent donc hors de
l’ontologie pour n’être qu’inventions (dont la légitimité reste à examiner) tous les êtres de
raison : ils ne sont pas perçus – comment percevoir une force, une cause, une substance une
matière ? Et ils ne sont pas des esprits dont la présence serait donnée par le fait évident que
nous serions en communication avec eux. On ne parle pas à une matière et elle ne nous parle
pas !]
C’est une évidence que nous avons des idées. Par idées Berkeley n’entend pas des
choses comme l’égalité, la disjonction, la conjonction, l’implication, etc. Non, la vision du
bleu est une idée, l’odeur du chèvrefeuille en est une autre, le goût de l’eau de goudron une
autre encore, ad libitum. Il faut se débarrasser de tout intellectualisme pour penser les idées de
Berkeley. Ces idées sont des sensations : celle du bleu, mais du bleu actuel, de ce bleu
singulier faisant l’objet d’une jouissance perceptive ponctuelle, celle d’une surface lisse,
surface actuellement touchée, celle de la chaleur, etc. Ces idées peuvent être, mais plus
faibles, les rémanences en notre imagination des sensations. Il y a d’autres idées c’est celle
que l’esprit invente pour s’expliquer ces idées vives et perceptives les seules authentiques en
somme, ces idées explicatives n’emporteront jamais la conviction ontologique si elles sont
étrangères à la fois au perçu et au percevant.
Ses idées sont donc des idées sensibles plus que des opérateurs d’intelligibilité. Pas
d’examen transcendantal chez lui. Ses idées ne sont moins des principes d’ordonnancement et
de jugement que dans le fond des « choses». Comme l’avoue Philonous : « je ne vise pas à
changer les choses en idées mais les idées en choses » (Trois Dialogues...p. 125). C’est bien
plus tard dans la Siris que, se référant à Platon dont il loue admirablement l’œuvre, il
développera la thèse d’idées (mais il préfère dire notions, ou prénotions) tels que « l’être, la
beauté, la bonté, la ressemblance et l’égalité » (§ 308). Mais nous passerons sur ce dernier
développement de sa pensée.
Il y a autant de types d’idées que de sens (idées auditives, olfactives, visuelles,
tangibles, gustatives, mais aussi que d’impressions intéroceptives : la douleur est une idée :
autrement dit, est idée tout ce qui est état mental, ou état psychique, qualia plutôt que
contenus intentionnels d’ailleurs. Les idées ne peuvent être référées qu’à elles-mêmes, elles
sont vraies du fait qu’elles sont, elles ne visent en soi aucune réalité au-delà, elles sont la
réalité. A propose de l’existence même des idées (ou des choses sensibles) Berkeley dit
qu’elles n’attendent la preuve de l’existence d’un Dieu vérace pour être certaines (Trois
dialogues p. 107).
Les idées sont décrites en somme comme un spectacle qui se déroule dans mon esprit. Bien
que Yolton dans un ouvrage paru en 1984 (Perceptual Acquaintance from Descartes to Kant
cité par Jacques Bouveresse dans le tome II de Langage, perception et réalité 2004) ait
soutenu qu’il ne fallait pas prendre à la lettre les expressions « être dans l’esprit », mais
qu’elles devaient être entendues comme « percevoir, connaître, comprendre » (il n’y a pas de

3
raison, dit Yolton, d’ajouter un objet dans l’esprit qui viendrait doubler l’objet extérieur
perçu) cette mise au point me semble, si j’ose me le permettre, peu pertinente pour Berkeley :
car précisément il refuse de distinguer l’objet extérieur de l’idée qui est dans l’esprit. Il n’y a
pas d’objet extérieur, si on entend extérieur en un sens fort : là quelque part, pouvant être
ignoré royalement et totalement, sans que personne n’ait à avoir affaire à lui pour qu’il soit. Il
n’y a rien d’autre que ce qui est dans l’esprit. Pour Berkeley, exister et être dans un esprit sont
indissociables. (cf. Trois dialogues p. 132 Œuvres II). Le esse est percipi est d’ailleurs selon
Berkeley la seule réponse possible contre le scepticisme : le sceptique est dans le fond un
matérialiste car il croit qu’il y a une chose en soi et qu’elle est inconnaissable ; nous ne
connaissons que des phénomènes : on pourrait opposer ces deux textes l’un est de Sextus
Empiricus, l’autre de Berkeley
« la pomme est lisse, odorante, douce et jaune ; a-t-elle, dans sa réalité, toutes ses
qualités, ou a-t-elle une seule qualité mais apparaît-elle diverse suivant la diversité de la
constitution des organes sensoriels, ou encore a-t-elle plus de qualités que celles qui
apparaissent, certaines d’entre elles ne tombant pas sous nos sens ?… Ce qu’est la pomme est
un point obscur. » Sextus Empiricus Esquisses Pyrrhoniennes (Seuil, points) I, 94
« Je vois cette cerise, je la touche, je la goûte ; je suis sûr que le néant ne peut pas être
vu, être touché, être goûté ; elle est donc réelle. Enlevez les sensations de mollesse,
d’humidité, de rougeur, d’acidité, et vous enlevez la cerise. Puisqu’elle n’est pas un être
distinct des sensations, une cerise, je le dis, n’est rien qu’un conglomérat d’impressions
sensibles ou idées perçues par des sens divers, idées qui sont unies en une seule chose par
l’esprit (ou qui reçoivent un seul nom à elles donné par l’esprit) parce qu’on constate qu’elles
s’accompagnent l’une l’autre. Ainsi quand le palais est affecté de cette saveur particulière, la
vue est affectée d’une couleur rouge, le toucher de rondeur, de mollesse et ainsi de suite. En
conséquence, quand je vois et que je touche et que je goûte en de certaines diverses manières,
je suis sûr que la cerise existe, qu’elle est réelle, puisque sa réalité n’est pas à mon avis
quelque chose d’abstrait à séparer de ces sensations. Mais si vous entendez par le mot de
cerise une nature inconnue (une matière en soi, une substance corporelle objective) distincte
de toutes ces qualités, sensibles, et par son existence quelque chose de distinct de ce qu’elle
est perçue, alors certes, je l’avoue, ni vous ni moi ni personne d’autre ne peut être assuré
qu’elle existe » 3 Dialogues entre Hylas et Philonous p.131.
Mais avant de poursuivre sur la raison pour laquelle il ne peut rien exister d’autre que
ce qui est mental, je voudrais développer un peu la pensée du senti de Berkeley dans quelques
unes de ses dimensions.
Ce que Berkeley énonce doit toujours être référé au vécu perceptif de l’honnête homme qui
désire ne pas étendre son savoir au-delà de ce qu’il sait de façon éprouvée plutôt
qu’expérimentée. Le vécu (le terme n’existe pas dans la prose de notre auteur) est la pierre de
touche de la validité de son discours.
Ainsi Berkeley défend la thèse de l’hétérogénéité radicale des domaines sensoriels: il n’y a
pas de commune mesure entre une sensation auditive ou un son et une idée visuelle
(couleurs) : « Les idées introduites par chacun des sens sont radicalement différentes et
distinctes les unes des autres...Une même personne ne voit pas la même chose qu’elle sent,
pas plus qu’elle n’entend la même chose qu’elle sent...Ce qui est vu est une chose, ce qui est
senti en est une autre » (N.T.V p. 224-225 § 46, 47 & 49). « Ce que je vois est seulement une
diversité de lumière et de couleurs. Ce que je sens est dur ou mou, chaud ou froid, rugueux ou
lisse. Quelle similitude, quelle connexion ces idées-ci ont-elles avec celles-là ? » § 103 p. 254.

4
C’est pour cette raison que Berkeley considère que la perception de la profondeur, de
la distance n’est pas visuelle : par la vue, nous ne percevons que la couleur et la lumière. La
connaissance de la distance ou de la profondeur vient de l’association entre des impressions
tactiles et kinesthésiques et des impressions visuelles : « question 12 Si un homme n’avait
jamais perçu de mouvement, aurait-il jamais connu ou conçu une chose comme distante d’une
autre ? » (L’analyste p. 325 Œuvres II). En réalité nous voyons de fait peu de choses. «Dans
tout acte de vision l’objet visible pris absolument est peu pris en considération » (N.T.V p.
239 § 239). Réduit à voir, nous aurions peine à nous orienter dans le monde : c’est ce qui se
passerait si nos yeux avaient l’acuité du microscope dit Berkeley. « Dans le cas des yeux
microscopes je vois seulement cette différence à savoir que par la disparition d’une certaine
connexion observable entre les diverses perceptions de la vue et du toucher connexion qui
nous rendrait incapables de régler nos actions par les yeux, la vue serait rendue totalement
inutilisable à cette fin » (N.T.V § 86 p. 246). Mais on peut se demander ce que signifie
s’orienter dans le monde pour Berkeley ? Mais la Nouvelle théorie de la vision peut paraître
condamnée par moments par le besoin même d’entamer le prestige attribué au voir (il ne
livrerait pas la réalité) à louer le toucher comme sens du réel.
La difficulté énorme avec Berkeley est celle du statut de la réalité extérieure, on en
reparlera : mais que peut-il dire par exemple quand au § 11 de la N.T.V il écrit : « toutes les
choses visibles sont également dans l’esprit et n’occupent aucune partie de l’espace
extérieur ; elles sont par conséquent, équidistantes de toute chose tangible, qui existe hors de
l’esprit » (p. 258). [ «Certes il y a une opinion curieusement dominante parmi les hommes,
selon laquelle des maisons, des montagnes, des rivières, bref tous les objets sensibles
possèdent une existence naturelle ou réelle, distincte du fait qu’ils sont perçus par
l’entendement. mais, quels que soient l’assurance et l’accord avec lesquels un tel principe est
reçu dans le monde, pourtant, quiconque trouvera au fond de son cœur des motifs de
s’interroger sur la question pourra, si je ne me trompe, y déceler une contradiction
manifeste » Principes § 4 pp . 320-321 Oeuvres I PUF)]. Cf aussi Trois Dialogues p. 124.
Il n’y a pas de perception à strictement parler d’objets. Les objets sont le lieu où se
recueillent une série d’impressions qui sont régulièrement associées. Si une idée sonore (par
exemple entendre le bruit d’une voiture) nous fait penser à l’idée visuelle d’un volume qui se
déplace, ce n’est que sur la base d’une habitude que nous inférons de l’audition de tel bruit la
survenue de telle impression visuelle. Ensuite l’esprit projette en un objet les sensations qui
ont coutume d’être liées : un objet, c’est la cristallisation d’un réseau d’impressions liées
habituellement. L’identité d’un objet ne vient pas de lui : l’objet n’est rien de perçu, il n’existe
pas en tant que substance séparée des accidents que seraient les qualités secondes – c’est
seulement un nœud de perceptions habituellement connectées ou signes les unes des autres.
L’objet est le produit d’une synthèse passive pourrait-on dire en parodiant Husserl. Mais
Berkeley ne s’interroge pas vraiment à ma connaissance, sur ce qui nous entraîne assez
universellement à hypostasier des objets. Il se contente trop vite de dire qu’il est en accord
avec le sens commun et opposé aux errances des doctes...Il se contente au moins dans la
N.T.V de dénoncer « la matrice prolifique qui a produit des erreurs et des difficultés
innombrables dans toutes les parties de la philosophie et dans toutes les sciences » (§ 125 p.
265).
La philosophie de la sensation de Berkeley constitue une sorte d’absorption des
qualités premières dans ce que Galilée puis Descartes et Locke avaient nommé les qualités
secondes et que Platon avait déjà pressenties dans le Théétète. Pour Berkeley la distinction
entre qualités premières et qualités secondes n’a aucune pertinence. Les qualités dites
secondes, ce sont ces qualités qui n’existeraient pas à part de l’observateur ou du moins du
sujet sensible. La sucré n’existe que par et dans la rencontre entre des papilles gustatives et

5
une substance ayant certains attributs objectifs et une puissance de faire naître la sensation de
sucré si elle rencontre certains papilles gustatives. Mais le sucré et non le sucre disparaîtraient
si les organismes susceptibles d’avoir cette sensation ou ce vécu disparaissaient. Autrement
dit, le sucré est un adjectif dont le physicien n’a pas besoin pour écrire son texte ayant pour
thème le sucre en soi, hors de toute présence humaine ou animale, « une fois l’animal ôté »
disait Galilée (Le Saggiatore). Le sucré regarde plus la psychophysiologie que la physique. En
revanche il y a des attributs qui ne disparaîtraient pas si le sujet humain ou animal
disparaissait et ces attributs dits qualités premières sont l’étendue, la solidité, la figure, le
mouvement, le poids qui restent dans l’objet même en l’absence de tout sujet.
C’est cette absence de tout sujet que Berkeley interrogera – comment un point de vue
de nulle part est-il possible ? Comment peut-on prétendre connaître l’objet ou même faire des
hypothèses sur ce qu’est l’objet en l’absence de tout observateur par définition sensible ? En
se posant cette question, Berkeley met directement en cause la possibilité d’une certaine
science qui prétend accéder au delà de la subjectivité au réel en soi ou s’en approcher
indéfiniment. De la science il n’aura qu’une conception phénoméniste : la science est cette
activité de l’esprit qui enregistre les impressions en leur succession (dans le temps) et repère
les régularités (lois de la nature). Mais la science ne peut avoir la prétention d’accéder au
substantiel et encore moins au causal. Berkeley annonce par certains côtés la conception
positiviste de la science, j’y reviendrai.
Il y a en effet, il faut l’avouer, une difficulté interne (ou une difficulté humaine) à
concevoir ce que serait une existence qui n’existerait absolument pour personne : supposons
ce qui semble absurde (et vain donc d’imaginer) que toute conscience ait disparu du cosmos,
s’il restait quelque chose de réel, cette chose n’existerait pas pour elle-même ni a fortiori pour
personne : ce serait vu de hauteur d’homme l’équivalent du néant.
Les qualités premières pour Berkeley sont obtenues par abstraction à partir des
qualités secondes : concevoir une surface pure, c’est dépouiller, par une opération de l’esprit
(d’un esprit sophistiqué, qui a perdu la contact avec le bon sens vivant), les seules surfaces
réelles i.e tactiles et visibles des qualités tactiles ou visibles qui en font précisément des
surfaces. Les qualités premières ne sont pas premières, mais au contraire abstraites par une
contorsion abstractive des qualités secondes. Berkeley voit dans les prétendues qualités
premières des fantômes des qualités sensibles et qu’on a tendance ensuite à éloigner du
sensible pour en faire le socle des objets qui continuerait à perdurer au-delà de toute
perception. C’est déjà la critique de Merleau-Ponty : ce que la science thématise à partir de
l’expérience, on le considère comme le socle de l’expérience – se suffisant à lui-même et
déterminant même la perception. Il se produit une inversion : le premier devient le second,
bref le dépendant devient la prétendue cause.
Mais surtout dans cette distinction entre les qualités premières qui seraient des
attributs immuables et indépendants de l’esprit et qui appartiendraient à la matière, aux objets
inertes en tant que tels, Berkeley voit poindre le matérialisme. Si les qualités secondes se
créent dans la rencontre entre l’objet et le sujet sensible, il y a une dépendance réglée entre la
matière et l’esprit qu’on peut analyser. Il y a dans les choses comme le disait Locke un
pouvoir de déterminer dans une sensibilité donnée des sensations.
Berkeley trouve absurde de supposer que des qualités sensibles (qui sont des états
mentaux) soient des effets ou des émanations, des expressions causalement déterminées de
quelque réalité qui, elle, ne serait pas perçue ou ne serait pas de l’ordre des qualités sensibles.
Les matérialistes sont d’abord ceux qui supposent qu’il y a une matière abstraite, extérieure
aux qualités sensibles, une matière donc non pensante, non percevante, non descriptible en
termes de couleur, lumière, saveur, tact, son, goût qui serait le support invisible, inodore,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%