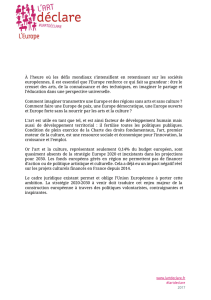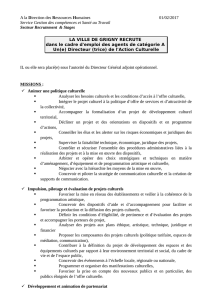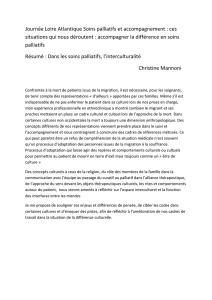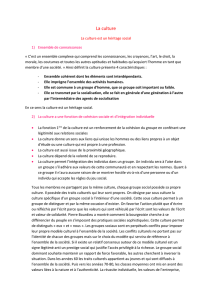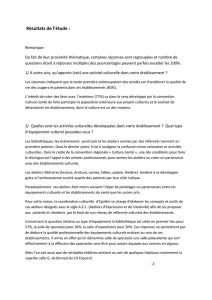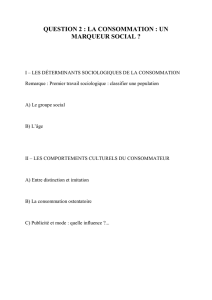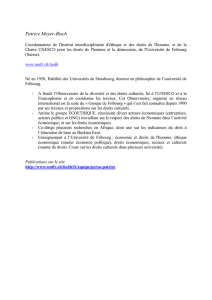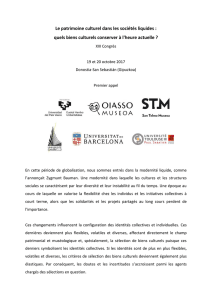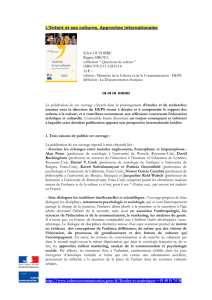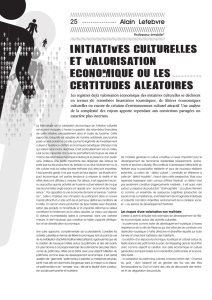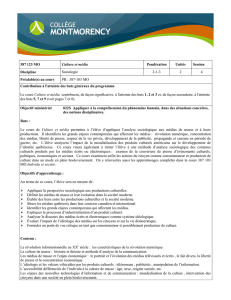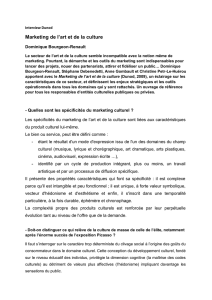L`entreprise culturelle entre fossile et mutant

- 1 -
L’entreprise culturelle entre fossile et mutant
Article rédigé pour les « cahiers du management culturel »
© êcume & Institut Claude-Nicolas Ledoux 1994
1 - L’entreprise culturelle existe-t-elle ?
11 - Incommensurable culture
12 - Protectionnisme culturel
13 - Patrimoine contre délocalisation
2 - Le Management de l’impossible : quinze constats
21 - Étalon de la valeur
22 - “Perte de contrôle” de la gestion
23 - Marché des signes
24 - Fin des romantiques
3 - L’impossible culture du Management
31 - Consommation : de l’autre côté du miroir
32 - Nouveaux enjeux de la culture
33 - Nouveaux managements
note : ce texte date de 1994

- 2 -
Luc GRUSON, diplômé HEC, a travaillé comme consultant auprès de
nombreuses institutions françaises et internationales avant de rejoindre Arc et
Senans où il a notamment développé les nouvelles technologies, les activités
d’édition et de formation. Il a été avec Mario d’Angelo l’un des initiateurs du
“Mastère Européen”, où il coordonne les enseignements de gestion.
Vice-Président d’Ecume, il est également depuis 1993 le Directeur de l’Institut
Claude-Nicolas Ledoux, Centre Européen de Rencontres d’Arc et Senans.

- 3 -
Résumé : Dans cet article, l’auteur s’interroge sur les pratiques du
management dans le secteur culturel. Après avoir montré les limites du
concept d’entreprise culturelle, il montre les contradictions du management
appliqué au secteur culturel, en traitant plus particulièrement la gestion
financière, le contrôle de gestion, le marketing et la gestion des ressources
humaines.
Mais il développe ensuite l’hypothèse que ce sont les concepts du
management qui ne sont plus adaptés à la société moderne où l’échange des
symboles domine l’échange des marchandises. Dans ce contexte post-
industriel, et avec en arrière-fond les échanges internationaux, il indique
quelques pistes pour repenser l’économie de la culture européenne, en
s’appuyant notamment sur les lieux du patrimoine.

- 4 -
Bien qu’ils s’en défendent, les milieux culturels sont finalement perméables aux
modes qui régissent les attributs de la modernité dans les organisations. Ces
modèles dominants, qui touchent aux concepts comme aux discours, sont
relayés et amplifiés dans une société où la mondialisation et la médiatisation
accélèrent la circulation des idées.
Ainsi les panacées universelles du management, la Direction par objectifs et le
contrôle de gestion dans les années 70, la glorification du modèle d’entreprise
et du projet professionnel dans les années 80, la vogue du concept de réseau
en ces années 90, ont-elles exercé à des degrés divers une fascination sur les
acteurs et les structures de la culture, toujours en quête d’identité.
Il est troublant de constater que le concept d’”entreprise culturelle” a envahi les
discours sur la culture en France au début des années 80, exactement au
moment où l’entreprise perdait dans la société française son caractère
diabolique pour devenir une catégorie supérieure de l’organisation humaine et
de la citoyenneté.
Il est intéressant, dix années après, de s’interroger sur le sens de l’irruption de
ce modèle. Ne s’agit-il que du dernier avatar de structures incapables de
s’adapter à l’évolution accélérée de notre monde, ou peut-on y lire l’émergence
d’un nouveau type d’organisation, caractéristique des sociétés post-
industrielles, où la production de symboles importe davantage que celle de
biens et de services ?
1 - L’entreprise culturelle existe-t-elle ?
Concept hexagonal s’il en est, l’entreprise culturelle renvoie à cet autre
particularisme national qu’est la notion de culture, entendue non pas comme
l’ensemble des valeurs fondant une nation, mais comme un secteur d’activité. Il
suffit de franchir nos frontières pour mesurer la fragilité de ce concept que bien
des européens du nord ne parviennent pas à formuler tant leurs catégories
sont différentes.
On préfère là-bas le mot d’”Arts” (visual arts, performing arts, arts
management) à celui de culture.

- 5 -
La pauvreté des nomenclatures ou des typologies communes paraît à cet
égard révélatrice de la difficulté de trouver un langage commun. Ainsi, dans un
secteur émergent comme l’environnement, des groupes d’experts ont proposé
des batteries d’indicateurs communs ou des nomenclatures communes (1),
afin de pouvoir comparer des éléments quantitatifs ou qualitatifs différents,
voire afin de comparer l’impact des politiques nationales.
Dans le domaine de la culture, bien qu’il s’agisse d’un secteur moins nouveau
et bien plus important en terme de poids économique, l’appareil statistique
disponible est étonnamment pauvre.
11 - Incommensurable culture
En France, il n’y a pas d’organisation professionnelle ou d’administration (2)
disposant des outils permettant une approche rationnelle et quantifiée des
entreprises culturelles :
• il n’existe pas de branche culture, et donc pas d’enquête de branche ;
• il n’existait pas jusqu’à récemment de références précises aux produits et
services culturels dans la NAP (3), ce qui interdit l’exploitation sectorielle de
toutes les grandes enquêtes nationales et statistiques administratives sur les
entreprises ;
• il n’y a pas eu d’essai probant d’élaboration d’un compte satellite de la
culture, permettant d’évaluer au niveau macro-économique la portée du
secteur culturel, en termes de valeur ajoutée et de commerce extérieur par
exemple.
La nouvelle codification APE, destinée à préparer l’harmonisation
communautaire et entrée en vigueur en 1993, prévoit pour la première fois un
code 92 pour les “activités récréatives, culturelles et sportives”. Ce code
permettra dans une certaine mesure de disposer des statistiques classiques
d’entreprises sur certains secteurs.
Mais outre les limites bien connues de la codification (qui ne distingue que
l’activité principale), il n’y a pas eu de réflexion pertinente sur la typologie des
activités culturelles comme l’indique le détail de la nomenclature ci-dessous.
Par ailleurs, on est surpris que l’édition continue de figurer dans la branche
industrie manufacturière au code DE : “industrie de papier et du carton ; édition
et imprimerie (sic)”.
Plus incroyable la sous-branche 22 “édition, imprimerie, reproduction”
comprend le code DE.22.3 qui inclut les enregistrements sonores (DE.22.3A)
vidéo (DE 22.3B) et informatiques (DE.22.3C). Qui aurait pu penser que les
nouvelles technologies multimédia appartenaient en France à l’industrie du
papier et du carton ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%