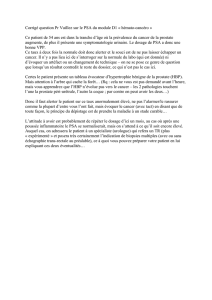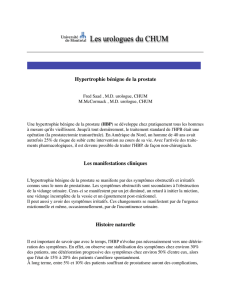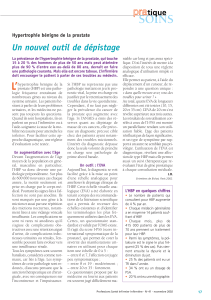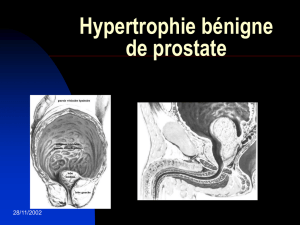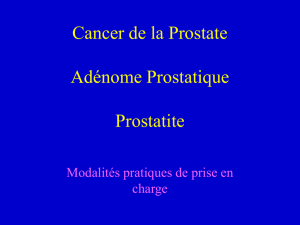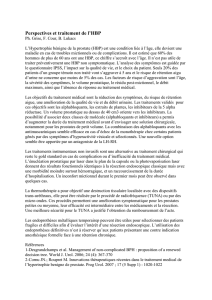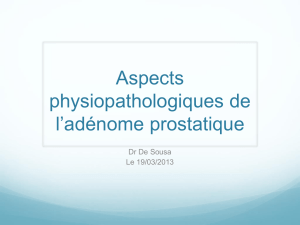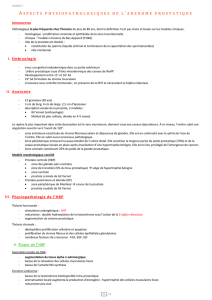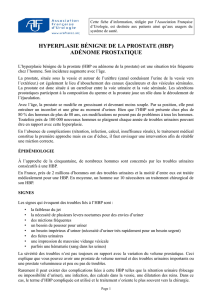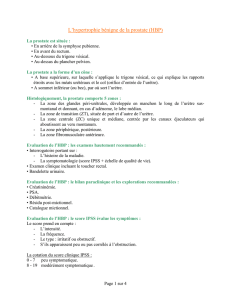Hypertrophie Bénigne de la Prostate

1
247. Hypertrophie Bénigne de la Prostate
Objectifs principaux
- Diagnostiquer une Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP).
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Objectifs spécifiques
- Savoir que la prévalence de l'HBP augmente avec l'âge.
- Savoir décrire les éléments du diagnostic d'HBP à l'interrogatoire et au toucher rectal
- Savoir apprécier la gène fonctionnelle liée à une HBP à l'interrogatoire
- Connaître les éléments cliniques et para cliniques nécessaires lors de l'évaluation
initiale d'une HBP
- Connaître les éléments cliniques et para cliniques et leurs modalités de prescription,
nécessaires pour la surveillance d'une HBP.
- Etre capable d'identifier les situations nécessitant un avis spécialisé (aggravation
symptomatique, complications, élévation des PSA)
- Connaître les autres pathologies pouvant entraîner des symptômes du bas appareil
urinaire (sténose urétrale, tumeur de vessie, cancer de prostate, neuropathie
périphériques, troubles du transit intestinal, prises médicamenteuses).
- Connaître les indications et les modalités de prescriptions du traitement médical
d'une HBP symptomatique non compliquée.
- Connaître les principes des indications et de la technique des principales
interventions chirurgicales.

2
EPIDEMIOLOGIE
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une maladie de l’homme après
50 ans. Il s’agit d’une affection très fréquente puisque 80 % des hommes développent
une HBP au cours de leur vie alors que 30 % devront être opérés.
La prévalence de l'HBP varie en fonction de la définition, clinique ou anatomo
pathologique, utilisée. L'HBP histologique (présence d'hyperplasie glandulaire et du
stroma sur des pièces opératoire ou d'autopsie) n'est pas retrouvée avant 30 ans. La
prévalence augmente progressivement dans chaque groupe d'âge, culminant à 88%
chez les hommes entre 80 et 89 ans. L'HBP clinique (présence de symptômes
urinaires) est présente chez 40% des hommes âgés de 60 ans.
Eu égard à sa situation anatomique, l’augmentation de volume de la prostate
détermine un obstacle au niveau du col vésical avec des conséquences variables sur
les conditions de la vidange vésicale à l’origine de son expression clinique.
PHYSIO-PATHOLOGIE
Le développement de l’HBP créée un obstacle à la vidange vésicale dont le pronostic
est dominé par son retentissement sur la vessie et le haut appareil urinaire.
L’obstruction en rapport avec l’HBP résulte de deux phénomènes :
- une composante mécanique liée à l’augmentation du volume de la prostate ;
- une composante dynamique en rapport avec le tonus du muscle lisse présent dans la
glande prostatique.
En conséquence, la résistance urétrale au passage du flux urinaire augmente. La
vessie compense initialement en s’hypertrophiant ; les caractéristiques du débit
urinaire sont maintenues grâce à une plus forte contraction du détrusor qui
s’hypertrophie. C’est le stade dit de “ vessie de lutte ”. Si l’obstruction se maintient, les
cellules musculaires lisses sont colonisées par du collagène ; il en résulte une
diminution de la compliance vésicale et à terme une incompétence du détrusor. C’est
le stade de vessie “ claquée ” responsable d’une rétention chronique incomplète ou
complète.

3
Les symptômes et le retentissement de l’HBP ne sont pas systématiquement en
rapport avec le volume de la glande.
Le retentissement sur le haut appareil urinaire procède soit d’un obstacle à la vidange
urétérale secondaire à l’hypertrophie du détrusor, soit d’un reflux. Il risque d’aboutir à
bas bruit à une détérioration du parenchyme et donc à une insuffisance rénale plus ou
moins définitive.
Le degré de l’obstruction et de ses conséquences sont variables suivant les individus.
En particulier il n’y a aucun parallélisme anatomoclinique : les symptomes et le
retentissement de l’HBP ne sont pas mécaniquement liés au volume de la glande.
EXAMEN CLINIQUE
Le diagnostic de l’HBP repose sur
- la mise en évidence lors de l’interrogatoire des symptômes en rapport avec
l’obstacle prostatique et le dérèglement fonctionnel vésical,
- la reconnaissance au toucher rectal de l’hypertrophie de la glande prostatique.
SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE
Signes obstructifs
Signes irritatifs
• Retard au démarrage
• Jet en pomme d’arrosoir
• Jet faible
• Gouttes retardataires
• Miction prolongée
• Rétention
• Miction par regorgement
• Pollakiurie
• Impériosité
• Mictions nocturnes
• Urgence mictionnelle
• Volume mictionnel réduit
La sévérité des symptômes et leur retentissement sur la qualité de vie peuvent être
évalués objectivement grâce à la mise au point de système de cotation des
symptômes. Ces scores symptomatiques, sous forme d'auto questionnaire (IPSS)
ne sont pas spécifiques de l'HBP. Ils sont cependant utiles pour évaluer l’efficacité des
méthodes thérapeutiques proposées.

4
L’interrogatoire s’attachera également à préciser les conditions générales du patient,
ses antécédents urologiques, les pathologies et les traitements pouvant affecter la
diurèse et le fonctionnement de la vessie et des sphincters.
EXAMEN PHYSIQUE
- Il repose principalement sur le toucher rectal qui retrouve en cas d’hypertrophie
bénigne une prostate augmentée de volume avec disparition du sillon médian ; elle est
souple, lisse et régulière, de consistance ferme, indolore.
- Le reste de l’examen appréciera l’état des organes génitaux externes et surtout
l’existence éventuelle d’un globe vésical.
COMPLICATIONS EVOLUTIVES
La rétention aigue d’urine nécessite pour soulager le patient d’évacuer la vessie soit
par cathétérisme uréthral, soit par cathétérisme suspubien. La rétention aigue d’urine
n’est pas toujours définitive. Après évacuation des urines vésicales, le sujet peut
retrouver son équilibre mictionnel antérieur ; mais dans 60 % des cas la rétention
risque de se reproduire dans l’année qui suit.
La rétention chronique complète donne lieu à un tableau clinique particulier de
“ fausse incontinence ” s’agissant en fait de mictions par regorgements. Le globe
vésical est en règle facile à reconnaître du fait de son importance. Il n’est pas
douloureux. La recherche d’un retentissement sur la fonction rénale est ici
indispensable. La dérivation des urines vésicales doit être faite tenant compte du
risque de syndrome de levée d’obstacle.
L’infection peut donner lieu à des tableaux variables : prostatite, orchi-épididymite ;
la survenue de calculs de la vessie, secondaires en règle à la stase urinaire.
L’hématurie est rare, habituellement initiale. Devant toute hématurie, le diagnostic
étiologique d'HBP doit rester un diagnostic d'élimination. Il faut vérifier l'absence de
tumeurs urothéliales associées.
LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES

5
L'ECBU est recommandé lors de l'évaluation initiale
L’ECHOGRAPHIE VESICO-PROSTATIQUE ET RENALE.
Moins invasive et moins onéreuse, elle remplace de nos jours l’urographie
intraveineuse longtemps considérée comme l’examen de référence. Elle est réalisée
par voie trans-abdominale et/ou transrectale. Sous réserve d’une technique adaptée,
elle permet d’évaluer :
- Le retentissement de l’obstacle prostatique sur la vessie et les reins (voie
trans-abdominale), le résidu post-mictionnel, la présence d'un diverticule vésical,
d'une lithiase vésicale, d'une dilatation des cavités pyélocalicielles.
- Les caractéristiques morphologiques, le volume de l’HBP (voie transrectale).
L’appréciation du volume est utile en cas d’indication opératoire pour définir la
technique opératoire. Les coupes sagittales permettent mieux que tout autre examen
de reconnaître un lobe médian L’analyse de l’échostructure est globalement en échec
pour identifier un cancer non palpable.
LA DEBITMETRIE
C’est la mesure du débit urinaire, c’est-à-dire du volume uriné en fonction du temps. Le
débit urinaire normal se situe entre 20 et 30 ml/s (figure 8).
La débitmétrie permet d’objectiver et de quantifier la dysurie. L’enregistrement doit être
réalisé dans des conditions aussi proches que possible d’une miction normale ; le
volume uriné doit être supérieur à 150 ml. Sous réserve de variations possibles d’un
enregistrement à l’autre pour un même patient, il est considéré comme franchement
pathologique en dessous de 10 ml/s (figure 9).
DOSAGE DE L’ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA)
Son intérêt n’est pas de confirmer l’hypertrophie mais de s’assurer de l’absence de
probabilité de cancer prostatique associé. Le PSA est un marqueur spécifique de la
prostate ; il n’est pas pour autant spécifique de cancer. En cas d’augmentation du
volume de la prostate, le taux de PSA peut se trouver augmenté au-dessus du seuil de
normalité (4 nanogrammes/ml). Ce taux est à interpréter en fonction du volume de la
glande. Cependant un cancer de la prostate peut co-exister avec une HBP ; il y a 20 à
40 % de probabilité de cancer de la prostate lorsque le PSA est compris entre 4 et 10
nanogrammes/ml, et 50 à 70 % lorsque le PSA est supérieur à 10 nanogrammes/ml.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%