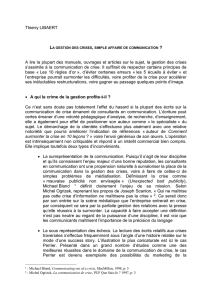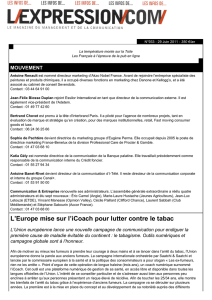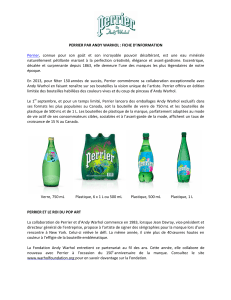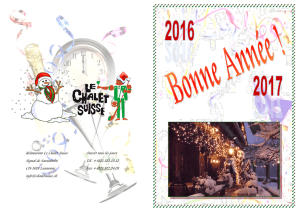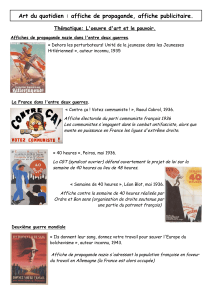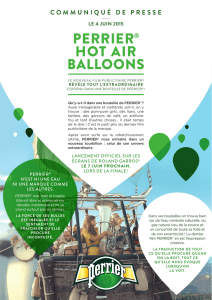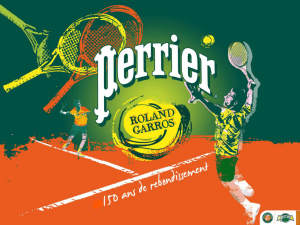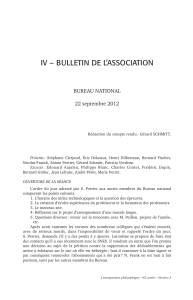41Kb version

Thierry LIBAERT
LA GESTION DES CRISES, SIMPLE AFFAIRE DE COMMUNICATION ?
A lire la plupart des manuels, ouvrages et articles sur le sujet, la gestion des crises
s’assimile à la communication de crise. Il suffirait de respecter certains principes de
base « Les 10 règles d’or », d’éviter certaines erreurs « les 5 écueils à éviter » et
l’entreprise pourrait surmonter les difficultés, voire profiter de la crise pour accélérer
ses inéluctables restructurations, voire gagner au passage quelques points d’image.
A qui le crime de la gestion profite-t-il ?
Ce n’est sans doute pas totalement l’effet du hasard si la plupart des écrits sur la
communication de crise émanent de consultants en communication. L’écriture peut
certes émaner d’une volonté pédagogique d’analyse, de recherche, d’enseignement,
elle a également pour effet de positionner son auteur comme « le spécialiste » du
sujet. Le démarchage de la clientèle s’effectuera plus aisément avec une relative
notoriété que pourra améliorer l’indication de références « auteur de Comment
surmonter la crise en 10 leçons ? » voire l’envoi généreux de son œuvre. L’opération
est intrinsèquement non critiquable et répond à un intérêt commercial bien compris.
Elle implique toutefois deux types d’inconvénients.
La surreprésentation de la communication. Puisqu’il s’agit de leur discipline
et qu’ils connaissent l’enjeu majeur d’une bonne réputation, les consultants
en communication ont une propension naturelle à survaloriser la place de la
communication dans la gestion des crises, voire à faire de celles-ci de
simples problèmes de médiatisation. Définissant la crise comme
« mauvaise publicité non envisagée » (Unexpected bad publicity),
Michael Bland
1
définit clairement l’enjeu de sa mission. Selon
Michel Ogrizek, reprenant les propos de Joseph Scanlon, « Qui ne maîtrise
pas cette crise d’information ne maîtrisera pas la crise »
2
. Ce serait donc
par son entrée sur la scène médiatique que l’entreprise entrerait en crise,
par conséquent ce sera par la parfaite gestion des relations avec la presse
qu’elle réussira à la surmonter. La capacité à faire accepter une définition
n’est pas neutre au regard de la puissance d’une discipline, il est vrai que
les communicants maîtrisent l’importance de la précision du langage
La sous représentation des échecs. La lecture des écrits relatifs aux crises
traversées s’effectue fréquemment sous l’angle d’une histoire relatée sur le
mode d’une success story. L’illustration la plus caricaturale est ici le cas
Perrier. Présenté dans un grand nombre d’études comme une des
meilleures réussites dans le domaine de la communication de crise, le cas
Perrier est devenu exemplaire des possibilités du marketing de la
1
: Michael Bland, Communicating out of a crisis, MacMillan, 1998, p. 5
2
: Michel Ogrizek, La communication de crise, PUF Que Sais-Je ? 1997, p. 3

2
communication de crise. Selon Michel Ogrizek, « la crise exemplaire quant
aux leçons à tirer, est incontestablement « la crise Perrier »
3
. Dans
l’ouvrage de Maud Tixier, La communication de crise
4
, nous trouvons ainsi
un happy end somptueux : « le retour de la bouteille Perrier fut un
événement marketing brillant. Les distributeurs renouvelèrent leur
confiance en Perrier, les consommateurs achetèrent comme par le passé
et, en Bourse, l’action remonta. Perrier venait de remporter sa dernière
victoire ... Le succès fut tel que des esprits chagrins virent dans la crise
Perrier un excellent outil de promotion pour la société ». Comme à la fin
des films hollywoodiens, le héros peut savourer sa victoire et repartir pour
de nouvelles aventures.
Après avoir constaté un fait non anodin (l’auteur présidait l’agence conseil
de Perrier), il convient de revenir à quelques fondamentaux : une
communication de crise s’évalue d’abord au regard des résultats effectifs
sur l’activité de l’entreprise. Après une chute prolongée des cours de
l’action, le départ du président Gustave Leven, ce n’est qu’en 2000, soit dix
années après la crise que Perrier parvint à retrouver ses parts de marché.
Avec une image durablement dégradée à l’international
5
, et des traces
psychologiques persistantes qu’illustre le fait que 44 % des français s’en
souviennent
6
et qu’il suffise d’une crise comparable du type Coca-Cola en
1999 pour la faire resurgir, la crise Perrier semble loin du succès présenté.
La seule réussite incontestable semble davantage résider dans celui de la
communication sur la communication de crise.
A la recherche de l’opinion publique
Un nouvel interlocuteur règne désormais en maître sur la communication de crise.
Insaisissable, invisible mais incontournable, l’opinion publique est devenue la
référence suprême de toute action de communication. La sauvegarde de l’image
serait l’objectif ultime de toute stratégie d’entreprise. L’image de marque serait un
« antidote à la crise »
7
, elle serait le paramètre essentiel d’une politique
d’anticipation des crises puisque celles-ci frapperaient préférentiellement les
entreprises disposant d’une mauvaise réputation, elles permettraient de traverser la
crise en rappelant ses messages et valeurs, enfin elle permettrait en aval de
redresser l’image dégradée, voire de capitaliser sur les résultats acquis lors de la
phase de gestion.
Afin de mieux cerner le poids réel de l’opinion publique dans la gestion de crise, trois
cas peuvent être réétudiés.
Le 12 décembre 1999, l’Erika s’échoue au large des côtes bretonnes. De
l’avis unanime, cette catastrophe, dont on découvre réellement l’ampleur le
3
: Michel Ogrizek, op. cit., p. 20
4
: Maud Tixier, La communication de crise, Mc GrawHill, 1991
5
: en ce sens, cf Jean-Marc Lehu, Alerte Produit, Editions d’Organisation, 1998, p. 85
6
: Alain Delcayre, « L’image de marque, un antitode à la crise », Stratégies, n° 1240, 7 juin 2002, p. 33
7
: sondage CSA / TMO pour Edelman, cf notamment Florence Amalou, « La communication n’efface pas
totalement les crises », Le Monde, 7 décembre 1999

3
24 décembre lorsque les premières nappes de pétrole frappent les plages,
se double d’un naufrage pour le groupe Total incapable d’une
communication cohérente. Total communique tardivement, minimise sa
responsabilité, « nous ne sommes pas juridiquement responsables », ne
fait preuve d’aucune empathie, hésite à se rendre sur les lieux, se laisse
piéger lors des interviews « Je suis prêt à donner une journée de mon
salaire ». La crise de la communication supplante largement la
communication de crise.
A l’exemple de la crise Perrier, un élément doit toujours être considéré pour
évaluer une action : l’impact économique et financier. A la suite de l’Erika,
le groupe Total n’a perdu que 0,1 % de parts de marché, le cours de son
action s’est accru de 40 % et les bénéfices 2000 se sont élevés à
60 Mds de F, le montant le plus élevé pour une entreprise française.
L’image du groupe a certes fortement chuté puisque le groupe Total se
retrouva aussitôt en dernière position au classement Ipsos / Nouvel
Economiste
8
. Dans le domaine des sciences de l’information, un des
principes de base repose sur l’analyse de toute action de communication
en fonction d’un enjeu, d’un objectif et d’une cible. Si l’on considère que
l’objectif d’une entreprise est d’abord de réaliser des bénéfices, si l’on
considère que l’enjeu d’une communication maladroite est limité s’agissant
d’une entreprise réalisant les trois quarts de ses résultats à l’étranger
9
et
que la cible principale n’est peut-être pas le grand public mais la
communauté financière internationale, on peut comprendre que la
communication grand public n’ait peut-être pas été privilégiée.
L’exemple Total rejoint la longue liste d’exemples d’entreprises dont
l’objectif économique et financier apparaît pleinement lorsque, à l’exemple
du groupe Michelin le 21 septembre 1999, l’entreprise annonce le même
jour une hausse de 20 % de ses bénéfices semestriels et,
concomitamment, la suppression de 7.500 postes en Europe dont 1.880 en
France. Comme auparavant pour le cas Renault-Vilvoorde, il s’agit
vraisemblablement d’une maladresse. Toutefois, ici également,
l’événement doit se resituer dans une logique de gestion économique et
financière. Michelin réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’international, le
risque sur le marché français est réduit, la cible n’est pas le grand public. Ici
aussi, le groupe doit affronter une tempête médiatique, il n’empêche que la
première conséquence de cette « erreur de communication » fut que le 21
septembre 1999, le titre Michelin gagna 12 % à la Bourse de Paris.
Le cas Danone est également révélateur en ce qu’il ruine toute certitude
sur l’effet bouclier de la bonne réputation. Lorsque le 11 janvier 2001,
Le Monde annonce le plan de restructuration du groupe Danone, celui-ci
bénéficiait d’une image solide. 80 % des français en avaient une bonne
opinion et chacun s’accordait à considérer que son image basée sur des
valeurs de responsabilité, de citoyenneté et d’avancée sociale le protégeait
8
: cf notamment Le Nouvel Economiste, n° 1148, 24 mars 2000, p. 50-51
9
: Sylvie Hattemer-Lefèvre, « Ces entreprises qui se moquent de la France », Le Nouvel Economiste, n° 1153,
31 mai 2000, p. 52

4
de toute crise majeure. Fin janvier, l’entreprise passe de la 5ème à la 25ème
place des baromètres d’opinion pour se retrouver au dernier rang en avril
2001. Loin de l’effet bouclier, la réputation amplifierait la crise et un
mauvais paramètre intervient alors ; la déception. Le consommateur se
sent victime d’une manipulation en s’apercevant de la réalité de l’entreprise
derrière l’image. La chute est alors plus rapide.
La médiation de la presse peut également accélérer ce processus. Il est,
selon l’angle journalistique, plus intéressant d’attaquer une entreprise à
forte réputation puisque les révélations disposeront ainsi de l’effet surprise.
Comme le remarquait Lise Chartier à propos de la gestion de la crise du
verglas du Québec en 1998, l’entreprise « était une société suffisamment
grande, forte, organisée et responsable pour ce faire, les médias n’en ont
que redoublé d’ardeur pour la piéger, commenter son manque de
transparence et accorder une place prépondérante durant tout le reste de
l’année à ceux qui la contestaient »
10
.
La réputation ne protège pas de la crise, elle peut permettre une sortie de
crise plus rapide mais rien n’a pu à ce jour être démontré.
Au début des années 1990 aux Etats-Unis, la chaîne de restauration
Denny’s fut l’objet d’une large campagne basée sur des discriminations
raciales opérées par des membres de l’entreprise. Des centaines de
plaintes et un nombre croissant de procès portaient sur une différence de
traitement, les personnes de couleur se voyaient devoir attendre trop
longuement avant de pouvoir commander ou être servies, et provocation
suprême, l’être souvent après des clients arrivés ultérieurement.
Le groupe aurait certes pu respecter les principes de la communication de
crise, voire lancer une campagne de reconquête de l’opinion. En
l’occurrence, il préféra quelques actions tangibles
11
: l’obligation pour tout
employé de la chaîne de signer un engagement de non discrimination, le
recrutement d’un directeur de couleur, l’accélération des franchises
confiées aux minorités, un partenariat avec le NAACP
12
. Il y eut certes des
actions de communication (effectuées avec une agence détenue par une
minorité) mais il est évident que la crise n’aurait pu être surmontée sans un
engagement à long terme basé sur une succession d’avancées sociales et
non sur un dispositif de communication, aussi performant fut-il.
Les limites de la communication
Il est d’abord nécessaire de considérer que face à l’ampleur de certains
événements, la communication est impuissante. Une communication de
crise optimale n’aurait eu aucune efficacité face à des événements comme
10
: Lise Chartier, « Hydro Québec et les médias », in Danielle Maisonneuve et al., Communication en temps de
crise, Presses de l’Université du Québec, 1999, p. 133
11
: Jim Adamson, The Denny’s story, Wiley, 2000
12
: National Association for the Advancement of Coloured People

5
Tchernobyl ou Bhopal. L’événement est trop fort, il se grave directement
dans nos esprits et aucune communication ne peut en atténuer l’impact.
La communication de crise est un domaine d’étude qui reste embryonnaire
et sur lequel les certitudes sont infimes. Certaines procédures et stratégies
fonctionnent dans certaines organisations, échouent ailleurs. Au sein
même de certaines structures, les résultats sont parfois aléatoires. Elf a
parfaitement géré l’affaire des avions renifleurs en 1983 mais échoué face
à celle des frégates. EDF a parfaitement conduit la crise tempête en 1999
mais a donné le sentiment d’hésiter lors de l’inondation de certaines
installations de la centrale nucléaire du Blayais. Air France a
remarquablement géré la crise sociale à la veille de la coupe du monde de
football en 1998 et échoué à comprendre la campagne médiatique après
avoir refusé le 9 juillet 1998 l’embarquement d’un adulte trisomique.
La communication de crise semble obéir à des modes. Durant longtemps,
l’école technicienne pour laquelle il est préférable de communiquer sur des
faits concrets, précis et rationnels prévalut. Actuellement, l’école symboliste
apparaît dominante. Sa vision repose sur l’idée que lors d’une crise, la
perception se déplace sur un registre affectif, émotionnel, visuel. Il faudrait
ainsi communiquer sur un sentiment d’empathie, sur une attitude
responsable, sur une volonté de transparence. Il est probable que
l’habitude d’entendre les chefs d’entreprise se déclarer « bouleversés » lors
de chaque catastrophe réduira la crédibilité de cette approche. Le recours
au concept de transparence n’a jamais été autant utilisé que par les
groupes Enron et Vivendi.
Le temps des paradoxes
La communication de crise vit sur un certain nombre de principes intangibles, règles
de bon sens dont l’application scrupuleuse permettrait d’émerger de la crise sans
dommage. Une analyse approfondie indique toutefois que leurs applications sont
irréalistes voire contradictoires entre elles.
Tarte à la crème des communicants de crise, l’un des premiers devoirs de
l’entreprise en crise serait « d’obéir au principe de la transparence de
l’information »
13
. La formule incantatoire se heurte aussitôt à l’observation
que la logique industrielle est parfois fondamentalement opposée à la
transparence pure et parfaite. Le secret industriel gouverne amplement
l’économie de marché et il n’est pas certain qu’une communication
d’entreprise sur les risques potentiels et les incertitudes soit le meilleur outil
de rassurance.
La désignation d’un porte-parole unique et entraîné à la prise de parole
figure en bonne place dans les modalités de communication de crise. La
recette serait excellente si elle n’oubliait un interlocuteur de taille, le
journaliste. Ceux-ci étaient près d’un millier à Toulouse au lendemain de
13
: Michèle Gabay, « La nouvelle communication de crise », Stratégies, 2001, p. 167
 6
6
1
/
6
100%