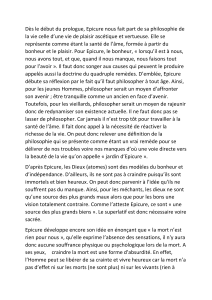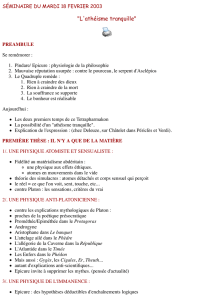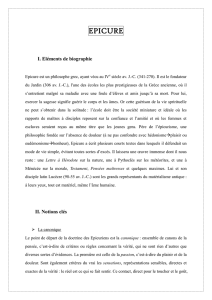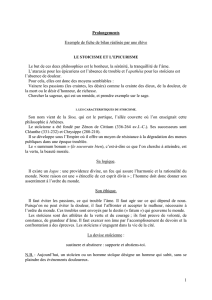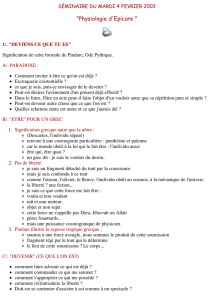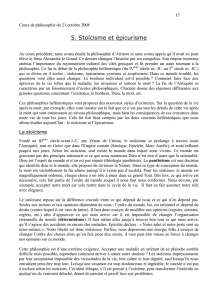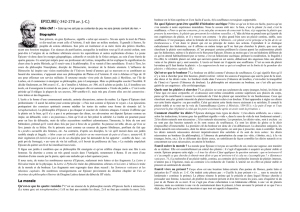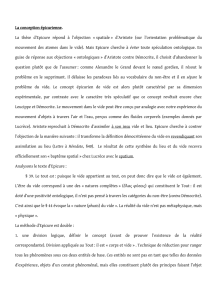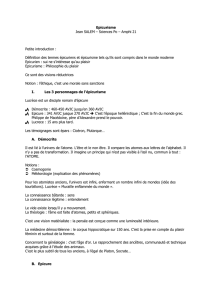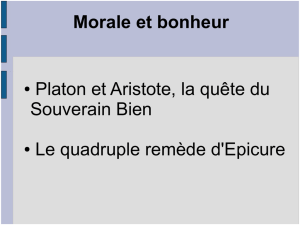ii. le soin de l`ame : les dieux et la mort

1
Lettre à Ménécée
Épicure
I: Texte:
"Épicure à Ménécée, salut.
Même jeune, on ne doit pas hésiter à philosopher. Ni, même au seuil de la vieillesse, se fatiguer de
l’exercice philosophique. Il n’est jamais trop tôt, qui que l’on soit, ni trop tard pour
l’assainissement de l’âme. Tel, qui dit que l’heure de philosopher n’est pas venue ou qu’elle est
déjà passée, ressemble à qui dirait que pour le bonheur, l’heure n’est pas venue ou qu’elle n’est plus.
Sont donc appelés à philosopher le jeune comme le vieux. Le second pour que, vieillissant, il reste
jeune en biens par esprit de gratitude à l’égard du passé. Le premier pour que jeune, il soit aussi un
ancien par son sang-froid à l’égard de l’avenir. En définitive, on doit donc se préoccuper de ce qui
crée le bonheur, s’il est vrai qu’avec lui nous possédons tout, et que sans lui nous faisons tout pour
l’obtenir. Ces conceptions, dont je t’ai constamment entretenu, garde-les en tête. Ne les perds pas
de vue quand tu agis, en connaissant clairement qu’elles sont les principes de base du bien vivre.
D’abord, tenant le dieu pour un vivant immortel et bienheureux, selon la notion du dieu
communément pressentie, ne lui attribue rien d’étranger à son immortalité ni rien d’incompatible
avec sa béatitude. Crédite-le, en revanche, de tout ce qui est susceptible de lui conserver, avec
l’immortalité, cette béatitude. Car les dieux existent : évidente est la connaissance que nous avons
d’eux. Mais tels que la foule les imagine communément, ils n’existent pas : les gens ne prennent
pas garde à la cohérence de ce qu’ils imaginent. N’est pas impie qui refuse des dieux populaires,
mais qui, sur les dieux, projette les superstitions populaires. Les explications des gens à propos des
dieux ne sont pas des notions établies à travers nos sens, mais des suppositions sans fondement. A
cause de quoi les dieux nous envoient les plus grands malheurs, et faveurs : n’ayant affaire en
permanence qu’à leurs propres vertus, ils font bonne figure à qui leur ressemble, et ne se sentent
aucunement concernés par tout ce qui n’est pas comme eux.
Familiarise-toi avec l’idée que la mort n’est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal résident
dans la sensation, et que la mort est l’éradication de nos sensations. Dès lors, la juste prise de
conscience que la mort ne nous est rien autorise à jouir du caractère mortel de la vie : non pas en lui
conférant une durée infinie, mais en l’amputant du désir d’immortalité.
Il s’ensuit qu’il n’y a rien d’effrayant dans le fait de vivre, pour qui est radicalement conscient qu’il
n’existe rien d’effrayant non plus dans le fait de ne pas vivre. Stupide est donc celui qui dit avoir
peur de la mort non parce qu’il souffrira en mourant, mais parce qu’il souffre à l’idée qu’elle
approche. Ce dont l’existence ne gêne point, c’est vraiment pour rien qu’on souffre de l’attendre !
Le plus effrayant des maux, la mort ne nous est rien, disais-je : quand nous sommes, la mort n’est
pas là, et quand la mort est là, c’est nous qui ne sommes pas ! Elle ne concerne donc ni les vivants
ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n’est point, et que les autres ne sont plus.
Beaucoup de gens pourtant fuient la mort, soit en tant que plus grands des malheurs, soit en tant que
point final des choses de la vie. Le philosophe, lui, ne craint pas le fait de n’être pas en vie : vivre ne
lui convulse pas l’estomac, sans qu’il estime être mauvais de ne pas vivre. De même qu’il ne choisit

2
jamais la nourriture la plus plantureuse, mais la plus goûteuse, ainsi n’est-ce point le temps le plus
long, mais le plus fruité qu’il butine ? Celui qui incite d’un côté le jeune à bien vivre, de l’autre le
vieillard à bien mourir est un niais, non tant parce que la vie a de l’agrément, mais surtout parce que
bien vivre et bien mourir constituent un seul et même exercice. Plus stupide encore celui qui dit
beau de n’être pas né, ou
sitôt né, de franchir les portes de l’Hadès.
S’il est persuadé de ce qu’il dit, que ne quitte-t-il la vie sur-le-champ ? Il en a l’immédiate
possibilité, pour peu qu’il le veuille vraiment. S’il veut seulement jouer les provocateurs, sa
désinvolture en la matière est déplacée. Souvenons-nous d’ailleurs que l’avenir, ni ne nous
appartient, ni ne nous échappe absolument, afin de ne pas tout à fait l’attendre comme devant
exister, et de n’en point désespérer comme devant certainement ne pas exister.
Il est également à considérer que certains d’entre les désirs sont naturels, d’autres vains, et si
certains des désirs naturels sont contraignants, d’autres ne sont... que naturels. Parmi les désirs
contraignants, certains sont nécessaires au bonheur, d’autres à la tranquillité durable du corps,
d’autres à la vie même. Or, une réflexion irréprochable à ce propos sait rapporter tout choix et rejet
à la santé du corps et à la sérénité de l’âme, puisque tel est le but de la vie bienheureuse. C’est sous
son influence que nous faisons toute chose, dans la perspective d’éviter la souffrance et l’angoisse.
Quand une bonne fois cette influence a établi sur nous son empire, toute tempête de l’âme se
dissipe, le vivant n’ayant plus à courir comme après l’objet d’un manque, ni à rechercher cet autre
par quoi le bien, de l’âme et du corps serait comblé. C’est alors que nous avons besoin de plaisir :
quand le plaisir nous torture par sa non-présence. Autrement, nous ne sommes plus sous la
dépendance du plaisir.
Voilà pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse. C’est lui
que nous avons reconnu comme bien premier, né avec la vie. C’est de lui que nous recevons le
signal de tout choix et rejet. C’est à lui que nous aboutissons comme règle, en jugeant tout bien
d’après son impact sur notre sensibilité. Justement parce qu’il est le bien premier et né avec notre
nature, nous ne bondissons pas sur n’importe quel plaisir : il existe beaucoup de plaisirs auxquels
nous ne nous arrêtons pas, lorsqu’ils impliquent pour nous une avalanche de difficultés. Nous
considérons bien des douleurs comme préférables à des plaisirs, dès lors qu’un plaisir pour nous
plus grand doit suivre des souffrances longtemps endurées. Ainsi tout plaisir, par nature, a le bien
pour intime parent, sans pour autant devoir être cueilli. Symétriquement, toute espèce de douleur
est un mal, sans que toutes les douleurs soient à fuir obligatoirement.
C’est à travers la confrontation et l’analyse des avantages et désavantages qu’il convient de se
décider à ce propos. Provisoirement, nous réagissons au bien selon les cas comme à un mal, ou
inversement au mal comme à un bien.
Ainsi, nous considérons l’autosuffisance comme un grand bien : non pour satisfaire à une
obsession gratuite de frugalité, mais pour que le minimum, au cas où la profusion ferait défaut,
nous satisfasse. Car nous sommes intimement convaincus qu’on trouve d’autant plus d’agréments
à l’abondance qu’on y est moins attaché, et que si tout ce qui est naturel est plutôt facile à se
procurer, ne l’est pas tout ce qui est vain. Les nourritures savoureusement simples vous régalent
aussi bien qu’un ordinaire fastueux, sitôt éradiquée toute la douleur du manque : galette d’orge et
eau dispensent un plaisir extrême, dès lors qu’en manque on les porte à sa bouche. L’accoutumance

3
à des régimes simples et sans faste est un facteur de santé, pousse l’être humain au dynamisme dans
les activités nécessaires à la vie, nous rend plus aptes à apprécier, à l’occasion, les repas luxueux et,
face au sort, nous immunise contre l’inquiétude.
Quand nous parlons du plaisir comme d’un but essentiel, nous ne parlons pas des plaisirs du noceur
irrécupérable ou de celui qui a la jouissance pour résidence permanente — comme se l’imaginent
certaines personnes peu au courant et réticentes, ou victimes d’une fausse interprétation — mais
d’en arriver au stade où l’on ne souffre pas du corps et ou l’on n’est pas perturbé de l’âme. Car ni
les beuveries, ni les festins continuels, ni les jeunes garçons ou les femmes dont on jouit, ni la
délectation des poissons et de tout ce que peut porter une table fastueuse ne sont à la source de la
vie heureuse : c’est ce qui fait la différence avec le raisonnement sobre, lucide, recherchant
minutieusement les motifs sur lesquels fonder tout choix et tout rejet, et chassant les croyances à la
faveur desquelles la plus grande confusion s’empare de l’âme.
Au principe de tout cela, comme plus grand bien : la prudence. Or donc, la prudence, d’où sont
issues toutes les autres vertus, se révèle en définitive plus précieuse que la philosophie : elle nous
enseigne qu’on ne saurait vivre agréablement sans prudence, sans honnêteté et sans justice, ni avec
ces trois vertus vivre sans plaisir. Les vertus en effet participent de la même nature que vivre avec
plaisir, et vivre avec plaisir en est indissociable.
D’après toi, quel homme surpasse en force celui qui sur les dieux nourrit des convictions
conformes à leurs lois ? Qui face à la mort est désormais sans crainte ? Qui a percé à jour le but de
la nature, en discernant à la fois comme il est aisé d’obtenir et d’atteindre le « summum » des biens,
et comme celui des maux est bref en durée ou en intensité ; s’amusant de ce que certains mettent en
scène comme la maîtresse de tous les événements — les uns advenant certes par nécessité, mais
d’autres par hasard, d’autres encore par notre initiative —, parce qu’il voit bien que la nécessité n’a
de comptes à rendre à personne, que le hasard est versatile, mais que ce qui vient par notre initiative
est sans maître, et que c’est chose naturelle si le blâme et son contraire la suivent de près (en ce sens,
mieux vaudrait consentir à souscrire au mythe concernant les dieux, que de s’asservir aux lois du
destin des physiciens naturalistes : la première option laisse entrevoir un espoir, par des prières, de
fléchir les dieux en les honorant, tandis que l’autre affiche une nécessité inflexible).
Qui témoigne, disais-je, de plus de force que l’homme qui ne prend le hasard ni pour un dieu,
comme le fait la masse des gens (un dieu ne fait rien de désordonné), ni pour une cause fluctuante
(il ne présume pas que le bien ou le mal, artisans de la vie bienheureuse, sont distribués aux
hommes par le hasard, mais pense que, pourtant, c’est le hasard qui nourrit les principes de grands
biens ou de grands maux) ; l’homme convaincu qu’il est meilleur d’être dépourvu de chance
particulière tout en raisonnant bien que d’être chanceux en déraisonnant, l’idéal étant évidemment,
en ce qui concerne nos actions, que ce qu’on a jugé « bien » soit entériné par le hasard.
A ces questions, et à toutes celles qui s’y rattachent, réfléchis jour et nuit pour toi-même et pour qui
est semblable à toi, et veillant ou rêvant jamais rien ne viendra te troubler gravement : ainsi
vivras-tu comme un dieu parmi les humains. Car il n’a rien de commun avec un vivant mortel,
l’homme vivant parmi des biens immortels."
II Explication:

4
Introduction:
On oppose traditionnellement Epicure aux stoïciens. Il est vrai que l'on a affaire dans un cas à une
morale du bonheur et du plaisir; dans l'autre, à une morale du devoir et de la vertu. L'adjectif
"épicurien", passé dans le vocabulaire courant, désignera en effet le bon vivant, celui qui aime les
plaisirs de la vie, tandis que l'image du sage stoïcien est plutôt celle d'un homme résigné, qui se plie
à la nécessité et dont l'idéal de vie repose sur la modération: "Abstiens-toi et supporte", dit la devise
de Marc Aurèle. En réalité, cette opposition est le résultat d'une déformation de la pensée d'Epicure.
Le poète latin Horace est en partie responsable de cette caricature qui fait des épicuriens les
"pourceaux du troupeau d'Epicure". Cette conception vulgaire, qui ramène la morale épicurienne à
l'invitation à satisfaire tous ses désirs, témoigne d'une méconnaissance de la doctrine du philosophe
du Jardin. S'il est vrai qu'il faut "profiter de la vie", que doit-on comprendre par ces mots?
Eléments biographiques:
Epicure vit aux IVème et IIIème siècles avt J.C. (il est né à Samos en 341). Il s'installe à Athènes où
il fonde une école baptisée le Jardin, en référence à la propriété où il vit en communauté avec ses
disciples, où l'on est accueilli par ces mots: "Ici le souverain bien est le plaisir".
La plus grande partie de son œuvre (De la nature ou Peri physeos) est perdue. Il ne nous reste que
quelques fragments de ce traité découverts dans une maison de Pompéi, ainsi que trois lettres et les
Maximes capitales, conservées grâce à Diogène Laërce, qui nous les a transmises dans ses Dix
livres sur les vies et les sentences des philosophes illustres (livre X). Enfin, les Sentences vaticanes
ont été découvertes dans une bibliothèque du Vatican
Heureusement, Epicure a eu un disciple peu original, mais fidèle: Lucrèce (I er siècle avt J.C.), dont
le De la nature reprend le titre du livre d'Epicure, expose en vers les idées de son maître. La
doctrine d'Epicure, comme celle des stoïciens, peut être divisée en trois parties:
La canonique (théorie de la connaissance) remplace la logique
La physique
La morale
La Lettre à Pythoclès est à caractère scientifique, elle concerne les phénomènes naturels, en
particulier météorologiques; la Lettre à Hérodote est un résumé de la canonique et de la physique;
la Lettre Ménécée est un abrégé de la morale d'Epicure. La morale repose sur la théorie de la
connaissance et sur la connaissance de la nature. Il faut donc avoir quelques notions de canonique
et de physique épicuriennes pour comprendre les fondements de sa morale.

5
I. LES FONDEMENTS DU SYSTEME : CANONIQUE ET PHYSIQUE
1. L'évidence sensible
La canonique (canon = critère) est la recherche du critère du vrai. A quoi reconnaît-on une
connaissance vraie? Qu'est-ce qui peut garantir que l'on est dans le vrai? Selon Epicure, c'est la
sensation (aisthésis). Epicure s'inspire des cyrénaïques, notamment Aristippe. La sensation est
toujours vraie, elle est infaillible. Le critère du vrai, c'est l'évidence sensible (énargeia), le
sentiment d'évidence qui accompagne les données sensibles. C'est paradoxal. Une telle affirmation
se heurte à l'objection des illusions des sens. Un sceptique aura tôt fait de trouver des exemples
pour mettre une telle doctrine en difficulté. Les sens nous trompent parfois, dira-t-il, et les
exemples d'illusions sensibles ne manqueront pas. Comment la sensation pourrait-elle être critère
du vrai, puisque, par exemple, une tour carrée, vue de loin, paraît ronde? Comment Epicure
prend-il en compte cette objection?
Il maintient que la sensation est toujours vraie, mais concède que sa validité est limitée d'une part à
l'instant où elle est éprouvée, et d'autre part au sujet qui l'éprouve. A l'instant où je vois la tour
ronde, il est vrai que je la vois ronde. C'est évident. Descartes rappellera à son tour que la
subjectivité détermine un champ d'évidence absolue: quelle que soit la vérité de ce que je pense, il
est certain que je le pense. En revanche, si je prends le risque d'étendre ma certitude à tous les sujets
ou à tous les moments, je peux me tromper. Tant que je me contente de dire que je vois la tour
ronde, je ne cours aucun risque d'erreur; en revanche, si j'affirme que la tour est effectivement
ronde, alors je peux me tromper. Autrement dit, ce ne sont pas les sens eux-mêmes qui nous
trompent. Toute erreur vient du jugement ou, dit Epicure, de l'opinion que l'on ajoute aux
informations reçues des sens. Les sens ne se trompent jamais parce qu'ils ne jugent pas. Si, au loin,
j'aperçois quelqu'un qui ressemble à un ami, je ne peux me tromper que si j'anticipe, si j'affirme
qu'il s'agit bien de lui. La sensation est donc critère de vérité; le jugement, en revanche, est source
d'erreur. C'est pourquoi la doctrine d'Epicure ne repose pas, comme celle des stoïciens, sur une
logique.
2. La méthode
Fort de cette théorie, Epicure peut se lancer dans la connaissance de la nature selon une méthode
expérimentale, donc fondée sur les données sensibles. Or, Epicure reprend la maxime de
Démocrite: "La vérité est profondément enfouie", ou "la vérité est cachée". C'est-à-dire: la vérité
n'est pas manifeste, elle n'est pas sensible. Comment peut-il faire sienne cette affirmation alors
qu'il tient la sensation seule pour infaillible?
La formule de Démocrite signifie que l'on ne peut pas expliquer le visible par lui-même. Ce que la
nature nous donne à voir n'est pas explicable par soi seul, le visible ne suffit pas à s'auto-expliquer.
Il faut, pour expliquer les phénomènes, supposer quelque chose d'invisible. Ce qui est donné aux
sens doit être expliqué par des principes invisibles. Mais comment faire, puisque seule la sensation
est critère du vrai? L'expérience va servir de contrôle. Chaque hypothèse doit être confrontée à
l'expérience, mise en parallèle avec les données sensibles pour voir si elle n'est pas contredite par
elles. Si l'hypothèse a des conséquences contraires à ce que l'on observe, c'est donc qu'elle est
fausse. En revanche, si elle permet, sans contradiction, d'expliquer les phénomènes, alors elle est
probable.
Quels sont ces principes des choses qui échappent à l'expérience et sont cependant confirmés par
elle, grâce auxquels Epicure explique les phénomènes naturels et la constitution de l'univers?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%