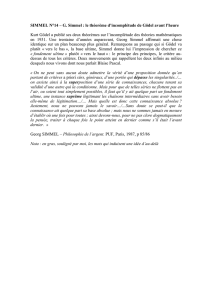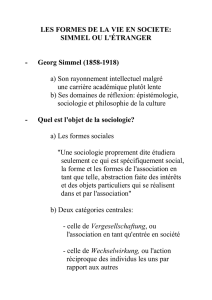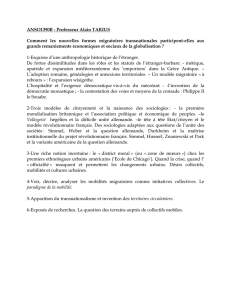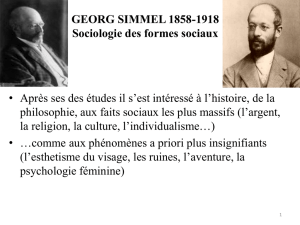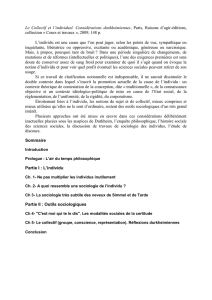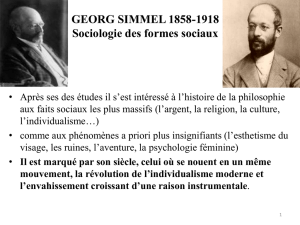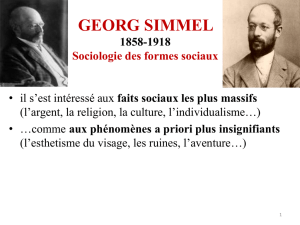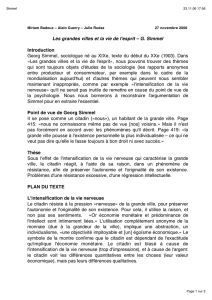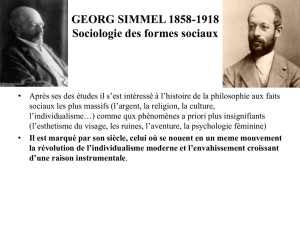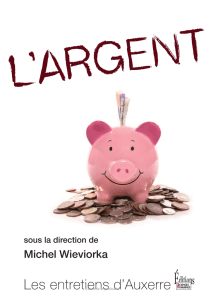Philippe CORCUFF - Université Populaire de Lyon

1
Université Populaire de Lyon
Janvier/avril 2005
Figures du je dans les sociétés individualistes contemporaines
(sociologie)
Philippe CORCUFF
(Maître de conférences de science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon)
Séance 4 (2 février 2005) : Les classiques de la sociologie-3 : Georg Simmel
(1858-1918) et l’individualisation
- Avertissement :
Ce texte rassemble les notes écrites qui ont servi pour le cours, dont
l’enregistrement a été perdu -
I – Les classiques de la sociologie (Marx – Durkheim – Simmel)
On a commencé à aborder les thèmes de « l’individualité », de « l’individualisation » et
de « l’individualisme » chez deux classiques des sciences sociales, Marx et Durkheim.
Aujourd’hui, je vais consacrer mon cours à un pionnier de la sociologie allemande
moins connu en France, Georg Simmel, mais qui est redécouvert depuis quelques
années. Par contre, il a eu des effets plus anciens sur la sociologie allemande, bien
sûr, dont il est un des fondateurs avec Max Weber, mais aussi sur la sociologie
américaine. Je rappelle que la 2e heure sert à clarifier des points, des questions, des
débats soulevés dans la 1e heure, n’hésitez donc pas à intervenir et poser des
questions.
I.3 - Georg Simmel (1858-1918) et l’individualisation
------------------------------------------------------------------
Bibliographie utilisée
* Georg Simmel (1858-1918)
. Philosophie de l’argent (PA, 1900)
. Sociologie (S, 1908)
* Max Weber (1864-1920) : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905)
* Frédéric Vandenberghe : La sociologie de Georg Simmel (FV, La Découverte,
« Repères », 2001)
---------------------------------------------------------------------
Georg Simmel est un des fondateurs, avec Max Weber (1864-1920), de la sociologie
allemande. Lui aussi vient de la philosophie (il a fait une thèse sur Kant), et continue
plus que Weber à être un philosophe. On doit le définir alors tout à la fois comme un
philosophe et un sociologue. Je m’arrêterai sur deux ouvrages importants de Simmel.

2
L’un est une somme consacrée à l’argent, à la fois son histoire dans les sociétés
humaines et son rôle dans les sociétés modernes : Philosophie de l’argent (1900).
L’autre est conçu comme une synthèse générale de sa sociologie : Sociologie –
Etudes sur les formes de socialisation (1908). Comme je n’ai pas pour l’instant écrit
directement sur Simmel, je renvoie à un livre d’introduction qui resitue ses travaux de
manière intéressante ; il s’agit de : Frédéric Vandenberghe, La sociologie de Georg
Simmel (La Découverte, « Repères », 2001).
J’aborderai d’abord rapidement sa posture sociologique, puis le contenu de son
analyse de l’individualisation.
A – Une sociologie de “ l’action réciproque ”
Simmel centre son analyse, ni sur le tout de la société (holisme méthodologique), ni
sur les individus (individualisme méthodologique), mais sur les relations sociales
(relationnalisme méthodologique). Pour analyser ces relations, il avance un concept
directeur : celui d’ “ action réciproque ”. Par là, il entend l’influence que chaque individu
exerce sur autrui. “ L’idée que l’homme est déterminé dans son être tout entier et dans
toutes ses manifestations par le fait qu’il vit en action réciproque avec d’autres
hommes – voilà qui en fait doit conduire, dans tout ce que l'on nomme les sciences
humaines, à une nouvelle façon de voir les choses ”, note-t-il (S).
L’action réciproque inclut, pour Simmel, une variété de contenus, de tailles et de
stabilité : “ de la réunion éphémère en vue d’une promenade jusqu’à la famille, de
toutes les relations "provisoires" jusqu’à la constitution d’un Etat ”, écrit-il (S). La notion
d’action réciproque apparaît comme un concept général, qui prend la place centrale
occupée par “ la société ” (pour les holistes méthodologiques) et “ l’individu ” (pour les
individualistes méthodologiques) : “ Tout ce que les individus (…) recèlent comme
pulsions, intérêts, buts, tendances, états et mouvements psychiques, pouvant
engendrer un effet sur les autres ou recevoir un effet venant des autres ” (S).
« La société » ou les structures collectives (comme « l’Etat », « les classes sociales »,
etc.) peuvent alors être appréhendées comme des « actions réciproques durables ».
Ces « actions réciproques durables » acquièrent toutefois une réalité propre, distincte
des relations sociales qui les alimentent. Elles constituent des « objectivations » : non
pas un caractère « objectif » donné à l’avance, mais une « objectivité », une extériorité
produite au cours d’un processus de relations sociales>, des cristallisations de
relations sociales. Il y aurait donc tout à la fois un caractère émergent et cristallisé aux
institutions collectives : elles naissent d’un processus et elles acquièrent une
existence propre>. Simmel écrit : « Le tout, bien qu’il n’existe que grâce aux éléments
particuliers, acquiert quand même en face de ceux-ci une position autonome,
substantielle, indépendante d’eux » (cité par FV).
Avec cette vue relationnaliste, Simmel ne prétend pas incarner un point de vue total
sur les sociétés humaines et sur les êtres humains : la sociologie telle qu’il l’entend
n’est qu’une “ façon de voir ”, qu’un des “ points de vue ” possibles. Il récuse ainsi ce
qu’il appelle “ la nostalgie d’une image globale de la réalité qui embrasserait tous les
points de vue ” ; nostalgie qui peut-être la nostalgie du point de vue total longtemps
incarné par Dieu dans les sociétés humaines. On a donc une sociologie qui est

3
consciente de la pluralité des points de vues sur la réalité et qui est aussi consciente
des limites de son propre point de vue.
B – Relations sociales et individualisation
Tout à la fois dans le cours de l’histoire des sociétés humaines et dans le cours de la
socialisation de chaque individu, Simmel voit un facteur important d’individualisation
dans la multiplication des “ cercles sociaux ” auxquels participent les individus. Un
« cercle social », c’est une forme répétée de relations sociales (par exemple, se rendre
régulièrement dans une boulangerie le matin, c’est déjà participer à un « cercle
social »). Il repère ainsi une tendance convergente dans les premières sociétés
humaines comme dans les premiers apprentissages d’un individu au sein de la
famille : “ L’individu se voit d’abord dans un environnement, qui, relativement
indifférent à son individualité, l’enchaîne à sa destinée et lui impose de vivre
étroitement lié à ceux auprès desquels le hasard de la naissance l’a placé ” (S). Mais
les choses (historiquement pour les sociétés et dans l’évolution biographique de
chacun) tendraient ensuite à se déplacer : “ cette évolution vise en fait à constituer des
relations associatives d’éléments homogènes issus de cercles hétérogènes ” (S).
Qu’est-ce à dire ? Que, d’abord, surtout lié à un seul groupe “ primaire ”, je vais rentrer
en relation avec de plus en plus de personnes d’autres groupes, et que je vais
moi-même appartenir à de plus en plus de groupes de tailles variables. Cela se passe
au niveau de la socialisation individuelle : “ Ainsi, la famille englobe un certain nombre
d’individualités diverses qui au départ sont très étroitement dépendantes de cette
association. Mais au fur et à mesure de l’évolution, chaque individu tisse des liens
situés à l’extérieur de ce premier cercle d’association ”, indique Simmel (S). Une chose
analogue se passerait au niveau global de l’évolution historique des sociétés
humaines.
La multiplication des “ cercles sociaux ” auxquels appartient un individu favoriserait
son individualisation, le développement de son individualité : “ c’est à partir des
différents éléments de la vie, dont chacun est apparu socialement ou est mêlé à des
facteurs sociaux, que nous constituons notre personnalité, ce que nous appelons la
subjectivité par excellence, qui produit des combinaisons individuelles des éléments
de la culture ” (S). La subjectivité de chacun serait constituée d’un agencement
individuel de dimensions sociales Ainsi Simmel associe le développement de la
“ singularité ” individuelle au “ croisement individuel des cercles sociaux ”. L’individu
apparaît alors, de manière convergente avec Marx, comme une combinaison
singulière de relations sociales. La singularité de ces combinaisons individuelles
s’accroîtrait historiquement avec le développement des relations sociales de chacun.
C’est ce que note encore Simmel : “ La personnalité morale acquiert des
déterminations, mais aussi des tâches tout à fait nouvelles, quand elle cesse d’être
solidement enracinée dans un seul cercle pour se situer au croisement de nombreux
cercles ” (S).
C – Ambivalences de l’individualisation
Dans son livre Sociologie, Simmel note une série d’ambivalences et de contradictions
dans ce mouvement historique d’individualisation dans les sociétés humaines :

4
* Une 1e contradiction entre la pluralité de la personne et son unité : Simmel observe
ainsi que, dans les sociétés modernes, “ la pluralité des appartenances sociologiques
engendre des conflits internes et externes, qui menacent l’individu de dualité
psychique, voire de déchirement ” (S). Toutefois, optimiste sur ce point, il pense que
cette tendance dissociatrice est le plus souvent surmontée au profit de l’unité
individuelle : “ plus la variété des intérêts des groupes qui se rencontrent en nous et
veulent s’exprimer est grande, plus le moi prend nettement conscience de son unité ”
(S).
* Une 2e ambivalence concerne la division du travail : Simmel voit que, d’une part, le
développement de la division du travail et de la spécialisation du travail participe de cet
élargissement des “ cercles sociaux ” accessibles aux individus dans une société de
plus en plus complexe. C’est ce qui le rapproche de la défense par Durkheim de la
division du travail comme facteur d’individualisation. D’autre part, il saisit aussi dans la
division du travail un appauvrissement du côté de l’individu. Il prend un cas : “ ainsi,
par exemple l’ouvrière sur machine à broder exerce une activité beaucoup plus
dépourvue d’esprit que la brodeuse – alors que l’esprit de cette activité est en quelque
sorte passé dans la machine ” (S). Ici Simmel se rapproche de la critique par Marx de
la division du travail. Sans résoudre cette contradiction, Simmel met en quelque sorte
en tension Durkheim et Marx, les effets positifs et négatifs de la division du travail pour
la consolidation de l’individualité sociale.
* Une troisième contradiction est pointée par Simmel : entre l’émancipation des liens
traditionnels des sociétés les plus restreintes et les plus fermées, qui apporte à
l’individu de plus grandes marges de liberté, d’une part, et la “ solitude croissante de la
personne ”, la “ privant de bien des secours et des avantages du groupe restreint ”,
d’autre part (dans S). Si on se retourne sur nos ambivalences personnelles vis-à-vis de
notre propre famille – nos attitudes ambivalentes dans des époques différentes ou
même à un même moment -, on comprend mieux cette contradiction : car la famille
peut être vécue comme une protection, un cocon qui nous permet de nous réfugier
et/ou comme un étouffoir dont il faut s’émanciper. Si on envisage des problèmes
actuels de société, on comprendra mieux aussi le sens de cette contradiction : la face
positive, ce serait par exemple le mouvement d’émancipation des femmes vis-à-vis
des dépendances traditionnelles de la famille patriarcale ; la face sombre, ce serait la
mort solitaire de milliers de personnes âgées l’été de la canicule.
Simmel suggère que l’évolution moderne offre un moyen d’atténuer cette contradiction
(sans la faire disparaître) : l’accroissement du nombre de liens sociaux plus légers
compenserait pour partie la perte d’un nombre de liens sociaux plus solides. Simmel
écrit : “ alors cette production de cercles et de confréries où peuvent se retrouver un
nombre quelconque de gens aux intérêts communs, compense cette solitude
croissante de la personne qu’engendre la rupture avec le strict enclavement qui
caractérisait la situation antérieure ” (S).
D – Les ambivalences des sociétés modernes dans Philosophie de l’argent
Dans son livre Philosophie de l’argent, Simmel apporte des éclairages spécifiques
complémentaires sur l’individualisation.

5
Tout d’abord, historiquement, il analyse un processus antérieur au développement de
la monnaie, mais qui l’a rendu possible. Il s’agit de la dissociation du sujet et de l’objet.
A l’origine des sociétés humaines, la vie psychique se trouverait dans une état
d’indifférence : n’étant pas encore conscient ni de soi-même en tant que sujet ni des
objets qui l’entourent, le sujet ne serait que pulsions et se confondrait avec ses
pulsions. Or, dans le processus de différenciation entre le sujet et les objets, l’homme
va être amené à dire « je », en se démarquant du monde extérieur, en se distanciant
du monde extérieur. L’individu conscient de lui-même comme sujet ne serait donc pas
historiquement premier, mais le produit d’un processus de différenciation sujet/objet.
Ensuite, Simmel, dans son analyse historique du développement de la monnaie et du
monde de la marchandise, va mettre en évidence que cette monétarisation va créer de
l’individualisation, et même de la liberté individuelle. Dans les groupes restreints des
sociétés traditionnelles, l’individu serait fortement dépendant de ses relations avec les
autres (par exemple, dans la famille de la société villageoise). Les groupes plus larges
des sociétés modernes lui donneraient plus d’autonomie. Notamment l’économie
monétaire a permis à l’individu de se libérer de l’étroitesse des relations de
dépendance interpersonnelle des sociétés traditionnelles.
Autre facteur d’individualisation : la rationalisation instrumentale, en particulier à
travers le développement du calcul coûts/avantages de l’homo œconomicus, du calcul
de son intérêt économique personnel. Il y a là une convergence avec Max Weber dans
son analyse classique sur L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme
(1904-1905), qui lui aussi mettait l’accent sur l’émergence et la consolidation de
capacités individuelles. Cela participe aussi de l’individualisation.
Mais Simmel met en évidence le caractère libérateur, mais aussi aliénant des sociétés
marchandes modernes. Il propose une esquisse de sociologie des ambivalences des
sociétés modernes. Car les œuvres humaines (la production matérielle ou les
productions culturelles) en se détachant de l’homme lui échapperaient, deviendraient
étrangères à ses producteurs. Il y a là une convergence avec l’analyse de l’aliénation
chez Marx : « aliénation religieuse », « aliénation politique » et « aliénation du travail »
dans ses œuvres de jeunesse, ou analyse du « fétichisme de la marchandise » dans le
livre 1 du Capital... Les produits humains « évoluent suivant une logique immanente, et
deviennent par là même étrangers à leur origine comme à leur fin » (cité par FV). Il y
aurait alors peu à peu « une perte de sens » de la vie humaine. Libération et aliénation,
individualisation et dépersonnalisation seraient les deux faces des sociétés modernes.
Simmel écrit : « Comme l’argent est à la fois symbole et cause de l’extériorisation
indifférente de tout ce qui se laisse avec indifférence extérioriser, il devient aussi le
gardien de l’intimité profonde », mais, ajoute-t-il, les objets humains deviennent à leur
tour « maîtres des hommes » .
E – Les deux individualismes de Simmel
Si l’on revient à son livre Sociologie, Simmel va identifier deux figures assez distinctes
de l’“individualisme” : “ l’individualisme de la similitude ” et “ l’individualisme de la
dissimilitude ”. Au 18e siècle des Lumières, aurait surtout été affirmé un
“ individualisme de la similitude ”, c’est-à-dire le souci de la liberté et de l’autonomie
individuelles dans l’égalité entre humains. C’est la période des “ droits de l’homme ”,
qui servent d’instrument “ de la délivrance des énergies personnelles à l’égard de toute
 6
6
 7
7
1
/
7
100%