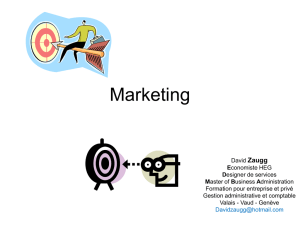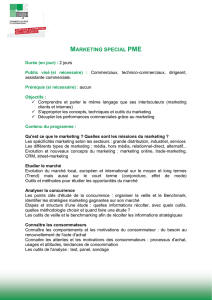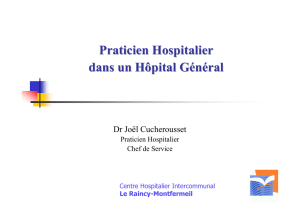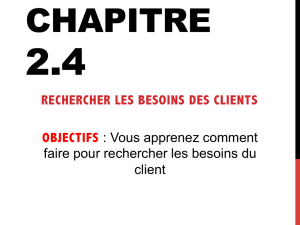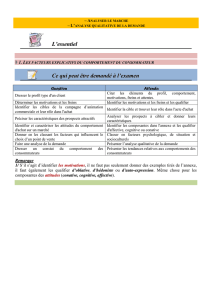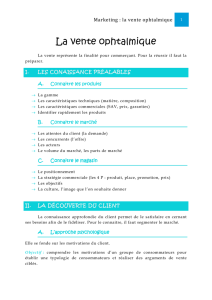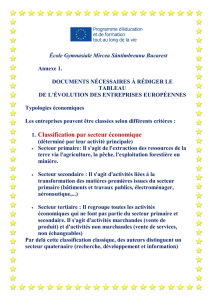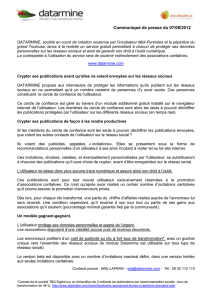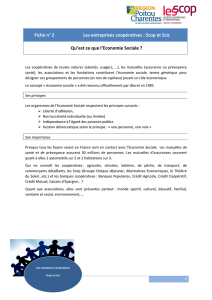les mutuelles et cooperatives : une histoire humaniste, preuve de

« LES MUTUELLES ET
COOPERATIVES : UNE HISTOIRE
HUMANISTE, PREUVE DE
DIVERSITE DANS UN PAYSAGE
CAPITALISTE »
Stéphanie ARNAUD
Professeur Associée
ICN Business School
L’Université Nancy 2
CEREFIGE
Cahier de Recherche n°2011-01
CEREFIGE
Université Nancy 2
13 rue Maréchal Ney
54000 Nancy
France
Téléphone : 03 54 50 35 80
Fax : 03 54 50 35 81
www.univ-nancy2.fr/CEREFIGE
n° ISSN 1960-2782

2
« Les mutuelles et coopératives : une histoire humaniste, preuve
de diversité dans un paysage capitaliste »1
1 Article présenté aux QUATRIEMES RENCONTRES INTERNATIONALES, DE LA DIVERSITE », « Faire vivre
la diversité » à CORTE, les 2, 3 et 4 octobre 2008
Résumé :
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont animées par des normes sociales
d’entraide et de partage du pouvoir égalitaire. Elles regroupent des salariés, bénévoles,
sociétaires et élus. Quels sont les modes de GRH adaptés aux spécificités de ces entreprises ?
Selon la théorie économique standard, l’homo oeconomicus n’est animé que de motivations
extrinsèques, asociales et amorales. Cette hypothèse étant rejetée dans le cas de l’ESS fondée
sur des valeurs morales et sociales, les préconisations managériales issues de l’économie
standard peuvent s’avérer contre-productives (cf littérature sur « les coûts cachés des
incitations »). A l’aide de la théorie de l’autodétermination, nous expliquons ce phénomène et
préconisons une GRH « conforme aux principes de la philosophie humaniste ».
Mots clés : Entreprises de l’économie sociale et solidaire / GRH humaniste / motivations
autorégulées / coûts cachés des
incitations.
Abstract:
Third sector organizations share a set of values and social norms, such as mutual assistance
and an egalitarian power sharing. Employees, voluntary workers, members and elected
representatives, constitute their human resources. What kinds of HRM types are appropriated
for the specific characteristics of these organizations? According to standard economic theory,
homo oeconomicus is only driven by asocial and amoral extrinsic motivations. Since the third
sector is based on moral and social values, this hypothesis is rejected. In consequence, for this
sector, standard economic recommendations, in terms of management, can be
counterproductive (See literature on the “hidden costs of incentive systems”). Using self-
determination theory (SDT) we explain these counterproductive effects, and we recommend a
HRM type based on the principles of humanist philosophy.
Key words: third sector organizations / Humanist HRM / self-regulated motivations / hidden
cost of incentives

3
Introduction
Les entreprises à but non lucratif sont regroupées dans le secteur « d’économie sociale et
solidaire », qui comprend les mutuelles, les coopératives, les diverses formes associatives, etc.
D'une part, tous ces organismes sont régis par un ensemble de règles institutionnelles de
gouvernance et une philosophie commune :
- principe de démocratie participative et égalitaire selon le principe « un homme = une
voix », lucrativité limitée, indivisibilité du capital propre de l’entreprise,
- valeurs et missions d’entraide sociale ; primautés de la personne sur l’économique et
de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel.
D'autre part, ces entreprises « sociales » combinent divers types de ressources humaines :
salariés, bénévoles, sociétaires, élus, etc. Quels sont les modes de GRH adaptés aux
spécificités de ces entreprises à but non lucratif ? Quelles préconisations managériales peut-on
établir afin d’améliorer l’efficience de ces entreprises ?
Nous allons voir que ces entreprises trouvent leur raison d’être dans des valeurs morales et
dans leur désir d’appliquer les normes sociales d’entraide et de réciprocité. Elles sont
porteuses d’un « sens collectif » fort et sont issues des mouvements humanistes du 19ièmes
siècle (Section 1). Or, selon l’économie néoclassique standard, l’homo oeconomicus n’est
animé que de motivations extrinsèques (agir sous l’effet d’incitations externes à la tâche, pour
obtenir par exemple une rémunération ou éviter une punition), de surcroît asociales et
amorales. Cette hypothèse s’éloigne donc d’autant plus de la réalité que l’on se rapproche des
entreprises à but non lucratif, puisque ces dernières sont animées par des valeurs morales et
normes sociales fortes. Par conséquent, nous proposons d'élargir le cadre conceptuel de
l'homo oeconomicus en intégrant les motivations intrinsèques (le plaisir issu directement de la
réalisation d’une tâche), ainsi que les motivations extrinsèques internalisées (vouloir adopter
un comportement ou réaliser un acte pour les valeurs et normes véhiculées ou atteintes)
(Section 2). Cet élargissement du spectre des motivations de l'homme au travail permet
d'expliquer « les coûts cachés des incitations » dont témoignent de nombreuses études
expérimentales et enquêtes de terrain. Nous allons voir, en effet, que les préconisations en
matière de GRH issues de l’économie standard peuvent s’avérer contre-productives pour les
entreprises de l'économie sociale (Section 3). La théorie de l’autodétermination (Deci &
Ryan, 2000) développée en psychologie et appliquée aux situations de travail, permet non
seulement d’expliquer ce phénomène, mais elle contient également un ensemble de
préconisations managériales pour stimuler les motivations intrinsèques et extrinsèques
internalisées des acteurs de l’entreprise. Cet article a donc pour vocation d’identifier des
modes de GRH pouvant nourrir la recherche d’efficience poursuivie par les organisations
« sociales ».
1. Historique et spécificités idéologiques et institutionnelles des entités de l’économie
sociale.
Au 19ième siècle, la volonté de lutter contre les dégâts du capitalisme industriel, tout en
refusant l'étatisation des moyens de production trouve comme solution l’invention de
nouvelles formes d'organisation d'entreprise, dans lesquelles le pouvoir et la propriété sont
partagés. Nous allons rappeler les mouvements sociaux et idéologiques qui ont fait naître
l’économie sociale et présenter ses spécificités institutionnelles actuelles.

4
1. 1. Son histoire et ses fondements idéologiques.
1. 1. 1. Son histoire
Au Moyen Age, les guildes, confréries, jurandes, compagnonnages et corporations
représentent les ancêtres de l’économie sociale. Les premières coopératives et mutuelles
apparaissent dans les années 1830. En 1844, « la Société des équitables pionniers de
Rochdale », coopérative de 28 ouvriers tisserands, voit le jour près de Manchester et
représentera un des plus grands succès dans l’histoire de cette forme organisationnelle. En
France, ce n’est qu’en 1852 que les sociétés de crédit mutuel sont reconnues par décret et en
1867 que la constitution d’entreprises coopératives devient légale. Quant à la loi fondatrice de
la mutualité, elle date de 1898. Pourtant, c’est en 1846 que Jean-Baptiste Godin, industriel
humaniste voulant supprimer la misère ouvrière et associer développement économique et
social, crée son entreprise, à laquelle il adosse « son Palais social » ou « Familistère », avec
un ensemble de services sociaux (loisirs, retraites) et une mutuelle. De 30 salariés au départ,
son entreprise passe en 1880 à 1500 membres et devient une coopérative ouvrière de
production, qui existera jusqu’en 1968. Tout au long du 19ième siècle, un combat contre la Loi
Le Chapelier est mené par les sociaux chrétiens (Frédéric Le Play, Charles Gide), les
républicains laïcs, les socialistes (Jean Jaurès), les solidaristes (Léon Bourgeois), pour
restaurer le droit de créer des regroupements volontaires sur des bases professionnelles.
Ces différents courants idéologiques refusent de croire que la pauvreté du prolétariat et la
misère constituent des faits inéluctables qui seraient aggravés par l’action volontaire –
contrairement aux libéraux qui défendent la thèse inverse – sans vouloir pour autant étendre à
l’excès le rôle de l’Etat. Pour eux, la solution se trouve dans l’action collective et volontaire
des personnes intéressées, accompagnée éventuellement du soutien étatique. La création de
mutuelles et de coopératives de production et de consommation doit permettre de lutter contre
la pauvreté et la croissance numérique du prolétariat en encourageant les producteurs
indépendants et l’entraide. Le mouvement mutualiste est ainsi né de la volonté des salariés de
développer des systèmes de solidarité pour se prémunir collectivement contre les risques de
maladie et d'invalidité.
L’idéologie de l’économie sociale ne relève donc pas du libéralisme économique
« pur », qui refuse toute intervention de l’Etat dans la sphère économique et prône le recours
au marché et aux actions privées pour toute création et allocation de richesses. Elle ne relève
pas non plus du socialisme « pur » selon lequel l’Etat doit organiser la solidarité nationale et
corriger les inégalités en s’appuyant sur un système de redistribution obligatoire et un service
public centralisés, des entreprises nationales, une économie gérée administrativement par « le
plan », etc. Les coopératives et mutuelles s’appuient sur le marché, (leurs activités sont
marchandes) sans toutefois avoir pour objectif « la constitution de profits ». Nous allons voir
que l’économie sociale relève d’une idéologie « humaniste » et plus précisément
« personnaliste », car elle place « la personne », avec sa liberté, sa responsabilité et sa dignité,
au centre de l’action économique.
1. 1. 2. L’humanisme comme fondement idéologique
L’humanisme englobe de nombreuses écoles de pensée (courants de la Renaissance et du
siècle des Lumières), dont le « personnalisme » développé au 20ième siècle, qui a pour
affirmation centrale « l’existence de personnes libres et créatrices » (Mounier, 1949, p.4).
L’homme n’est pas un être prédéterminé, par une divinité, la Nature, le Cosmos, ou la Cité,

5
mais un être autonome et responsable, qui trouve ses fins et ses raisons d’exister en lui. Il se
distingue de l’animal par sa sphère de liberté, par sa capacité à s’autodéterminer et à vouloir
donner un sens à sa vie. Quelles sont les conditions propices à l’expression de cette quête « de
l’auto accomplissement » (Leroux, 1999, p.46), à cette logique de l’autodétermination ?
- Premièrement, la personne a besoin d’un espace de liberté et d’autonomie pour se
créer, se déterminer et choisir les modalités d’élaboration et d’expression de sa personnalité.
L’action doit exprimer et ce faisant, prolonger et développer l’identité de l’acteur.
- Deuxièmement, la quête de l’auto accomplissement conduit la personne à vouloir
exprimer et concrétiser ses talents et qualités qu’elle sent détenir en elle de façon potentielle
(Leroux, 1999). Ce qui se traduit par un besoin d’éprouver ses compétences, de les affirmer et
de les stimuler. Pour cela, l’homme doit pouvoir façonner la matière et plus largement le
monde extérieur afin de s’exprimer et imprimer en lui, à la manière de l’artiste, ses talents et
sa personnalité.
- Troisièmement, la philosophie personnaliste postule la nécessité, pour la personne,
de convoquer le regard d’autrui sur ses actions, afin d’en obtenir la reconnaissance,
indispensable à un sentiment complet d’existence. « Mis en appel, notre jugement réclame le
concours d’un tiers, appelé à porter sa propre évaluation sur notre acte et ce qu’il révèle. »
(Leroux, 1999, p.73.) Le personnalisme présente l’altérité comme constitutive de notre pleine
humanité. La rencontre avec l’Autre engendre une nouvelle naissance pour l’individu car
désormais il est aux yeux d’autrui. « On me regarde, donc je existe » (Todorov, 1995, p.38).
Mais ce sentiment d’existence grâce à la reconnaissance d’autrui doit être maintenu tout au
long de la vie : A chaque nouvelle rencontre, le sujet va tenter d’obtenir la reconnaissance de
l’autre afin de se sentir exister à ses yeux. « L’appétit de la reconnaissance est désespérant.
(…) Notre incomplétude est donc non seulement constitutive, elle est aussi inguérissable »
(Todorov, 1995, p.118). Cette demande de reconnaissance par le regard d’autrui participe à la
recherche d’intériorité du sujet, à l’élaboration de son identité, et l’aide ainsi à répondre à la
question « Qui suis-je ? », voire « Quel sens donner à ma vie ? ». « La personne nous apparaît
aussi comme une présence dirigée vers le monde (…) Les autres personnes ne la limitent pas,
elles la font être et croître. Elle n’existe que vers autrui, elle ne se connaît que par autrui, elle
ne se trouve qu’en autrui. L’expérience primitive de la personne est l’expérience de la
seconde personne. Le tu, et en lui le nous, précède le je, ou au moins l’accompagne »
(Mounier, 1949, p33).
En résumé, pour vivre pleinement cette quête d’autodétermination et
d’accomplissement de soi, la philosophie personnaliste affirme que la personne a besoin d’un
espace de liberté et d’autonomie, de la possibilité d’exprimer ses talents potentiels et ses
compétences (Leroux, 1999), et enfin, de pouvoir convoquer un regard bienveillant d’autrui,
afin d’en recueillir une attention suffisante, nécessaire à l’obtention d’une reconnaissance
(Mounier, 1949 ; Todorov, 1995). Cependant, la création de soi par soi « ne peut se déployer
sans un confort matériel minimum. Quand l’être humain ne peut satisfaire des besoins
physiques élémentaires, des désirs psychiques primordiaux ou des exigences sociales
fondamentales, il ne vit plus. Tout au plus, survit-il » (Leroux, 1999, p.133-134). L’économie
sociale a justement comme mission d’éviter que toute personne soit « affamée,
désespérée ou exclue », avec comme objectif de promouvoir une organisation
économique créatrice de lien social et d’entraide, reposant sur des personnes libres et
responsables. Elle défend les initiatives privées « à utilité sociale », comme le revendiquent
les chartes française et européenne de ce secteur économique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%