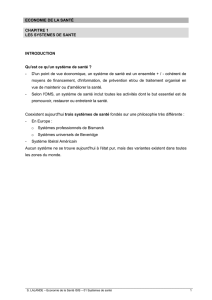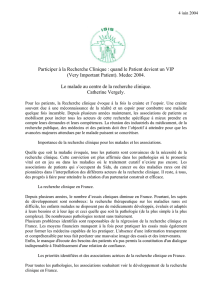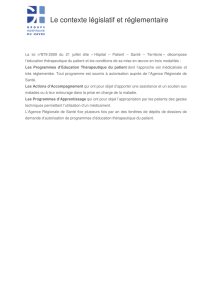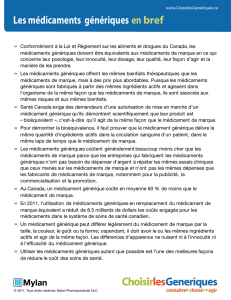I. Les offreurs de soins

__________________________________________________________________________________________________________
S. LALANDE – Economie de la Santé ISIS – 04 Offre de soins 1
ECONOMIE DE LA SANTE
CHAPITRE 4
LE COMPORTEMENT DES AGENTS – L'OFFRE DE SOINS
L'offre se caractérise par sa très grande diversité, en termes de :
- Statut économique public / privé
- Objectifs gestion d'un service public / profit
- Demande local / national / international
- Situation monopole / concurrence
- Taille grande taille / isolé
- Concentration fort / faible
I. LES OFFREURS DE SOINS
A. LES MEDECINS
1. Organisation de la profession
La profession médicale est une profession très réglementée caractérisée par :
- Un diplôme d'Etat obligatoire
- Une protection pénale contre l'exercice illégal
- L'existence d'un ordre professionnel
- L'existence d'un code de déontologie
Les principes de la médecine libérale :
- Liberté d'installation du médecin
- Liberté de choix par le malade de son médecin (dont accès direct au spécialiste, même
s'il sera moins bien remboursé)
- Liberté de prescription du médecin
- Entente directe entre le médecin et son patient essentiellement caractérisé par le
"paiement à l'acte" sans intervention d'un "tiers-payant" (tierce personne payant à la
place du malade) et assortie du secret professionnel
L'exercice de la médecine, tout en respectant ces principes, est néanmoins conditionné par
la position du médecin au regard de la Sécurité Sociale.
Conventionnement :
- La convention médicale régit les relations entre le corps médical et les caisses de
Sécurité Sociale. Ce procédé fondé sur un double engagement :
o Engagement des syndicats de médecins à l'égard des honoraires demandés aux
malades

__________________________________________________________________________________________________________
S. LALANDE – Economie de la Santé ISIS – 04 Offre de soins 2
o Engagement des caisses pour ce qui est des remboursements dus aux assurés
sociaux
- Trois partenaires dans la convention :
o L'Assurance maladie, le payeur
o Le corps médical, l'ordonnateur des dépenses
o Les pouvoirs publics (= le Gouvernement) qui contrôlent sans gérer
- Les secteurs :
o Secteur 1 : Le montant de l'acte est fixé dans la convention ; tous les patients
bénéficient d'un même tarif et d'un même taux de remboursement de l'ordre de 70 %.
En échange, les cotisations sociales personnelles du médecin sont prises en charge
par la Sécurité Sociale.
o Secteur 2 : Le médecin peut pratiquer un dépassement d'honoraire avec "tact et
modération" pour une partie de sa clientèle. Les patients sont alors remboursés sur la
base du tarif du secteur 1, le dépassement d'honoraires étant à leur charge. En
contrepartie, le médecin devra participer pour une grande part à ses propres
cotisations sociales.
- L'afflux de plus en + importants de médecin vers le secteur 2 à conduit les pouvoirs
publics à "geler" son accès en 1990 (il faut désormais certains titres hospitaliers, une
certaine ancienneté…).
Mesure de l'activité :
- Leur activité se mesure selon une échelle + ou – détaillée, la grille d'honoraires qui en
France, se présente sous la forme de lettres clés (nature de l'acte) assortie d'un
coefficient (complexité) et d'un prix unitaire ajustable :
o C Consultation
o V Visite
o K Acte de Chirurgie
o B Acte de Biologie
o Z Acte de Radiologie
- Certaines interventions sont rémunérées au forfait (comme les accouchements)
- Cette classification est en retard par rapport à l'évolution des pratiques médicales.
2. Quelques données chiffrées
Evolution des effectifs de médecins :
1973
1980
1995
2007
% 2007
Omnipraticiens
44 097
65 265
94 556
101 549
48,8 %
Spécialistes
24 681
38 818
92 144
106 642
51,2 %
Total
68 778
104 083
186 700
208 191
100,0 %
Libéraux
83 222
116 286
122 103
58,6 %
Salariés exclusifs
57 078
70 414
86 088
41,4 %

__________________________________________________________________________________________________________
S. LALANDE – Economie de la Santé ISIS – 04 Offre de soins 3
Féminisation du corps médical :
- Taux de féminisation : 8 % (1960) 31,5 % (1991) 38 % (2005)
- Féminisation variable :
o selon les secteurs : 30 % en exercice libéral / 49% en exercice salarié (2005)
o selon les spécialités : 88 % en gynécologie médicale ; 67 % en endocrinologie ; 63 %
en dermatologie … 17 % en cardiologie ; 6 % en chirurgie générale (2005)
Mode d'exercice :
Les médecins se répartissent en 3 groupes :
- Exercice libéral exclusif : 1/3
- Exercice salarié exclusif : 1/3
- Exercice mixte : 1/3
Conventionnement :
1990
2004
Généralistes
Secteur 1
Secteur 2 + Dépassement
78 %
20 %
86 %
14 %
Spécialistes
Secteur 1
Secteur 2 + Dépassement
58 %
42 %
62 %
38 %
3. Modèles de comportement
Plusieurs modèles économiques de comportement sont disponibles. Ils montrent que les
médecins recherchent :
- à maximiser leur résultat financier (Médecins du secteur II à honoraires libres)
- à atteindre un revenu net déterminé (Médecins conventionnés)
B. ETABLISSEMENTS DE SANTE
1. Missions des établissements de santé
- Assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes
- Participer à des actions de santé publique
- Participer à la mise en œuvre du dispositif de vigilance
- Lutter contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes
- Mener une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge
médicale

__________________________________________________________________________________________________________
S. LALANDE – Economie de la Santé ISIS – 04 Offre de soins 4
Au niveau des soins, les établissements de santé ont pour objet de dispenser :
- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou
psychiatrie, avec ou sans hébergement
- des soins de suite ou de réadaptation
- des soins de longue durée comportant un hébergement
2. Typologie des établissements
On distingue traditionnellement 3 catégories d'établissements de soins (chiffres 2004) :
- les établissements publics de santé (EPS) : 1.000 établissements qui fondent
largement le service public hospitalier. Les EPS :
o sont des PM de droit public régies par les principes de :
la spécialisation : l'EPS assure la gestion d’un SP
l'autonomie administrative et financière : l'EPS dispose de la capacité juridique et
d’un budget
la tutelle : le plus souvent communale (EPS = EPA placés sous le contrôle de
l’Etat)
o sont organisés en services, voire départements
o sont classés selon leur structure de SPH
o sont administrés par un Conseil d'Administration
o sont dirigés par un directeur (autorité sur le personnel)
- les établissements privés : 1.940 établissements :
o établissements participant au service public hospitalier (1/3 du privé) :
établissements à but non lucratif de droit privé (en particulier des établissements
gérés par des mutuelles, associations, fondations, congrégations)
o établissements privés, habituellement désignés sous le terme de “cliniques privées”
(SA, SARL…) (2/3 du privé) : établissements à but lucratif.
Total : 2.940 établissements (public / privé + hospitalisation à temps complet / court séjour)
Les établissements assurent principalement des soins en hospitalisation complète. Mais les
évolutions récentes des technologies et des pratiques médicales conduisent les hôpitaux à
s'orienter cers de nouvelles prises en charge des malades :
- Hospitalisation de jour
- Hospitalisation de nuit
- Hospitalisation à domicile

__________________________________________________________________________________________________________
S. LALANDE – Economie de la Santé ISIS – 04 Offre de soins 5
3. Le service public hospitalier (SPH)
Contenu – Quoi ? :
Les 3 piliers du SPH sont : le diagnostic, le soin et le service d'urgence
En plus des missions de tout établissement de santé, le SPH participe :
- à l'enseignement médical et pharmaceutique, universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers
- à la recherche médicale, biomédicale
- à des actions de médecine préventive
- à l'aide médicale d’urgence
- à la lutte contre les exclusions sociales
- au service de santé dans les établissements pénitentiaires
Les principes directeurs du SPH – Comment ?
Les soins dans le service public sont :
- Egaux pour tous (sans discrimination des malades)
- Adaptés en fonction de l'évolution médicale (concentration des équipements
sophistiqués, des laboratoires et des explorations fonctionnelles dans des départements
transversaux car toutes les unités de soins y ont recours)
- Assurés en permanence de jour comme de nuit (principe de la continuité du SP)
- UNIVERSALITE : les établissements assurant le SPH sont ouverts à toutes les
personnes dont l’état requiert leurs services
- EGALITE : les établissements assurant le SPH garantissent l’égal accès à tous aux soins
qu’ils dispensent ; ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce
qui concerne les soins
- CONTINUITE : les établissements assurant le SPH :
o doivent être en mesure d’accueillir toute personne jour & nuit, éventuellement en
urgence ou d’assurer leur admission dans un autre établissement assurant le SPH =
PERMANENCE
- dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état
et veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou
de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence
nécessaires à la poursuite de leur traitement = CONTINUITE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%