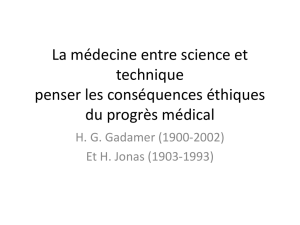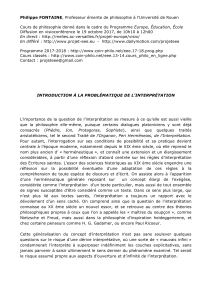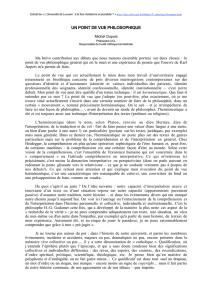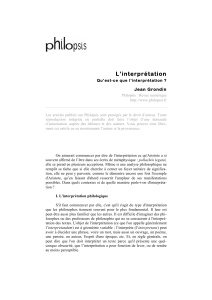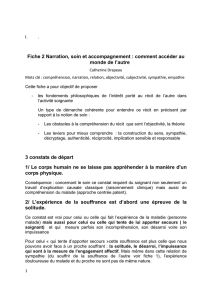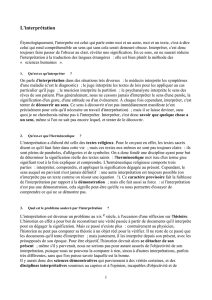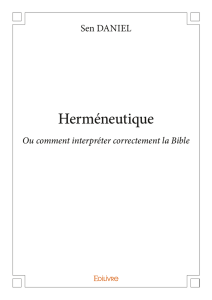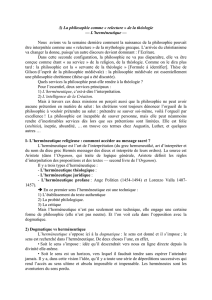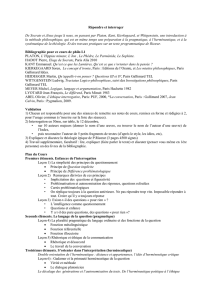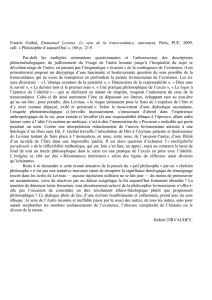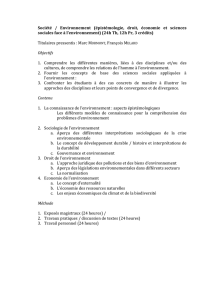Herméneutique, éthique et politique

1
Herméneutique, éthique et politique
BERNER Christian, UMR 8163 « Savoirs, textes, langage » (CNRS, Université de Lille 3,
Université de Lille 1)
RESUME : L’herméneutique, au départ méthode d’interprétation des textes en vue de les comprendre, est ici
resituée dans sa dimension philosophique. La non-compréhension qui est à son fondement est analysée, à travers
la dialectique de la volonté de comprendre et du vouloir-être-compris, dans son ouverture à la philosophie de la
communication. C’est alors dans le dialogue que se manifeste le devoir de comprendre qui témoigne de la
dimension éthique de l’herméneutique. Reprise au niveau du dialogue entre les cultures, par-delà l’universalisme
et le relativisme, l’herméneutique trouve finalement son prolongement politique dans la transposition
institutionnelle du désir de vivre ensemble qui présuppose la reconnaissance, et donc, malgré les différences
irréductibles, une forme de compréhension.
DESCRIPTEURS : herméneutique – compréhension – culture - tolérance
Dans le concert des théories philosophiques contemporaines, l’herméneutique désigne
des courants de pensée qui diffèrent tant par leur objet que par leur méthode, leurs pôles
oscillant entre des théories générales relatives au rapport interprétatif de l’homme au monde et
des méthodes de la compréhension qui donnent des règles de l’interprétation. On a ainsi
souvent affirmé que comprendre peut être pris tour à tour comme un mode d’être ou un mode
de connaître, en cherchant soit à opposer les deux soit à les articuler. Et en effet, les véritables
philosophies sont celles qui savent articuler théorie et pratique, le savoir et le faire : elles nous
disent quelque chose de l’homme, du monde et quelque chose sur la manière dont le premier
s’oriente dans le second au moyen de sa pensée. Ce qui semble en exclure l’herméneutique
qui n’est au sens le plus strict et originel qu’art de comprendre et d’interpréter des textes ou
des discours ou plutôt art d’interpréter ces derniers pour les comprendre. Elle est initialement
une méthode qui permet d’établir le sens d’un discours étranger, étranger parce qu’il n’est pas
le nôtre, qu’il soit altéré par le temps où qu’il vienne d’ailleurs, d’une autre source de sens.
Une fois le sens constitué par le travail technique d’interprétation, l’herméneutique laisserait
aux sciences, à la philosophie, à la métaphysique ou à la théologie les questions portant sur la
vérité ou la valeur de ce sens. L’herméneutique n’apparaît de ce fait que comme le premier
moment dans le processus de la connaissance ou de l’action et il n’est en rien surprenant
qu’elle ait été appréhendée comme un simple appendice de la logique et complément de la
rhétorique : si la logique est art de bien penser, la rhétorique art de bien communiquer la
pensée, l’herméneutique est l’art complémentaire de bien comprendre la pensée
communiquée. L’herméneutique est donc une démarche préalable à la recherche de la vérité
tributaire de la transmission des discours, ce qu’on appelle traditionnellement la connaissance
« historique » par opposition à la connaissance « rationnelle ». Dans ce qui suit, nous nous
proposons de partir de cette définition traditionnelle de l’herméneutique pour esquisser, en
articulant les deux pôles qui la définissent, quelques unes des perspectives qu’elle ouvre à
notre sens de manière féconde sur des dimensions éthiques et politiques.

2
1. Herméneutique : la non compréhension
L’herméneutique au sens restreint est donc définie comme art de comprendre et
d’interpréter les discours, textes ou paroles, étrangers. Sont étrangers les discours que l’on ne
saurait assimiler directement : il gardent en eux une part irréductible qui ne fait pas sens pour
nous. Sont donc étrangers les discours que l’on ne comprend pas immédiatement, dont on se
demande ce qu’ils signifient ou veulent dire. Pour dégager le sens ou la signification, il faut
alors s’arrêter sur le discours ou le texte, repérer en lui ce qui se soustrait à notre
compréhension ou qui lui fait obstacle, c'est-à-dire ce qui pose problème. Ce qui pose
problème est ce à quoi on se heurte, ce qui nous empêche de continuer. Dans le cas de la
compréhension d’un discours, par exemple, c’est ce qui nous interdit de poursuivre la lecture
ou le dialogue avec autrui. L’herméneutique est alors la méthode qui élabore des règles
permettant de surmonter la non-compréhension en reconstruisant un sens attendu comme
étant celui de l’auteur du texte ou du discours. Pour cela, au cœur même de la non-
compréhension, il faut supposer que le discours est sensé, qu’il est habité par une intention
signifiante et que le texte, dans son agencement et au moyen de ses ressources linguistiques,
cherche à dire quelque chose. C’est ainsi que des règles doivent permettre de reconstruire, à
même les déterminations du texte qu’elles soient prises dans un contexte immédiat ou dans un
contexte élargi, le sens en retrouvant la cohérence signifiante du discours. On compare ainsi la
partie et le tout, l’œuvre singulière et le genre, le style et notre connaissance de la langue. On
établit des dictionnaires qui collectent des occurrences, des passages parallèles etc. Tout cela
permet de construire le sens à partir d’éléments que l’on complète progressivement. Pour les
compléter, l’interprète est obligé d’élaborer des hypothèses interprétatives à partir des
connaissances partielles et situées qui sont les siennes, à partir des différents
conditionnements du lecteur ou auditeur, qui appelle « sens » ce qu’il comprend et qui,
rétabli, lui permet de poursuivre l’intelligence du discours.
On sait que de méthode réservée aux textes, l’herméneutique a été étendue à la
problématique générale du sens. Elle s’attache alors à la situation de l’homme dans le monde
à partir de son rapport compréhensif à ce dernier. Ici aussi le problème herméneutique se
manifeste dans l’expérience de la non-compréhension, qui doit être explicitée. Lorsque nous
éprouvons ne pas comprendre, nous prenons conscience de notre attente de sens. En fait, nous
ne comprenons plus : la totalité ou la cohérence que nous présentait la compréhension
ordinaire ou jusque là acceptée est brisée, le sens ne va plus de soi. Peu importe qu’il s’agisse,
comme on le croit le plus souvent, d’une absence de sens ou, ce qui désoriente tout autant,
d’une surabondance de sens offerts : dans la non-compréhension une attente de sens reste
insatisfaite. Cette expérience peut ainsi être très variée, notamment suivant les moments
historiques, et si une époque a pu ressentir l’absurde ou la carence du sens, la prolifération des
interprétations, c'est-à-dire la multiplication du sens dans nos sociétés à l’ère de la
mondialisation peut tout autant susciter l’appel herméneutique. Le sens est alors ce dont on
attend qu’il nous oriente, l’étrangeté étant sentiment de désorientation. Comprendre est en
effet toujours saisie d’une totalité, ou la possibilité d’intégrer, notamment par la traduction ou
la transposition, dans un ensemble. Comprendre se manifeste par un sentiment de cohérence.
L’expérience de la non-compréhension au contraire est l’expérience d’une totalité brisée : on
ne peut plus continuer, on est désorienté. On ne s’y retrouve plus dans le monde, on ne peut
poursuivre le dialogue avec autrui, la lecture d’un texte, on ne sait plus comment faire etc.
La notion de sens est donc intimement liée à l’acte de comprendre qui doit, lui aussi,
être analysé et éclairci. Car nous ne savons rien du sens en dehors du fait de le comprendre.
La conséquence d’une telle définition du sens est qu’il peut, ramené à l’acte de comprendre,
paraître simplement subjectif : il est ce qu’un sujet comprend et ne serait donc pas
intrinsèquement attaché à l’objet. Une telle approche peut sembler trop constructiviste en ce

3
qu’elle laisse le sens à la force d’interpréter, qui « donne » sens, faisant l’impasse sur
l’expérience courante suivant laquelle le sens que nous saisissons est bien celui de l’objet qui
s’offre à nous, celui du texte ou du discours, pour reprendre les objets traditionnels. Il ne nous
appartient pas, à titre de sujets, de choisir librement du sens : nous le trouvons, nous le
recevons.
Pour préciser l’analyse, revenons sur le processus de la compréhension herméneutique
à partir de la non-compréhension. Ce dont nous faisons l’expérience dans la non-
compréhension, ce n’est évidemment pas le sens mais l’appel du sens. Lorsque nous
interprétons un objet, c’est que nous voulons le comprendre parce que nous le supposons
sensé. Nous l’appréhendons comme s’adressant à nous : il est alors ob-jet comme adresse,
comme demande à être interprété. Il se présente dans le cadre d’une attente de sens, d’une
attente inquiétée parce que le sens ne se donne pas immédiatement. C’est ainsi qu’il nous
apparaît comme un signe, à la différence de la chose que l’on laisse comme telle. Bien
entendu, il y a des signes que nous comprenons, en ce qu’ils renvoient à autre chose. Il y a
aussi des choses que ni nous comprenons, ni nous ne comprenons pas, c'est-à-dire qui sont
indifférentes à la compréhension. Mais ce que nous comprenons est un signe (Simon 1989 :
43). C’est pourquoi nous tenons pour un signe ce que nous voulons comprendre, ce qui se
manifeste dans la non-compréhension. Même si, à la réflexion et après interprétation, ce que
nous prenions pour un signe peut finalement s’avérer ne pas en être un. Nous avons donc
affaire dans l’herméneutique à des objets dont il faut mesurer la particulière « objectité ». Car
en présence de ces objets, l’appel (objectif) de sens que nous éprouvons est simultanément
une attente (subjective) de sens. Le signe se fait remarquer dans la non-compréhension : « dire
qu’une chose est remarquable, c’est introduire un homme, - une personne qui y soit
particulièrement sensible, et c’est elle qui fournit tout le remarquable de l’affaire. […] Ôtez
donc l’homme et son attente, tout arrive indistinctement […]» (Valéry 1957 : 897). Certes,
mais à vrai dire il semble difficile de démêler les deux : est-ce l’objet qui attire sur lui
l’attention, ou alors est-ce notre seul esprit, en fonction de ses intérêts et perspectives, qui le
construit comme signifiant ? Comment comprendre cet appel vécu comme une adresse ? Il
faut que quelque chose se fasse remarquer. Mais se fasse remarquer à quelqu’un : le signe,
dont l’interprétation donne le sens, n’existe donc pas en lui-même, mais pour quelqu’un qui le
comprend ou veut le comprendre.
Cela s’éprouve facilement dans notre expérience de la lecture. C’est notre attente
inquiétée par l’écart qui enraye notre compréhension immédiate qui nous fait recourir à
l’herméneutique. C’est en ce sens que Gadamer par exemple écrit : « Il faut bien dire que ce
n’est, en général, que l’expérience du choc [Erfahrung des Anstosses] que nous inflige un
texte – soit qu’il ne dégage aucun sens, soit que son sens soit inconciliable avec notre attente
– qui nous arrête et nous rend attentifs à la possibilité d’un usage de la langue différent
[Anderssein des Sprachgebrauchs] de celui qui nous est familier » (Gadamer 1990 : 272).
C’est cette différence intrinsèque qui manifeste l’altérité du sens, son être-autre qui appelle à
être compris. D’une manière générale, comprendre vraiment suppose toujours que l’on prenne
conscience de cette altérité et que l’on pose donc au fondement la non-compréhension
(Schleiermacher 1989 : 72, 122-123). Dans l’expérience générale de la non-compréhension,
nous sommes donc face à quelque chose qui n’est plus pour nous quelque chose comme
quelque chose, mais quelque chose qui se manifeste dans son opacité ou son être propre. Cette
non-compréhension est la version herméneutique de ce que l’ontologie percevait comme
étonnement devant l’être, la philosophie de la conscience comme doute quant à ses
représentations. A chaque fois, c’est dans l’étrangeté que la philosophie se plait à mettre à son
origine : il y a arrêt, qui appelle l’interprétation, jusqu’à ce que l’on comprenne, c'est-à-dire
jusqu’à ce que l’on se contente de ce qu’on comprend à nouveau, d’un sens nouveau qui
convient à nos attentes et qui nous permet de continuer la discussion, la lecture, l’action…

4
L’expérience de la non-compréhension nous apprend donc quelque chose à travers la
résistance à la saisie. Elle nous apprend l’altérité, l’hypothèse d’une autre source de sens : ce
qui appelle à être compris ne vient pas de nous. C’est pourquoi il faut interpréter,
l’interprétation consistant à parvenir à dire la même chose en d’autres mots, dans les mots qui
nous sont familiers. En cela, la traduction figure souvent en paradigme de la compréhension,
puisque traduire est une manière de ramener l’autre au même, de dire la même chose
autrement, étant entendu qu’étant autrement dite la chose n’est plus tout à fait la même. C’est
en cela que réside toute l’élégance de la formule par laquelle Ricœur caractérise la traduction
comme « équivalence sans identité » (Ricœur 2003 : 40). Tout autant que la différence, il dit
dans le mouvement de traduction le déplacement qui rapproche l’autre du même. Et l’on ne
comprend vraiment que ce qui peut ainsi être rapproché. C’est pourquoi la manière la plus
courante de nous attendre à du sens est de supposer de manière tout à fait anthropocentrique
qu’il est constitué comme nous le construisons, rapportant la constitution de l’objectivité à la
structure de la subjectivité. C’est ainsi par exemple qu’on comprend un texte en faisant
l’hypothèse d’une intention signifiante, d’un sujet que nous appelons « auteur ». On sait que
cette approche, toute orientée sur l’expérience du texte et du discours, a été élargie par Dilthey
aux objectivations de sens en général qui sont la matière des sciences de l’esprit : l’esprit s’y
reconnaît lui-même et se comprend dans ce qu’il a créé. Le fondement de la compréhension
est alors l’analogie entre les hommes, que Kant, Humboldt, Schleiermacher et Dilthey, qui
pensait en termes de communauté de structure de l’expérience vitale, mettaient au fondement
du processus de compréhension : il doit y avoir quelque analogie entre celui qui comprend et
ce qui est à comprendre pour pouvoir y rattacher le travail de l’interprétation. Plus même,
c’est ainsi que nous comprenons la nature. Lorsque je remarque quelque chose dans la nature,
qui excite ma curiosité et demande à être compris, qui se fait remarquer, comme la coquille
que je ramasse sur le sable et que je veux la comprendre, saisir la géométrie de ses formes qui
m’intriguent, je l’attribue à une quelconque intention. Même si cette intention n’est pas à
penser sur le mode personnel. C’est là le sens du jugement téléologique chez Kant, par
exemple. Et à l’analogie il faut, comme Kant, ajouter l’affinité. Kant place plusieurs fois au
cœur de son analyse le « principe d’affinité » qui permet à l’imagination, dans sa faculté
d’invention, de penser l’union de parties hétérogènes en construisant des totalités
systématiques. Une telle construction est ce qu’on appelle comprendre, le principe d’affinité
étant la puissance d’unir le dissemblable qui, dans la nature, permet de reconnaître l’esprit, ou
d’associer réceptivité et spontanéité, l’entendement retrouvant la sensibilité. Comprendre la
coquille que je ramasse sur le sable, être attentif aux formes géométriques qui s’y déploient,
c’est pouvoir la considérer comme l’œuvre d’un homme, c'est-à-dire percevoir l’affinité entre
nature et esprit, ou penser comme si un esprit, même extérieur ou supérieur au nôtre, avait
veillé à son établissement. N’y reconnaître en revanche aucune intention me la fait attribuer à
la simple nature. Même si les sciences cognitives et les études morphologiques ont beaucoup
à nous apprendre en matière de genèse du sens (voir par exemple Petitot 2004), nous pouvons,
au niveau herméneutique, réfléchir aux présupposés et conséquences d’une telle attente de
sens.
2. Ethique : le devoir de comprendre
« Ne pas comprendre », situation initiale de l’herméneutique, est donc une ouverture à
l’altérité. Cette altérité est particulière, avons-nous vu, en ce qu’elle fait appel, c'est-à-dire que
nous la recevons comme une adresse. C’est ainsi qu’interpréter pour comprendre est accepter
de se laisser instruire par cette altérité, malgré les difficultés intrinsèques que recèle tout
rapport du même et de l’autre. Cette situation est celle qui permet l’ouverture éthique. Mais il

5
faut pour cela expliciter davantage encore l’expérience de la non-compréhension et la
dialectique de la volonté de comprendre qui la sous-tend.
Vouloir comprendre et vouloir être compris
La non-compréhension nous découvre simultanément notre volonté de comprendre et
l’altérité de la volonté d’être compris. La réflexion sur la conscience de la non-compréhension
nous découvre notre initiale volonté de comprendre. Lorsque je ne comprends pas, c’est que
je veux comprendre. Cette situation, bien que courante, est néanmoins spécifique. Car on ne
saurait négliger qu’il y a beaucoup de choses que l’on ne comprend pas et qui ne nous
conduisent pour autant à aucune expérience de non-compréhension. Qu’il s’agisse de choses
indifférentes, qui ne m’empêchent pas, par exemple, de s’orienter, de poursuivre l’action etc.,
ou alors de choses que nous comprenons immédiatement, c’est-à-dire dont le sens nous
contente. Car de telles choses immédiatement comprises doivent toujours être présupposées si
l’on veut que la compréhension soit possible, la régression à l’infini ajournant indéfiniment la
compréhension. En cela, toute compréhension présuppose une compréhension immédiate,
même s’il faut convenir que cette dernière peut elle aussi, à tout moment et suivant les
questions qu’on lui pose, devenir problématique. Autrement dit, cette expérience de la non-
compréhension n’est pas universelle, pas plus que ne l’est l’herméneutique. Dans la non-
compréhension la volonté de comprendre porte sur quelque chose qui est interprété comme
signe parce qu’il appelle à être compris. Je présuppose alors que le signe est lui-même signe
d’une volonté d’être compris : je ne comprends pas un sens autre qui, en ce que je le vois
comme adresse, semble vouloir être compris. La non-compréhension se manifeste ainsi
comme une initiale confiance dans la densité signifiante, dans ce que les Allemands appellent
la Bedeutsamkeit, la « signifiance » ou « significativité », qui est appel à l’interprétation. Il est
remarquable que l’allemand dise par Bedeutsamkeit simultanément l’importance, par quoi
précisément quelque chose se fait remarquer, se distingue, la signification (Bedeutung) et
l’interprétation (deuten). Aussi peut-on dire que la non-compréhension dans la double prise de
conscience de la volonté de comprendre et du vouloir-être-compris repose sur une certaine
forme de générosité herméneutique, une forme de sa « bienveillance ». Car c’est bien ce que
recèle le principe d’équité ancien, aujourd’hui présent sous la forme du principle of charity,
qui présuppose que le signe que je prends comme adressé tient sa compréhensibilité de la
volonté d’être compris qui anime l’autre donneur de sens.
Cette dialectique au fondement de la compréhension, ouvre, dans la rencontre entre
vouloir comprendre et vouloir être compris, sur la dimension du dialogue. Avec toutes les
difficultés qui lui sont attachées : car même dans le dialogue, les signes de l’autre ne sont que
des signes pour moi et nous ne comprenons l’autre qu’à partir de nous-mêmes, tout comme
l’autre ne nous comprend qu’à partir de lui-même. Or c’est dans la conscience de cette
finitude, de ce conditionnement de notre compréhension liée à notre perspective, notre
situation, que la non-compréhension se révèle comme effort et devoir de comprendre. Certes,
ce devoir ne peut pas être lui-même fondé, malgré l’argumentation avancée par l’éthique de
la discussion de Karl-Otto Apel qui veut reconstruire les conditions éthiques de possibilité et
de validité de l’argumentation humaine dans le cadre de la communication (Apel 1994). Le
dialogisme de Guido Calogero est sur ce point plus conséquent, qui reconnaît que
« l’impératif de comprendre n’a jamais d’autre fondement que lui-même. Il est cette bonne
volonté qui soutient sur ses épaules tout l’univers moral » (Calogero 2007 : 196). Avec tout ce
que peut avoir de préoccupant le fondement sur une bonne volonté, un peu comme Kant qui,
lorsqu’il doit fonder la « croyance morale » comme pure « croyance de la raison », ne peut
s’empêcher de s’inquiéter de devoir présupposer des dispositions morales. Nous devons donc
partir de la volonté de comprendre en la présupposant. Elle seule permet de dégager le devoir
de comprendre. La communication, à laquelle nous avons abouti, présuppose de son côté la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%