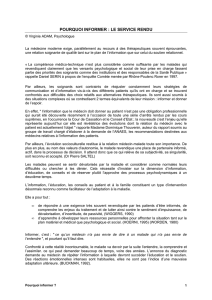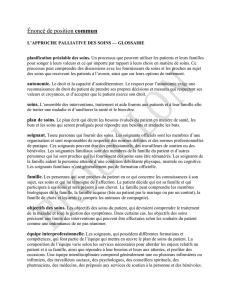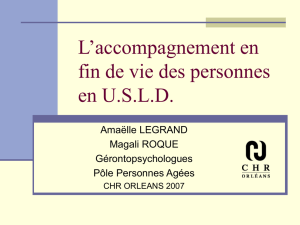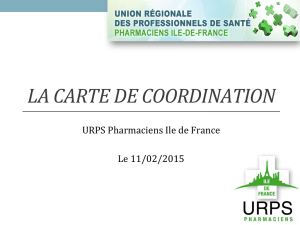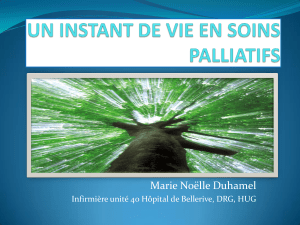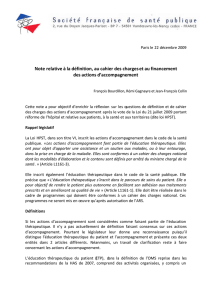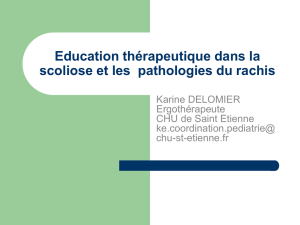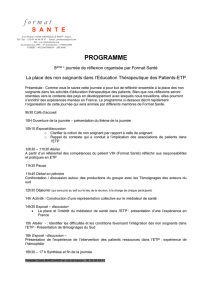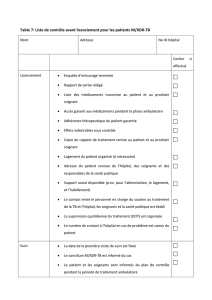2012-06 - Entretien Olivier Blaise (Patient Expert et ETP

Éducation Thérapeutique du Patient
Qui mieux qu’un patient peut éduquer votre patient ?
Entretien avec Olivier Blaise, ancien élève de l’Université des patients
L’Université des Patients, première en France, propose aux patients atteints de maladies chroniques et à
leurs familles, un diplôme universitaire en éducation thérapeutique. Le but est d’apporter des compétences
et des connaissances pédagogiques, complémentaires et méthodologiques complémentaires à celles des
autres professionnels de santé. La double compétence, acquise par leur expérience de patient et les
connaissances du diplôme permettrait de faire de ces « patients-experts » des acteurs naturels de
l’éducation et l’accompagnement des patients.
Suite à une expérience personnelle de maladie, Olivier Blaise, urbaniste, a suivi le diplôme universitaire de
l’Université des Patients pour s’intéresser aux projets impliquant les usagers de santé. « Je n’étais pas
acteur de mon parcours de santé ». Partant du constat du manque d’implication des patients dans leur
propre parcours de soin, il entame une réflexion sur la place d’un patient- éducateur dans la gouvernance
du système de santé.
C’est de là qu’est venu le projet de suivre ce DU à l’Université des patients avec Catherine Tourette Turgis,
connue pour son approche du counselling et approches centrées sur la personne (Carl Rogers). Il s'agissait
ainsi de devenir partie prenante et force de proposition du système de soins. « Formateur, c’est la
dimension pédagogique et politique qui m’ont intéressé dans ce DU ». Les enseignements sont diversifiés et
délivrés par de nombreux intervenants : professionnels de santé mais aussi professionnels de la pédagogie,
de la relation d'aide et des approches motivationelles.
« Je m’implique souvent dans les projets d’innovation, car j’aime développer et structurer les idées en
projets et actions qui ont du sens. Au cours du DU, l’infirmière en ETP du service du CHU m’a souvent
impliqué avant ou après les consultations avec les soignants pour accompagner les patients. J’ai ainsi pu
mesuré l’apport bénéfique de ce DU. »
Des formations hétérogènes
Aujourd’hui, les formations à l’éducation thérapeutique du patient sont nombreuses et disparates. Ce sont
des formations différentes des formations préparant à des fonctions d’éducateur dans le médico-social
(ITRS-éducateur spécialisé…). « Tout le monde peut devenir patient expert ! » Cependant, n'entreprends
cette démarche par hasard. Les compétences relationnelles et pédagogiques se développent à partir d’une
acquisition innée. La posture et les missions du métier d'éducateur sont différentes et complémentaires de
celle d'un soignant. Les compétences biomédicales et de soins recoupent seulement deux des quinze
compétences recensées par l'OMS. Les compétences relationnelles, les compétences pédagogiques et
d’animation ou encore la méthodologie et l'organisation ne se trouvent pas nécessairement que dans le
monde des soignants.
En France, ces formations sont essentiellement destinées aux soignants, mais les formations de l’université
des patients (Paris VI et Nice) accueillent les patients et les mettent au cœur des dispositifs d’éducation. Les
soignants s’y inscrivent pour croiser les regards croisés patients-soignants et améliorer la relation soignants-
soignés. D’autres DU, plus biomédicaux, commencent à ouvrir les formations à des responsables associatifs
et patients. « Dans un premier temps, il serait alors utile de recenser les expériences impliquant des
patients-experts. »

Certains patients experts sont formés par les associations de patients (40 heures-attestation de niveau 1),
d’autres formés aux côtés des soignants dans une faculté de médecine (40 heures, DU, Master). La
formation, les acquis en termes de savoir, les rôles et les compétences de terrain diffèrent et un équilibre
reste à trouver entre ces patients-experts et les soignants pour bâtir l'éducation thérapeutique de demain.
Pour faire émerger un nouveau métier dans une organisation déjà complexe, il est nécessaire de clarifier le
rôle, la place du patient expert, d’organiser et d’encadrer les formations.
Actuellement, d’après la loi, les programmes ETP peuvent impliquer des patients dans la conception à
l’animation des ateliers. Les programmes d'ETP peuvent être coordonnés par une personne mandatée par
une association de patients agrée. Pour information, selon les chiffres du ministère de la santé, seulement
0.8 % des programmes sont portés par des associations de patients. Le ministère n’a aucune statistique
concernant l’implication de patients dans la mise en œuvre des programmes. La loi parle d’associations de
patients, pas des patients experts. La posture de patient expert demeure pour l’heure une posture
universitaire. Il s’agirait d’apporter aux patients d’apporter un plus, une innovation au système de soins, en
complémentarité avec les soignants et en complémentarité avec les associations de patients.
Un acteur complémentaire et formé avec les soignants
Les soignants peuvent innover avec « l'expertise profane » des patients-experts. L’éducation thérapeutique
du patient par des patients experts permet d’humaniser le soin et d’apporter une expérience, un soutien et
un accompagnement aux patients atteints de maladies chroniques. Les professionnels de santé apportent
leurs compétences de soin, les associations de patients apportent de la visibilité aux malades et aux
maladies, les patients experts doivent faire le lien et aider les patients à mieux vivre.
Le patient expert est un acteur de l’éducation, son rôle se situe en complément du soin. Il ne substitue pas
au soin, il est un acteur de l’éducation. C’est une interface, un collaborateur, un partenaire, un acteur
innovant se situant aux cotés des soignants dans le système de santé. Il apporte un rôle social, une
expertise dans l’organisation des soins et une pédagogie. Il ne travaille pas sur la qualité des soins mais sur
la qualité de vie, le mieux-être ses missions spécifiques sont différentes des soignants. Avec la connaissance
à la fois profane et riche d'expérience de sa pathologie, de son vécu et d’un capital social « qualité de vie »
avec une formation adaptée et qualifiante (avec les soignants, comme celle du DU de l’université des
patients), le patient-éducateur n’a pas un rôle de soignant, mais un rôle de santé, d’aidant social et
d’éducateur. L’éducation thérapeutique demande des techniques éducatives spécifiques appropriées et
autres techniques de relation d’aide centrées sur la personne.
Pour prétendre à cette fonction, le patient expert doit connaître :
le mode de vie des patients et les différents modèles liées à la maladie
les compétences de l’éducateur pédagogue (écoute active, entretien motivationnel, ingénierie
pédagogique et en animation…)
l’organisation et du fonctionnement sanitaire de santé (réseaux de santé, planification, droit des
usagers…), la politique associative et les associations de patients
Une place à trouver entre les professionnels de santé et les représentants des usagers
Ce que certains ont pris l’habitude d’appeler « patient expert » est à bien différencier des représentants des
usagers. Pour autant, cette traduction littérale des experts patient anglo-saxon ne renvoie en France à
aucune réalité, aucune place actuelle, aucun métier. Ce rôle est encore à définir, à encadrer à développer…
Pour se démarquer parmi les soignants et les associations, il faudrait un métier reconnu. Au Royaume-Uni,
aux Etats- Unis, aux Pays-Bas et au Canada, les formations en éducation ont donné lieu à une
professionnalisation du métier. Pour pouvoir exercer, les éducateurs canadiens doivent obtenir
l’agrément/certificat national en suivant une formation continue et un examen. Au Royaume-Uni, il est
possible d'accéder aux formations en ETP, sans pré-requis médical ou para-médical. En Allemagne, aux Pays-

bas, il existe des praticiens de soins non-soignants "HeilPraktiker".
Aujourd’hui, l'éducation thérapeutique du patient est et doit être perçu comme un apport complémentaire
aux compétences des soignants et d’établir des chartes avec les hôpitaux et autres acteurs de santé pour
définir un rôle encadré de ce « patient au service des patients ». A court-terme, il pourrait signer avec le
service dans lequel il collabore une charte, une convention (missions, rôle et place…). Il serait identifié,
présenté au service de soins, au service administratif, sous la responsabilité d’un cadre de santé.
La mise en place d’un tel « métier » suppose de clarifier la situation en définissant le patient- expert
(patients experts, patients partenaires, patients ressources, patient educateur), sa place, ses missions, ses
compétences, sa responsabilité vis-à-vis des patients et des autres professionnels de santé… Il s'agit encore
de clarifier l'encadrement et la mise en œuvre des programmes d'ETP et la formation et la sélection des
patients experts.
« Nous avons notre place à conquérir : nous devons persuader, argumenter, rentrer dans le système. Tout
dépend des services et de l’ouverture des soignants. Un responsable de service à l’ARS Lorraine m’a
confirmé la plus-value de l’intégration de patients formés dans les équipes pédagogiques et de leur
participation à la constitution du l’expertise collective, comme véritable partie prenante de la santé ! »
1
/
3
100%