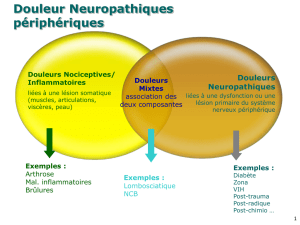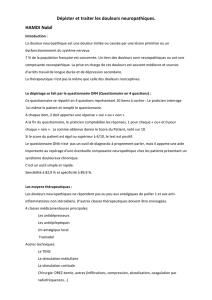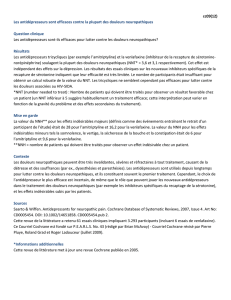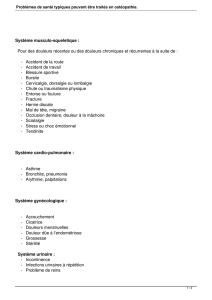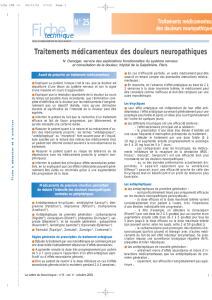Les douleurs neuropathiques - Neuropathic pain

Mise au point
Mise au point
226
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006
Les douleurs neuropathiques
Neuropathic pain
# D. Bouhassira*, N. Attal*
* INSERM U-792, centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne-Billancourt.
POINTS FORTS
L’étude des douleurs neuropathiques représente un des
domaines les plus actifs de la recherche sur la douleur.
Le diagnostic et l’évaluation clinique de ces douleurs sont
désormais facilités par la validation récente en France d’outils
spéciques comme le questionnaire DN4 (Douleur neuropathi-
que en 4 questions) et le questionnaire d’évaluation spécique
des douleurs neuropathiques NPSI (Neuropathic Pain Symptom
Inventory), déjà traduits dans de nombreuses langues.
La physiopathologie de ces douleurs, objet de multiples
travaux expérimentaux, fait intervenir des mécanismes
périphériques (décharges ectopiques, changements phé-
notypiques) et centraux (sensibilisation, modications des
mécanismes de modulation).
Les avancées thérapeutiques reposent essentiellement sur
de nouveaux antiépileptiques comme la prégabaline (déjà
disponible, AMM “douleur neuropathique périphérique”) et la
lancosamide (en développement clinique avancé), ainsi que de
nouveaux antidépresseurs, comme la duloxétine (non encore
disponible, AMM “douleur neuropathique du diabète”).
Les traitements de première et de seconde intention font
désormais l’objet d’un consensus sur le plan européen.
La prise en charge non pharmacologique des douleurs neuro-
pathiques réfractaires doit faire appel à des centres spécialisés.
Mots-clés : Douleur neuropathique – Évaluation –
Diagnostic – Traitement pharmacologique.
SUMMARY
The study of neuropathic pain represents one of the
most active fields of pain research. The diagnosis and
clinical assessment of neuropathic pain are now faci-
litated by the recent development and validation in
French of a specific questionnary, called DN4
(Douleur
neuropathique en 4 questions)
and NPSI (Neuropathic
Pain Symptom Inventory), which have now been trans-
lated in various languages. The mechanisms of neuro-
pathic pain have been studied extensively over the last
few years. They include ectopic neuronal discharges
and phenotypic changes at the periphery, and central
sensitization and alteration of inhibitory controls at
the central level. Therapeutic advances include newer
antiepileptics, such as pregabalin and lancosamide, a
potassium channel blocker, and new antidepressants
such as duloxetine. European guidelines for the pharma-
cological treatment of neuropathic pain have recently
been published. In refractory patients, other therapeutic
options such as central neurostimulation or surgery
necessitate specialized advice.
Keywords: Neuropathic pain – Assessment – Diagnosis –
Pharmacological treatment.
trois notions ont été complètement contredites par une série
de travaux menés ces dernières années. Des progrès considé-
rables ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes
physiopathologiques qui sont analysés aujourd’hui aux niveaux
moléculaire et cellulaire. Concernant les traitements, les très
nombreuses études conduites au cours des dix dernières années
ont montré que la prise en charge de ces patients pouvait être
envisagée de façon plus rigoureuse et rationnelle. Enfin, des
données épidémiologiques nouvelles fournies par une étude
française récente en population générale – l’étude STOPNEP
(STudy Of the Prevalence of Neuropathic Pain) –, permettront
bientôt d’estimer pour la première fois la prévalence de ces
douleurs en population générale.
L’
étude des douleurs neuropathiques représente sans
conteste l’un des domaines les plus dynamiques des
recherches sur la douleur, comme en témoigne notam-
ment le nombre considérable et toujours croissant de publi-
cations consacrées chaque année à ce sujet. Il s’agit là d’une
évolution profonde, car ces douleurs, considérées comme relati-
vement rares, assez mystérieuses sur le plan physiopathologique
et très difficiles à prendre en charge sur le plan thérapeutique,
ont longtemps été négligées par la communauté médicale. Ces
LN7-UNEbis.indd 226 21/09/06 15:59:48

Mise au point
Mise au point
227
Système nerveux central
Neuroplasticité
Sensibilisation
centrale
Altération
des systèmes
de modulation
Système nerveux périphérique
Changements
phénotypiques
Changements
phénotypiques
Décharges
ectopiques
Décharges
ectopiques
Lésion
bre C
bre Aβ
Figure 1.
Illustration schématique des principaux mécanismes
périphériques et centraux à l’origine des douleurs des neuro-
pathies périphériques.
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006
DIAGNOSTIC
Les douleurs neuropathiques se caractérisent par leur grande
richesse d’expression sur le plan sémiologique. Les patients peu-
vent se plaindre de douleurs spontanées continues (brûlures,
sensations de froid douloureux, etc.), ou paroxystiques (décharges
électriques, coups de couteau, etc.), souvent associées à des dou-
leurs provoquées par des stimulations mécaniques (frottement,
pression légère) ou thermiques (surtout froides) de faible inten-
sité, particulièrement invalidantes, appelées “allodynie” (douleur
évoquée par des stimulations normalement non douloureuses)
ou “hyperalgésie” (augmentation de la douleur évoquée par des
stimulations normalement faiblement douloureuses).
Aussi, en pratique, le diagnostic de douleur neuropathique est
exclusivement clinique. Il repose sur un interrogatoire bien
conduit et un examen clinique de la sensibilité. Les examens
complémentaires sont cependant souvent nécessaires pour le
diagnostic étiologique ou l’évaluation de la lésion neurologique
sous-jacente.
L’interrogatoire doit s’attacher à repérer certains descripteurs
caractéristiques des douleurs neuropathiques tels que les brûlu-
res, les décharges électriques, ainsi que la présence, dans le même
territoire, de sensations anormales, mais non douloureuses
(paresthésies/dysesthésies), décrites comme des fourmillements,
des picotements ou encore un engourdissement.
L’examen clinique permet, en règle générale, de montrer que
la douleur siège dans un territoire où existe un déficit sensitif,
qui peut intéresser une ou plusieurs modalités sensorielles :
tact léger, piqûre, sensibilité thermique. Le second élément à
rechercher par l’examen clinique est la présence d’une allodynie,
en particulier au frottement ou au contact avec un object froid
dans la zone de douleur spontanée.
Il est cependant important de noter qu’aucun de ces symptômes
ou signes, pris individuellement, n’est pathognomonique ou
spécifique d’une douleur neuropathique, puisqu’ils peuvent
être observés, bien qu’avec une fréquence moindre, chez des
patients présentant une douleur inflammatoire. C’est donc l’as-
sociation de ces différents symptômes et signes qui va orienter
le diagnostic.
À cet égard, on peut mentionner le questionnaire DN4 (Douleur
neuropathique en 4 questions), un outil d’aide au diagnostic
conçu et validé par un groupe d’experts français pour faciliter le
dépistage des douleurs neuropathiques en pratique clinique quo-
tidienne (1). Le diagnostic de douleur neuropathique reposant
sur des bases cliniques, ce questionnaire qui comporte un total
de 10 questions s’appuie exclusivement sur l’interrogatoire des
patients et un examen succinct de la sensibilité. Les 7 premières
questions visent à préciser les caractéristiques de la douleur, les
3 autres reposent sur un examen clinique visant à rechercher une
hypoesthésie au tact ou à la piqûre et/ou une douleur déclenchée
par le frottement (allodynie). Un score de 1 est attribué à chaque
item positif et le score DN4 total correspond à la somme des
réponses aux 10 items. Cet outil permet d’établir le diagnostic
de douleur neuropathique avec une spécificité de 89,9% pour
un score de 4/10, considéré comme la valeur seuil.
PHYSIOPATHOLOGIE
Les douleurs neuropathiques s’opposent classiquement sur
le plan physiopathologique aux douleurs dites par “excès de
nociception”, liées à des lésions somatiques ou viscérales. Ces
dernières sont le plus souvent associées à des processus inflam-
matoires responsables de phénomènes de sensibilisation d’abord
périphérique, puis centrale, conduisant à une augmentation des
messages nociceptifs générés par les nocicepteurs et à l’ampli-
fication de leur transmission dans le système nerveux central.
Les douleurs neuropathiques ne dépendent pas des phénomènes
inflammatoires, mais des altérations directement liées à la lésion
nerveuse peuvent également conduire à une hyperexcitabilité
périphérique et centrale (2, 3).
Mécanismes périphériques
Parmi les nombreux mécanismes périphériques révélés par les
études expérimentales réalisées dans divers modèles animaux,
les plus documentés sont l’apparition de décharges d’activités
anormales au sein des nerfs lésés et les modifications métabo-
liques susceptibles de conduire à une véritable transformation
(switch) phénotypique des fibres périphériques (figure 1).
Décharges ectopiques
Une des conséquences d’une lésion nerveuse périphérique est
l’apparition d’activités électriques anormales
au sein des fibres
lésées. De telles activités, dites ectopiques, car elles ne sont pas
générées au niveau des terminaisons nerveuses, peuvent, dans
les conditions pathologiques, naître directement au niveau des
bourgeons de régénération, d’une plaque de démyélinisation
sur un tronc nerveux, ou encore directement des corps cellulai-
res localisés dans les ganglions rachidiens. De telles décharges
aberrantes sont vraisemblablement liées pour une large part à
des remaniements des canaux ioniques qui règlent l’excitabilité
LN7-UNEbis.indd 227 21/09/06 15:59:49

Mise au point
Mise au point
228
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006
membranaire. Il existe notamment une surexpression et une
accumulation de certains sous-types de canaux sodiques (les
canaux NaV 1.8, 1.9, 1.3) au niveau de la lésion, qui pourraient
entraîner un abaissement du seuil d’activation des fibres. Ces
canaux ioniques, qui font actuellement l’objet de multiples travaux,
constituent sans aucun doute une cible potentielle de première
importance pour le développement de nouveaux antalgiques. Les
autres pistes de recherche dans ce domaine concernent notam-
ment certains canaux potassiques ou encore les récepteurs de la
famille TRP (Transient Receptor Potential), qui contribuent eux
aussi à la genèse des décharges ectopiques.
Changements phénotypiques
Les lésions nerveuses induisent de profondes modifications
métaboliques au niveau des corps cellulaires des neurones affé-
rents primaires localisés dans les ganglions rachidiens. Ces modi-
fications se traduisent par une réduction ou une augmentation
de l’expression de plusieurs centaines de gènes parmi lesquels
ceux impliqués dans la synthèse et la libération de divers neuro-
peptides (substance P, CGRP, VIP, galanine, somatostatine, etc.)
dont on connaît l’importance dans la transmission des messages
nociceptifs. Il est intéressant de souligner qu’une surexpres-
sion de la sous-unité alpha2delta des canaux calciques voltage
dépendants (CCVD) a également été mise en évidence après
une lésion nerveuse périphérique. Cette sous-unité régulatrice
des CCVD représente le principal site de fixation de la gaba-
pentine, ce qui pourrait rendre compte des effets analgésiques
bien documentés de cette molécule. Outre leur rôle dans la
régulation de la libération médullaire des neuromédiateurs, les
CCVD pourraient participer au développement des phénomènes
de sensibilisation centrale.
De véritables transformations phénotypiques ont également été
décrites, de telle sorte que des fibres de gros calibres (les fibres
Abêta), qui véhiculent normalement les messages tactiles non
nociceptifs, se “comportent” comme des nocicepteurs (les fibres
fines de type C ou Adelta) et synthétisent des neuromédiateurs
pronociceptifs tels que la substance P ou le BDNF (Brain Derived
Neurotrophic Factor). Ainsi, dans les conditions pathologiques,
les fibres de gros calibre pourraient aussi participer au deve-
loppement des modifications centrales.
Mécanismes centraux
Il est bien établi aujourd’hui que les mécanismes périphéri-
ques décrits ci-dessus peuvent secondairement induire des
modifications centrales qui contribuent à majorer la douleur
et pourraient également être impliqués dans la pérennisation
des syndromes douloureux neuropathiques.
La sensibilisation centrale
correspond à un état d’hyperex-
citabilité des neurones nociceptifs médullaires, qui se traduit
sur le plan électrophysiologique par une augmentation de leur
activité spontanée, une baisse de leur seuil d’activation et une
augmentation des réponses aux stimulations supraliminaires.
Depuis ces dernières années, les mécanismes cellulaires et molé-
culaires susceptibles de conduire à une telle sensibilisation des
neurones de la corne postérieure de la moelle ont donné lieu
à de multiples investigations. Un faisceau d’arguments attri-
buent aux acides aminés excitateurs (AAE), notamment au
glutamate, impliqués dans la neurotransmission médullaire
des messages nociceptifs, un rôle essentiel dans ces processus.
Les AAE agissent en se fixant sur des récepteurs spécifiques de
type NMDA (N-Methyl-D-Aspartate) ou non NMDA (AMPA/
kainate, métabotropiques). Dans les conditions pathologiques,
l’activation anormale des fibres nerveuses périphériques, liée
notamment aux décharges ectopiques et aux changements phé-
notypiques décrits ci-dessus, entraîne une libération accrue
d’AAE au niveau de la moelle, susceptible de dépolariser suf-
fisamment les neurones pour activer les récepteurs NMDA et
déclencher une cascade d’événements intracellulaires à l’origine
de modifications de longue durée des propriétés fonctionnelles
des neurones. De nombreuses molécules sont susceptibles de
moduler l’action des AAE et contribuent ainsi vraisemblable-
ment également à l’installation de ces modifications durables de
l’excitabilité des neurones nociceptifs. Les travaux les plus récents
ont souligné le rôle de certains neuropeptides (notamment la
substance P), du BDNF ou encore des canaux calciques. En outre,
un ensemble de données expérimentales ont mis en évidence
le rôle des interactions neuro-immunes médiées notamment
par les cytokines et des cellules gliales dans le développement
de l’hyperexcitabilité médullaire.
La transmission des messages nociceptifs est soumise dès l’étage
médullaire à de puissants
mécanismes de modulation
, capables
de réduire, d’augmenter ou de filtrer le flux des informations.
Des dysfonctionnements de ces mécanismes, dont certains sont
organisés dans la moelle épinière (les contrôles segmentaires et
propriospinaux) et dont d’autres font intervenir des structures
cérébrales (les contrôles descendants), pourraient également
expliquer l’hyperexcitabilité des neurones nociceptifs. Les
contrôles descendants s’exerçant sur les neurones nociceptifs
médullaires apparaissent modifiés au cours des neuropathies
dans des conditions expérimentales chez l’animal et chez les
patients douloureux (4). Une réduction des inhibitions seg-
mentaires a également été observée après lésion traumatique
du nerf sciatique chez l’animal, ce qui pourrait être lié à une
réduction de la concentration en neurotransmetteurs inhibiteurs,
comme l’acide gamma aminobutyrique (GABA), dans la corne
postérieure ou le ganglion sensitif.
ÉVALUATION
L’évaluation d’une douleur neuropathique comporte une étape
d’entretien semi-structuré, suivie d’un examen clinique standar-
disé, éventuellement complété par des techniques d’évaluation
quantitative des troubles sensitifs et des examens complémen-
taires spécialisés (5).
Intensité douloureuse et caractérisation des symptômes
Pour évaluer l’intensité globale de la douleur neuropathique en
consultation et sur les 24 dernières heures (douleurs moyenne,
maximale et minimale), l’échelle la plus recommandée est une
LN7-UNEbis.indd 228 21/09/06 15:59:50

Mise au point
Mise au point
229
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006
échelle numérique
de Likert en 11 points (0 à 10) [équivalente
à l’échelle visuelle analogique (EVA) et plus rapide]. Un carnet
d’auto-évaluation est très utile pour reporter les scores douloureux
sur ce type d’échelle, de façon quotidienne ou biquotidienne.
Il est essentiel de savoir caractériser et quantifier les symptô-
mes neuropathiques au moyen d’outils validés et spécifiques.
Récemment, le Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)
a été développé spécifiquement pour une telle évaluation, et
validé dans une population de langue française, ainsi que dans
plusieurs autres langues (6). Il s’agit d’un autoquestionnaire de
passation rapide et simple, comportant 10 descripteurs (brûlure,
étau, compression, décharges électriques, coups de couteau, four-
millements, picotements, douleur provoquée par le frottement,
la pression, le contact du froid), dont l’intensité est évaluée sur
une échelle numérique en 10 points. Ces items peuvent être
regroupés en 5 dimensions distinctes (douleur superficielle
de type brûlure, douleurs profondes, douleurs paroxystiques,
paresthésies/dysesthésies, allodynie/hyperalgésie). S’y ajoutent
deux items temporaux évaluant la durée de la douleur spontanée
et la fréquence des paroxysmes douloureux.
Impact de la douleur neuropathique
Le retentissement de la douleur sur la qualité de vie, sur le som-
meil et sur l’humeur peut aussi être évalué, dans la mesure où les
douleurs neuropathiques ont un retentissement important sur
la qualité de vie et sont souvent associées à des comorbidités,
qui peuvent parfois être améliorées par certains traitements.
Les échelles les plus simples dans le contexte clinique sont le
questionnaire Hospital Anxiety and Depression (HAD) pour
l’humeur et l’anxiété, le questionnaire Short-Form-12 Health
Survey (SF-12) ou les items “fonctionnement” du Brief Pain
Inventory (questionnaire concis sur les douleurs) pour la qua-
lité de vie et le handicap et une échelle visuelle analogique ou
numérique pour le sommeil (5).
Examen clinique et évaluation quantitative
des troubles sensitifs
Outre la recherche d’un déficit sensitif et d’une allodynie (notam-
ment au frottement) dont on peut évaluer l’intensité et l’éten-
due, l’examen clinique peut nécessiter l’utilisation de
méthodes
dites “quantitatives” d’étude de la sensibilité
(quantitative
sensory tests). Ces méthodes sont définies comme l’analyse de
la perception en réponse à des stimulations externes d’intensité
contrôlée (5). Initialement destinées aux études psychophysiques
de laboratoire, elles peuvent aujourd’hui être appliquées relati-
vement aisément chez les patients. Elles reposent sur l’utilisation
d’appareils qui permettent d’appliquer de façon non invasive
des stimuli thermiques (thermotest), mécaniques (filaments
de von Frey, algomètre de pression) ou vibratoires (vibramètre)
d’intensité contrôlée. Les mesures concernent les seuils des sous-
modalités somesthésiques (seuils de détection et de douleur),
mais aussi les sensations évoquées par des stimulations supra-
liminaires (“au-dessus du seuil”). Ces techniques permettent
de quantifier les différents déficits ainsi que les phénomènes
d’allodynie et d’hyperalgésie (au froid, au chaud, à la pression),
dont on peut mieux tenter d’élucider la physiopathologie et
préciser la réponse à certains traitements (5, 7). De façon inté-
ressante, l’utilisation du questionnaire NPSI permet d’obtenir
des informations similaires à celles de l’évaluation quantifiée en
ce qui concerne la présence ou l’importance des phénomènes
d’allodynie/hyperalgésie (6).
Place des examens complémentaires
Plusieurs types d’explorations paracliniques spécifiques peuvent
être réalisés pour compléter le bilan d’une douleur neuropathi-
que et mieux en explorer les mécanismes chez l’homme (5): il
s’agit de techniques électrophysiologiques (réflexe nociceptif de
flexion, potentiels évoqués laser, microneurographie), d’imagerie
fonctionnelle et de techniques neuro-anatomiques (biopsie ner-
veuse ou cutanée). Pour la plupart, ces techniques sont encore
du domaine de la recherche expérimentale.
TRAITEMENTS
Traitements pharmacologiques
Les douleurs neuropathiques ne répondent pas ou peu aux antal-
giques usuels (anti-inflammatoires non stéroïdiens, paracétamol,
salicylés), et les antidépresseurs ainsi que les antiépileptiques
constituent les traitements de référence de ces douleurs (8). La
grande majorité des essais thérapeutiques a porté sur les douleurs
des polyneuropathies sensitives, notamment diabétiques, et sur
la douleur postzostérienne, mais la plupart des traitements ont
une efficacité similaire quelle que soit l’étiologie douloureuse,
en dehors de quelques exceptions, comme la névralgie faciale
essentielle et certaines neuropathies douloureuses évolutives
(sida, cancer). En revanche, l’efficacité des traitements n’est pas
nécessairement la même sur tous les symptômes douloureux.
Antidépresseurs
L’efficacité des antidépresseurs tricycliques (75-150 mg/j en
moyenne en commençant à 10-25 mg) est largement confirmée
dans le traitement des douleurs neuropathiques, à l’exception de
la neuropathie du sida. Cette activité est probablement médiée
en partie par un blocage de la recapture des monoamines (séro-
tonine et noradrénaline), permettant de renforcer les contrôles
inhibiteurs descendants, mais des mécanismes d’action sup-
plémentaires (effet sur différents récepteurs impliqués dans la
transmission des messages nociceptifs ou effet bloqueur des
canaux sodiques) pourraient rendre compte de l’efficacité géné-
ralement supérieure des tricycliques par rapport aux autres
antidépresseurs. Parmi ces traitements, l’amitriptyline possède
une AMM “algie rebelle” et l’imipramine et la clomipramine
ont une AMM “douleur neuropathique”. La corrélation entre
efficacité et doses administrées ou taux plasmatiques est contro-
versée et, de ce fait, le dosage de ces taux n’est pas nécessaire
en pratique. Le problème majeur de ces produits est lié à leurs
effets indésirables fréquents et à leur sécurité d’emploi. Outre
les contre-indications habituelles, il convient d’être particulière-
ment prudent en cas de pathologie cardiovasculaire, notamment
LN7-UNEbis.indd 229 21/09/06 15:59:51

Mise au point
Mise au point
230
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006
chez le sujet âgé. Ainsi, près de 20 % des patients traités par la
nortriptyline après un infarctus du myocarde développent des
effets indésirables cardiaques, et une augmentation du risque
d’accidents cardiaques mortels a été rapportée avec des doses
de tricycliques supérieures à 100 mg/j.
Les inhibiteurs de recapture sélectifs de la sérotonine et de la
noradrénaline (ISRNA) constituent désormais une alternative
aux tricycliques et présentent une meilleure sécurité d’emploi
avec des risques cardio-vasculaires négligeables. Plusieurs études
contrôlées réalisées dans les polyneuropathies douloureuses ont
confirmé l’efficacité de la venlafaxine (Effexor
®
) [150-225 mg/j]
et de la duloxétine (Cymbalta
®
) [60-120 mg/j], non encore dis-
ponible (AMM “douleur neuropathique du diabète”). L’efficacité
de ces molécules semble inférieure à celle des tricycliques d’après
les méta-analyses (8, 9), mais il n’existe pas d’études comparatives
directes sur des échantillons suffisants. Les effets indésirables
essentiels concernent une somnolence, des troubles gastro-intes-
tinaux, une sécheresse de la bouche, mais la venlafaxine peut à
fortes doses (300 mg/j) provoquer des poussées tensionnelles et
il est conseillé de surveiller la tension artérielle pour des doses
supérieures à 200 mg/j.
Antiépileptiques
La plupart des antiépileptiques ont des effets bloqueurs des
canaux sodiques, qui jouent un rôle dans la genèse des acti-
vités ectopiques. D’autres agissent préférentiellement sur les
canaux calciques (gabapentine, prégabaline) ou sur l’inhibi-
tion GABAergique (valproate de sodium). Ces traitements ont
une bonne efficacité sur la douleur continue (brûlure), et pas
seulement sur les paroxysmes, contrairement à une idée répan-
due de longue date, mais leur efficacité sur l’allodynie n’est pas
clairement établie.
La carbamazépine (Tégrétol
®
) est le seul antiépileptique à possé-
der une AMM dans le traitement de la douleur neuropathique.
Cependant, son efficacité est relativement peu étayée, en dehors
de la névralgie faciale. Du fait de ses effets indésirables, du risque
d’interaction médicamenteuse et de la nécessité de surveillance
biologique, son utilisation tend actuellement à se restreindre
à la névralgie faciale. Il en est de même pour la phénytoïne,
qui n’est quasiment plus utilisée à ce jour. Il est possible que
l’efficacité remarquable de la carbamazépine dans la névralgie
faciale compense sa tolérance médiocre et augmente ainsi son
acceptabilité dans cette indication.
L’oxcarbazépine (Trileptal
®
) est un kéto-analogue de la carba-
mazépine non inducteur enzymatique. L’oxcarbazépine est plus
facile à manier que la carbamazépine, mais induit autant de
risque d’hyponatrémie et il n’est pas établi que cette molécule
présente moins d’effets indésirables centraux. Son efficacité sur
les douleurs neuropathiques autres que la névralgie faciale, pour
lesquelles ce produit semble avoir une efficacité comparable à la
carbamazépine, est encore assez peu documentée et controver-
sée. Ainsi, une étude a mis en évidence une efficacité modeste de
ce traitement (900-1800 mg/j) dans les douleurs neuropathiques
du diabète, mais les résultats d’autres études publiées sous forme
d’abstract sont négatifs dans cette indication.
La lamotrigine (Lamictal
®
) [200-400 mg/j] a prouvé son efficacité
dans les neuropathies douloureuses du diabète et les douleurs de
l’accident vasculaire cérébral (AVC), à un moindre degré dans la
névralgie essentielle du trijumeau (dans une étude présentant de
nombreux biais). Un certain bénéfice de ce traitement a aussi été
rapporté sur les douleurs neuropathiques du sida, mais limité,
semble-t-il, aux patients souffrant d’une neuropathie toxique. Si
ce produit est généralement bien toléré, il présente des risques
rares, mais potentiellement très graves de complications cutanées
(syndrome de Lyell, épidermolyse), notamment en cas de titrage
rapide et d’association avec le valproate de sodium. Les recom-
mandations officielles incitent donc à une très grande prudence
dans son utilisation, ce d’autant que ce produit n’a pas d’indication
officielle en dehors de l’épilepsie.
L’efficacité du topiramate (Epitomax
®
) n’a été étudiée que dans
les neuropathies douloureuses du diabète, avec des résultats
plutôt négatifs dans l’ensemble, une seule étude sur 4 étant très
faiblement positive.
La gabapentine (Neurontin
®
) [AMM “douleur postzostérienne”]
et la prégabaline (Lyrica
®
), bientôt disponible (AMM “douleurs
neuropathiques périphériques”), de structure et de mécanismes
d’action similaires, ont fait la preuve de leur efficacité sur la
base de larges études multicentriques dans les douleurs post-
zostériennes et la douleur neuropathique du diabète avec en
outre des effets bénéfiques sur le sommeil et la qualité de vie.
Leur efficacité a également été rapportée sur les douleurs du
syndrome de Guillain-Barré, du membre fantôme et sur les
douleurs neuropathiques du cancer (gabapentine) ainsi que
les douleurs d’origine médullaire (gabapentine, prégabaline).
En l’absence d’études comparatives directes, il est impossible
de savoir si la prégabaline est supérieure à la gabapentine ou
aux tricycliques. Les doses efficaces de gabapentine varient de
1200 à 3 600 mg/j (dose moyenne de 1800 mg) et celles de la
prégabaline de 150 à 600 mg/j, avec une efficacité dose-réponse
pour ce dernier traitement. Leurs effets indésirables surviennent
essentiellement au cours du titrage et comportent une somno-
lence, une impression vertigineuse, une asthénie, mais une prise
de poids est possible au long cours. Notons que si la prégabaline
est assez bien tolérée à des doses modérées, le risque d’arrêt
thérapeutique pour effets indésirables augmente nettement à la
dose de 600 mg/j (jusqu’à 20 % dans certaines études).
Le clonazépam (Rivotril
®
) reste l’un des antiépileptiques les plus
prescrits dans les douleurs neuropathiques en France, ce qui
tient vraisemblablement pour une large part à ses propriétés
hypnotiques et anxiolytiques. En effet, bien que son efficacité
sur les douleurs paroxystiques ait été suggérée de longue date,
ce produit n’a fait l’objet d’aucune étude contrôlée permettant
de vérifier son intérêt dans le traitement des douleurs neu-
ropathiques. En outre, même à des doses faibles, il n’est pas
exempt d’effets indésirables (sédation diurne, troubles mnésiques
et attentionnels), notamment chez le sujet âgé, et il présente,
comme toutes les benzodiazépines, un risque de dépendance
au long cours.
Parmi les antiépileptiques en développement clinique avancé, on
peut citer la lancosamide, bloqueur des canaux potassiques, dont
LN7-UNEbis.indd 230 21/09/06 15:59:52
 6
6
 7
7
1
/
7
100%