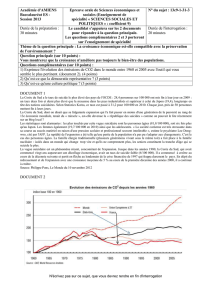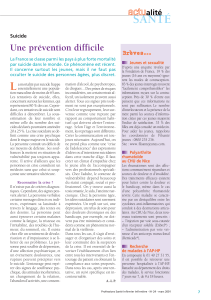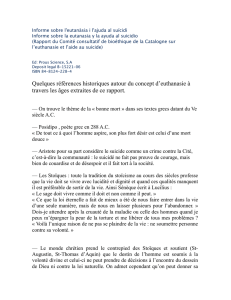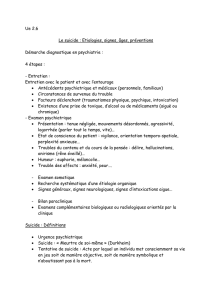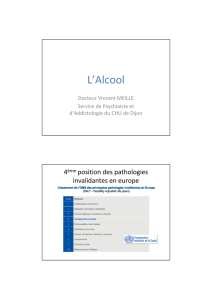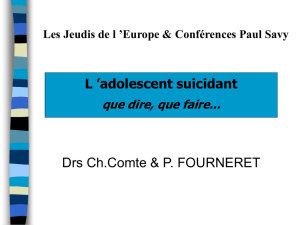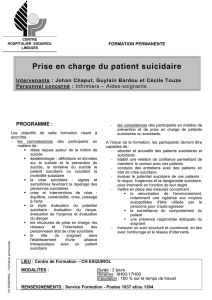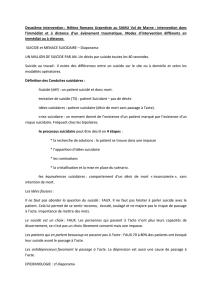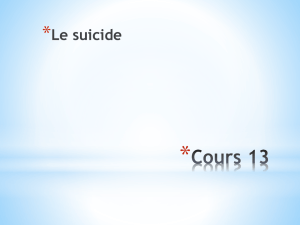Le médecin et le patient suididaire

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 730
Lorsqu’on interroge les patients qui ont fait une
tentative de suicide sur ce qu’il eût alors fallu
pour leur permettre, avant leur tentative, de
parler de leur état avec quelqu’un, on obtient
la plupart du temps la réponse suivante: il au-
rait fallu quelqu’un qui soit capable d’écouter
et n’aie pas peur d’une conversation sur le
suicide.
L’art d’amener le patient à parler
Il faut se rendre compte que dans un état
de crise ou dans l’évolution d’une maladie
dépressive de longue durée, l’idée du suicide
comme issue possible à une situation ou un état
insupportables est quelque chose d’éminem-
ment personnel, dont on ne peut être facilement
dissuadé. Un être humain en état de crise ne
se démettra pas de ses idées suicidaires par
amour pour un autre être humain et ce n’est
que lorsqu’il entrevoit lui-même de nouvelles
raisons de vivre que l’idée suicidaire peut
s’estomper.
Mais chez le patient suicidaire, nous devons
prendre en considération avant tout l’extrême
atteinte du sentiment de valeur personnelle et
la tendance au repli par crainte de nouvelles
blessures infligées par l’entourage (y compris
le médecin). Après une tentative de suicide,
seulement 10% des patients pensaient qu’un
médecin aurait pu les aider [1]. La moitié disait
que personne n’aurait pu les aider – un indice
qu’une tentative de suicide ne peut pas simple-
ment être interprétée comme un appel au se-
cours. Le patient ne parlera de lui et de ses dif-
ficultés que si le médecin est capable d’écouter
sans émettre de jugement de valeur et s’il laisse
assez d’espace au patient. Cela est d’ailleurs
généralement valable pour atteindre tout pa-
tient présentant des problèmes psychiques ou
émotionnels. C’est selon sa capacité à se mettre
à la portée du patient que le médecin saura sai-
sir et comprendre correctement les contenus
émotionnels et la problématique dépressive de
celui-ci [2].
L’idée qu’une conversation sur le suicide pour-
rait justement déclencher un passage à l’acte
chez l’être humain en danger est infondée et
les experts sont unanimes sur ce point. Au
contraire, il semble que l’individu en état de
crise passera plus facilement à l’acte suicidaire
lorsqu’il n’a personne avec qui il puisse parler
de sa situation momentanée et de ses idées sui-
cidaires impérieuses.
Dans l’exploration, les questions suivantes peu-
vent être utiles:
– «Au cours de votre existence, avez-vous déjà
eu des crises ou des problèmes psy-
chiques?»
– «Parfois, vous sentez-vous mal au point de
penser que la vie n’a pour vous plus de
sens?»
– «Avez-vous déjà aussi songé à en finir avec
la vie?»
– «Vous représentez-vous de quelle manière
vous voudriez le faire?»
Le suicide est un acte
Dans la conversation avec le patient suicidaire,
il est utile d’être conscient que le suicide et la
tentative de suicide sont des actes et qu’en gé-
néral, on peut expliquer ses actes. Les actes
sont expliqués sous la forme d’une histoire
(narrative). En fait, dans une étude sur le plan
national, nous avons trouvé que les patients
ayant fait une tentative de suicide possédaient
une faculté narrative étonnante, c’est-à-dire
qu’ils pouvaient très bien expliquer l’acte suici-
daire dans le contexte de l’histoire de leur vie
[3], pour autant qu’ils y aient été encouragés au
début de l’entretien. Mais cela présuppose que
le médecin renonce au rôle de personnage
omniscient et soit capable d’écouter le patient,
avec comme objectif le développement d’un
modèle d’explication commun.
Même chez le patient gravement dépressif,
l’exécution de l’acte nécessite une décision.
C’est donc bien l’être humain qui commet
l’acte, et non pas la dépression. Selon les théo-
riciens de l’agir, les actes sont orientés vers un
but. Le but à court terme est de mettre fin à un
état insupportable ou à une vie devenue insup-
portable («to end a bad story»). Le suicide existe
certes dans un coin reculé de la pensée pour
bon nombre (la plupart?) d’entre nous comme
une issue possible au cas où, pour une raison
quelconque, nous ne parviendrions plus à faire
face; mais cette idée n’a la plupart du temps
aucune priorité significative lorsque l’existence
Le médecin et le patient suicidaire
Partie II: Aspects pratiques
K. Michel
Correspondance:
Pr Konrad Michel
Universitäre Psychiatrische
Dienste (UPD)
Direktion Sozial- und
Gemeindepsychiatrie
Murtenstrasse 21
CH-3010 Berne

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 731
est nourrie d’autres objectifs et plans de vie.
Cependant, en période de crise émotionnelle,
lorsque nos plans de vie importants sont me-
nacés et que nous sommes à bout, des pensées
suicidaires peuvent soudainement se presser
au premier plan comme une alternative pos-
sible – et ces pensées peuvent tout aussi bien
retourner à l’arrière-plan dès que la crise est
passée.
Entre la première idée que «la mort serait une
solution» et la décision de commettre l’acte, il
y a la plupart du temps un long développement
qui implique théoriquement et pratiquement
de nombreuses possibilités d’intervention, car,
selon la théorie de l’agir, les actes sont des pro-
cessus «solidaires», donc socialement influen-
cés. Un tel processus peut aussi se dérouler
comme un dialogue intérieur, sous la forme de
l’ambivalence et de peser le pour et le contre.
Chez les individus atteints de maladie soma-
tique incurable, les idées suicidaires sont
souvent l’expression de la peur de situations
très précises, comme par exemple d’être livré
impuissant à des douleurs incontrôlables. La
plupart du temps, la crise se résout lorsque
l’angoisse est expliquée et que l’on trouve le
moyen de réduire le sentiment d’impuissance
du patient (par exemple mise en œuvre d’an-
talgiques plus puissants). En tout cas, le moyen
le plus important pour surmonter une crise
suicidaire est de parler avec d’autres per-
sonnes. C’est en devant expliquer à quelqu’un
une situation pénible qui semble sans issue
que des idées de voies alternatives émergent
d’elles-mêmes. C’est pourquoi nous ne de-
vrions pas de prime abord essayer de dissua-
der quelqu’un de ses idées suicidaires. Il est
plus pertinent de l’interroger sur d’autres buts
d’orientation de sa vie. Chez bon nombre d’in-
dividus, les priorités changent étonnamment
rapidement. Les patients que nous voyons aux
urgences après une tentative de suicide veulent
souvent retourner à la maison quelques heures
plus tard et sont souvent à nouveau au travail
ou à l’école le jour suivant.
L’expérience de vie actuelle
Il est très instructif d’écouter les patients par-
ler de leur état psychique avant un acte suici-
daire. De nombreux patients se sentaient alors
complètement sans valeur et sans espoir, par
exemple suite à un conflit avec un proche et/ou
comme expression d’une auto-dévalorisation
dépressive. Les patients parlent alors très sou-
vent de douleurs psychiques et d’un état pour
eux insupportable. Dans la littérature améri-
caine, cela a été décrit sous le vocable «mental
pain» ou «psychache» [4]. Les patients vivent
cela de façon si insoutenable que le motif à
court terme de l’acte autodestructeur est de
mettre un terme à cet état, donc à fuir. Dans ce
contexte, il n’est donc pas étonnant que lors des
tentatives de suicide, on ingère dans ce but
principalement des psychotropes, des antal-
giques et de l’alcool. Lorsqu’on interroge les
patients après une tentative de suicide, ils
disent souvent qu’au moment de l’ingestion, ils
avaient l’intention de supprimer l’état insup-
portable, mais s’étaient alors également ac-
commodés de la mort. Les douleurs psychiques
sont souvent accompagnées d’une intense ex-
citation intérieure qui peut aller si loin qu’un
véritable état second s’installe (état dissociatif),
dans lequel les patients ne ressentent par
exemple aucune douleur ou aucune peur, en
vertu de quoi ils commettent l’acte «comme en
transe».
La prévention du suicide exige dès lors une
ouverture au patient en tant qu’être humain
avec son vécu intérieur.
Derrière tout acte suicidaire,
il y a une histoire
Un acte suicidaire a toujours une histoire anté-
rieure et le comportement d’un individu a tou-
jours une logique interne, même dans la crise
suicidaire. La plupart du temps, il y a derrière
un acte suicidaire d’anciennes expériences et
blessures intimes cachées dans l’histoire du pa-
tient. Ceci est parfois très difficile à comprendre
sur le moment, même si nous croyons bien
connaître cet individu. C’est pourquoi nous de-
vrions avant tout nous mettre simplement en
état d’écouter et essayer de comprendre com-
ment il est parvenu aux projets suicidaires ou à
la tentative de suicide. En partant du principe
de la théorie de l’agir selon lequel l’être humain
peut expliquer les raisons de ses actes, notre
devoir consisterait à encourager le patient à
nous raconter l’histoire qui se cache derrière.
Dans notre étude du Fonds national, nous
avons trouvé que la grande majorité des pa-
tients n’ont besoin que de dix à vingt minutes
(et non pas deux heures, comme nous le re-
doutions au début) pour nous raconter l’his-
toire conduisant à leur acte suicidaire. La no-
tion de «narrative based medicine» s’est établie
aussi bien en médecine de premier recours
qu’en psychiatrie [6]. La notion de narration
repose sur la supposition que la vie de chaque
être humain est constituée d’histoires qui per-
mettent à l’individu de s’expliquer ou d’essayer
de comprendre autrui. Le récit subjectif du pa-
tient n’est pas en contradiction avec l’evidence
based medicine, mais, à côté du trésor person-
nel d’expériences du médecin, constitue au
contraire un élément de l’évaluation clinique
intégrative. Un accès au patient par la narra-
tion suppose que le médecin exerce un rôle
différent de celui de l’expert omniscient: quand

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 732
il s’agit de l’histoire du patient, celui-ci est lui-
même l’expert de sa propre histoire. Les rôles
sont bien sûr à nouveau distribués autrement
lorsqu’il s’agit de faire et interpréter le status
psychique, ou de définir les implications théra-
peutiques.
Reconnaître et traiter
les dépressions
S’il y a une raison pour une dépression, il n’y a
alors aucune raison de ne pas poser le dia-
gnostic de dépression. Pour ce diagnostic, on
utilise aujourd’hui des termes tels que «épisode
dépressif» (léger, modéré, sévère; selon ICD-10,
1993), ou «dépression majeure/trouble dys-
thymique» (DSM-III-R), ou tout simplement
«syndrome dépressif typique». Les symptômes
les plus importants sont:
– perte d’intérêt et d’entrain (souvent lié à un
repli social),
– perte d’appétit et de poids,
– insomnie,
– inhibition psychomotrice ou agitation,
– perte d’énergie, fatigue,
– idées à contenu dépressif (sentiments de dé-
valorisation, idées de mort, idées suicidaires
récurrentes),
– difficultés de concentration et problèmes de
mémoire.
Diverses études ont d’ailleurs montré que le
symptôme insomnie va avec un risque suici-
daire augmenté. Dans chaque cas, il faudrait
s’enquérir de troubles du sommeil, en particu-
lier de son modèle dépressif typique (réveil
précoce).
La présence d’une symptomatologie dépressive
nette constitue une indication claire à un anti-
dépresseur. Le traitement antidépresseur exige
certaines connaissances et de l’expérience [7].
Il est essentiel d’expliquer au patient comment
les antidépresseurs agissent et surtout de l’in-
former qu’il n’existe aucun danger de dépen-
dance. En principe, on peut employer tous les
antidépresseurs, mais il faut être attentif à
certaines différences importantes. Pour les
dépressions sévères, les antidépresseurs tradi-
tionnels sont peut-être d’une efficacité légère-
ment meilleure que les ISRS, mais il faut tenir
compte du fait qu’au contraire des ISRS, ils sont
toxiques et qu’ils peuvent être létaux en cas de
surdosage intentionnel [8]. Ce danger peut être
évité en ne délivrant au patient que la ration de
quelques jours ou d’une semaine au maximum.
Les effets secondaires qui peuvent survenir
avec les deux groupes de médicaments sont
susceptibles d’entraver considérablement l’ob-
servance thérapeutique. Les effets secondaires
typiques des antidépresseurs tricycliques sont:
sécheresse buccale, constipation, sédation,
prise pondérale. Les effets secondaires typi-
ques des nouveaux antidépresseurs sont les
nausées, les vomissements, les sudations et la
nervosité.
Le principal est que le médecin surveille atten-
tivement le succès ou l’échec du traitement
médicamenteux et adapte la dose en consé-
quence ou, si nécessaire, modifie le traitement.
Diverses études ont montré que le lithium, qui
est utilisé en première intention pour le traite-
ment des troubles affectifs bipolaires, réduit
considérablement le risque suicidaire même
lorsque l’effet stabilisateur de l’humeur est in-
suffisant [9]. En cas d’insomnie ou d’agitation
sévères, les neuroleptiques sont parfois indi-
qués au début du traitement, en combinaison
avec un antidépresseur. Dans le traitement des
patients schizophrènes, il a été montré que la
clozapine réduit le risque suicidaire.
Il faut éviter d’utiliser les benzodiazépines à
long terme, non seulement en raison du risque
de dépendance, mais aussi parce que ces mé-
dicaments peuvent masquer une symptomato-
logie dépressive. Par contre, dans les crises
suicidaires aiguës – qu’il n’est d’ailleurs pas
rare d’observer en relation avec des attaques
Suicide et diagnostics psychiatriques
Diagnostics psychiatriques dans les cas de suicides réussis >90%
Fréquence de troubles affectifs dans les cas de suicides réussis* 40–70%
Fréquence de dépendance (alcool, drogues) dans les cas de suicides réussis* 25–50%
Fréquence de troubles de la personnalité dans les cas de suicides réussis* 30%
Risque de suicide la vie durant en cas de dépression majeure 15%
Risque de suicide la vie durant en cas de schizophrénie 10%
Risque de suicide la vie durant en cas de dépendance 3%
* une comorbidité avec plusieurs diagnostics psychiatriques est fréquente
[Sources: The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, K. Hawton,
K. van Heeringen (eds). Chichester; Wiley & Sons: 2000]

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 733
de panique – les benzodiazépines conservent
toute leur place.
Impliquer les proches
En l’absence d’amélioration ou si le risque sui-
cidaire est considéré comme très élevé, il est
utile d’impliquer les proches les plus impor-
tants pour le patient. Ces personnes peuvent li-
vrer des informations complémentaires essen-
tielles et il n’est pas rare que, pour la première
fois, viennent alors au jour des problèmes et des
conflits jouant un rôle dans le développement
de la dynamique suicidaire. S’il existe des pro-
jets de suicide concrets, il faut, avec l’accord du
patient, s’efforcer d’éloigner les moyens dan-
gereux tels qu’armes à feu, cordes, etc.
Collaborer avec le psychiatre
Il deviendra parfois nécessaire de faire appel
au psychiatre pour un consilium ou pour colla-
borer à la poursuite du traitement. Le médecin
de premier recours et le psychiatre devraient
coopérer dans toute la mesure du possible, car
c’est un gage de meilleur soutien pour le pa-
tient. Il faudrait en tout cas éviter que le patient
n’ait plus de rendez-vous ultérieur chez son
médecin de famille après une consultation chez
le psychiatre ou une policlinique psychiatrique.
Traitement hospitalier en milieu
psychiatrique
Une hospitalisation peut certes être une mesure
vitale pour les patients gravement suicidaires,
mais devrait si possible toujours être décidée en
accord avec le patient. Une hospitalisation sous
la pression peut représenter une lourde me-
nace pour le patient dépressif. Une hospitalisa-
tion d’office (non volontaire) peut s’avérer né-
cessaire lorsque la tâche d’assistance devient
impossible en raison d’un manque de coopéra-
tion et d’un comportement provocateur du pa-
tient. Dans ce cas, il est important de faire par-
ticiper les proches à une telle prise de décision
et de les informer en détail des implications.
Attention: une clinique psychiatrique ne consti-
tue pas une assurance contre le suicide. Il n’est
pas rare en effet d’observer des suicides à
l’hôpital ou peu après la sortie.
Le médecin en tant que
«suicide survivor»
Tout suicide laisse l’être humain en proie à une
foule de sentiments extrêmes et face à de nom-
breuses questions pour la plupart sans réponse.
Aux USA, on a adopté le terme de «suicide sur-
vivor» pour désigner les personnes qui ont
perdu un proche par suicide [10]. On met ainsi
l’accent sur le traumatisme que représente un
tel événement, cette dimension étant souvent
sous-estimée par les individus non concernés.
Ces dernières années, diverses publications ont
à juste titre également traité des répercussions
du suicide d’un patient sur le médecin traitant
et les thérapeutes [11]. Lorsqu’on les interroge,
on entend très souvent les médecins dire qu’ils
se trouvent confrontés non seulement à des
impressions aiguës de choc et de paralysie,
mais aussi à des doutes quant à leur propre
compétence, des sentiments de culpabilité et
d’insécurité. Il n’est pas rare que des théra-
peutes songent à changer de profession après
un tel événement. Les individus de sexe mas-
culin en particulier ont souvent beaucoup de
peine à en parler avec quelqu’un et ont ten-
Quintessence
Le suicide et la tentative de suicide sont des actes souvent accomplis dans
certains états psychiques (et biologiques). La plupart du temps, l’acte
suicidaire est précédé d’une longue évolution (souvent méconnue de
l’entourage).
Lors des consultations médicales, il est rare que les patients parlent
spontanément d’idées suicidaires. Une bonne connaissance des facteurs
de risque est donc importante pour la prévention du suicide. Le facteur
de risque numéro 1 est la présence d’une symptomatologie dépressive.
Les autres indicateurs de risque suicidaire sont la dépendance à l’alcool
et/ou aux drogues, les troubles de la personnalité ainsi que les états
psychologiques de désespoir ou d’horizon bouché. Attention, chez les indi-
vidus de sexe masculin en particulier, une dépression peut se cacher
derrière un problème de dépendance ou un comportement agressif.
Au cabinet médical, les problèmes de communication entre le médecin et
le patient suicidaire sont un des plus importants obstacles à l’efficacité de
la prévention du suicide. Le mode de réflexion causale habituellement uti-
lisé en médecine ne se prête pas volontiers à l’exploration de l’agir des
autres êtres humains. Derrière chaque acte, il y a un développement per-
sonnel, c’est-à-dire une histoire intimement liée à la biographie du patient.
Le patient lui-même est le meilleur expert pour expliquer (narrer) cette
histoire – il a seulement besoin d’un auditeur attentif et intéressé.
Le vécu intérieur de la crise suicidaire est empreint d’une douleur éprou-
vée comme insupportable (en anglais: mental pain, psychache), de senti-
ments de dévalorisation et de désespoir. L’expérience correspond souvent
à un traumatisme intérieur aigu. Il est utile que le médecin soit capable
de se représenter l’état d’âme suicidaire.
La fréquence du suicide est une grandeur influençable. Une formation
continue dans la problématique de la dépression et du suicide ciblée sur le
médecin de premier recours eut, dans le cas de l’étude sur l’île de Gotland,
une influence significative sur la fréquence du suicide dans la population.
En cas de suicide réussi, il ne faut pas sous-estimer ses répercussions
sur les proches, le médecin et le personnel soignant.

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 734
dance à se distraire en se réfugiant dans le tra-
vail. Puisque dans les cliniques psychiatriques
ce sont avant tout de jeunes assistants qui sont
concernés, il est extrêmement important d’of-
frir à ces collègues tout le soutien professionnel
nécessaire. Mais cela est également valable tant
pour le personnel et les patients de l’unité de
soins que pour le médecin traitant.
Références
1 Michel K, Valach L, Waeber V. Un-
derstanding deliberate self-harm:
The patients’ views. Crisis 1994;15:
172–8.
2 Goldberg DP, Jennkins L, Millar T,
Faragher EB. The ability of trainee
general practitioners to identify
psychological distress among their
patients. Psychol Med 1993;23:
185–93.
3 Michel K, Dey P, Valach L. Suicide
as goal-directed action. In: K. van
Heeringen (ed). Understanding
Suicidal Behaviour: the Suicidal
Process Approach to Research and
Treatment. Chichester; Wiley &
Sons: 2001.
4 Shneidman ES. Suicide as a psy-
chache. J Nerv and Ment Dis 1993;
181:145–7.
6 Greenhalgh T. Narrative based
medicine in an evidence based
world. Br Med J 1999;318:323–5.
7 Hell D, Böker H, Marty T. Integra-
tive Therapie der Depression. Swiss
Med Forum 2000;1:491–9.
8 Cassidy SL, Henry JA. Fatal toxicity
of antidepressant drugs in over-
dose. Br Med J 1987;295:1021–4.
9 Müller-Oerlinghausen B, Müser-
Causemann B, Volk J, Suicides and
parasuicides in a high-risk patient
group an and off lithium long-term
medication. J Affect Dis 1992;25:
261–70.
10 Grad OT. Suicide: How to survive
as a survivor? Crisis 1996;17/3:
136–42.
11 Michel K. After suicide: Who coun-
sels the therapist? Crisis 1997;
18/3,128–40.
Littérature recommandée
– Basisbroschüre Suizid und Krise,
dritte Auflage. Zu beziehen bei Ver-
bindung der Schweizer Ärzte FMH,
Abteilung Prävention, Elfenstrasse
18, 3000 Bern 16.
– M. Wolfersdorf: Der suizidale Patient
in Klinik und Praxis. Stuttgart;
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
GmbH: 2000.
– A. Finzen. Suizidprophylaxe bei psy-
chischen Störungen. Bonn; Psychia-
trie-Verlag, Thieme: 1997.
– K. Michel, AA. Leenaars, DA. Jobes,
JT. Maltsberger, I. Orbach, L. Valach,
et al.: Meeting the Suicidal Person.
Richtlinien und Literatur zum Ge-
spräch mit dem suizidalen Patienten:
http://www.aeschiconference.unibe.
ch.
1
/
5
100%