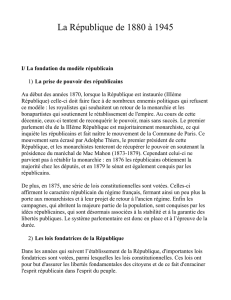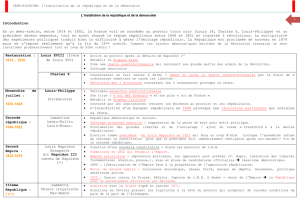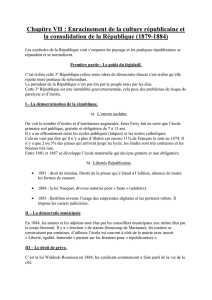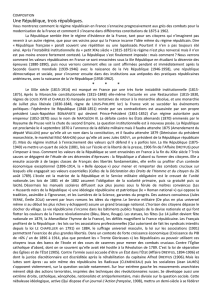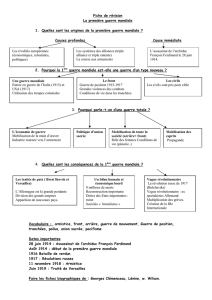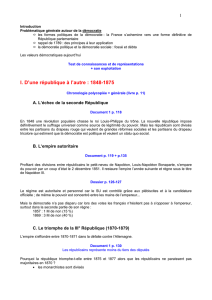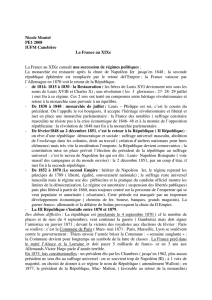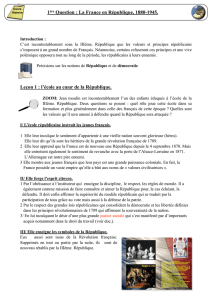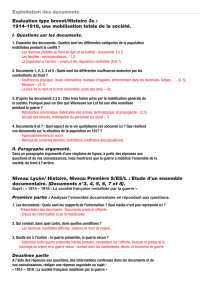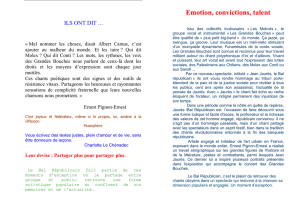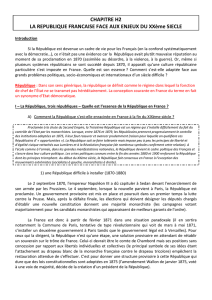Fiches réalisées par Arnaud LEONARD

1
Fiches réalisées par Arnaud LEONARD
(Lycée français de Varsovie, Pologne)
à partir de sources diverses, notamment des excellents « livres du professeur »
des éditions Nathan (dir. Guillaume LE QUINTREC)

2
HC – A la recherche d'un régime politique en France de 1848 à 1879
Approche scientifique Approche didactique
Définition du sujet (termes et concepts liés, temps court et temps long, amplitude
spatiale) :
Insertion dans les programmes (avant,
après) :
Sources et muséographie :
Ouvrages généraux :
Demier Francis, La France du XIXe siècle, 1814-1914, Le Seuil, 2000, coll. «Points Histoire», p. 163-322.
Rémond René, La Vie politique en France depuis 1789, tome 2, « La vie politique en France, 1848-1879 », Armand Colin, coll.
«U», 3e éd. 1986, 382 p.
J. Baronnet, Regard d’un Parisien sur la Commune, Gallimard/Paris bibliothèques, 2006.
Rougerie Jacques, La Commune de 1871, PUF, 1992, coll. «Que sais-je?», 128 p.
Rougerie Jacques, Paris insurgé, la Commune de 1871, Gallimard, 1995, coll. «Découvertes», 160 p.
Winock Michel, « La poussée démocratique 1840-1870 », in Berstein Serge et Winock Michel (dir.), Histoire de la France
politique, tome 3, «L’invention de la démocratie, 1789-1914 », Le Seuil, 2002, coll. « L’Univers historique », p. 109-152.
J.-C. Caron, La nation, l’État et la démocratie en France de 1789 à 1914, coll. « U », A. Colin, 1995.
Caron, F., La France des patriotes de 1851 à 1918, Fayard, 1993.
M. Agulhon, Les Quarante-huitards, Gallimard, Paris, 1992.
Agulhon, M., 1848 ou l’apprentissage de la république (1848-1852), tome 8 de NHFC, Le Seuil, 1973.
Plessis, A., De la fête impériale aux murs des fédérés (1852-1871), tome 9 de NHFC, Le Seuil, 1973.
Mayeur, J.-M., Les Débuts de la IIIe République (1871-1898), tome 10 de NHFC, Le Seuil, 1973.
F. Furet, La Révolution : 1770-1880, Hachette, 1988 (réédition chez Pluriel en 2 volumes).
Furet (F.), Ozouf (M.), Le Siècle de l’avènement républicain, Hachette, 1986
J. Garrigues, La France de 1848 à 1870, coll. « Cursus », A. Colin, 1995.
P. Lévêque, Histoire des forces politiques en France, coll. « U », A. Colin, tome 1 (1789-1880), 1992, tome 2 (1880-1940), 1994.
A. Olivesi & A. Nouschi, La France de 1848 à 1914, Nathan, 2e éd. 1997.
É. ANCEAU, La France de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, coll. « La France contemporaine », Livre de Poche, 2002.
E. Anceau (textes présentés par), Les grands discours parlementaires du XIXe siècle, de Benjamin Constant à Adolphe Thiers,
1800-1870, A. Colin/Assemblée nationale, 2005.
J. Garrigues (textes présentés par), Les grands discours parlementaires de la Troisième République, de Victor Hugo à
Clemenceau, 1870-1914, A. Colin/Assemblée nationale, 2004.
J. Ferry, La République des citoyens, anthologie présentée par Odile Rudelle, coll. « Acteurs de l’Histoire », Imprimerie
Nationale, 1996 (2 volumes).
H. Fréchet & J.-P. Picq, Lexique d’histoire politique de la France de 1789 à 1914, Ellipses, 1988.
J. Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970.
M. Mopin, Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, La Documentation française, 1988.
H. Néant, La politique en France (XIXe-XXe siècle), coll. « Carré Histoire », Hachette, 2e éd. 2000.
B. Noel, Dictionnaire de la Commune, Mémoire du Livre, 2001.
S. Rials, Textes politiques français (1789-1958), coll. « Que sais-je ? », PUF, 2e éd. 1987.
N. Vivier (dir.), Dictionnaire de la France du XIXe siècle, coll. « Carré », Hachette, 2002.
R. Huard, Le suffrage universel en France, Aubier, 1991.
Rosanvallon, P., Le Sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France, Gallimard, (1992) 2001.
M. Offerlé, Un homme, une voix ? Histoire du suffrage universel, coll. « Découvertes », Gallimard, Paris, 2002.
J.-L. Mayaud (dir.), 1848, actes du colloque du cent cinquantenaire tenu à l’Assemblée nationale, Créaphis, 2002.
J. ETEVENAUX, Napoléon III, un empereur visionnaire à réhabiliter, De Vecchi, 2006.
P. Milza, Napoléon III, Perrin, 2004.
L. Girard, Napoléon III, Fayard, Paris, (1986), 1986, rééd. Hachette, coll. « Pluriel », 2002.
J.-C. YON, Le Second Empire. Politique, société, culture, coll. « U », A. Colin, 2004.
Tulard (J.), Dictionnaire du Second Empire, Fayard, 1995
B. H. Moss, Aux origines du mouvement ouvrier français : Le socialisme des ouvriers de métier, 1830-1914, Les Belles Lettres,
1989.
C. Nicolet, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Gallimard, 1982.
J. GRONDEUX, La France entre en République. 1870-1893, Le Livre de Poche, 2000.
Audouin-Rouzeau (S.), 1870. La France dans la guerre, Armand Colin, 1989
S. Guichard, Paris 1871, la Commune, Berg International, 2006.
G. BOURGIN, La Commune, coll. « Que sais-je »,PUF, n° 581.
J. Rougerie, La Commune de 1871, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1988 (1997).
J. ROUGERIE, Procès des Communards, Archives Julliard, 1964.
R. Tombs, La guerre contre Paris. 1871, coll. « Collection historique », Aubier, 1997 (édition originale, 1981).
Documentation Photographique et diapos :
Revues :

3
« Faut-il réhabiliter Napoléon III ? », L’Histoire, juin 1997, n°211.
Napoléon III, TDC, N° 958, du 15 au 30 juin 2008
Les voies du suffrage universel, TDC, N° 831, du 1er au 15 mars 2002
Le Paris d’Haussmann, Au nom de la modernité, YVES CLERGET, TDC, N° 693, du 1er au 15 avril 1995
Carte murale :
Enjeux scientifiques (épistémologie, historiographie et renouvellement des
savoirs, concepts, problématique) :
Entre 1848 et 1879, la France est plus que jamais déchirée par l’héritage
révolutionnaire, qui a ouvert les questions de l’égalité civile et de la démocratie.
Traversée par trois régimes (Seconde République de 1848 à 1852, Second Empire
de 1852 à 1870, IIIe République proclamée le 4 septembre 1870), cette période
est marquée tout entière par la question de l’adoption du suffrage universel. Si la
démocratie politique et sociale des premiers temps de la Seconde République
échoue, l’enracinement démocratique et l’apprentissage de la citoyenneté se
poursuivent néanmoins en profondeur, y compris sous l’Empire, par le biais du
plébiscite et, à partir de 1860, par son inflexion parlementaire. Au rythme d’une
histoire souvent tragique, la Troisième République consacre finalement la
maturité de la démocratie politique par l’instauration d’un régime libéral et
parlementaire, fondé sur un suffrage universel rétabli pleinement, ignorant
cependant des aspirations sociales qui se sont violemment exprimées dans
l’explosion communaliste de 1871.
Cette question d’histoire politique « classique » ne présente pas de difficultés
particulières. Il faut analyser les différents types de régimes expérimentés au
cours de cette trentaine d’années, sans se perdre dans un récit événementiel trop
détaillé. L’important est d’expliquer le fonctionnement de chacun de ces régimes
et les causes de son échec ou de son succès.
Il faut faire attention cependant à éviter une approche téléologique, qui
présenterait la Troisième République comme un point d’aboutissement
nécessaire. Le Second Empire, en effet, a été victime d’une guerre mal engagée,
beaucoup plus que de l’opposition républicaine. Les républicains modérés ont su
ensuite convaincre les Français, en se démarquant à la fois de la Commune et des
royalistes, encore puissants dans les années 1870.
Comment expliquer l’instabilité politique de la France entre 1848 et 1879 ?
L’étude de cette question doit permettre de montrer l’affrontement des différents
courants politiques qui luttent pour le pouvoir ainsi que leurs valeurs respectives
: monarchistes (légitimistes et orléanistes ; les premiers, autour du comte de
Chambord héritiers de la monarchie absolue de droit divin, les seconds, autour du
comte de Paris défenseurs d’une monarchie parlementaire fondée sur un régime
censitaire), bonapartistes (on abordera alors la notion de césarisme, pouvoir
exécutif fort qui prétend s’appuyer sur le peuple) et républicains (on montrera
leur diversité : conservateurs, radicaux, socialistes
et leurs valeurs communes, notamment la défense du suffrage universel).
Le Second Empire est, dès ses débuts, un régime ambigu. D’une part, il prétend
tenir sa légitimité du suffrage universel masculin, qui est rétabli dès 1851, et
multiplie les appels au peuple français par l’intermédiaire des référendums. De
l’autre, l’Empire s’affirme comme une monarchie autoritaire, au moins jusqu’en
1860 ; les pouvoirs de l’empereur sont immenses et les libertés restreintes. Après
cette date, le régime se libéralise progressivement et devient une monarchie quasi
parlementaire. Ces réformes rencontrent un certain appui populaire, même si le
gouvernement ne renonce pas à intervenir pour influencer le vote des électeurs.
L’historiographie récente a pris ses distances avec une vision caricaturale du
Second Empire, héritée de la propagande républicaine et des manuels de la IIIe
République. En maintenant le suffrage universel, même manipulé, le régime
bonapartiste a permis une certaine acculturation politique des Français. Le vote
pour le candidat officiel – souvent un homme nouveau – peut s’interpréter
comme un rejet des anciens notables. Par ailleurs, le régime est devenu quasi
parlementaire à l’issue d’un processus de démocratisation assez remarquable.
Comment l’idée de la République a-t-elle fini par s’imposer ?
Cette question permet de développer une réflexion autour de la notion-clé du
suffrage universel et de souveraineté populaire. Elle conduit aussi à aborder la
Enjeux didactiques (repères, notions et
méthodes) :
BO 1ere : « De la Deuxième République à
1879 : la recherche d’un régime politique
On examine comment la France est à la
recherche d’institutions capables d’inscrire
l’héritage de la Révolution dans la société
nouvelle. La présentation des années 1870-
1871 – de la défaite à la Commune - permet
de souligner cet enjeu. »
BO 4
e
actuel : « La France de 1815 à 1914 (4
à 5 heures)
L’accent est mis sur la recherche, à travers de
nombreuses luttes politiques et sociales et de
multiples expériences politiques, d’un régime
stable, capable de satisfaire les aspirations
d’une société française majoritairement
attachée à l’héritage révolutionnaire.
•Repères chronologiques : les révolutions de
1848 ; la Seconde République (1848-1852) ;
le Second Empire (1852-1870) ;
l’inauguration du canal de Suez (1869) ;
proclamation de la République (4 septembre
1870) ; l’Affaire Dreyfus (1898).
•Documents : Delacroix : La Liberté guidant
le peuple ; Victor Hugo : extraits des
Châtiments et des Misérables ; la loi sur la
séparation de l’Église et de l’État (1905). »
Socle : Nouveau commentaire
« La succession des régimes au cours de cette
période manifeste la difficulté de parvenir à
une stabilité politique jusqu’à l’enracinement
de la IIIe République malgré les crises
violentes qui ont marqué ses origines.
Ajout aux repères
La Commune (1871). »
BO 4
e
futur : « L’ÉVOLUTION POLITIQUE
DE LA FRANCE, 1815-1914
La succession rapide de régimes politiques
jusqu’en 1870 est engendrée par des ruptures
: révolutions, coup d’État, guerre. La victoire
des républicains vers 1880 enracine
solidement la IIIe République qui résiste à de
graves crises.
Les régimes politiques sont simplement
caractérisés ; le sens des révolutions de 1830
et de 1848 (établissement du suffrage
universel et abolition de l’esclavage) et de la
Commune est précisé.
Situer dans le temps
- Les régimes politiques successifs de la
France de 1815 à 1914
- L'abolition de l'esclavage et suffrage
universel masculin en 1848 »

4
notion de libertés fondamentales. Héritées de 1789, ces notions forment le socle
commun des républicains. Toutefois, il faudra aussi montrer les divergences qui
se font jour au sein du camp républicain, notamment en ce qui concerne la
conception de la République. Autrement dit, quelle République souhaitent les
Français ? Est-ce une République conservatrice (qui garantit les libertés
fondamentales, l’égalité civique mais se veut conservatrice sur le plan social),
une République radicale (dont les valeurs sont la défense de la laïcité et des
valeurs républicaines, la limitation des inégalités sociales) ou est-ce une
République sociale (héritière de 1793 et de ces valeurs plus égalitaristes) ?
L’étude de la Commune doit permettre de trancher cette question.
La Commune, comme l’a montré depuis longtemps Jacques Rougerie, n’est pas
la première révolution du prolétariat moderne comme l’avaient cru Marx et
surtout Lénine. Elle s’inscrit dans l’histoire du mouvement ouvrier français, celle
du « socialisme de métier » étudié par l’historien américain Bernard H. Moss. Les
revendications des Communards sont très proches de celles des « démoc-soc. »
de 1848 : organiser dans chaque branche d’activité des coopératives ouvrières,
avec l’aide d’une République résolument sociale. C’est l’échec de la Commune
qui a ensuite poussé les ouvriers français à prendre leurs distances avec les
républicains et à s’organiser sur leurs propres bases.
Plan, entrées originales (événements, acteurs, lieux, œuvres d’art), supports
documentaires et productions graphiques :
Le plan chronologique s’impose ici. On analyse donc la IIe République, puis le
Second Empire. On présente ensuite la période très dense des années 1870-1871,
en approfondissant l’étude de la Commune (par exemple à travers l’itinéraire de
Louise Michel). Puis il faut montrer comment la IIIe République s’est imposée
entre 1871 et 1879, en étudiant d’une manière précise les institutions mises en
place (les lois de 1875 et le régime parlementaire).
Un questionnement transversal consacré à l’héritage de la Révolution dans le
débat politique permet de voir comment chaque famille politique se situe dans
cette problématique centrale. Les bonapartistes prétendent concilier les principes
de 1789 (souveraineté nationale) et un ordre monarchique. Les légitimistes
rejettent très largement l’héritage révolutionnaire et restent nostalgiques de la
France d’avant 1789. Les républicains modérés veulent achever l’oeuvre de la
Révolution, tout en se démarquant de ses aspects violents. Les républicains «
rouges » veulent poursuivre la Révolution, dont ils assument totalement
l’héritage. Les républicains puisent leurs références dans la philosophie des
Lumières et dans la Révolution de 1789 dont ils veulent faire vivre l’héritage :
liberté, égalité, souveraineté nationale, exaltation de la patrie. À partir de 1879,
contrôlant tous les rouages du pouvoir, ils mettent en place un régime
parlementaire qui assure la pré éminence du législatif sur l’exécutif et la
prépondérance de la Chambre des députés, des lois garantissant les libertés
fondamentales : liberté de la presse, de réunion, liberté syndicale. Ils posent ainsi
les bases d’une démocratie libérale et parlementaire.
I. Révolutions et Seconde République (1848-1852) : l’échec d’une république
fraternelle, généreuse et démocratique
Les quelques mois charnières qui font suite à l’échec de la monarchie de Juillet et
à la révolution de 1848 témoignent d’une recherche effrénée d’institutions
efficaces pour diriger la France. Les acquis et les principes révolutionnaires
marquent les aspirations des « quarante-huitards », mais l’effervescence
passionnée et les libertés conquises qui s’ensuivent ne tardent pas à effrayer les
élites et la paysannerie. La période est marquée par de nombreux
questionnements : attitude face à la démocratie sociale, articulation entre
représentation politique et suffrage universel, entre autorité et démocratie, entre
exécutif et législatif, entre Paris et province…
On peut dire que le gouvernement reconnaît le droit au travail dans la mesure où,
le 25 février 1848, « il s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail ».
Mais cette déclaration n’est pas vraiment suivie d’effets. L’extrême gauche
républicaine réclame en vain la création d’un Ministère du travail (fondé en 1906
seulement par Clemenceau). Le gouvernement se contente de nommer une
Activités, consignes et productions des élèves
:
Accompagnement 1
ère
: « Ce thème invite à
une réflexion sur la recherche d’institutions
efficaces pour un État important, dont la
société est marquée par les acquis et les
principes de la Révolution et engagée dans
les mutations liées au processus
d’industrialisation. Les questions des années
1848-1851 : démocratie sociale, articulation
entre représentation politique et suffrage
universel, entre autorité et démocratie, entre
exécutif et législatif et entre Paris et province
constituent le point de départ ainsi
que les enjeux durables. Le Second Empire
est un césarisme démocratique, dans lequel le
suffrage universel n’est pas remis en question
mais confisqué par une pratique autoritaire: la
souveraineté populaire est absorbée par un
homme. L’évolution libérale maîtrisée voulue
par Napoléon III :
hérédité, appel direct au peuple et
gouvernement représentatif, se brise sur sa
politique étrangère, inscrite dans la tradition
solidement ancrée de la gloire nationale.
La crise nationale qui court de septembre
1870 à mai 1871 illustre l’intérêt du temps
court et la valeur explicative de l’événement.
Le désastre de la guerre avec la Prusse
entraîne la proclamation de la république,
durablement marquée par le provisoire. Deux
conceptions s’affrontent alors : la vision
nationaliste de Gambetta qui veut poursuivre
la guerre heurte le libéralisme et la prudence
des républicains modérés et les aspirations à
la paix des ruraux. Le suffrage universel élit
une Assemblée majoritairement monarchiste,
qui confie le pouvoir exécutif à Thiers,
partisan de la paix. Une partie des Parisiens,
refusant que leur résistance, toute jacobine,
contre les Prussiens se termine ainsi, estimant
la république menacée et refusant la «
décapitalisation » de leur ville, s’insurge en

5
Commission du gouvernement pour les travailleurs, qui siège au palais du
Luxembourg sous la présidence de Louis Blanc et de l’ouvrier Albert. On
organise des ateliers nationaux, qui ne sont en fait que des grands chantiers de
charité, et non l’organisation du travail réclamée par Louis Blanc, supervisés par
le ministre Marie (représentant des républicains modérés fidèles au libéralisme).
Tous les ouvriers sans travail y sont admis, avec un salaire de 2 francs par jour.
Les ateliers sont organisés sur un modèle militaire (lieutenances, brigades,
escouades), mais avec des chefs élus. Au moment de leur dissolution, les ateliers
nationaux employaient 130 000 ouvriers (pour un coût de plus de 7 millions de
francs). Cette décision fut prise parce que les ateliers nationaux étaient considérés
comme un foyer d’agitation et parce qu’ils coûtaient cher à l’État, qui avait dû
augmenter de 45 % les impôts directs (c’est «l’impôt des 45 centimes», sous-
entendu par franc d’imposition, très impopulaire dans les campagnes).
La jeune République issue des événements de 1848 se veut girondine.
Immaculée, elle véhicule l’image d’un humanitarisme sincère dont sont issues les
aspirations diffuses des vainqueurs : démocratie, pitié et générosité, justice
sociale, fraternité… Elle répudie tout système et toute tentative de terreur. La
férocité jacobine de 1793 est condamnée. Il y a pourtant parenté entre les deux
épisodes révolutionnaires. La jeune vierge de 1848 s’adresse à sa « soeur » de
l’An II, reconnaissance explicite d’un héritage, d’une continuité entre les
révolutions de 1793 et 1848. Victor Hugo montrant bien la complémentarité des
deux républiques : « La première a détruit, la seconde doit organiser. L’oeuvre
d’organisation est le complément nécessaire de l’œuvre de destruction ».
Mais après la proclamation le 4 mai d’une république conservatrice, les meneurs
socialistes les plus résolus (Blanqui, Barbès, Raspail…) manquent, à l’issue
d’une manifestation désordonnée le 15 mai 1848, de faire vaciller le régime. Le
désir de réaction va être exaspéré par cet épisode. La dignité de la République
issue du suffrage universel a été violée, sa légitimité contestée par le peuple de
Paris. Les sanglantes Journées de juin rompent l’euphorie de la fraternité nouvelle
inaugurée par la révolution de février 1848. Les journées de juin 1848 sont
déclenchées par la décision du gouvernement de fermer les Ateliers nationaux
créés par le gouvernement provisoire de février pour lutter contre le chômage
(dans lesquels on versait un salaire aux chômeurs contre un travail, le plus
souvent de terrassement, dont l’utilité n’était pas toujours avérée) et d’enrôler les
chômeurs célibataires dans l’armée. La fermeture des ateliers, ainsi que l’élection
à l’Assemblée des révolutionnaires Leroux et Proudhon et de Louis Napoléon
Bonaparte mettent le feu aux poudres. Les ouvriers au chômage qui ne survivent
que grâce aux ateliers nationaux, sont acculés au désespoir suite à leur abolition.
L’arrestation en mai des leaders les plus connus empêche toute organisation
efficace Le 23 juin, Paris se hérisse de barricades. Les soldats de la Garde
nationale livrent durant 4 jours un cruel combat contre les insurgés.
L’insurrection parisienne de juin 1848
La France est déchirée une guerre civile qui oppose la classe ouvrière et les
partisans de l’Ordre. Un ouvrier accuse explicitement la bourgeoisie républicaine
d’avoir fusillé et déporté les militants de gauche révoltés les 23-26 juin 1848. Le
général Cavaignac, le « prince du sang », ministre de la Guerre puis chef du
pouvoir exécutif, est chargé de réprimer l’émeute. Le 26 juin, après des combats
sanglants, les dernières barricades tombent. La bataille se solde par quelques
exécutions sommaires et d’immenses rafles de suspects. 1 500 hommes attendent,
dans des prisons improvisées, la « transportation en Algérie ». L’écrasement de
l’insurrection par l’armée marque la fin de « l’illusion lyrique » et de la «
République sociale ».
Jean-Louis Meissonnier est l’un des peintres d’histoire et de scènes de genre les
plus populaires et les plus décorés de la monarchie de Juillet et du Second
Empire. Cette oeuvre, La barricade de la rue de la Mortellerie, illustre la terrible
répression des Journées de juin à Paris. Les affrontements sont acharnés entre un
camp « bourgeois » très résolu dont les valeurs d’ordre, de propriété, de liberté se
voient attribuées des mérites absolus et celui des « ouvriers socialistes »
combattant au nom de la justice, du bonheur et de la vie.
La Constitution du 4 novembre 1848
Dès le lendemain de la révolution de 1848, une Assemblée constituante est
formée d’une majorité de républicains modérés prêts à défendre la République
mars 1871. La Commune défend la
démocratie directe, mène une politique qui
anticipe sur celle de la Troisième République
et esquisse des projets (république sociale et
pour partie fédérale). Après son écrasement,
la période 1871-1879 est marquée par la
marginalisation de ceux qui refusent la
république et la victoire de la conception
libérale et parlementaire du pouvoir sur la
conception autoritaire. Le suffrage universel
tranche à plusieurs reprises, amenant la
démission de Mac-Mahon en janvier 1879.
Ce fait entérine une césure importante, pour
le fonctionnement des institutions comme
pour la recomposition du système des forces
politiques. »
L’INCONNU DE LA PREMIÈRE FOIS
À la suite de la Révolution de février 1848, le
gouvernement provisoire de la République
française décrète, le 5 mars, le vote universel,
c’est-à-dire le suffrage universel masculin. «
On entrait dans l’inconnu », écrit Garnier-
Pagès, l’un des membres du gouvernement
provisoire. Dimanche de Pâques, 23 avril
1848, la scène a été souvent décrite : Garnier-
Pagès trace les contours idylliques de ce
premier vote massif et apaisé des campagnes
avec 83 % des inscrits qui ont participé à ce
premier banquet civique !
Les électeurs, venus en cortèges au chef-lieu
de canton, ont été appelés, commune après
commune, nominalement par le président du
bureau de vote à qui ils remettent leur
bulletin de vote, qui a été rédigé à la main en
dehors du bureau, ou à défaut imprimé. Le
bon électeur est en effet celui qui est capable
d’écrire lui-même son bulletin, mais, la
population masculine étant analphabète à 50
%, les agents électoraux des candidats ont
répandu dans la population de fortes quantités
de bulletins imprimés.
Lors de ce premier vote, les pressions des
puissants, des prêtres et des représentants de
la jeune République n’ont pas dû manquer.
Le président glisse lui-même le bulletin dans
l’urne, tandis qu’un assesseur appose son
paraphe à côté du nom de l’électeur. Cette
procédure restera inchangée jusqu’en 1913,
date d’adoption de l’enveloppe et de l’isoloir.
Toutefois le vote aura désormais lieu dans la
commune et la procédure de l’appel nominal
des citoyens tombera en désuétude. Preuve
aussi de l’individualisation du vote : on vient
voter quand on le veut.
Toutefois, la belle unanimité quarante-
huitarde est ternie par les contestations des
résultats à Limoges et surtout à Rouen, dans
les quartiers ouvriers. Deux mois plus tard, ce
seront 4 000 morts que l’insurrection de juin
fauchera. La pacification des conflits est une
condition, mais aussi une conséquence de la
gestion douce des passions politiques par le
vote. Si, par la loi du 31 mai 1850, le parti de
l’ordre exclut « la vile multitude » (Thiers),
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
1
/
154
100%