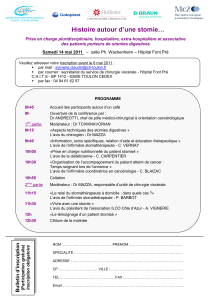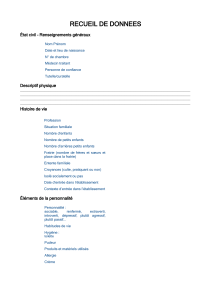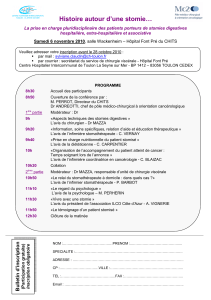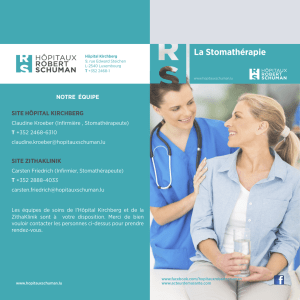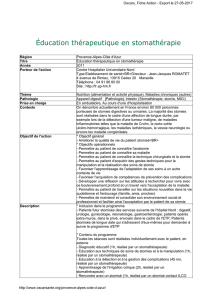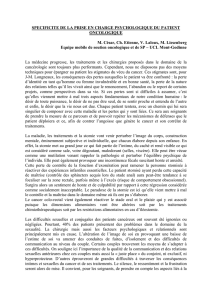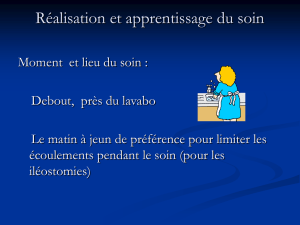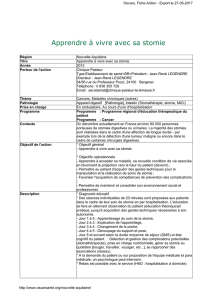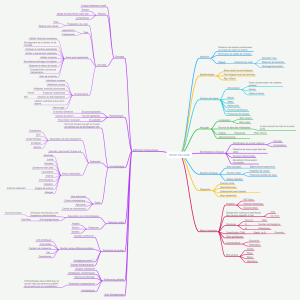Prise en charge chirurgicale de la rectocolite

Dossier
19
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
http://dx.doi.org/10.1016/j.revinf.2013.12.006
Les maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin
La revue de l’infi rmière ● Mars 2014 ● n° 199
Prise en charge chirurgicale
de la rectocolite hémorragique
La chirurgie chez les patients atteints de maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin
est utilisé en cas d’échec du traitement médicamenteux. Parfois lourdes et réalisées
en plusieurs temps, les interventions chirurgicales impliquent les infi rmières dans
l’éducation du patient, la surveillance, la prévention et le repérage des complications.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
Surgical treatment of ulcerative colitis. Surgery for patients suff ering from infl ammatory
bowel diseases is an option when medication-based treatment fails. Sometimes complex
and carried out in several stages, the procedures require the nurses to be involved in the
education of the patient, monitoring, prevention and identifi cation of complications.
Dans le service de chirurgie colorectale de
l’hôpital Beaujon (AP-HP) de Clichy-la-
Garenne (92), les patients sont hospitalisés
la veille de l’intervention. Ils sont familiers de l’hôpi-
tal, ayant souvent subi plusieurs hospitalisations
pour la prise en charge de leur maladie inflamma-
toire chronique de l’intestin (Mici) et pris de nom-
breux traitements médicamenteux. La chirurgie
représente leur dernier recours.
Dès l’accueil, et outre la mise en œuvre des prescriptions
médicales, l’infi rmière en charge du futur opéré vérifi e s’il
a bien compris le sens de l’intervention et ses consé-
quences. Il est constaté que bien souvent ils n’ont pas
vraiment intégré les explications fournies par le chirurgien
durant la consultation. Aussi, ils abordent l’hospitalisation
sans avoir vraiment conscience des suites opératoires qui
vont pourtant nécessiter des auto-soins.
La consultation avec l’infi rmière stomathérapeute
de l’équipe permet d’expliquer de nouveau, de
conseiller, d’écouter le patient, de répondre à ses
questions, de lui montrer du matériel (fi gure1), le
rassurer et l’orienter vers les membres de l’équipe
pluridisciplinaire (psychologue, diététicien, assis-
tante sociale, association...). L’emplacement de la
future stomie1 est alors repéré.
La chirurgie de la rectocolite hémorragique (RCH)
s’eff ectue le plus souvent en trois temps.
Premier temps opératoire
Le premier temps opératoire consiste en une colec-
tomie subtotale2.
Les chirurgiens retirent une importante partie du
côlon, ne laissant que le sigmoïde (partie terminale
du côlon) et le rectum. L’iléon, partie terminale de
l’intestin grêle, est abouché à la peau, créant ainsi un
anus artifi ciel temporaire (stomie). Le rectum, tou-
jours en place, est très infl ammatoire. Dans ce milieu
hostile, la réalisation d’anastomoses digestives n’est
pas indiquée car les sutures ne tiendraient pas. En
attendant ce deuxième temps opératoire, des lave-
ments anti-infl ammatoires sont eff ectués pendant
plusieurs semaines.
Ce type d’intervention se réalise sous cœlioscopie,
ce qui implique des suites opératoires souvent plus
simples et une durée d’hospitalisation plus courte.
Éducation thérapeutique du patient
Le rôle de l’infi rmière et en particulier de la stoma-
thérapeute est de mettre en place une éducation,
Sarah Alves
Infi rmière
Cindy Gauthier
Infi rmière
Marine Hascoet
Infi rmière
Linsee Lucien
Infi rmière
Delphine Paradis*
Infi rmière stomathérapeute
Hélène Corté
Chef de clinique en chirurgie
colorectale
Service de chirurgie
colorectale,
Hôpital Beaujon,
100 boulevard du Général
Leclerc, 92110 Clichy-
la-Garenne, France
*
Auteur correspondant.
Adresse e-mail :
(D. Paradis).
Mots clés - chirurgie; colectomie; maladie infl ammatoire chronique de l’intestin; rectocolite hémorragique;
stomie
Keywords- colectomy; infl ammatory bowel disease; stoma; surgery; ulcerative colitis
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved
Figure 1. Échantillons de diff érents types
d’appareillages.
© Hôpital Beaujon
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 14/03/2016 par CHU TOULOUSE - (322385)

Les maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin
20
Dossier
La revue de l’infi rmière ● Mars 2014 ● n° 199
Notes
1 Stomie vient du grec stoma
qui signifi e “bouche”, d’où
l’abouchement de l’intestin au
niveau de la paroi abdominale.
2 Voir schéma sur www.snfge.
org/02-Connaitre-maladie/0D-
colon/faq/colon_rch.htm.
pour la stomie et les lavements, qui pourra
commencer une fois la douleur maîtrisée.
L’éducation est débutée assez tôt afi n que le
patient retourne à domicile dans de bonnes condi-
tions. Mais ce n’est pas toujours facile car les
patients sont déjà sous antalgiques depuis de nom-
breuses années et la douleur est de plus en plus
difficile à faire disparaître. Pour cela, l’équipe
mobile de prise en charge de la douleur vient en
renfort.
L’infirmière stomathérapeute éduque le
patient aux soins de stomie et parfois même son
entourage, quand celui-ci ne peut se résoudre à
les réaliser lui-même. Une relation se crée avec le
patient. La stomathérapeute adapte l’appareillage,
explique les complications possibles. Elle le sou-
tient dans son cheminement vers l’acceptation
de sa stomie. Le fait d’essayer divers appareillages,
avec son aide, permet au patient de retrouver un
certain confort, essentiel au bien-être et au travail
d’acceptation.
Surveillance du transit
En parallèle de l’éducation et de la prise en charge
de la douleur, la principale surveillance infi rmière
porte sur la reprise du transit, qui peut prendre
parfois plusieurs jours. L’équipe infi rmière surveille
l’évolution de la stomie car des complications peu-
vent survenir (tableaux 1 et 2).
L’infi rmière stomathérapeute explique au patient
qu’une stomie doit être rosée, humide, vascularisée,
avec au pourtour une peau saine (fi gure2). Elle le
sensibilise à l’importance de surveiller sa stomie.
Suivi du patient
À la sortie du patient, la stomathérapeute fait le lien
entre l’hôpital et le domicile ou le service de soins
de suite, programme des rendez-vous de suivi, rédige
les ordonnances de sortie, fournit des contacts
utiles, laisse ses coordonnées ainsi que celles des
stomathérapeutes de la région.
Le patient est suivi par le service de gastroentérolo-
gie et assistance nutritive pour les conduites à tenir
Nature Origine Symptômes Actions à mener
Abcès et infection Maladie de Crohn,
corticothérapie, désunion Pus sur le pourtour stomial,
douleurs, parfois fi èvre Vu par le médecin, soins
locaux
Prolapsus Eff ort important, paroi
défi ciente Déroulement de l’intestin sur
lui-même vers l’extérieur S’il ne réintègre pas sa place
dès que le patient est allongé,
manipulation manuelle par
un médecin
Désinsertion et désunion Lâchage de suture partiel ou
total Brèche entre la stomie et la
paroi abdominale Vu par un médecin, soins
locaux si pas d’intervention
en urgence
Nécrose Mauvaise vascularisation de
la stomie Stomie sèche, qui ne saigne pas
et est noire Urgence de reprise au bloc
opératoire
Œdème Infl ammation physiologique
de l’intestin Stomie gonfl ée,
voire translucide Surveillance locale par le
médecin
Irritation et ulcération Fuites des effl uents, mauvais
appareillage, soins insuffi sants Douleurs péristomiales, peau
suintante, ulcérée Soins locaux à réaliser pour
une cicatrisation
Tableau 1. Complications précoces les plus fréquentes survenant sur une stomie
Nature Origine Symptômes Actions à mener
Bourgeons Cicatrisation anarchique,
résidus de fi ls, lésions Douleurs, saignements, gêne à
l’appareillage Soins locaux
Folliculites Rasage agressif Boutons, pustules, douleurs à
la base des poils Utilisation de tondeuse
électrique; soins locaux
Eczéma de contact Réaction à l’appareillage Assèchement de la peau,
rougeurs, prurit Changement d’appareillage
Éventration Prise pondérale, eff ort intense Relâchement de la paroi
abdominale, troubles du
transit
Si importante et gênante, voir
pour ceinture abdominale
Tableau2. Complications tardives les plus fréquentes survenant sur une stomie
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 14/03/2016 par CHU TOULOUSE - (322385)

Dossier
21
Les maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin
La revue de l’infi rmière ● Mars 2014 ● n° 199
et suivis médicaux, lors d’hospitalisation longue ou
courte durée. Dans ce cas, la stomathérapeute peut être
amenée à le rencontrer. Cette infi rmière experte est un
soutien pour l’équipe, qu’elle forme régulièrement.
Deuxième temps opératoire
Le second temps opératoire consiste en une protec-
tomie secondaire, c’est-à-dire à l’ablation du reste
du côlon et de tout le rectum, jusqu’à l’anus. Une
anastomose iléo-anale est eff ectuée dans un milieu
beaucoup moins inflammatoire, ce qui est source
d’une meilleure cicatrisation. La création d’un réser-
voir “en J” avec l’iléon terminal2, pour remplacer le
rectum (néo-rectum), autorise une meilleure régula-
tion des selles. Une iléostomie latérale est mise en
place afin de protéger l’anastomose et d’éviter les
conséquences d’une éventuelle désunion de celle-ci.
À son retour du bloc, le patient dispose d’une sonde
rectale qui permet d’évacuer les potentiels saigne-
ments du néo-rectum et de pratiquer des lavements
si besoin. Une sonde urinaire est également posée
au bloc. Elle restera en place durant cinq jours car la
dissection pelvienne est importante et la reprise de
la diurèse peut s’avérer diffi cile.
Surveillance infi rmière
Le patient sait en principe déjà réaliser ses auto-soins
de stomie.
Il est cependant important de quantifier le
débit de la stomie car, suite à cette seconde interven-
tion, les principales complications sont la déshydra-
tation et la dénutrition. En eff et, l’iléon n’absorbe pas
suffi samment d’eau, de minéraux et de nutriments.
Pour pallier ce problème, l’équipe travaille avec
le service d’assistance nutritive spécialisé dans la
prise en charge des Mici.
Les complications sont les mêmes que lors du
premier temps opératoire: liées à la stomie, des
diffi cultés de reprise du transit, une hémorragie du
néo-rectum, une non-reprise de la diurèse à l’abla-
tion de la sonde vésicale (dans ce cas, une sonde est
reposée). À long terme existe un risque de pouchite,
qui est l’infl ammation du néo-rectum.
Troisième temps opératoire
Le troisième temps opératoire peut intervenir
lorsque l’anastomose est bien cicatrisée. Il consiste
en un rétablissement de continuité digestive. Cette
intervention est beaucoup moins lourde que les
précédentes et l’hospitalisation moins longue.
Surveillance infi rmière
Les surveillances infirmières ciblent la reprise du
transit ainsi que la propreté du pansement de réta-
blissement qui s’eff ectue avec des irrigations et des
méchages en stérile jusqu’à cicatrisation complète.
Le méchage vise à drainer les sérosités pour per-
mettre une cicatrisation en profondeur.
Une attention particulière est portée aux compli-
cations possibles.
Celle qui est la plus redoutée est la péritonite
due à un lâchage de suture. La vie du patient est alors
en jeu et ce dernier doit être pris en charge chirurgi-
calement le plus vite possible. Les signes d’alerte sont
les suivants: hyperthermie, douleurs intenses non
calmées par la morphine, abdomen parfois météorisé
et distendu, altération de l’état général.
Des zones de sténose peuvent se former. La
surveillance est primordiale pour en repérer les
signes de survenue: nausées/vomissements en
postprandial et arrêt du transit.
Au niveau du pansement, les principales
complications sont l’abcès de paroi (écoulement de
pus par l’orifi ce) et la fi stule entéro-cutanée (écou-
lement de liquide digestif par l’orifi ce).
Conclusion
Le traitement chirurgical de la rectocolite hémorra-
gique est lourd mais off re une guérison défi nitive
–ce qui n’est pas le cas, à ce jour, de la maladie de
Crohn. Au-delà de la lourdeur des traitements
qu’elles nécessitent, les Mici appellent aussi une
réelle prise en charge psychologique des patients.
Une écoute est proposée par la psychologue du
service de chirurgie colorectale. Les patients sont
entourés d’une équipe pluridisciplinaire pour pallier
au mieux leurs pathologies et les accompagner vers
une guérison partielle ou totale. Gageons que les
progrès liés à la recherche permettent de guérir la
maladie de Crohn dans quelques années. •
Figure 2. Exemple de stomie saine.
© Hôpital Beaujon
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas
avoir de confl its d’intérêts en
relation avec cet article.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 14/03/2016 par CHU TOULOUSE - (322385)
1
/
3
100%