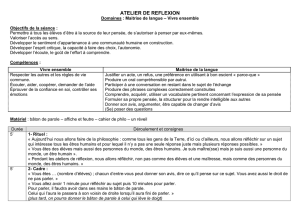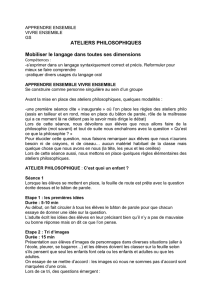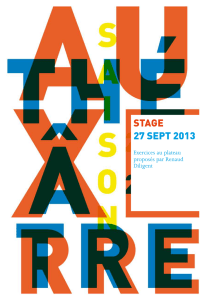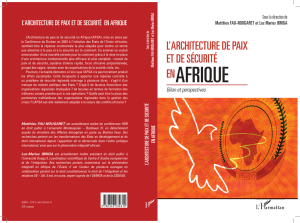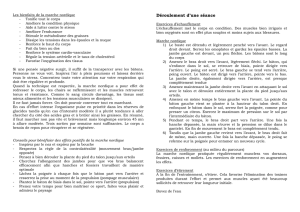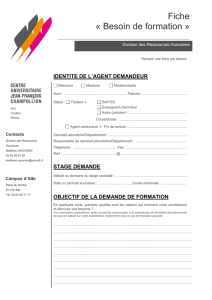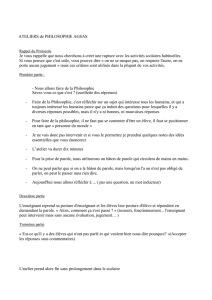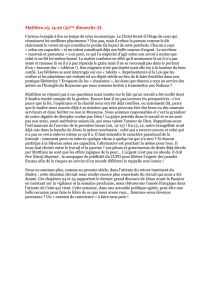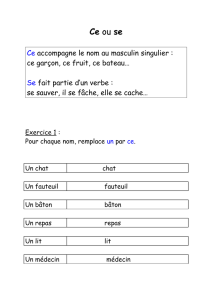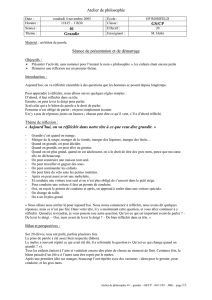Ni sandales, ni bâton

--------------Bible
au
scanner-
Passer
la
«Bible au scanner »,
c'est scruter une «aspérité» de son texte
avec un maximum de minutie et de pénétration.
On
peut difficilement dans ce sens que Jacques
BUCHHOLD
ci-dessous.
Ni
sandales,
ni
bâton
par Jacques BUCHHOLD
P
armi
les
difficultés d'harmonisation que
posent les évangiles,
la
recommanda-
tion de Jésus en Matthieu
10.9-10,
lors de l'envoi des Douze
en
mission, de
ne prendre «
ni
sandales
ni
bâton
»,
est
certainement l'une des plus ardues. Car
Marc 6.8-9 semble rapporter précisément
le
contraire! Jésus,
en
effet, ydemande à
ses disciples «de ne
rien
prendre
...
sinon
un bâton
seulement»
et
de
«chausser
des sandales
».
Le
penseur
Stephen
1.
Davies, un évangélique déclaré, avoue,
qu'il s'agit
là,
de l'un des six lieux scriptu-
raires
dont
«
il
ne voit pas
comment
résoudre les contradictions »(11.
Le
témoignage
de
Luc vient
encore
accroître la difficulté.
En
effet, s'il
s'accorde,
avec celui
de
Matthieu, sur
l'interdiction de prendre un bâton (9.1,
3),
la
recommandation du Seigneur,
de
ne
pas emporter de sandales, appartient aux
conditions
de
la mission des soixante-
douze(2
1
(1004).
Le
tableau qui suit (voir page suivante)
résume
la
situation, et indique, entre
parenthèses, l'ordre dans lequel chaque
élément apparaît dans les différents pas-
sages.
Plusieurs tentatives d'explication des
divergences entre Matthieu et Luc (sans
bâton
ni
sandales) et Marc (avec bâton et
sandales) ont été proposées. Nombreux
sont ceux qui voient, dans
la
recension de
Marc, une adaptation des «paroles
de
Jésus
...
aux conditions nouvelles des mis-
(1)
Stephen
1.
Oavies,
The
Debate about the Bible
(Philadelphie: Westminster, 1977),
p.
106, cité par
Craig
L.
Blomberg,
The
Historical Reliability
of
the
Gospels, p. 145,
n.
1.
[21
Cf.
La
Bible du Semeur, TOB. Des manuscrits
assez nombreux ont
70,
leçon retenue par
la
Bible à
la
Colombe. Ce nombre pourrait représenter les
nations du monde, car 70 peuples apparaissent
dans
le
texte hébreu de
Gn
10, alors que dans
la
traduction grecque de
la
LXX,
on
en
trouve 72.
Cf.
Leon Morris, L'Evangile selon Luc, traduit
et
adapté
par Jacques Blocher (Commentaires Sator ;Paris:
Les
Editions Sator, 1985)
p.
101.
Fac-RéflexÎoII
nO
33
31--

-Bible
au
scanner
Mt
10.9-10 (aux 12)
Me
6.8-9 (aux 12) Le 9.3 (aux 12) Le 10.4 (aux 72)
1.
N'acquérez
ne
rien
prendre
Ne
prenez
rien
N'emportez
pour
le
chemin
pour
le
chemin
2.
ni
bâton
(7)
sauf
un
bâton
ni
bâton
(1)
seulement
(1)
3.
ni
pain
(2)
ni
pain
(3)
4.
ni
sac
ni
sac
(3)
ni
sac
(4)
ni
sac
(2)
pour
le
chemin
(4)
5.
ni
monnaie
dans
5.
ni
monnaie
dans
vos
ceintures
(3)
la
ceinture
(4)
6.
ni
sandales
(6)
mais
chausser
ni
sandales
(3)
des
sandales(3)
(5)
7.
ni
deux
tuniques
(5)
ne
pas
revêtir
ne
pas
avoir
deux
tuniques
(6)
deux
tuniques
(5)
8
.ni
or
(1)
9.
ni
argent
ni
argent{4)
(4)
10.
ni
bourse
(1)
11.
ne
pas
saluer
12.
en
chemin
(4)
sionnaires
hors
de
Palestine
où
le
bâton
et
les
sandales pouvaient
être
nécessaires
sans déroger à
la
pauvreté
(5)
». Cepen-
dant,
plusieurs
ne
se
satisfont
pas
d'une
telle
solution,
qui
fait
dire
àJésus
(dans
Mc)
le
contraire
même
des
paroles
qu'il a
réellement prononcées (Mt-Le). Aleurs
yeux,
le
témoignage
des
synoptiques
(Mt,
Mc,
Le),
dans
sa
diversité,
demeure
cohé-
rent,
et
ils
proposent
essentiellement
deux
types d'explication
de
la
divergence
qui
nous
préoccupe.
.Le «télescopage
(6)
»
Tout
le
monde
le
reconnaît: Matthieu,
dans
ses
cinq
sections
qui
rapportent
les
{31
Hupodémata
en
Mt et
Le,
hupodedemenous
san-
da/ia
en
Me.
(4)
Mt a
arguron,
alors que
Le
a
argurion.
(5)
TOB n.v sur Me 6.8.
(O)
Voir Blomberg, pp. 144-146, qui reprend iei la
solution qu'il avait déjà proposée dans «The Legiti-
maey and Limits of Harmonization ", dans
Herme-
neutics,
Authority and
Canon,
pp. 154-155.
--32
Fac-Réflexion n°
33

---------------Bible
au
scanner-
discours
de
Jésus(7),
offre
un
travail
rédac-
tionnel
de
synthèse, qui regroupe des
enseignements
du
Seigneur
donnés
à
des
moments
différents.
C'est
ainsi
que,
dans
l'envoi
des
Douze
en
mission,
Matthieu
a
regroupé,
en
un
seul
discours,
ce
qui
concerne, dans
Luc,
l'envoi des
Douze
(Lc
9.1-6) et celui des soixante-douze
(Lc
10.1-11
)1
8
1.
Un
tel
procédé,
notons-le,
n'a
rien
d'arbitraire
car,
selon
Luc
10.17
et
23,
les
Douze
faisaient
très
certainement
partie
des
soixante-douze(9).
C'est
sur
ce
fait
que
se
fonde
la
solution
envisagée
par
Craig
L.
Blomberg
:
l'envoi
des
Douze
àproprement
parler
(Lc
9.1-6)
ne
contenait
pas
d'interdiction
de
prendre
un
bâton
et
de
chausser des sandales,
d'où l'autorisation
de
se
munir
d'un
bâton
et
de
mettre
des
sandales
dans
la
recen-
sion
de
Marc
(6.6-8).
Jésus
n'aurait
émis
une
telle interdiction que lors
de
l'envoi
des soixante-douze
(Lc
10.1
-11). Mat-
thieu,
en
fusionnant ces deux envois,
aurait
alors
choisi
entre
la
permission
du
premier
envoi,
et
la
prohibition
du
second,
et
opté pour l'interdiction
(Mt
10.9-10).
(7)
Le
Sermon sur
la
montagne
(ch.
5à
7),
l'envoi des
Douze en mission (ch. 10), les paraboles du
Royaume
(ch.
13),
la
vie
de
la
communauté messia-
nique
(ch.
18) et
les
enseignements sur
la
fin
des
temps
(ch.
24-25).
(8)
On
retrouve
un
tel procédé
en
Mt 24,
p.
ex., qui
regroupe
Le
17.22-37 et 21.5-38.
Le
Sermon sur
la
montagne réunit des textes de Luc dispersés dans
tout l'évangile.
(9)
Le
"autres ",
de
Le
10.1, n'oppose pas
les
72
aux 12, mais aux disciples non conséquents
de
9.57-62. comme
le
souligne Blomberg,
"The
Legi-
timacy
...
",
p.
155.
Cette solution
du
«télescopage
»,
par
Matthieu, qui prône
le
recours
aux
sources, nous semble légitime
en
son
principe,
et
résout
la
contradiction,
entre
Matthieu
et
Marc,
concernant
le
port
de
sandales. Mais elle
ne
permet pas de
répondre, sans autre,
au
problème
du
bâton.
Car,
dans Luc, contrairement à
l'interdiction d'emporter des sandales,
celle
de
prendre
un
bâton
n'appartient
pas
à
l'envoi
des
soixante-douze
(10.4),
mais
bel
et bien àcelui des Douze
(9.3)
!
Certes,
ce
fait
pourrait
s'expliquer,
comme
le
suggère
Blomberg,
par
le
travail
rédac-
tionnel
de
Luc,
qui
aurait fait passer cet
élément de l'envoi des soixante-douze
dans celui des Douze. Mais une telle
hypothèse
fragilise
la
stratégie
du
recours
aux
sources. Pourquoi,
en
effet,
la
men-
tion
du
bâton
en
Luc
9.3
ne
serait-elle
pas
originale
(mais
rédactionnelle),
alors
qu'elle
le
serait dans
le
texte parallèle de
Marc
6.8?
L'harmonisation
La
solution
du
«télescopage» part
d'une évidence: Matthieu 10.9-10 et
Marc
6.8-9
se
contredisent.
Celle
de
l'har-
monisation
relativise
cette évidence:
La
contradiction dans
les
termes est fla-
grante ;
mais
la
pensée
exprimée,
sous
ces
deux
formes,
est
pourtant
la
même(10).
Il
faut,
en
effet,
tenir
compte
des
expres-
sions
qui
gouvernent
les
passages :
ne
(10) Frédéric Godet, Commentaire sur l'évangile de
Saint Luc,
t.
1(Neuchâtel: Editions de l'Imprimerie
Nouvelle L.-A. Monnier, 1969') pp. 556-557.
Fac-Réflexîoll
n°
33
33--

-Bible
au
scanner---------------
pas
acquérir(11)
(Mt
10.9),
ne
rien
prendre
pour
le
chemin
(Mc
6.8 ;
Lc
9.3),
ne
pas
emporter
(Lc
1004).
L'expression
utilisée
par
Matthieu
est
la
plus claire. L'évangéliste indique, par
l'emploi
du
verbe
«acquérir»
(ktaoma/)
,
que l'interdiction
de
Jésus
ne
vise
pas
l'équipement immédiatement
nécessaire
au
voyage
missionnaire,
dont
les
disciples
sont
déjà
en
possession.
Ce
qui
leur
est
interdit,
est
de
faire
des
appels
de
fonds
pour
leur
voyage(12}
(<<
or,
argent,
monnaie
dans
vos
ceintures
»),
de
se
munir
de
pro-
visions
(<<
sac
pour
le
chemin
»)
et
de
vête-
ments
de
rechange
(<<
deux tuniques
»).
«
Le
principe
rappelé
est
celui
de
6.25
ss
:
Dieu
pourvoira
(13)
»,
en
particulier
au
moyen
de
l'hospitalité
qui
sera
offerte,
aux
disciples,
dans
les
villes
où
ils
annonceront
la
Bonne Nouvelle
du
Royaume
(10.11-
13).
Si
tel
est
le
cas,
ne
faut-il
pas
aussi
discerner
dans
la
mention
du
bâton
et
des
sandales
une
interdiction
d'«
acquérir»
un
bâton
(14)
de
secours
et
des
sandales
de
rechange? L'habitude, d'ailleurs, n'était
pas
de
voyager
pieds
nus
et
«
le
geste
du
v.
14
suppose
une
sorte
de
chaussure
qui
retenait
la
poussière(15)
».
Les
recensions
de
l'envoi
des
Douze,
en
Marc
6.8-9
et
Luc
9.3, s'accordent
avec
une
telle
compréhension
de
celle
de
Mat-
thieu.
Dans
ces
deux
passages,
en
effet,
les
recommandations
de
Jésus concer-
nent
de
nouveau
les
fonds
(<<
monnaie
dans
la
ceinture,
argent
»),
les
provisions
(<<
pain, sac
»)
et
les
vêtements
de
rechange
«<
deux
tuniques
»)
que
les
dis-
ciples
auraient
pu
désirer
emporter
avec
eux.
La
précision
de
«
ne
rien
prendre
pour
le
chemin
»,
confirme
cette compré-
hension
des
paroles
du
Seigneur.
Jésus
n'interdit
pas,
à
ses
disciples,
de
partir
tels
qu'ils
sont
déjà
vêtus,
chaussés
et
équi-
pés,
mais
de
prévoir
à
l'avance
ce
dont
ils
pourraient avoir besoin
en
chemin(16).
L'autorisation,
dans
Marc,
de
prendre
un
bâton
et
de
chausser
des
sandales,
ne
contredit donc
pas
l'interdiction
de
Mat-
(11)
La
Bible
à
la
Colombe
traduit:
"ne
prenez ni".
",
mais note
que"
ce verbe signifie primitivement
acquérir
»,
La
TOB et
la
Bible
en
français
courant
traduisent de manière plus précise: "
ne
vous pro-
curez ni." ".
(12) Robert
H.
Gundry,
Matthew.
ACommentary
on
his
Uterary and Theological Art (Grand
Rapids:
Eerdmans, 1982),
p,
186, relève que l'interdiction
matthéenne
d'"
acquérir" porte sur
les
profits que
les
disciples pourraient tirer de leur
œuvre
mission-
naire,
car elle suit immédiatement
la
recommanda-
tion de Jésus
au
v.
8 : " Vous avez reçu gratuite-
ment, donnez gratuitement ".
(13)
R.T.
France,
L'Evangile
selon
Matthieu
(Commen-
taires
Sator ;Cergy-Pontoise:
Les
Editions Sator,
1987),
p.
166.
1"1
Le
mot
grec rabdos est utilisé, selon les con-
textes, pour désigner une baguette,
un
bâton, une
verge pour frapper,
un
bâton de commandement,
un
sceptre, une houlette de
berger,
une
hampe de
javelot.
Ici,
le
mot
ne
désigne pas
un
simple bout de
bois, mais une canne, "élément de l'équipement
indispensable au voyageur en Orient ", Voir
C.
Schneider,
rabdas,
TDNTI,
vol.
VI,
pp. 966-970,
en
part, 969.
(15)
R.T.
France,
p.
167,
(16)
Le
déplacement par Matthieu de l'expression"
en
chemin ", après
la
mention du "sac
",
s'explique
par l'emploi du
verbe"
acquérir ", qui suggère, par
lui-même, l'idée de préparation, ou de provisions,
ce qui n'est pas
le
cas du
verbe"
prendre ", de Mc
et Lc. L'emploi du
verbe"
emporter"
(bastaô)
en
Lc 1DA, pour l'envoi
en
mission des 72, renforce
l'idée de provisions et d'équipements de rechange.
--34
Fac-Réj/exion
nO
33

---------------Bible
au
scanner-
thieu de
se
procurer
un
bâton de secours
et des sandales de rechange.
Cependant, est-il possible d'expliquer
les
différences de formulation, entre Mat-
thieu et Marc, et peut-être plus encore
entre Marc 6.8-9 et Luc 9.3, qui sont tous
deux introduits par
la
même formule
(<<
ne
rien
prendre pour
le
chemin
»),
mais diver-
gent quant à
la
mention
du
bâton
(<<
sauf
un
bâton seulement
»,
«
ni
bâton
»)
?
Un
retour aux sources pourrait permettre
d'élucider ce
fait.
Retouraux sources
Comme nous l'avons
relevé
plus haut,
l'évangile selon Luc contient deux textes
d'envoi
en
mission. L'un concerne les
Douze, l'autre
les
soixante-douze.
Le
pre-
mier
envoi
est commun
aux
trois évangiles
(triple tradition),
le
deuxième àLuc et à
Matthieu, qui opère
un
«télescopage»
entre les deux envois (double tradition).
Pour
la
majorité des spécialistes, adeptes
de
la
théorie des deux sources, Matthieu
et Luc auraient rédigé les passages, de
leur évangile, appartenant à
la
triple tradi-
tion,
en
s'inspirant de l'évangile de
Marc
(17
). D'autres exégètes,
en
revanche,
inversent
le
processus. C'est Marc qui,
selon
eux,
atravaillé àpartir d'ébauches,
de Matthieu et de Luc, qui
ne
contenaient
que
la
triple tradition
i18i
.Sans chercher
ici
à
justifier notre point de
vue,
il
nous semble
que
la
seconde compréhension du rap-
port, entre
les
synoptiques, répond mieux
aux
données des
évangiles.
Elle
donne,
en
tout
cas, un éclairage intéressant sur
l'envoi des Douze dans
la
triple tradition.
Comment,
en
effet, expliquer
le
lien
entre
le
«sauf
un
bâton seulement» de
Mc 6.8, et
le
«
ni
bâton» de Mt 1
0.1
0et
Lc 9.3 » ? N'est-il pas tentant de discer-
ner,
dans
la
précision de Marc, «sauf
un
bâton seulement
»,
une réécriture de ce
qu'il lisait dans
les
ébauches de Matthieu
et de
Luc?
Cherchant àéviter l'ambiguüé
de l'expression matthéenne et lucanienne
«
ni
bâton
»,
qui pouvait êlre comprise
comme une interdiction de prendre tout
bâton (et non uniquement
un
bâton de
secours), Marc rend
la
pensée du Sei-
gneur plus explicite,
en
précisant que
les
disciples devaient
se
contenter de leur
seul
bâton.
Un
phénomène du même type pourrait
expliquer
le
«mais chausser des san-
dales »de Marc 6.9, qui semble de nou-
veau expliciter
le
«
ni
sandales» de Mat-
thieu 10.10.
Car,
l'évangile de Marc évite
l'ambiguïté du texte de Matthieu, dans
lequel certains pouvaient trouver,
(à
tort),
l'obligation pour
les
disciples de marcher
pied nus
i19i
. •
J.B.
(17)
Telle
est
en
particulier l'approche àlaquelle
se
ral-
lie,
p.
ex.,
l'"
Introduction aux évangiles synop-
tiques"
de l'édition complète de
la
TOB.
(18)
Cf.
en
particulier
les
travaux de Philippe Rolland,
Les premiers évangiles (Paris:
le
Cerf, 1984) ;L'ori-
gine
et
la
date des évangiles (Paris: Saint-Paul,
1994). Pour
un
bon résumé de cette approche, voir
P.
Rolland, "Synoptique, question ", Dictionnaire
encyclopédique
de
la
Bible (Brepols, 1987),
pp. 1227-1231.
(19)
La
difficulté que pose
la
mention des sandales,
vient
du
fait qu'elle n'apparaît pas
en
Lc
9.3, (triple
tradition), mais
en
Lc 10.4. L'explication
la
plus
simple nous semble être que l'ébauche de Mt, que
Mc consultait, portait déjà
la
mention «
ni
sandales
".
Fac-Réflexioll n° 33
35--
1
/
5
100%