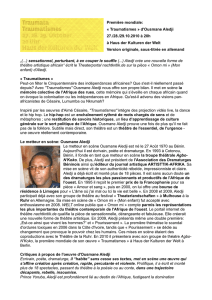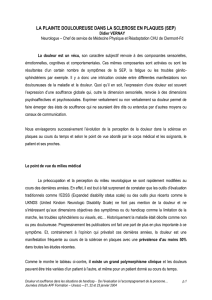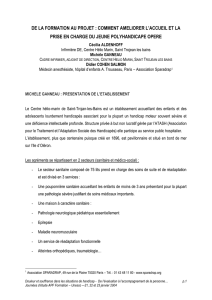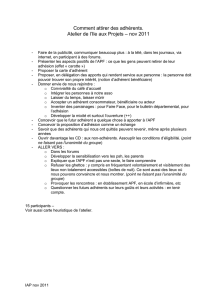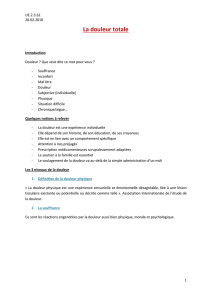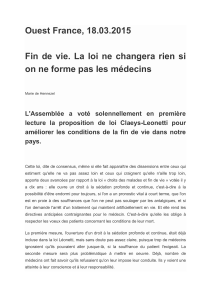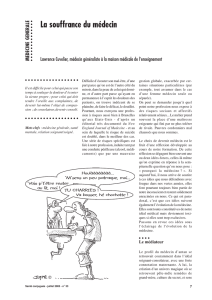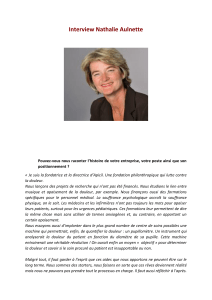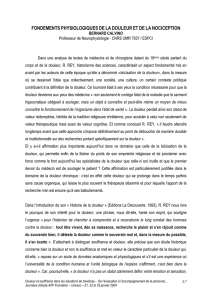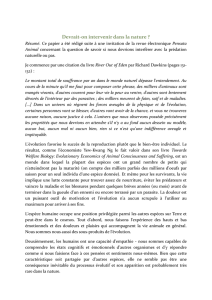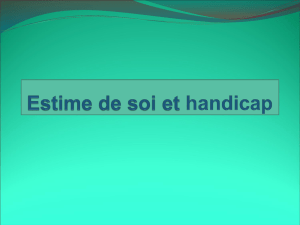17èmes JOURNEES D`ETUDE APF FORMATION

Douleur et souffrance dans les situations de handicap - De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.1
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004
REGARDS CROISES SUR LA DOULEUR :
Impact d’une intervention de médiation interculturelle dans une consultation
spécialisé dans le traitement de la douleur chronique
Anne MARGOT-DUCLOT
Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Fondation A. de ROTHSCHILD, Paris
Serge BOUZNAH
Centre Clinique de Médiation Interculturelle, Fondation A. de ROTHSCHILD, Paris
La douleur a un sens pas uniquement pour la compréhension
propre du sujet mais pour la compréhension du sens de son être,
de son futur et de sa destinée.
MERLEAU PONTY
La douleur occupe une place primordiale dans la condition humaine. Son vécu et son expression (par
les mots, les gestes..) ainsi que les réponses apportées pour la soulager relèvent de facteurs culturels,
sociaux et personnels.
La personnalité du sujet, ses expériences antérieures, l'humeur en cours, ses attentes, le sens donné à
la situation et à l'évènement déclenchant (l'interprétation faite par le souffrant mais aussi les
interprétations données par le milieu), et les réponses de l'environnement sont autant de facteurs
modulant l'expérience douloureuse.
Le vécu de la douleur diffère fondamentalement quand la douleur s’inscrit dans un événement
traumatique délibérément provoqué par un groupe, comme c'est le cas dans les rites d'initiation où
toutes les conditions de douleur physique sont réunies mais où la personne n'exprime ni ne semble
ressentir aucune douleur (par exemple lors des incisions, des tatouages..), et lorsque la douleur est
infligée, subie survenant dans un contexte pouvant avoir des conséquences néfastes pour l'individu
(blessure provoquée par un tiers, maladie...).
La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire
existante ou potentielle et décrite en fonction de cette lésion (IASP 1975). Ainsi la sensation est
indissociable de l’émotion douloureuse, et les liens entre lésion et douleur ne sont ni directs ni
proportionnels : il est de graves lésions non douloureuses, des lésions bénignes très douloureuses, et
des douleurs sans lésions retrouvées. En pratique clinique, nous constatons la grande variabilité de la
douleur pour une même situation lésionnelle.

Douleur et souffrance dans les situations de handicap - De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.2
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004
Effets des normes, représentations et valeurs culturelles sur le vécu et l'expression de la
douleur
Expérience intime et solitaire, la douleur met celui qui souffre face à sa vie et à son propre destin. La
douleur revêt un sens ontologique qui la rapproche de la maladie et de la mort. La douleur se pose en
tant qu'angoisse existentielle. Ainsi, la question du sens "pourquoi j'ai mal ?" s’impose dès l'irruption de
la douleur à la conscience. Cette interrogation est encore plus angoissante quand la douleur persiste
des mois et que les réponses médicales ne sont pas satisfaisantes : quel est le sens d’une douleur qui
dure ?
Exemples d’interrogations de la personne souffrante :
- sur l'origine de la douleur : "pourquoi j'ai mal ?", "pourquoi moi?" "pourquoi la douleur continue ?",
"pourquoi rien ne me soulage?"," c'est certainement très grave"… expérience métaphysique,
existentielle ;
- sur les liens qui l'unit à son environnement : "je souffre et personne ne me croit", "pourquoi ne me
soulage-t-on pas ? "," je suis seul là à souffrir et personne ne me comprend"… expérience de
solitude ;
- sur le contrôle de son état de santé : "je ne peux rien faire pour me soulager», "personne ne peut
rien pour moi"… expérience d'impuissance.
L’absence de sens avec des explications médicales confuses voire contradictoires, corrélée à l’absence
de soulagement par les traitements habituels, renvoie le sujet souffrant à lui même et l’ouvre à de
nouveaux champs d’interprétation.
Le questionnement de la douleur persistante affecte aussi le médecin qui a souvent du mal à trouver
une explication cohérente à une réalité douloureuse complexe. La relation thérapeutique s'en trouve
perturbée et les doutes, les suspicions et les échecs médicaux sont les fardeaux portés par les
protagonistes.
Chaque culture en proposant une compréhension de l'origine du mal, de la souffrance, de la maladie et
de la mort ainsi que des réponses spécifiques, apporte un sens à la douleur, une finalité philosophique

Douleur et souffrance dans les situations de handicap - De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.3
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004
et religieuse. Ainsi, la culture façonne l'expérience solitaire en une expérience culturelle dans laquelle
l'individu trouve des valeurs structurantes. Elle propose une manière de vivre la douleur et d'y faire face
à travers un langage et des comportements qui seront difficilement accessibles à un sujet non averti.
Les influences culturelles s'expriment chez tous les individus à des degrés divers.
Les modes d'interventions au sein du CETD
Le Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur de la Fondation ROTHSCHILD (CETD) prend en
charge des patients présentant des douleurs chroniques rebelles et invalidantes. Ces patients souffrent
de pathologies complexes où coexistent à des degrés divers des facteurs lésionnels et des facteurs
psychosociaux.
Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont les lombosciatiques séquellaires, les douleurs
neuropathiques (SEP, blessés médullaires, lésions nerveuses périphériques…), les douleurs
cancéreuses rebelles, les céphalées chroniques. La mission de cette consultation de la douleur est de
résoudre les problèmes spécifiques posés par ces patients.
Les modes d’intervention s'inspirent de l'approche biopsychosociale tentant d'appréhender l'individu
dans sa réalité physique, psychologique et sociale. La prise en charge est effectuée par une équipe
pluridisciplinaire, formée à aborder de façon globale la douleur. Ils sont basés sur :
- L'établissement d'une relation thérapeutique singulière au sens de particulière et spécifique de la
personne, duelle au sens "deux", utilisée comme lieu et outil pivot du changement désiré et
attendu par le patient et le thérapeute.
- Des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses ciblant les différentes
problématiques : organiques (lésion et dysfonctionnement physiologiques), psychologiques
(réactivation d’évènements traumatiques, troubles de l'humeur, troubles de l'adaptation…) et
sociales (isolement social, inadaptation professionnelle, litiges avec les assurances ou le tiers
responsable...).
Cette approche repose sur quelques principes, en particulier le fait que les interventions sont centrées
sur le sujet souffrant, sur ses aptitudes aux changements au sein d'un environnement social sur lequel
on pourra interférer tout au moins en partie. D’un être subissant et passif, il devient un être actif, un
« acteur » de son état de santé.

Douleur et souffrance dans les situations de handicap - De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.4
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004
Une expérience de médiation transculturelle dans un centre de la douleur
Les hypothèses de départ
Il existe plusieurs manières de décrire la genèse de notre projet de recherche. La première emprunte la
voie anecdotique, mais néanmoins décisive, de la rencontre fortuite entre un chef de service d’un
Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, préoccupé par les difficultés rencontrés dans la prise
en charge de certains patients migrants douloureux chroniques, et une équipe de médecins et de
médiateurs formés à l’approche ethnopsychiatrique soucieux quant à eux d’investiguer le champ
médical de la pathologie chronique.
Une seconde façon de raconter l’histoire est celle de la rencontre logique entre deux types d’approche,
l’ethnopsychiatrie et la prise en charge spécialisée de la douleur chronique, qui partagent la nécessité
de mettre le patient au centre du dispositif technique.
Cette rencontre nous a permis durant près de 3 ans d’expérimenter un dispositif original de médiation
interculturelle au sein du service spécialisé de lutte contre la douleur de la fondation Rothschild.
Ce dispositif a été proposé à des patients migrants de 1ère ou de 2ème génération présentant des
problématiques médicales complexes, installés dans la chronicité depuis plusieurs années et pour
lesquels le médecin référent se trouvait dans une difficulté sérieuse dans la mise en œuvre du projet
thérapeutique.
Notre hypothèse de départ a été que les difficultés rencontrées, et les échecs thérapeutiques qui en
découlent parfois, sont liés à une prise en compte insuffisante de l’univers culturel du patient dans l'acte
médical. En effet, pour des patients qui souffrent depuis des années, l’adhésion aux traitements
proposés dépend étroitement de l’inscription du projet thérapeutique dans leur univers de vie. La culture
joue là, naturellement, un rôle fondamental. Elle est susceptible de fournir au sujet une interprétation de
sa douleur et de sa maladie à partir de laquelle il construit son expérience et organise ses réseaux
thérapeutiques, y compris en faisant appel aux thérapies dites « parallèles ».
Dès 1996, lors d’une précédente recherche à l’hôpital Necker, nous avions montré la fréquence de ce
recours pour des familles migrantes dont un ou plusieurs enfants étaient touchés par le V.I.H. Juste une
précision à apporter sur le terme thérapies « parallèles » : celui-ci fait ici référence à l’ensemble des
réseaux thérapeutiques ne s’inscrivant pas dans le système médical occidental. Les recours aux

Douleur et souffrance dans les situations de handicap - De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.5
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004
thérapies parallèles restent le plus souvent méconnus des soignants. Les patients en effet ne parlent
quasiment jamais spontanément de ces réseaux de soins de crainte que leurs démarches ne soient ni
prises au sérieux, ni comprises par leur médecin traitant ou pire qu’elles soient considérées par celui-ci
comme une trahison. Le patient peut alors se retrouver en porte à faux entre deux systèmes
thérapeutiques qui s’ignorent. A l’inverse dans d’autres situations, le recours exclusif et surtout parfois
abusif au système médical est susceptible de couper le patient de toute une série de réseaux locaux de
solidarité.
Alors, comment aider les équipes médicales à mieux comprendre les problématiques des patients et
éviter les malentendus qui nuisent à la prise en charge ? Comment agir lorsque ces patients refusent
leur traitement ou à l’inverse semblent dépendre du système médical de manière excessive?
Pour répondre à ces questions, nous avons imaginé, dans le service hospitalier, un dispositif de
médiation interculturelle animé par un médecin formé à cette approche.
Qui sont les protagonistes de ce dispositif :
- Le patient, accompagné lorsqu’il le souhaitait, par ses proches ;
- Le médecin référent, médecin algologue prenant en charge le patient à son admission au
C.E.T.D. ;
- Le médiateur culturel. Qui est t’il ? C’est un professionnel, appartenant au même groupe culturel
que le patient.
En utilisant la langue maternelle du patient, le médiateur fait resurgir pour lui son univers culturel et le
rend accessible aux médecins. La langue maternelle est utilisée comme une clé. C’est cette clé qui
nous permettra d’accéder au monde de significations et au sens que le sujet attribue aux événements
comme la maladie, la souffrance ou la mort.
Ce médiateur va nous aider à faire émerger les interprétations qui circulent sur la maladie,
interprétations s’appuyant très fréquemment sur les théories locales spécifiques au groupe
d’appartenance du patient.
En médecine, une difficulté majeure relative au rôle même du médiateur est apparue. Car, si ce dernier
possède la compétence pour restituer les manières de penser et de faire de son groupe
d’appartenance, il lui est plus ardu, voire impossible en tant que non spécialiste, de transmettre aux
familles les logiques des médecins. D’autant que nous, médecins, nous sommes en général très
réservés sur le fait de communiquer des éléments sur la santé de nos patients à des tiers non
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%