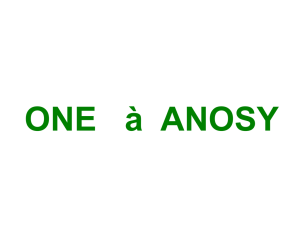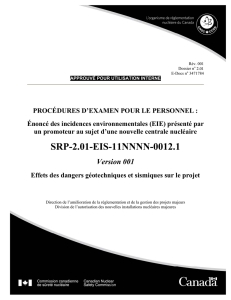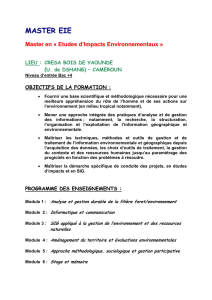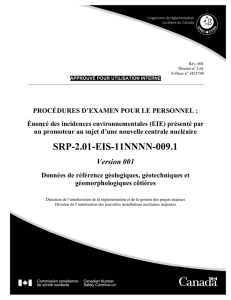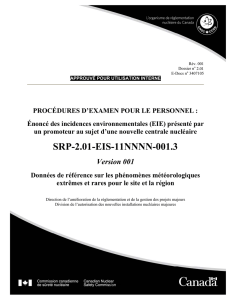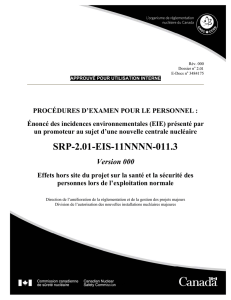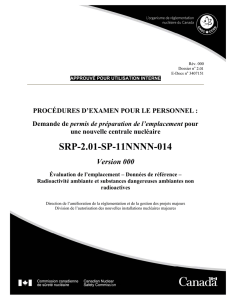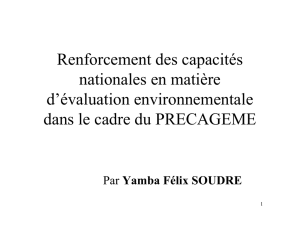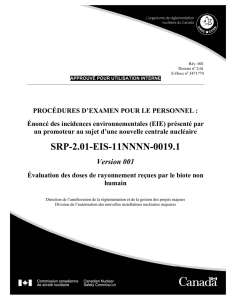Données de référence sur l`atmosphère

Rév. 001
Dossier no 2.01
E-Docs no 3407098
APPROUVÉ POUR UTILISATION INTERNE
PROCÉDURES D’EXAMEN POUR LE PERSONNEL :
Énoncé des incidences environnementales (EIE) présenté par
un promoteur au sujet d’une nouvelle centrale nucléaire
SRP-2.01-EIS-11NNNN-001.4
Version 001
Données de référence sur l’atmosphère – Qualité
de l’air ambiant
Direction de l’amélioration de la réglementation et de la gestion des projets majeurs
Division de l’autorisation des nouvelles installations nucléaires majeures
Page 1 de 7

Préface
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a élaboré les procédures d’examen pour
le personnel, sous forme de documents de travail internes, afin de l’aider à procéder à l’examen
réglementaire de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) présenté par des titulaires de
permis potentiels (promoteurs). L’EIE fait partie de la demande de permis et du processus
d’évaluation environnementale pour les projets de nouvelle centrale nucléaire au Canada. Ces
procédures d’examen s’inscrivent dans le contexte du cadre de gestion de projets de la CCSN. Il
ne s’agit pas de documents d’application de la réglementation, bien que leur sujet d’évaluation et
leurs critères respectifs soient liés aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
L’élaboration des procédures d’examen pour le personnel est une initiative entreprise dans le but
d’assurer une application uniforme des processus internes d’examen d’un EIE pour une nouvelle
centrale nucléaire et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ces examens.
Le personnel de la CCSN considère les procédures d’examen comme des documents en
évolution qui seront modifiés en fonction de l’expérience acquise au fil des examens des EIE.
Contexte
On procède à des évaluations environnementales (EE) afin de satisfaire aux exigences de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). Les EE servent à déterminer si un projet
particulier est susceptible d’entraîner des effets importants sur l’environnement et s’il est
possible de les atténuer.
En ce qui a trait aux nouvelles centrales nucléaires, la CCSN entame le processus d’évaluation
environnementale lorsqu’un promoteur demande un permis de préparation de l’emplacement,
aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN),
et qu’il soumet une description de projet complète (conformément à l’article 5 de la LCEE).
Avant de prendre une décision de permis, une évaluation environnementale doit être effectuée.
Dans le cadre du processus d’EE, le promoteur prépare un énoncé des incidences
environnementales (EIE) et le soumet à la CCSN, conformément à la LCEE, dans le but
d’appuyer la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et
l’abandon d’une nouvelle centrale nucléaire.
L’EIE est examiné en fonction des procédures d’examen rédigées à ce sujet. Les procédures
expliquent les attentes de la CCSN et fournissent des directives concernant l’évaluation de l’EIE.
Ils ont pour but de rehausser et de soutenir les recommandations sur l’EE formulées par le
personnel de la CCSN à l’intention du tribunal de la Commission.
Page 2 de 7

Description des révisions faites au document
Entrée en
vigueur Rév.
No Section Modifications apportées
24-10-2008 000 Toutes Nouveau document publié sous le Dossier de modifications (DM)
3303166
09-01-2009 001 Toutes Révision et modification finales avant la publication. Toutes les
modifications non techniques conformément au DM 3336309 et à la
DMD 3335520
Page 3 de 7

1. Sujet de l’examen
La présente procédure porte sur l’examen des documents soumis par le promoteur concernant les
données de référence sur la qualité de l’air ambiant du site et des alentours.
La portée de l’examen comprend la confirmation de ce qui suit :
• L’établissement de conditions de référence qui reflètent la qualité de l’air ambiant dans
les zones d’étude avant le début du projet.
• Une description adéquate de la qualité de l’air ambiant de la région qui sera prise en
compte dans l’évaluation de la conception de la centrale.
• Les conditions météorologiques et les régimes climatiques locaux et régionaux sont
adéquatement identifiés. Ces données servent à déterminer le transport atmosphérique et
les caractéristiques de dispersion pris en compte dans la dose du public qui résultera
probablement du projet.
La procédure a pour but de fournir à l’examinateur un cadre lui permettant de juger de la qualité
et de l’exhaustivité de l’information de référence sur la qualité de l’air dans le but de pouvoir
évaluer, par la suite, l’importance des effets environnementaux négatifs sur les composantes
valorisées d’un écosystème (CVE). Les renseignements de référence doivent également être
suffisants pour permettre une évaluation future de l’exactitude de l’évaluation environnementale
et de l’efficacité des mesures prises pour atténuer les effets négatifs du projet sur
l’environnement.
2. Critères et objectifs
2.1. Information et données
L’information que le promoteur doit fournir dans l’EIE est décrite dans les Lignes directrices
pour la préparation de l’EIE spécifique au projet. Le degré de détail devrait être modifié en
fonction de l’importance attendue des impacts potentiels. Afin de respecter la finalité des Lignes
directrices pour l’EIE, la CCSN s’attend à ce qu’un EIE inclue l’information suivante :
• Des données de référence provenant d’évaluations environnementales passées et d’études
du site ainsi que de la documentation publiée par des organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux et de la documentation scientifique publiée et revue par un comité
de lecture.
• Les méthodes employées pour déterminer les substances radiologiques et dangereuses qui
doivent être incluses dans la caractérisation de référence de la qualité de l’air.
• Les incertitudes et le type d’incertitude (p. ex. caractère aléatoire naturel, connaissances
insuffisantes, erreur d’échantillonnage ou de mesure), les limites et les lacunes dans la
qualité de la prévision des effets doivent être précisées et l’on doit en tenir compte. Il
faut, entre autres, préciser l’écart à la condition de référence qui serait considéré comme
typique à l’intérieur de l’écart naturel normal et ne pas indiquer l’effet potentiel. Cela
Page 4 de 7

peut se faire grâce à la mise en œuvre d’un modèle statistique dans les études de
référence.
• Les sites de référence doivent permettre d’assurer le suivi des changements qui ne sont
pas liés au projet mais qui coïncident avec ces activités et étayer les constatations sur la
caractérisation de référence de l’occurrence des espèces. La justification pour la sélection
et l’utilisation prévue des sites de référence devront être précisées. Des renseignements
supplémentaires à ce sujet sont disponibles à la section 2.11 du Cadre pour l’évaluation
du risque écotoxicologique : orientation générale, Le Programme national
d’assainissement des lieux contaminés, publié par le Conseil canadien des ministres de
l’Environnement (CCME) en mars 1996.
• Une caractérisation des conditions naturelles de la qualité de l’air pour la région à partir
de données provenant de stations de surveillance représentatives, et une vérification pour
savoir si les données météorologiques de la région sont appropriées pour des applications
sur le site du projet.
• Des données météorologiques sur le site pour au moins un cycle annuel afin d’évaluer les
impacts environnementaux potentiels sur les zones environnantes. Cette information
devrait fournir la dispersion atmosphérique aux alentours du site et dans les zones
voisines. Les hypothèses utilisées devraient être clairement indiquées dans une section
distincte. Il faudrait aborder le conservatisme de manière générale.
• Dans l’analyse des paramètres locaux et régionaux de qualité de l’air, il faudrait examiner
les données moyennes et extrêmes, et évaluer les paramètres de qualité de l’air du site et
les descriptions topographiques à proximité du site afin d’établir que les données
représentent les conditions du site et des alentours en examinant l’emplacement de la
station de surveillance sur le site.
• Protéger l’étendue de la zone d’étude régionale examinée.
2.2. Critères d’évaluation
L’EIE doit contenir une comparaison des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air par
rapport aux critères et objectifs provinciaux et fédéraux applicables pour la qualité de l’air. Voici
des exemples à l’échelle fédérale :
• Standards pancanadiens pour l’ozone et les particules, disponibles sur la page Web des
Standards pancanadiens du CCME (CCME 2008);
• Objectifs nationaux afférents à la qualité de l’air ambiant (ONQAA) – les concentrations
maximales acceptables sur une période annuelle, de 24 heures et d’une (1) heure pour le
NO2, le SO2 et le CO sont disponibles sur la page Web des ONQAA de Santé Canada (Santé
Canada 2008). Il existe des ONQAA spécifiques à certaines substances, comme les matières
particulaires et l’ozone. Comme il n’en existe pas pour d’autres substances, telles que le NO2
et le SO2, les niveaux établis dans le Tableau des lignes directrices et objectifs nationaux de
qualité de l’air ambiant au Canada (Santé Canada 2008) s’appliqueraient.
Page 5 de 7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%