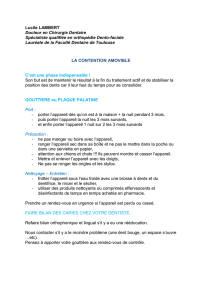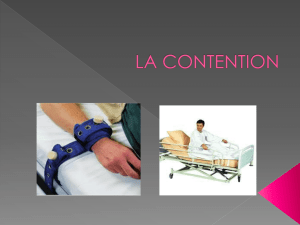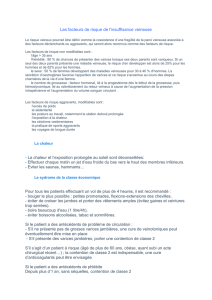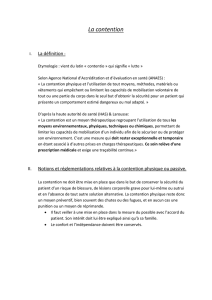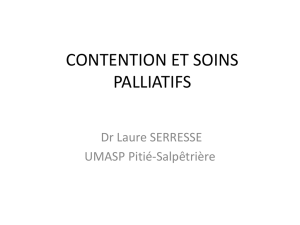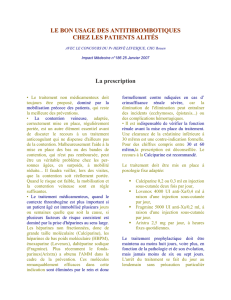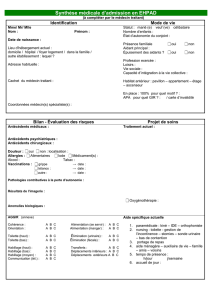Interprétation et pratiques autour du terme « contention chimique

Journal Identification = PNV Article Identification = 0521 Date: February 28, 2015 Time: 10:50 am
Synthèse
Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13 (1) : 31-5
Interprétation et pratiques autour du terme
«contention chimique »: étude qualitative
auprès de 50 professionnels de santé
Representation and practice about «chimical restraints»:
qualitative study with 50 health worker
Brice Colombier1
Sophie Moulias2,3
Niccolo Curatolo2
Tristan Cudennec2
Florence Muller1
Delphine Preulier1
Laurent Teillet1,2
1Soins de suite et de réadaptation
gériatrique, Hôpital Sainte Périne,
Hôpitaux universitaires Paris
Île de France Ouest, AP-HP
2Unité de court séjour gériatrique,
Hôpital Ambroise Paré, Hôpitaux
universitaires Paris Île de France Ouest,
AP-HP, Université de Versailles
Saint Quentin
3Laboratoire d’éthique médicale,
Université Paris Descartes
Tir ´
es `
a part :
B. Colombier
Résumé. Le terme «contention chimique », en anglais chemical restraints, semble être
utilisé en pratique, mais de perception hétérogène entre les différents professionnels de
santé franc¸ais. Il se rapproche, dans la littérature, de l’utilisation des psychotropes pour
les comportements perturbateurs. La méthode de recherche qualitative basée sur des
entretiens semi-dirigés a pour objectif de décrire la compréhension du terme «contention
chimique »auprès du personnel médical et paramédical en gériatrie. Ce terme est compris,
peu employé au quotidien, inexact pour certains car «les médicaments n’attachent pas ».
Le terme «contention physique »a une réalité plus visible. Le terme «sédation de symp-
tômes psychocomportementaux »est plus usité et de connotation moins culpabilisante. En
pratique, la contention chimique peut correspondre à l’utilisation en urgence de benzodia-
zépines ou neuroleptiques, par voie injectable, avec des posologies permettant la sédation
d’un patient sans son consentement.
Mots clés : contention chimique, neuroleptique, benzodiazépine, contrôle des troubles du
comportement
Abstract. The term «chemical restraints »seems to be used in medical practice, but do
not have the same meaning for all French health care professionals. In available literature it
is considered as use of psychotropic medications for behavioral disorders. We used quali-
tative research method based on semi-directive interviews, in order to better understand
meaning of «chemical restraint »term for geriatric medical and paramedical personnel.
This term is well understood, rarely used, wrong for some professional because «drugs
do not hold ». The term of «physical restraint »has a more tangible reality. The term of
«sedation of psychocomportemental troubles »is more common and seems to have a less
pejorative connotation. In practice chemical restraint may correspond to emergency use
of benzodiazepines or neuroleptics by injection at doses leading to the patient’s sedation
without his consent.
Key words: chemical restraints, major/minor tranquilisers, neuroleptic, benzodiazepine,
control behavior
Le terme «contention chimique »est historiquement
lié au développement de la psychiatrie. Depuis la
création des asiles en 1838 avec le mouvement
des «aliénistes », des médecins comme Pinel puis Esqui-
rol se sont intéressés aux troubles du comportement.
Le statut de «malade »a remplacé celui de «fou »
avec l’apparition d’une réflexion sur sa prise en charge
et la volonté d’accompagner voire de guérir. Il faudra
attendre les années 1950, avec les progrès de la pharma-
cologie, pour voir apparaître les premiers neuroleptiques.
Ceux-ci ont été accueillis avec crainte par certains psy-
chiatres, notamment Baruk, qui les qualifiait de «camisole
chimique ».
Concernant la contention, les définitions sont
récentes. En France, l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé (Anaes) a publié en 2000 un
guide des pratiques professionnelles intitulé «Limiter les
risques de la contention physique de la personne âgée »,
dans lequel sont distinguées les contentions physiques
posturales, actives et passives. D’autres approches parlent
de contention architecturale, psychologique ou relation-
nelle et de contention pharmacologique ou chimique. En
2002, le ministère québécois de la santé et des services
sociaux a publié des orientations ministérielles relatives
à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle,
au nombre de trois : l’isolement, la contention et les
doi:10.1684/pnv.2015.0521
Pour citer cet article : Colombier B, Moulias S, Curatolo N, Cudennec T, Muller F, Preulier D, Teillet L. Interprétation et pratiques autour du terme «conten-
tion chimique »: étude qualitative auprès de 50 professionnels de santé. Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(1) : 31-5 doi:10.1684/pnv.2015.0521 31
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0521 Date: February 28, 2015 Time: 10:50 am
B. Colombier, et al.
substances chimiques [1]. Cette dernière se définit comme
le fait de limiter la capacité d’action d’une personne en lui
administrant un médicament.
Dans les textes officiels, le terme de contention chi-
mique n’existe pas. La conférence de consensus de la
Société franc¸aise de médecine d’urgence de 2002 sur
«L’agitation en urgence »parle de sédation pharmacolo-
gique du patient agité. La Haute autorité de santé (HAS)
a publié en 2005 des recommandations sur les «Modali-
tés de prise de décision concernant l’indication en urgence
d’une hospitalisation sans consentement d’une personne
présentant des troubles mentaux », dans lesquelles est uti-
lisé le terme de sédation d’emblée indispensable. Dans les
recommandations de 2009 sur la «Confusion aiguë chez
la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation »
et «Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise
en charge des troubles du comportement perturbateurs »,
les experts décrivent des traitements médicamenteux
symptomatiques de courte durée ou des interventions
médicamenteuses par des psychotropes.
Pourtant, il semble que ce terme de «contention chi-
mique »soit utilisé en pratique courante et dans la littérature
anglo-saxonne sous le terme chemical restraints. Une étude
préliminaire réalisée en unité de gériatrie aiguë, en pneu-
mologie et en chirurgie vasculaire à l’hôpital Ambroise Paré
à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine) en octobre 2012
montrait une hétérogénéité de perception de la conten-
tion chimique entre médecins et infirmiers [2]. Le mode
de prescription en «si besoin »était majoritaire, lais-
sant à l’appréciation de l’infirmier le choix d’administrer
ou non le psychotrope, le plus souvent une benzodiazé-
pine. Qu’entendent les professionnels de santé par le terme
«contention chimique »?
Il nous a semblé pertinent d’approfondir ce questionne-
ment par une étude qualitative réalisée auprès de différents
professionnels de santé et ayant comme objectif de définir
la «contention chimique ».
Matériels et méthodes
Nous avons utilisé une méthode de recherche qualitative
basée sur des entretiens semi-dirigés selon la description
de Kaufmann, afin de permettre un recueil des opinions
sur la contention chimique sans imprimer à leur expres-
sion la rigidité de questionnaires aux questions fermées
[3].
L’identification des thèmes à aborder et l’élaboration du
guide d’entretien s’est faite en parallèle d’une recherche
bibliographique à partir des bases de données Pubmed,
Google Scholar et de la Bibliothèque InterUniversitaire de
Médecine. Les mots clés utilisés étaient «contention »,
«contention chimique »,«neuroleptique »,«benzodia-
zépine »,«contrôle des troubles du comportement »,
«agitation »et les références anglo-saxonnes : «restraint »,
«chemical restraints »,«major tranquilisers »,«minor tran-
quilisers »,«neuroleptic »,«benzodiazepine »,«control
behaviour »,«agitation ». Le guide d’entretien semi-dirigé
permettait au répondeur de s’exprimer sur sa définition,
son imaginaire et sa pratique de la contention chimique.
Il a été élaboré de fac¸on monodisciplinaire par deux
médecins.
La population cible était pluridisciplinaire, comprenant
des médecins et du personnel paramédical, avec un nombre
de personnes interrogées suffisant pour arriver à saturation
théorique. L’étude a été réalisée essentiellement à l’hôpital
gériatrique Sainte Périne, à Paris. Des formations sur la
contention physique ont été réalisées ces dernières années.
Comme pour tout hôpital gériatrique, les équipes sont sen-
sibilisées à l’usage des psychotropes, sans pour autant qu’il
existe de recommandations spécifiques. Les entretiens
étaient enregistrés par un même médecin exerc¸ant dans
l’hôpital, connaissant parfois les personnes interrogées, à
l’aide d’un magnétophone et retranscrits manuellement en
verbatim. Une analyse catégorielle thématique des données
a été réalisée selon la méthodologie de Deschamps [4]. Ceci
consiste à tirer un sens général de l’ensemble de la descrip-
tion puis de reconnaître des unités de signification afin de
réaliser une synthèse dans le respect du phénomène consi-
déré, et décrire la structure typique du phénomène. Une
deuxième lecture a été réalisée par un deuxième médecin
gériatre du groupe hospitalier.
Résultats
Au total 50 entretiens ont été réalisés entre le 31
mai et le 21 juin 2013 majoritairement à l’hôpital Sainte
Périne (Paris), chacun durant de 12 à 90 minutes, soit un
total de 22h30 d’enregistrement. Les personnes interro-
gées, âgées de 23 à 64 ans, étaient majoritairement des
femmes (70 % contre 30 % d’hommes). Vingt-huit sont
médecins, à différentes étapes de leurs formations, dont
un externe, trois internes et deux PUPH de gériatrie. Douze
sont gériatres exerc¸ant pour quatre en unité de gériatrie
aiguë (UGA), quatre en soin de suite et réadaptation (SSR),
deux en unité de soin de longue durée (USLD), un en
équipe mobile et un en psychogériatrie. Les autres méde-
cins interrogés sont trois psychiatres, deux médecins en
soins palliatifs, deux généralistes, un urgentiste, un chirur-
gien orthopédiste, un réanimateur pédiatre, un neurologue
et un radiologue. Sept personnes sont infirmiers et huit
32 Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, n ◦1, mars 2015
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0521 Date: February 28, 2015 Time: 10:50 am
Interprétation et pratiques autour du terme «contention chimique »
aides-soignants majoritairement en SSR de jour. Trois psy-
chologues, une psychomotricienne, une ergothérapeute,
une kinésithérapeute et une pharmacienne ont complété
cet échantillon de professionnels de santé. Il n’y a pas eu
de refus d’entretien.
Ce qui ressort des entretiens est la grande hétérogé-
néité de perception du terme «contention chimique ».La
première difficulté est celle de sa définition. Ce terme est
compris, peu employé au quotidien, inexact pour certains :
«les médicaments n’attachent pas ».
Le terme de contention physique est plus admis
par l’ensemble des professionnels de santé puisqu’il a
une réalité visible. Pour certains, la contention chimique
est une contention physique sans lien mais avec des
médicaments. D’autres évoquent le contrôle psychique
exercé par les psychotropes. Certains enfin voient un lien
avec d’autres termes utilisés dans leurs pratiques : pré-
médication, sédation-analgésie, sédation de symptômes
psycho-comportementaux, traitement des comportements
perturbateurs.
C’est un terme non accepté par quelques-uns, majoritai-
rement des médecins : «je n’ai pas l’impression de faire de
la contention chimique »,«je ne l’emploie pas, je n’ai jamais
employé et je n’ai pas envie d’employer ». La contention
chimique est culpabilisante pour le soignant qui la pratique
et dramatique pour le patient qui la subit. C’est parler du
«malade emmerdant », c’est répondre «avant d’avoir posé
le problème ». Les professionnels de santé expriment la
violence du terme : «image terrible »,«sadique »,«pas
une bonne intention ». Cette connotation négative pourrait
expliquer la non-appropriation de ce terme par près d’un
tiers des répondeurs. D’autres évoquent une pratique insi-
dieuse : «on va plutôt se cacher sous des mots [...] des
noms de molécules »,«on le fait plus souvent qu’on ne le
pense ».
Tout comme la contention physique, cette pratique inter-
roge le pouvoir médical. Il semble exister tout un gradient
de contention chimique allant de la «faible »,«légère »,
«douce »à«l’intermédiaire »et jusqu’à la contention
«lourde ». Les circonstances sont différentes allant de la
contention «ponctuelle pour le confort »du patient, celle
d’«urgence », la contention «chronique »jusqu’à celle de
«complaisance »pour l’entourage.
En pratique, la contention chimique se définit volontiers
pour certains comme l’utilisation de benzodiazépines ou
neuroleptiques surtout, par voie injectable, à forte poso-
logie, avec un effet sédatif franc, sans le consentement
du patient (forcé ou caché), dans un objectif de contrôle
physique et psychique. D’autres l’assimilent à une sur-
prescription ou abus de psychotrope à opposer à une
prescription adaptée.
Les circonstances de prescription sont souvent dans
l’urgence, bien que 32 % pensent qu’elle peut se jus-
tifier en chronique, pour des symptômes d’agitation ou
d’agressivité, avec un risque d’acte auto- ou hétéroagressif,
dans le cadre de pathologies psychiatriques, démentielles
ou de syndromes confusionnels. Parfois la contention se
justifie pour réaliser un examen clinique ou paraclinique ou
mettre en route un traitement. Elle questionne lorsque sa
justification est l’environnement inadapté ou le sentiment
d’incapacité ou de lassitude de l’entourage.
L’ensemble des professionnels de santé centre
l’objectif de la contention sur le patient. Celle-ci permet
de calmer un comportement, une agitation, une anxiété...
mais peut aussi protéger, sécuriser, maîtriser, permettre
une meilleure organisation du service. La frontière entre
soin et privation de liberté est ténue. Un environnement
tolérant et ayant les moyens d’accepter certains troubles
du comportement est important.
Les molécules citées sont dans 60 % des entretiens
l’utilisation de neuroleptiques avec la loxapine (32 %),
l’halopéridol (28 %) et la risperidone (22 %) et dans 58 %
les benzodiazépines avec l’alprazolam (38 %), le midazo-
lam (18 %), l’oxazépam (10 %). Vingt-huit pour cent des
répondeurs, majoritairement les paramédicaux, mais aussi
quelques médecins, ne connaissent pas le nom des médi-
caments utilisables. La voie privilégiée est la voie orale :
«il ne faut pas rajouter de la violence à la violence ».
Le choix de prescription est fonction de la formation, des
recommandations et des habitudes. Les psychiatres, par
exemple, utilisent de fortes doses d’emblée pour éviter des
situations embarrassantes où il faut réinjecter un patient
agressif avec 5 personnes pour le maintenir, alors que
les gériatres préconisent de petites doses pour évaluer la
tolérance.
D’autres classes médicamenteuses ont été citées
comme les anesthésiants, les antihistaminiques, les antal-
giques, les antidépresseurs, les antiépileptiques et les
inhibiteurs de l’acétylcholinestérase.
Discussion
Cette étude qualitative, complémentaire d’une étude
préliminaire que nous avions conduite en 2012, confirme
l’hétérogénéité de la perception de la contention chi-
mique par les professionnels de santé, notamment
en ce qui concerne la prescription des psychotropes
[2].
Les limites à la portée des résultats sont liées à la durée
parfois très réduite des entretiens, notamment avec les
aides-soignants, le côté monodisciplinaire de la rédaction
Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, n ◦1, mars 2015 33
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0521 Date: February 28, 2015 Time: 10:50 am
B. Colombier, et al.
du guide d’entretien, de la réalisation des entretiens et de
l’analyse, ainsi que le rapport hiérarchique avec certains des
interviewers.
On distingue deux niveaux de lecture : d’une part
concernant la définition de «contention chimique »
et, d’autre part, concernant la pratique se rapportant à
ce terme.
À travers l’analyse des entretiens, il semble que la
contention chimique soit un terme qui est utilisé mais dont
l’interprétation varie en fonction de la personne interrogée.
La terminologie chemical restraints, que les auteurs améri-
cains utilisent sans remise en question, a un sens différent
selon l’interlocuteur. Pour certains, elle est une réalité pra-
tique sous des termes plus usités comme sédation ou
traitements des troubles psycho-comportementaux. Pour
d’autres, elle renvoie à une pratique insidieuse se révélant
lorsqu’on la recherche ou un usage hors recommandation
et parfois inadapté de psychotropes. L’ensemble des pro-
fessionnels de santé ne s’accordent pas sur une définition
unanime de ce terme à la connotation plutôt négative,
même au sein d’une profession. Certains n’y ont même
pas recours ou ne désirent pas l’utiliser, notamment les
médecins, le vocabulaire médical étant assez riche pour
s’en passer.
En pratique, la contention chimique correspond le plus
souvent à la prescription de benzodiazépines et de neuro-
leptiques. Il semble néanmoins que le choix de l’halopéridol
retrouvé dans 28 % des entretiens ne soit pas le plus perti-
nent, contrairement aux antipsychotiques atypiques sur de
courtes durées [5, 6].
Certains espèrent une molécule idéale : d’administration
simple, d’action rapide, de courte durée de vie, sans effet
secondaire, permettant un contrôle du patient sans risque
pour lui ou autrui. Il semble alors que le danger soit de négli-
ger toute la démarche étiologique et de passer à côté d’un
diagnostic vital pour le patient.
Vingt-huit pour cent des professionnels de santé interro-
gés sont incapables de citer le nom des molécules utilisées.
Ceci interroge sur la réalité de la discussion pluridiscipli-
naire autour de la contention chimique et la capacité d’alerte
de ces professionnels sur les prescriptions leur semblant
inappropriées.
La prescription possible en chronique évoquée dans
32 % des entretiens et l’extension à d’autres classes
médicamenteuses comme les antidépresseurs, les anti-
épileptiques ou les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase,
questionnent sur la compréhension de l’utilisation des
psychotropes au sens large. Certains troubles du compor-
tement sont causés par des maladies psychiatriques ou
neurodégénératives, donc pouvant être chroniques, néces-
sitant un lieu et une prise en charge adaptés, souvent
psychocomportementale, afin de limiter des traitements
aux effets secondaires non négligeables. Aucune recom-
mandation ne permet de justifier la prescription de ces trois
dernières classes médicamenteuses pour l’agitation dans
la démence [7, 8]. Les indications dans ces recommanda-
tions reposent sur des accords professionnels et sont le
plus souvent hors AMM.
L’intérêt de protocole ou de prescriptions anticipées
individuelles pour normaliser les pratiques reste à démon-
trer. Une réflexion collective autour de ce terme pourrait
permettre une confrontation des différentes logiques et
attitudes concernant la prescription des psychotropes, de
discuter de manière multidisciplinaire d’éventuelles alter-
natives, de permettre de rester vigilant pour réévaluer ces
prescriptions plus «cachées »que la contention physique,
afin de toujours rester dans le soin approprié et de ne pas
glisser vers la maltraitance.
Des facteurs de risques d’utilisation de la conten-
tion sont connus [9]. Ceux-ci sont liés aux patients :
grand âge, déficit cognitif, perte d’autonomie fonction-
nelle, instabilité à la marche, agitation, comportement
perturbateur, errance et fugue, manque de collaboration
aux soins. Mais il existe aussi de nombreux facteurs
de risques possiblement modifiables liés aux établis-
sements, comme le manque de ressources humaines
ou financières ou un environnement physique inadéquat,
ou liés aux proches et aux professionnels de santé,
comme la méconnaissance de la problématique dont les
fausses croyances quant à l’efficacité de la contention,
la préséance de la sécurité sur la liberté de l’individu,
l’intolérance face à l’agitation et aux comportements per-
turbateurs.
La formation de l’ensemble des professionnels de
santé, de l’entourage et le maintien des compétences sur
la prise en charge des troubles du comportement semblent
un enjeu important pour diminuer la contention chimique et
physique. Les alternatives non médicamenteuses ne sont
pas toujours exploitées malgré leurs pertinences, bien que
leurs évaluations ne soient pas toujours évidentes [10, 11].
Il semble même que l’incidence des états d’agitation dimi-
nue lorsque l’intensité de l’agitation est mesurée à l’aide
d’outils cliniques standardisés [12].
Le problème de la contention chimique, ainsi que la
contention physique, n’est pas seulement un problème de
compétence pour faire le bon diagnostic, ou pour choisir
le bon endroit de prise en charge et le bon traitement.
Il est plutôt de confronter différentes logiques et valeurs
entre celles centrales du patient, n’ayant souvent pas
les moyens de consentir de manière éclairée ou étant
dans une situation imposant l’action de son entourage, et
celles des soignants, de la famille, voire de l’institution
34 Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, n ◦1, mars 2015
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0521 Date: February 28, 2015 Time: 10:50 am
Interprétation et pratiques autour du terme «contention chimique »
Points clés
•Le terme de «contention chimique »est perc¸u
de manière hétérogène par les différents acteurs de
soin.
•Il existe une polémique sémantique autour de la
terminologie et un questionnement sur l’usage des
psychotropes pour contrôler les symptômes psycho-
comportementaux.
ou de la société. Du point de vue légal, nous sommes
souvent partagés entre la protection des libertés indivi-
duelles, affirmée par les chartes des patients et la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qua-
lité du système de santé, dite loi Kouchner, et l’obligation
d’intervention devant la mise en danger d’autrui. Le terme
de contention chimique suscite de nombreuses questions.
Jusqu’où doit-on assurer la sécurité de la personne ? Quel
niveau de risque est acceptable ? Comment prendre à bon
escient la décision d’entraver la liberté individuelle ? Quels
troubles cognitifs ou psychiques justifient cette prescrip-
tion ? Quand protège-t-on un patient et quand lui fait-on du
tort ?
Conclusion
Il existe une polémique sémantique autour de la termi-
nologie «contention chimique »qui ne semble pas exister
chez les auteurs américains utilisant le terme «chemical
restraints ».La«contention chimique »est utilisée dans la
pratique des professionnels de santé mais semble difficile à
définir et reste d’interprétation hétérogène, entre contrôle
physique et psychique. Plusieurs médecins rejettent cette
dénomination, préférant le terme plus médical de sédation
des troubles psychocomportementaux.
En pratique, elle correspond à l’utilisation de psycho-
tropes dans les troubles du comportement perturbateurs,
dans des situations souvent complexes qui imposent une
action rapide, avec une balance bénéfice/risque parfois
difficile à estimer. L’enjeu est de développer une réflexion
collective autour de ces situations, pour rester dans le soin
approprié, favoriser les prises en charge personnalisées
non médicamenteuses et utiliser les psychotropes de
manière pertinente.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt en rapport avec cet article.
Références
1. Québec G. Orientations ministérielles relatives à l’utilisation excep-
tionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et
substances chimiques. Qué Ministère Santé Serv Sociaux 2002.
2. Curatolo N, Colombier B, Chinet T, Goeau-Brissonniere O, Teillet L,
Lemercier F, et al. GRP-190 Use of tranquillisers and restraint in a French
teaching acute care hospital. Eur J Hosp Pharm Sci Pract 2013;20
(Suppl. 1) : A68-168.
3. Kaufmann JC. L’entretien compréhensif,2
eédition. Paris : Armand
Colin, 2008.
4. Deschamps C. L’approche phénoménologique en recherche :
comprendre en retournant au vécu de l’expérience humaine. Mont-
réal : Guérin Universitaire, 1993.
5. Lonergan E, Luxenberg J, Colford J. Haloperidol for agitation in
dementia. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD002852.
6. Ballard C, Waite J. The effectiveness of atypical antipsy-
chotics for the treatment of aggression and psychosis in
Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:
CD003476.
7. Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, Gruneir A, Herrmann N, Rochon P.
Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. Cochrane
Database Syst Rev 2011;2:CD008191.
8. Lonergan E, Luxenberg J. Valproate preparations for agitation in
dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;3:CD003945.
9. Giroux MT, Maheux C, Chevalier M. Pour une approche bienfaisante
de la contention. Médecin Qué 2005 ; 40 : 83-91.
10. Palmer L, Abrams F, Carter D, Schluter WW. Reducing inappropriate
restraint use in Colorado’s long-term care facilities. Jt Comm J Qual
Improv 1999 ; 25 : 78-94.
11. Richter T, Meyer G, Möhler R, Köpke S. Psychosocial interventions
for reducing antipsychotic medication in care home residents. Cochrane
Database Syst Rev 2012 ; 12 : CD008634.
12. Lazignac C, Ricou B, Dan L, Virgillito S, Adam E, Seyedi M, et al.
Interest of psychiatric guidelines in managing agitation in intensive care.
Rev Médicale Suisse 2007;3:414-9.
Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, n ◦1, mars 2015 35
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
1
/
5
100%