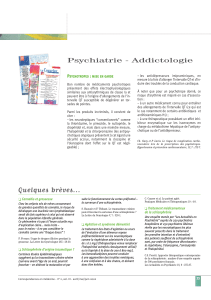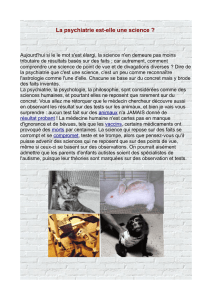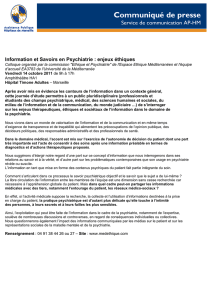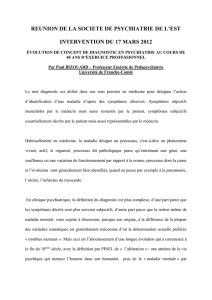Lire l`article complet

110
Le métissage
En séance inaugurale,
F. Laplantine, professeur
d’ethnologie à l’université
de Lyon, a présenté une
conférence sur la pensée
métisse. Le métissage est un
sujet qui n’a pas manqué de
soulever de nombreuses
controverses et questions,
parmi lesquelles : peut-on
aborder la maladie mentale de façon uni-
forme ? Devons-nous tenir compte de la cul-
ture de chaque peuple ?
La pensée métisse est une expérience diffi-
cile, parfois douloureuse, qui demande que
l’on renonce à la totalisation et à la propriété.
C’est l’acceptation de l’autre en nous. Ce n’est
pas l’un ou l’autre, ni l’un et l’autre mais l’in-
tervalle, l’interstice. Le métissage est fragile,
il se voit menacé par la logique de la disjonc-
tion, ce n’est pas le tout mais le presque tout.
Le métissage est presque toujours confondu
avec les notions non seulement insuffisantes
mais inadéquates de mélange, de mixité,
d’hybridité qui se situent à l’extrême opposé
de la notion de métissage en tant que concept.
La pensée métisse est une pensée du clair-
obscur, une pensée des nuances, des espaces
intermédiaires, c’est un mode de connais-
sance qui n’existe qu’en tension.
La multiplicité s’oppose donc à la simplifi-
cation. Survient alors le problème de la perte
de l’identité. Dans métissage, il y a tissage,
cela prend du temps, tout cela pour aboutir à
la torsion et au pli de la pensée. Ainsi, le
métissage représente ce qui n’a pas encore
été pensé.
C’est une exigence, c’est la pluralité, la ten-
sion qui demande que l’on renonce à la tota-
lisation et à la propriété. Le métissage est
quelque chose de fragile, qui est menacé par
la logique de la disjonction. Il ne faut pas pour
autant croire que le métissage est un tout.
La psychiatrie et la Martinique
La population générale s’est enrichie des
apports de diverses cultures qui se sont ren-
contrées dans cette région. Le concept de
maladie mentale à l’européenne est venu
s’ajouter et se mêler à d’autres compréhen-
sions de la nature des troubles psychiques
apportées de différents continents comme
l’Amérique du Sud, l’Afrique... En Marti-
nique, il s’est opéré un “métissage” entre les
thérapeutiques pratiquées en Europe et les
traitements traditionnels créoles. Les
échanges sont toujours présents dans cer-
taines prises en charge, où des thérapeutiques
novatrices se rattachent à des pratiques
locales plus anciennes. Il arrive encore que
les praticiens soient parfois confrontés à des
problèmes de reconnaissance des troubles
psychiatriques rencontrés dans un monde
antillais qui s’est construit sous l’influence
métropolitaine et l’influence africaine où le
mode magique prédomine.
À l’aube de l’an 2000 un nouveau tournant
décisif se produit dans l’histoire de la psy-
chiatrie en Martinique avec
la reconstruction de l’extra-
hospitalier. La décision de
rapprocher l’hôpital psy-
chiatrique des lieux de vie
est prise, l’hôpital actuel de
Colson est en effet situé en
pleine forêt tropicale.
Le projet en cours, regrou-
pant des lits de différents
secteurs, permettra la créa-
tion d’un nouvel hôpital
psychiatrique plus proche des bénéficiaires.
La médication psychiatrique
chez l’enfant
Le Professeur Yves Lamontagne, président
du Collège des médecins du Québec, a
animé un débat sur la médication en psy-
chiatrie chez l’enfant et l’adolescent. Le pro-
grès des sciences neuropsychiatriques, la
reconnaissance précoce de certains dys-
fonctionnements ont introduit la médication
psychotrope comme un outil possible, voire
indispensable en santé mentale de l’enfant
et de l’adolescent. Mais la place de la chi-
miothérapie demeure très limitée chez l’en-
fant. Cet usage a été le thème de nombreux
débats sur la pertinence de cette médication,
les aspects éthiques et légaux de l’utilisa-
tion de psychotropes chez les moins de 18
ans. Les psychotropes font partie des
moyens mis à notre disposition pour prendre
en charge la souffrance psychique, mais leur
utilisation chez l’enfant peut être rendue dif-
ficile par le respect de critères éthiques et
légaux comme ceux retenus dans l’AMM.
Un des problèmes rencontrés par le prati-
cien est que le nombre de produits autori-
sés chez l’enfant diminue régulièrement.
Cette situation ne semble pas s’améliorer
dans la mesure où les études d’efficacité et
écho des congrès
XVIIIes Journées
de la Société de l’information psychiatrique
Fort-de-France, 5-10 décembre 1999
C.V. Cuervo*
Neuf cents professionnels du monde psychiatrique,
venus de divers horizons ont participé aux XVIIIes
Journées de la Société de l’information psychiatrique.
Le programme de ces journées proposait
un équilibre intéressant entre trois aspects que sont
la psychiatrie, la langue et la culture. Ces thèmes ont été
développés au cours de communications orales, de tables
rondes, de symposiums et d’ateliers.
* Service de psychiatrie adulte,
CHU de Reims.
Écho des congrès
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 4, avril 2000

111
écho des congrès
de tolérance restent très peu nombreuses
chez l’enfant.
La médication doit être envisagée en fonc-
tion de la gravité des symptômes, de l’âge et
de la famille. Il faut avant tout favoriser la
réalisation de thérapies non médicamen-
teuses, les psychotropes ne doivent pas être
prescrits pour des enfants de moins de 5 ans.
Un autre point débattu par les praticiens
concerne la médication proposée par les
pédiatres et les généralistes. Les psychiatres
et pédopsychiatres souhaitent éviter que les
pédiatres et les généralistes effectuent des
prescriptions de psychotropes. Le professeur
Lamontagne a ensuite évoqué le cas particu-
lier de la surconsommation de la méthylphé-
nidate (Ritaline®) aux États-Unis. La Rita-
line®est proposée pour les déficits d’attention
et l’hyperactivité chez l’enfant. La situation
est telle qu’aux États-Unis, les enseignants
incitent même les parents à demander de la
Ritaline®à leur médecin traitant pour leurs
enfants. Contrairement aux États-Unis, la
Ritaline®demeure peu prescrite en France, et
il existe une nette différence de prescription
entre le Québec et la France. Il est à noter que
la communauté internationale souhaiterait
qu’une évaluation soit effectuée systémati-
quement par des pédopsychiatres. Paradoxa-
lement, les pédopsychiatres veulent s’appro-
prier la Ritaline®‚ mais beaucoup refusent
d’en prescrire.
Il paraît évident que l’arsenal médicamen-
teux doit être utilisé en combinaison avec
d’autres thérapeutiques. Le rôle du médica-
ment ne peut s’envisager qu’avec de nom-
breuses autres approches. Toutefois, dans cer-
tains cas, le problème de la médication ne se
pose pas : dépression, schizophrénie, trouble
obsessionnel compulsif... Cependant, dans
d’autres circonstances, l’enfant pourra
répondre à une psychothérapie ou à une thé-
rapie comportementale. Le rôle du médica-
ment ne peut se concevoir que dans une pers-
pective où l’association avec des approches
psychothérapeutiques, comportementales,
familiales et socio-éducatives permettra de
constituer et d’individualiser un véritable pro-
jet thérapeutique pour chaque enfant.
Dans quelle langue
le délirant délire-t-il ?
Ce thème a été exposé par le docteur
N. Ribault de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu à
Lyon.
Une étude clinique portant sur des dossiers
de patients d’origine étrangère ou parlant une
langue étrangère conduit les auteurs à préci-
ser trois hypothèses concernant le langage
utilisé par le psychotique délirant. Celui-ci
peut s’exprimer dans sa langue maternelle,
dans la langue de l’interlocuteur ou dans un
langage pathologique. Ces hypothèses per-
mettent de réfléchir au rôle et à la place d’un
interprète dans la relation entre le médecin et
le patient. L’étude présentée portait sur 158
patients d’origine étrangère ou parlant une
langue étrangère, hospitalisés plusieurs fois
au CHS Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Quatre-
vingt-dix-huit patients ont exprimé des idées
délirantes : 85 en français, 7 dans leur langue
maternelle et 6 dans les deux langues. Il est
à noter que 10 patients présentaient un lan-
gage pathologique.
La langue maternelle désigne le plus souvent
la langue de la mère, chargée de toute l’af-
fectivité des interactions mère-enfant. Dans
des contextes de mouvances sociales et de
migrations, l’usage de la langue peut être
modifié. Il peut y avoir des inférences lin-
guistiques, mises en évidence par l’appari-
tion d’éléments linguistiques empruntés à un
autre système linguistique. Il est aussi pos-
sible d’observer une alternance, définie par
l’existence d’éléments qui ne sont plus
empruntés mais intégrés au répertoire du
groupe. Il peut y avoir formation d’une
langue nouvelle dans laquelle les systèmes
se confondent, les repères culturels ou lan-
gagiers ne s’appliquant plus.
Enfin, une langue peut être assimilée plus
qu’une autre. Les déviations linguistiques
peuvent porter sur le sens des mots, on parle
alors de néologisme sémantique ou de glos-
somanie sémantique. On peut observer une
altération entre le signifiant et le signifié.
Cette pathologie du langage survient chez
certains patients schizophrènes et correspond
à la schizophasie de Kraepelin.
Le recours à un interprète professionnel se
justifie dans la majorité des cas. Le travail
avec l’interprète est parfois très difficile et
peut correspondre pour certains à l’équiva-
lent d’une cothérapie ou à la supervision d’un
thérapeute.
Faut-il évoquer la maladie
avec le patient ?
Dire ou ne pas dire le diagnostic ? L’attitude
des praticiens demeure contrastée. Bien qu’il
paraisse difficile d’aborder le problème de la
maladie du schizophrène, il est nécessaire
d’informer au mieux le patient pour que
celui-ci participe le mieux possible au projet
thérapeutique.
Est-il éthiquement possible d’évoquer la
maladie avec le patient ? C’est à cette ques-
tion que se sont heurtés les congressistes, lors
d’un débat sur le thème “l’information du
patient atteint de schizophrénie et sa famille”.
Le nombre de patients schizophrènes en
France représente en moyenne 24 % de la
clientèle des psychiatres. Certains psy-
chiatres sont favorables à l’annonce du dia-
gnostic, d’autres sont plutôt réticents.
Selon une enquête épidémiologique trans-
versale sur l’annonce du diagnostic de schi-
zophrénie menée en France, 20 % des
patients schizophrènes sont informés de leur
maladie. Quant à connaître la véritable rai-
son pour laquelle le malade n’est pas
informé : 28,8 % des psychiatres considèrent
le terme de schizophrénie comme une éti-
quette, 22 % tiennent compte de l’incapacité
du patient à comprendre et 21 % estiment que
le diagnostic n’est pas suffisamment précis.
Il est parfois plus facile de communiquer avec
la famille du patient sur les pathologies
qu’avec le patient lui même. Il faut admettre
que, dans certains cas, le psychiatre peut
“sous-estimer” la capacité de son patient à
établir une véritable communication sur sa
maladie. Quoi qu’il en soit, la tendance serait
Écho des congrès

à favoriser l’information, sans qu’elle soit
pour autant brutale. L’étude a aussi montré
que l’annonce est d’autant plus fréquente
que les psychiatres sont jeunes et que la pro-
portion de patients schizophrènes dans leur
clientèle est importante. Les perspectives de
cette étude mettent en exergue l’optimisme
des plus jeunes et le réalisme des plus âgés.
L’information du sujet atteint
de trouble schizophrénique
Le docteur Anne Carré, de Montpellier,
a soulevé une question essentielle : quelle
information faut-il transmettre au patient
et à sa famille ?
Les personnes souffrant de schizophré-
nie présentent souvent des troubles cogni-
tifs et des défauts d’introspection ou
d’“insight”. Il s’agit d’éléments prédic-
tifs qu’il est nécessaire de prendre en
compte dans les décisions thérapeutiques.
Les psychiatres s’accordent pour dire que
l’information délivrée au patient doit, dans
un premier temps, concerner les symptômes
dont celui-ci souffre. Il est préférable de
prendre pour cible le symptôme principal
ou bien celui qui justifie la mise en place du
traitement. Cette position préconise l’utili-
sation d’un discours implicite. Le praticien
aide le patient à prendre conscience du
caractère psychopathologique de ses
troubles, du retentissement des symptômes
dont il souffre sur sa vie quotidienne, son
activité professionnelle... Les autres symp-
tômes peuvent alors être identifiés.
L’information donnée au patient doit aller
au-delà de la dénomination de la maladie,
elle doit fournir plus d’informations sur les
symptômes, leur évolution et leur traitement.
L’APA recommande l’utilisation de supports
écrits pour pallier les problèmes cognitifs,
en particulier les problèmes attentionnels. Il
est important de souligner que l’information
délivrée au patient permet d’instaurer avec
le praticien une relation de collaboration. Le
rôle du thérapeute est aussi d’aider à mieux
appréhender les mesures thérapeutiques
proposées. Dans certains cas, l’information
doit être délivrée en deux phases. Lorsque
le patient ne désire pas connaître le dia-
gnostic, il faut respecter ce choix. L’infor-
mation à donner dans ce cas concerne la par-
ticipation du patient au projet thérapeutique.
Enfin, dans la mesure du possible, il est
souhaitable que l’information soit délivrée
progressivement.
Conclusion
Durant ces cinq jours de réflexion, les
organisateurs se sont efforcés de réaliser
un savant mélange entre thèmes classiques
et thèmes culturels. Entamer un réel dia-
logue sur ces deux aspects aura été le but
premier de ce congrès, qui a permis de
mettre également en avant, à l’aube de l’an
2000, un tournant décisif dans l’histoire
de la psychiatrie publique en Martinique.
écho des congrès
Écho des congrès
SÉROPRAM
1
/
3
100%