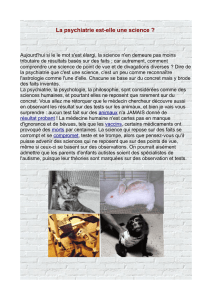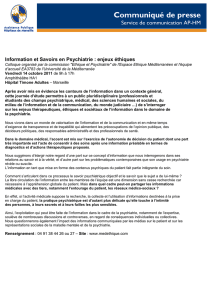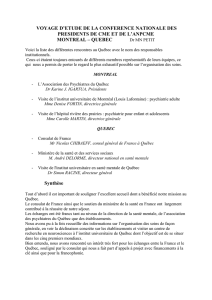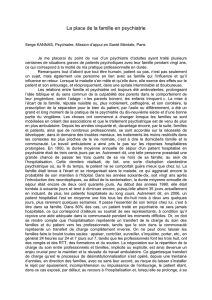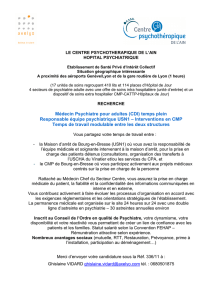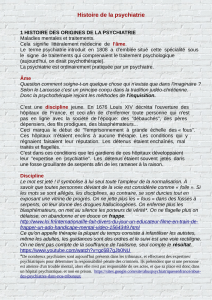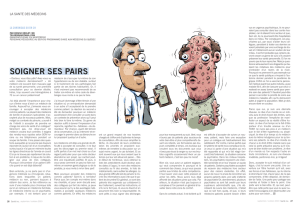Télécharger le fichier - Société de Psychiatrie de l`Est

REUNION DE LA SOCIETE DE PSYCHIATRIE DE L’EST
INTERVENTION DU 17 MARS 2012
ÉVOLUTION DE CONCEPT DE DIAGNOSTIC EN PSYCHIATRIE AU COURS DE
40 ANS D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Par Paul BIZOUARD – Professeur Emérite de Pédopsychiatrie
Université de Franche-Comté
Le mot diagnostic est utilisé dans son sens premier en médecine pour désigner l’action
d’identification d’une maladie d’après des symptômes observés. Symptômes objectifs
mesurables par le médecin mais aussi ressentis par le patient, symptômes subjectifs
essentiellement décrits par le patient mais aussi représentables par le médecin.
Habituellement en médecine, la maladie désigne un processus, c'est-à-dire un phénomène
vivant, actif, et organisé, processus dit pathologique parce qu’entraînant une gêne, une
souffrance ou une variation de fonctionnement par rapport à la norme, processus dont la cause
et l’évolution sont généralement bien identifiés, quand on pense par exemple à la pneumonie,
l’ulcère, l’infarctus du myocarde.
En clinique psychiatrique, la définition du diagnostic est plus complexe, d’une part parce que
les symptômes décrits sont plus souvent subjectifs, d’autre part parce que la notion même de
maladie mentale reste sujette à discussion, puisque son origine, à la différence de la plupart
des maladies somatiques est généralement méconnue d’où la dénomination actuelle préférée
« troubles mentaux ». Mais ceci est l’aboutissement d’une longue évolution qui a commencé à
la fin du 18ème siècle, avec la définition par PINEL de « l’aliénation » : une atteinte de la vie
psychique qui menace l’homme dans son humanité, puis de la « maladie mentale » par

ESQUIROL au début du 19ème siècle, époque où la souffrance, le trouble de la vie mentale
sont véritablement pris en charge par une nouvelle catégorie de médecins, « les psychiatres ».
Pourtant selon la terminologie médicale ces troubles mentaux ne peuvent être reconnus
comme maladie pour autant qu’on ne peut les rapporter à une lésion d’organe, ce qui fut
pourtant le cas dans l’antiquité puisque la mélancolie était rapportée à un trouble de la
sécrétion biliaire, l’hystérie à un dysfonctionnement de l’utérus. En fait La relation du trouble
mental avec un défaut de fonctionnement du cerveau est relativement récente (15 -16ème
siècles). Mais si la localisation de cette origine dans le cerveau fut un grand progrès qui se
perfectionne encore actuellement par les explorations neuroradiologiques, cette localisation ne
donne pas véritablement la cause de la maladie, mis à part le faux espoir suscité par l’exemple
célèbre de la Paralysie Générale décrite par Antoine BAYLE en 1822. On retrouve la même
illusion actuellement à propos de l’autisme, dont je reparlerai plus tard,car la découverte
d’anomalies structurelles ou fonctionnelles de zones temporales du cerveau (ZILBOVICIUS)
ne peut être considéré comme une explication étiologique simple, pas plus d’ailleurs que les
anomalies génétiques ou métaboliques comme l’annoncent périodiquement les médias.
Revenons au 19è siècle durant lequel, dans un mouvement classificatoire généralisé à
références scientifiques (Botanique, Zoologie), influencé par les idées positivistes d’Auguste
COMTE, les maladies mentales furent décrites essentiellement par des regroupements de
symptômes en syndromes, dont l’évolution pouvait être repérée dans le temps : c’est la
description de la folie circulaire par FALRET, de la folie à double forme par BAILLARGER
puis de la psychose maniaco-dépressive par KRAEPELIN qui individualisa aussi la démence
précoce que BLEULER nommera plus tard (1911) « schizophrénie », une dénomination
diagnostique qui coïncide et annonce le développement d’une psychiatrie plus explicative du

mécanisme du trouble que de sa simple description. En effet au début du 20è siècle les
hypothèses psychologiques d’explication des troubles se développeront considérablement
avec FREUD, psychiatre psychanalyste, mais aussi avec des psychologues tels que Pierre
JANET et des phénoménologues avec BINSWANGER. Le mode de fonctionnement de la
pensée, on parle « de structure de personnalité pathologique », sous-jacente à l’apparition des
symptômes, introduit une nouvelle forme de diagnostic, sur laquelle nous reviendrons dans
notre actualité.
Plus tard, l’action efficace de médicaments sur certains troubles mentaux tendra à substituer
aux symptômes significatifs de maladie ou de syndromes, des symptômes de dépression, d’
d’anxiété, de délire décrits selon qu’ils réagissent à l’action des médicaments anti-
dépresseurs, anxiolytiques, antidélirants.
Insatisfaits de la profusion et du manque de clarté de ces définitions hétérogènes, certains
vont définir les troubles mentaux comme « toute souffrance soignée par les psychiatres »
tandis que d’autres, se nommant antipsychiatres, dénonceront ce concept qu’ils considèrent
comme une appropriation excessive. C’est ici que l’on voit apparaître l’importance de la
« dénomination » du trouble par le médecin et la fonction que l’énonciation du diagnostic
remplit dans le fonctionnement du psychiatre lui-même.
C’est dans ce contexte historique de l’évolution de la discipline psychiatrique dans la société
que j’ai survolé rapidement qu’est venue s’inscrire pour moi la construction du concept de
diagnostic durant les quarante années de mon exercice professionnel. Elle s’est construite au
croisement, à l’interface, à l’interaction de mes activités professionnelles successives : interne
en médecine, en neuropsychiatrie, en pédiatrie, chef de clinique assistant en psychiatrie de

l’adulte, psychiatre adjoint de psychiatrie d’enfants et d’adolescents, enfin responsable de
services hospitaliers d’adultes et enfants, enseignant, chercheur… tout cela se croisant avec
l’évolution des idées concomitantes dans la discipline.
C’est ce que je vais essayer de vous rapporter, sachant bien qu’il s’agit d’un parcours
personnel, singulier, spécifique mais qui pourrait bien refléter l’évolution des psychiatres et
de la psychiatrie durant toute cette période et qu’il présente probablement des analogies avec
l’évolution d’autres psychiatres de ma génération dont j’espère que certains s’y reconnaîtront.
Venu de la médecine où je me suis réjoui de faire comme on dit de « beaux diagnostics »
(beaux pour qui ?)somatiques et d’appliquer des traitements remarquablement efficaces, je
suis venu à la psychiatrie par l’envie, la curiosité d’approfondir l’origine de la maladie et de la
souffrance dans une approche plus personnalisée, plus globale de l’être humain. Pourtant au
début, suppléant mon ignorance et mes incertitudes par un retour à des bases médicales, mes
premiers mois en psychiatrie furent occupés par la différenciation des maladies enseignées par
mon Maître Robert VOLMAT et décrites dans le manuel de psychiatrie de HENRI EY qui
différenciait les maladies aigues, psychonévroses émotionnelles, manies, mélancolies, délires,
confusions et épilepsies, des maladies chroniques : névroses, délires, schizophrénie, démence,
arriération et déséquilibres psychiques. Ces maladies mentales dont le mécanisme s’expliquait
par la perte de contrôle des centres supérieurs sur le cerveau primitif, selon une théorie dite
organo-dynamique néo Jacksonienne de Henri EY, étaient différenciées des troubles mentaux
engendrés par les processus organiques, hormonaux, infectieux, alcooliques, traumatiques,
tumoraux.
J’ai d’ailleurs fait à l’époque une thèse de médecine à propos du diagnostic de schizophrénie,
dans ses modes de début chez le sujet jeune, à propos d’une centaine de cas repérés dans le
service pendant trois années d’internat.

J’écrivais à l’époque : « Il parait difficile, voire dangereux d’affirmer avec certitude de
quelqu’un qu’il est schizophrène avec un recul évolutif de quelques années seulement, ceci en
raison du flou nosographique du concept, de l’évolutivité imprévisible de la maladie, du
risque non négligeable de catégoriser définitivement un malade étiqueté. Pourtant , poussé par
les nécessités de la thérapeutique, dont on observe tous les jours qu’elle est d’autant plus
efficace qu’appliquée précocement, on est amené dans un certain nombre de cas, à considérer
certains malades comme fortement suspects d’évoluer vers un processus de dissosciationde la
pensée, des affects. C’est à ce niveau de probabilité, plus que de certitude, que s’est déroulée
notre recherche ».
Une thèse complémentaire que j’ai codirigée quelques années après n’a confirmé ces
diagnostics que dans la moitié des cas.
A la même époque, les jeunes psychiatres de ma génération étaient interpellés par les travaux
des antipsychiatres LAING et COOPER en Grande-Bretagne, BASAGLIA en Italie qui
précisément remettaient en cause la démarche diagnostic et thérapeutique des psychiatres à
qui ils attribuaient l’origine des troubles mentaux, institutionnalisés en maladie du fait de leur
dénomination psychiatrique, et pérennisé par l’enfermement en établissements spécialisés
dont ils préconisaient la fermeture.
En parallèle la pratique psychiatrique des années 70 était aussi fortement influencée par la
découverte récente dans le service de Jean DELAY, où Robert VOLMAT avait été chef de
clinique assistant en même temps que Pierre DENICKER, de l’action thérapeutique des
psychotropes et l’expérimentation de leur action ( tri cyclique, benzodiazépines) orientaient
les diagnostics dans un sens privilégiant les symptômes (anxiolytiques, antidépresseurs) dont
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%