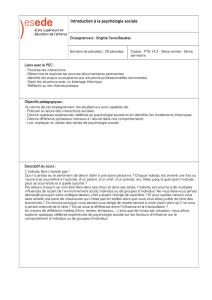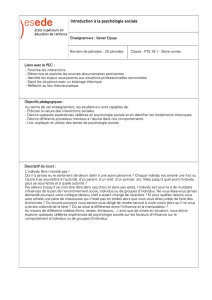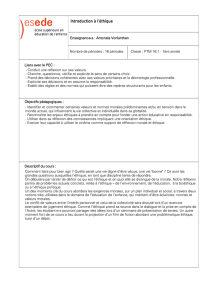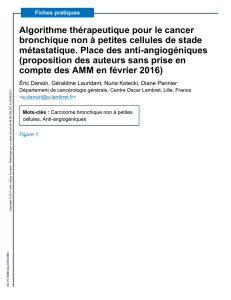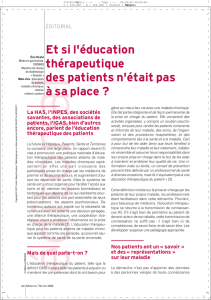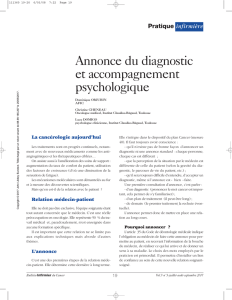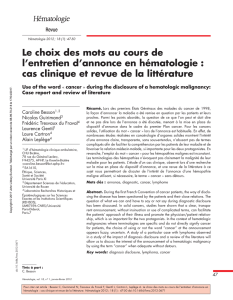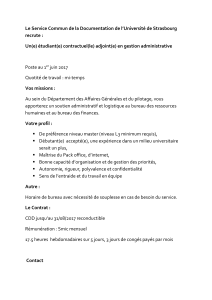13 Sujets divers - John Libbey Eurotext

13
Sujets divers
jlehma00403_cor2.indd 192jlehma00403_cor2.indd 192 2/25/2009 6:57:30 PM2/25/2009 6:57:30 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

193
Hématologie, n° spécial 1, vol. 15, mars 2009
Sujets divers
doi : 10.1684/hma.2009.0325
13-01
Intérêt de hautes doses de corticoïdes suivies
de splénectomie dans le purpura thrombopénique
idiopathique
M. Bradai
1,* ; S.A. Oukrif 2 ; M. Harireche 3 ; Y. Boukhatem 4
1 Service dÊhématologie clinique, Faculté de médecine de
Blida, Blida, Algérie ; 2 Clinique de chirurgie pédiatrique,
Faculté de médecine de Blida, Aucun Résultat, Algérie ;
3 Service de réanimation médicochirurgicale, Faculté de
médecine de Blida, Blida, Algérie ; 4 Service de chirurgie
générale, CHU de Blida, Faculté de médecine de Blida, Aucun
Résultat, Algérie
Introduction
Le traitement du purpura thrombopénique chronique (PTIC)
repose sur la splénectomie (Spc) qui permet dÊobtenir une
correction de la thrombopénie dans 80 % des cas. Le recours
à lÊimmunothérapie (Ig, anti-CD20) est souvent inaccessible à
notre niveau. Les protocoles utilisant les bolus de corticoïdes (BC)
sont prometteurs, mais dont les résultats ne sont pas unanimes
(Andersen JC). La transfusion plaquettaire (CP), souvent inutile,
exigée néanmoins par certaines équipes chirurgicales.
Patients et méthodes
Un total de 43 patients a subi une SPC pour PTIC, repartis
en deux groupes. GI : 23 patients, dÊâge moyen 37 μ 15 ans
(8-64), 14F/9H ; le taux de plaquettes avant la SPC était
21 μ 5 103/øL (14-30). Une transfusion de CP chez 13 (huit
en pré- et cinq en peropératoire). Le GII : 20 patients ont reçu un
BC, dÊâge moyen 37 μ 15 ans, 13F/7F ; le taux de plaquettes
avant lÊinclusion était de 18 μ 10 103/øL (2-36). La dexamé-
thasone est perfusée à raison de 40 mg/j pendant quatre jours,
débutée dix jours avant la Spc, avec surveillance quotidienne :
température (t°), ionogramme, calcémie, glycémie et NFS. Seuls
quatre patients de GII ont subi une Spc sous-laparoscopie.
Résultats
Dans le GII : après BC, le taux de plaquettes passe de
18 μ 10 103/øL (2-36) à 67 μ 32 (15-135), absence de réponse
chez trois patients : thrombopénie familiale (un), thrombopénie
médicamenteuse (un), lymphome splénique (un) [diagnostic
établi sur pièce de la Spc]. Un diabète CTC induit, observé
quatre fois. Une hyperleucocytose, en dehors de toute infection,
a été constante (GB 15 000/øL). Une patiente est décédée dans
un tableau de sepsis. Après la Spc : 11 rémissions complètes
(RC), quatre rémissions partielles (RP), un échec (E). On ne note
aucune complication hémorragique en per- ou postopératoire.
Dans le GI : le taux de plaquettes évalué 72 heures après la
Spc était de 116 μ 57 103/øL. Seul un cas dÊhémorragie de la
plaie opératoire est noté et un décès des suites dÊun abcès sous
phrénique ; 13RC, 6RP, 3E sont obtenus.
Conclusion
Les CTC à hautes doses, non dénués de risque, peuvent être
utilisés en alternative aux immunoglobulines lorsquÊen préopéra-
toire le risque hémorragique est menaçant. Ils peuvent confirmer
la nature auto-immune de la thrombopénie. Toutefois, ils ne
semblent pas améliorer les résultats à long terme de la Spc.
Référence
Andersen J, et al. N Eng J Med 1994 : 15604.
13-02
Motifs dÊadmission aux urgences des patients
atteints dÊhémopathies malignes.
Étude rétrospective du CHU de Limoges
J. Abraham
1,
4,* ; N. Signol 2 ; M.J. Rapp 3,
4 ; V. Truffinet 1,
4 ;
M. Touati
1,
4 ; N. Dmytruk 1,
4 ; E. Kfoury 1,
4 ; O. Chicaud 1,
5 ;
C. Vallejo
2 ; D. Bordessoule 1,
4,
5
1 Service dÊhématologie clinique et thérapie cellulaire, CHU
Dupuytren, Limoges ; 2 Service des urgences, CHU Dupuytren,
Limoges ; 3 Service de médecine interne, Centre hospitalier,
Guéret ; 4 Réseau Hématolim ; 5 Unité de recherche clinique
dÊhématologie
Introduction
Les hémopathies malignes (HM) et leurs traitements sont
responsables de multiples complications pour les patients (pts)
nécessitant souvent une prise en charge urgente. La mission de
continuité des soins est assurée par un numéro téléphonique
dÊurgence vers un médecin dÊastreinte, un numéro vert médical
doublé dÊun numéro infirmier et une éducation thérapeutique
des pts. LÊaccès aux urgences (U) est encore un recours utilisé
par les pts. Ce travail a pour objectif de décrire le profil dÊune
cohorte de pts atteints HM et les motifs de leur admission aux
U en région Limousin.
Patients et méthodes
LÊétude consiste en une analyse descriptive rétrospective des
dossiers de pts HM, contigus, admis aux U du CHU de Limoges
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 à partir des
résumés standardisés de sortie (RSS).
Résultats
Cent soixante-quatorze pts HM, âge moyen 69 ans (19-96),
sex-ratio 1,04, étaient en majorité âgés : 72 % º 65 ans.
LÊorigine géographique est régionale dans 82 % des cas (Haute-
Vienne 67 %, Corrèze 12 %, Creuse 2,3 %) et hors région pour
18,7 %. Les HM se répartissaient en myéloïde 49 % (n = 59),
lymphoïde 47 % (n = 57) et autres. Si 121/174 pts HM étaient
connus du service dÊhématologie (H) soit 69,5 %, le recours
aux U a permis le diagnostic dÊune HM méconnue chez 30,5 %
des pts. Les pts connus étaient en phase palliative 47 %, cura-
tive 26 % et de rechute 9 % (ND 18 %). Soixante-quinze pour
cent des pts étaient adressés par un médecin, 86 % par leur
médecin traitant. Les trois motifs principaux dÊadmission aux U
sont des complications dÊaplasie dans 40 % des cas (syndrome
infectieux 30 % et syndrome hémorragique 10 %), des symp-
tômes sans rapport avec lÊH pour 32 % (dont 21 % de troubles
psychologiques) et des perturbations du bilan biologique pour
28 %. Des signes de gravité nécessitant une prise en charge
urgente concernaient lÊanémie 88 % pts, la neutropénie 47 %
et la thrombopénie 71 %. Suite à leur admission, 91 % des
pts restaient hospitalisés, 9 % retournaient à leur domicile. Un
patient est décédé aux U (0,006 %). Le fait dÊêtre en phase
palliative, curative ou dÊavoir des signes de gravité biologique
nÊest pas un facteur prédictif dÊhospitalisation directe en H
(p = NS). Les pts HM, de 65 ans et plus, sont moins hospita-
lisés directement en H (p = 0,017), illustrant la nécessité dÊune
meilleure adéquation entre les lits des services spécialisés
et ceux à développer dans les structures de suite spécifique
dÊhématogériatrie.
jlehma00403_cor2.indd 193jlehma00403_cor2.indd 193 2/25/2009 6:57:31 PM2/25/2009 6:57:31 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

194
Sujets divers
Hématologie, n° spécial 1, vol. 15, mars 2009
Conclusion
Malgré la mise en place dÊactions préventives, les U demeu-
rent une structure de recours pour les pts HM présentant des
complications sévères qui justifient, avec un ratio élevé, une
hospitalisation via les U. Ce travail se poursuivra par un
renforcement de la formation continue des médecins traitants,
notamment par la rédaction dÊun guide thérapeutique face
aux HM.
13-03
Lymphome hodgkinien primitif du poumon :
à propos dÊun cas
R. Ben Lakhal
1,* ; R. Fehri 1 ; K. Kacem 1 ; L. Aissaoui 1 ;
R. Ben Amor
1 ; W. Bouteraa 1 ; R. Jeddi 1 ; Z. Belhadjali 1 ;
H. Ben Abid
1 ; S. Chatti 2 ; B. Meddeb 1
1 Service dÊhématologie clinique, Hôpital Aziza-Othmana,
Tunis, Tunisie ; 2 Service dÊanatomie pathologique, Hôpital de
Nabeul, Nabeul, Tunisie
Introduction
Le lymphome hodgkinien primitif (LHP) du poumon est une entité
rare mais distincte, dont le diagnostic clinique est difficile vu
quÊil faut exclure formellement une atteinte ganglionnaire.
Cas clinique
Une jeune femme de 24 ans se présente initialement avec un
prurit, une toux sèche et une hémoptysie. La Rx thorax : opacité
alvéolaire paracardiaque droite. Au TDM thoracique : conden-
sation parenchymateuse du lobe supérieur droit et moyen. Elle
a été mise sous traitement antituberculeux mais aggravation des
symptômes avec amaigrissement, fièvre et sueurs nocturnes. Au
TDM thoracique : extension de la condensation bilobaire. La
fibroscopie bronchique ainsi que la biopsie bronchique étaient
négatives. La biopsie pulmonaire chirurgicale révèle une
maladie de Hodgkin type cellularité mixte CD15+, CD30+.
La patiente a eu huit ABVD avec bonne évolution clinique et
radiologique.
Discussion
Le LHP est une entité rare, touchant surtout les femmes avec un
sex-ratio 2/1 et les sujets âgés. LÊatteinte prédomine au niveau
des parties supérieures du poumon. La présence de symp-
tômes B est fréquente. Les manifestations cliniques ne sont pas
spécifiques. Les images radiologiques les plus décrites sont les
nodules, uniques ou multiples et les cavitations.
Les explorations non invasives telles que la biopsie bronchique
ou transcutanée permettent rarement de faire le diagnostic, et
on a souvent recours à la biopsie pulmonaire chirurgicale.
LÊâge supérieur à 60 ans, les symptômes B, lÊatteinte bilatérale
et multilobulaire, lÊatteinte pleurale et les images de cavitation
sont de mauvais pronostic.
Malgré le caractère défavorable du LHP du poumon, la plupart
des patients ont une évolution favorable.
Conclusion
La difficulté diagnostique de cette entité repose sur la négati-
vité des explorations non invasives et la nécessité à la biopsie
chirurgicale.
13-04
Perturbations biochimiques au cours du syndrome
dÊactivation macrophagique de lÊadulte :
étude de dix cas
R. Tagajdid* ; M. Nazih ; M. Chakour ; A. Belmekki ;
N. Messaoudi
Service dÊhématologie biologique, Hôpital militaire
dÊinstruction Mohamed-V, Rabat, Maroc
Introduction
Les manifestations biologiques au cours du syndrome dÊactiva-
tion macrophagique sont à la fois hématologiques et biochi-
miques. Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés
aux perturbations biochimiques accompagnant le SAM chez
dix malades ayant été hospitalisés au service de réanimation
sur une période de deux ans.
Résultats
Paramètres
biochimiques Moyenne
des valeurs
obtenues
Valeurs de
référence Nombre
de patients
ayant une
perturbation
Ferritine (øg/L) 41 340 30300 8
Triglycérides (g/L) 7,82 0,61,5 2
Bilirubine totale (mg/L)
22 010 7
ASAT (U/L) 56 035 8
ALAT (U/L) 60 045 7
Gamma GT (U/L) 75 055 6
Phosphatase alcaline
(U/L) 195 50136 8
LDH (U/L) 605 190430 7
Sodium (mmol/L) 134 136145 5
Urée (g/L) 0,8 0,150,39 4
Créatinine (mg/L) 16 613 3
CRP (mg/L) 65 0,537
Conclusion
Une hypertriglycéridémie, très caractéristique au cours du
SAM, est associée à une augmentation des lipoprotéines de très
basse densité (VLDL) ; la cholestérolémie est normale. LÊhyper-
ferritinémie, parfois considérable, est principalement liée à
lÊaccumulation de la ferritine dans les macrophages survenant
lors de la phagocytose des hématies. Cette hyperferritinémie
constitue actuellement un des signes biologiques caractéristi-
ques de la maladie, comme lÊest lÊhypertriglycéridémie. LÊéléva-
tion de lÊactivité des transaminases est fréquemment rencontrée,
avec une cholestase souvent plus tardive. LÊhyponatrémie est
fréquente.
jlehma00403_cor2.indd 194jlehma00403_cor2.indd 194 2/25/2009 6:57:31 PM2/25/2009 6:57:31 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

195
Hématologie, n° spécial 1, vol. 15, mars 2009
Sujets divers
13-05
Maladie de Gaucher révélée à un âge adulte :
à propos de deux cas
A. Atig ; M. Khalifa* ; N. Ghannouchi ; A. Alaoua ; A. Letaief ;
F. Bahri
Service de médecine interne, CHU Farhat-Hached, Sousse,
Tunisie
Introduction
La maladie de Gaucher est une affection génétique autoso-
mique récessive rare due à un déficit en une enzyme lysoso-
miale, la bêtaglucosidase acide. Le déficit enzymatique conduit
à lÊaccumulation pathologique du substrat non dégradé (gluco-
sylcéramide) dans les lysosomes. Cette surcharge métabolique
est responsable dÊune atteinte multisystémique avec, essentiel-
lement, une hépatosplénomégalie, une anémie, une thrombo-
pénie et une atteinte osseuse. Nous rapportons deux cas de
maladie de Gaucher découverts à un âge adulte.
Observation
La première observation est celle dÊun patient âgé de 21 ans,
issu dÊun mariage non consanguin qui se présente, en 2005,
pour exploration dÊune hépatosplénomégalie et une pancyto-
pénie. LÊexamen clinique a révélé une énorme hépatospléno-
mégalie arrivant jusquÊaux deux fosses iliaques ; le reste de
lÊexamen est sans particularités, en particulier, neurologiques.
¤ la biologie : hémoglobine à 6 g/dL, globules blancs à
2 100 éléments/mm
3
, plaquettes à 13 000 éléments/mm
3
. Le
myélogramme a objectivé la présence de cellules de Gaucher. La
maladie de Gaucher sÊest confirmée par le dosage enzymatique
de la β-glucosidase acide, mais la mutation N370 est néga-
tive. Le dosage de lÊenzyme de conversion de lÊangiotensine et
la ferritinémie sont augmentés. Les investigations nÊont pas mis
en évidence de trouble ventilatoire restrictif, ni atteinte myocar-
dique ou valvulopathie, ni de signes dÊostéopénie ou ostéoné-
crose. Un traitement enzymatique substitutif est en cours. La
deuxième observation est celle dÊune patiente âgée de 27 ans,
se présentant, en 2008, pour exploration dÊune asthénie et
pâleur. LÊexamen clinique nÊa pas mis en évidence de syndrome
tumoral. Les examens biologiques montrent une hémoglobine
à 11,4 g/dL, des globules blancs à 5 300 éléments/mm
3
et une thrombopénie à 51 000 éléments/mm
3
. La moelle est
de richesse moyenne et comprend de nombreuses cellules de
Gaucher. Les dosages enzymatiques confirment la maladie
de Gaucher : lÊactivité de la β-glucosidase acide est basse. La
recherche de la mutation N370S est positive. Elle nÊa pas, par
ailleurs, dÊatteinte neurologique, cardiaque, rénale ou respira-
toire associée.
Conclusion
La maladie de Gaucher est une affection rare. Le dosage de
lÊactivité de la β-glucosidase a constitué un progrès considé-
rable dans la prise en charge des patients. Une surveillance
clinique et biologique stricte est recommandée devant le risque
de survenue dÊhémopathie.
13-06
Prévalence de lÊhémoglobinurie
nocturne paroxystique dans les aplasies
médullaires acquises
N. Ghrairi ; W. Elborgi ; N. Bensalah ; E. Gouider* ;
F. Benlakhal ; R. Hafsia
Laboratoire dÊhématologie, Hôpital Aziza-Othmana, Tunis,
Tunisie
Introduction
LÊhémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) est une maladie
acquise et clonale des cellules souches hématopoïétiques.
LÊassociation entre HPN et aplasie médullaire acquise (AMA)
est largement décrite dans la littérature. LÊobjectif de notre
travail est de déterminer la prévalence du clone HPN au cours
des aplasies médullaires acquises.
Matériels et méthodes
La recherche du clone HPN est réalisée par cytométrie de flux sur
les granuleux en utilisant des anticorps monoclonaux anti-CD66b
et anti-CD16 et sur les monocytes en utilisant les anti-CD14.
Résultats
Notre étude comporte 67 patients. LÊâge moyen est de 26 ans
(1-60) avec un sex-ratio (homme/femme) de 0,80. Dans notre
série, la prévalence du clone HPN au cours des AMA est
de 32 %.
Discussion
Dans la littérature, la prévalence du clone HPN au cours des
AMA varie de 25 à 88 % selon les séries. Dans notre série, la
prévalence est de 26,19 %. Ce résultat est très influencé par les
valeurs seuils de positivité choisies. La cytométrie de flux est,
actuellement, lÊexamen le plus performant dans la détermina-
tion du clone HPN même très minime et indépendamment du
statut transfusionnel du patient.
Conclusion
LÊassociation HPN et aplasie médullaire acquise est fréquente.
Un clone HPN survient souvent soit au diagnostic, soit au cours
de lÊévolution de lÊaplasie médullaire acquise. La recherche du
clone HPN doit être réalisée de façon systématique devant toute
AMA. La recherche du clone HPN pourrait avoir des implica-
tions thérapeutiques et pronostiques.
13-07
Le syndrome dÊactivation macrophagique (SAM) :
à propos de quatre cas
S. Zriba
1,*, K. Kacem
2, R. Abid
1, W. Bouteraa
2, Z. Hattab
1,
F. MÊsadek
1, B. Louzir
1, B. Meddeb
2, S. Othmani
1
1 Service de médecine interne, Hôpital militaire de Tunis, Tunis,
Tunisie ; 2 Service dÊhématologie clinique, Hôpital Aziza-
Othmana, Tunis, Tunisie
Introduction
Le syndrome dÊactivation macrophagique (SAM) est une entité
clinicobiologique caractérisée par lÊexacerbation dÊune réponse
inflammatoire qui résulte dÊun déficit des fonctions cytotoxiques
des lymphocytes T et des cellules NK.
jlehma00403_cor2.indd 195jlehma00403_cor2.indd 195 2/25/2009 6:57:31 PM2/25/2009 6:57:31 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

196
Sujets divers
Hématologie, n° spécial 1, vol. 15, mars 2009
Les étiologies du SAM sont dominées par les infections, les défi-
cits immunitaires et les hémopathies.
Patients et méthodes
Nous rapportons quatre observations de SAM colligées dans
un service de médecine interne et un service dÊhématologie
clinique.
Le SAM est retenu selon les critères dÊImashuku 1997.
Résultats
Patient Étiologie Sexe ˜ge
(ans) PNN
(/mm3)Hb
(g/dL) PLQ
(/mm3)Ferritinémie (øg/L) Évolution
1 LLC M 70 100 7,5 4 000 46 000 DCD
2 MDH M 21 600 6,2 114 000 2 300 DCD
3 Sepsis F 85 800 6,1 18 000 2 243 DCD
4 MDH M 59 900 6,7 14 000 16 500 Vivant
VZV 1 200 6,8 54 000 44 500
Discussion
Le diagnostic repose actuellement, outre les signes cliniques et
biologiques habituels, sur des critères en rapport direct avec la
physiopathologie à savoir une activité natural killer diminuée
ou absente et lÊaugmentation du taux du CD25.
Le spectre des pathologies associées à ce syndrome est
extrêmement large et le tableau clinique est dominé par les
manifestations secondaires à lÊhypersécrétion de cytokines
pro-inflammatoires.
Conclusion
LÊincidence du SAM est largement sous-estimée.
La mortalité reste importante malgré un traitement qui repose
essentiellement sur des substances immunosuppressives et
immunomodulatrices.
Références
Costello R, et al. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Hémato-
logie, 13-012-G-10, 2007.
Arceci RJ. Curr Opin Hematol 2008 : 35967.
13-08
Le mastocyte : une cellule peu connue
N. Messaoudi
1,* ; K. Doghmi 2 ; M. Chakour 3 ; R. Taghgdid 3 ;
A. Jeadi
3 ; A. Belmekki
3 ; M. Naji 3
1 Laboratoire central dÊhématologie, Hôpital militaire
dÊinstruction Mohamed-V, Rabat, Maroc ; 2 Service
dÊhématologie clinique, Hôpital militaire dÊinstruction
Mohamed-V, Rabat, Maroc ; 3 Laboratoire dÊhématologie,
Hôpital militaire dÊinstruction Mohamed-V, Rabat, Maroc
Introduction
Les mastocytes (MC) sont des cellules du tissu conjonctif qui
contiennent des granulations cytoplasmiques métachromati-
ques. Décrits pour la première fois par Paul Ehrlich en 1878,
leur nom provient de mästen qui veut dire engraisser, nourrir.
Ils sont caractérisés par ses granulations et ses récepteurs de
haute affinité pour les IgE. Ils prennent naissance au niveau de
la moelle osseuse et sont considérés actuellement comme des
cellules hématologiques à part entière, constituant une lignée
différente de celle des polynucléaires basophiles.
orangé par le bleu alcian à pH acide. Cette identification est
difficile en cas de dégranulation spontanée ou provoquée par
une agression mécanique. Leur mise en évidence est possible
après coloration par le bleu de toluidine à pH moins acide ou
après fixation de lÊacridine orange qui lui donne une fluores-
cence rouge orangé en lumière ultraviolette. Ces granulations
ont des aspects très divers, homogènes, granulaires, lamellaires
ou hélicoïdaux [13]. La recherche histochimique de certaines
activités enzymatiques intracellulaires peut aider à lÊidentifica-
tion du mastocyte telle lÊactivité naphtol ASD chloracétate estéra-
sique, présente également dans les granulocytes neutrophiles et
éosinophiles ; lÊactivité aminocaproate estérase plus spécifique
et des activités chymase, tryptase ou carboxypeptidase. Elles
jouent un rôle fondamental dans lÊimmunité innée plus particuliè-
rement dans les processus inflammatoires et allergiques.
Conclusion
Le mastocyte est une cellule rare et peu connue. Il est souvent
pris pour un polynucléaire basophile dont il doit être distingué.
CÊest une cellule qui doit être mieux connue par les hémato-
logistes, car lÊinfiltration médullaire par les MC constitue un
critère majeur pour le diagnostic des pathologies liées à cette
cellule.
Références
Arock M, et al. Ann Biol Clin 2004 : 65769.
Escribano L, et al. Ann Hematol 2002 : 67790.
13-09
Les cytopénies profondes au cours de lupus
érythémateux systémique
A. Alaoua ; M. Khalifa* ; A. Atig ; N. Ghannouchi ; A. Letaief ;
F. Bahri
Service de médecine interne, CHU Farhat-Hached, Sousse,
Tunisie
Introduction
LÊatteinte hématologique au cours de lupus érythémateux systé-
mique est fréquente (27-81 %), néanmoins peu dÊétudes se sont
intéressées aux cytopénies profondes. Le but de ce travail est
de déterminer la prévalence des anomalies hématologiques
Observation
Le MC est une cellule mononucléée de 8 à 20 øm de diamètre, de
forme variable (ronde, ovalaire, polygonale ou fusiforme) avec
un gros noyau rond central, un nucléole mal individualisé et un
cytoplasme basophile rempli de très nombreuses granulations
denses de 0,3 à 1,5 øm. LÊidentification du mastocyte repose
essentiellement sur la mise en évidence de la métachromie de
ces granulations colorées en violet par le Giemsa et en rouge
jlehma00403_cor2.indd 196jlehma00403_cor2.indd 196 2/25/2009 6:57:31 PM2/25/2009 6:57:31 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%