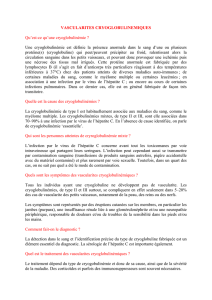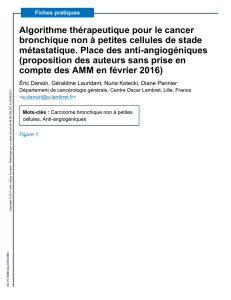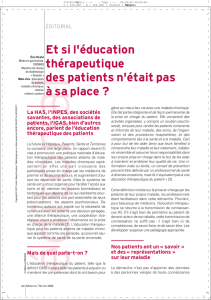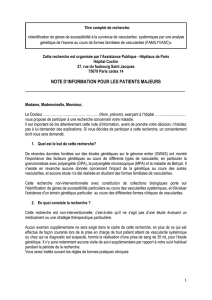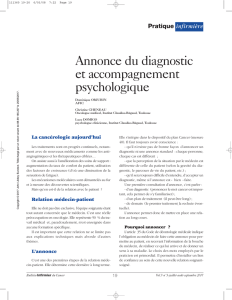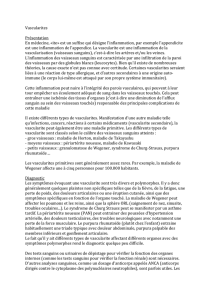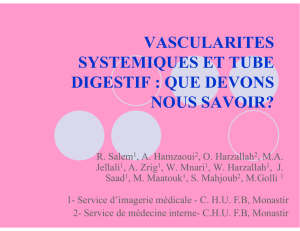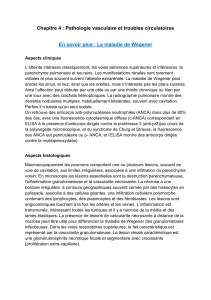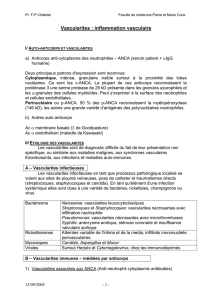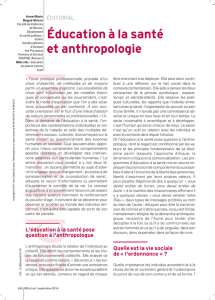Manifestations digestives des maladies systémiques

Mise au point
Manifestations digestives
des maladies systémiques
Gérard Gay
1
, Jean-François Roche
1
, Valérie Laurent
2
,
Muriel Frédéric
1
, Michel Delvaux
1
1
Unité de médecine interne à orientation digestive et métabolique, Hôpitaux de Brabois
adultes, CHU de Nancy, Allée du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
2
Département de radiologie, Hôpitaux de Brabois adultes, CHU de Nancy, Allée du Morvan,
54511 Vandœuvre-lès-Nancy
Les maladies systémiques sont habituellement séparées en deux groupes, les connectivites et
les vascularites. Les manifestations digestives sont de fréquence et de nature variées, souvent
peu spécifiques tout en pouvant révéler la maladie. La sclérodermie représente une entité à
part, où les signes digestifs plus spécifiques occupent le devant de la scène clinique et font
partie des éléments évocateurs du diagnostic. Les manifestations digestives des maladies
systémiques posent des problèmes difficiles aussi bien lorsque la maladie est connue, par leurs
significations (complication iatrogène ou spécifique, nouvelle poussée), que lorsqu’elles sont
inaugurales. Elles nécessitent une approche pluridisciplinaire et bénéficient des progrès de
l’immunologie et des nouvelles techniques d’exploration, notamment de l’intestin grêle
(capsule vidéoendoscopique, entéroscopie double-ballon), véritable « terra incognita » de
l’interniste.
Mots clés :maladie systémique, manifestation digestive, connectivité, vascularite
Généralités
Les maladies systémiques regrou-
pent des affections très hétérogènes
dont les caractéristiques communes
sont :
–des symptômes qui affectent des
organes multiples,
–des anomalies biologiques et
immunologiques,
–une évolution progressive vers la
chronicité,
–une sensibilité aux immunosup-
presseurs pour certaines.
Pour une meilleure compréhen-
sion, il est habituel de séparer les
maladies systémiques en deux grands
groupes [1, 2] : les connectivites ou
collagénoses où prédomine l’atteinte
du tissu conjonctif, et les vascularites
où l’inflammation des vaisseaux asso-
ciée à plus ou moins de nécrose est sur
le devant de la scène. Des mécanis-
mes physiopathologiques se retrou-
vent à des degrés divers dans chacun
de ces deux groupes d’affections : pro-
duction anormale et dérégulation de
la synthèse du collagène pour les col-
lagénoses, troubles de la perméabilité
vasculaire ou thrombose, ischémie tis-
sulaire pour les vascularites, produc-
tion anormale de protéines ou de
cytokines, anomalies de l’immunité
humorale et cellulaire aboutissant à
des phénomènes inflammatoires
retrouvées dans les deux groupes avec
parfois des lésions musculaires (atro-
phie, fragmentation). Le tableau clini-
que final associe dysfonction vascu-
laire et endothéliale, atteinte
musculaire et neurologique, en parti-
culier au niveau du tractus digestif
(figure 1).
Les manifestations
digestives
La fréquence des manifestations
digestives des maladies de système est
m
t
Tirésàpart:G.Gay
doi: 10.1684/met.2007.0086
mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 171
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

variable, notamment dans les cas de vascularites
(tableau 1) [3]. Les symptômes digestifs interpellent à la
fois le médecin interniste et le gastroentérologue. Le clini-
cien doit s’interroger sur la signification de ces manifesta-
tions et répondre à trois questions :
–s’agit-il d’une manifestation inaugurale ou d’une
nouvelle poussée de la maladie lorsqu’elle est connue ?
–est-on devant le témoin clinique d’une complication
iatrogène ?
–enfin, s’agit-il d’une complication spécifique de
l’affection ?
Pour essayer de répondre à ces trois questions, nous
nous proposons :
–de rappeler les éléments pertinents de l’interroga-
toire, de l’examen clinique et les éléments significatifs du
bilan biologique qui caractérisent une maladie systémi-
que ;
–d’exposer les éléments nouveaux des examens com-
plémentaires qui sont maintenant disponibles dans ce
cadre nosologique ;
–de préciser les tableaux réalisés par les manifesta-
tions digestives les plus fréquentes rencontrées au cours de
chaque maladie systémique avec les caractères particu-
liers qui s’y rattachent ;
–avant de proposer une attitude pratique en présence
des symptômes digestifs que la maladie systémique soit
connue ou non.
Les points-clés de l’interrogatoire
et de l’examen clinique
Les symptômes les plus fréquemment retrouvés en cas
de connectivite ou de vascularite sont peu spécifiques à
l’exception de la sclérodermie où souvent ils occupent
une place centrale et révélatrice de la maladie. Ils asso-
cient le plus souvent des diarrhées, des hémorragies diges-
tives, des douleurs abdominales et des signes péritonéaux.
Pour chaque symptôme, le tableau 2 indique la lésion
rencontrée et la maladie systémique à laquelle il est le plus
souvent associé [4].
Dans ce contexte d’urgence abdominale ou à l’opposé
de douleurs abdominales chroniques, l’interrogatoire doit
être minutieux à la recherche d’antécédents de transfu-
sions sanguines (viroses), de voyage, d’addictions
(cocaïne, amphétamines), de facteurs de risque cardiovas-
culaires et de prises médicamenteuses (ergotamine et déri-
vés, AINS) dans le but d’éliminer ce qui n’est pas une
vascularite. L’examen clinique sera complet et systémati-
que, appareil par appareil, après avoir recherché des
signes généraux : fièvre, perte de poids, asthénie. La pré-
sence de signes extradigestifs sera susceptible d’orienter le
diagnostic : anomalies cutanées (urticaire systémique,
purpura), signes neurologiques (mononeuropathie, trou-
bles sensitifs), douleurs arthromusculaires, atteintes uro-
néphrologiques (orchite, hématurie, HTA), signes respira-
toires ou ORL (sinusite ou rhinite traînante, otite, toux,
asthme, hémoptysie), péricardite, syndrome de Raynaud,
sans oublier la recherche parfois difficile et subjective d’un
syndrome sec (xérodermie, xérophtalmie, sécheresse
muqueuse).
Glossaire
PAN : périartérite noueuse
PR : polyarthrite rhumatoïde
SCS : syndrome de Churg et Strauss
GW : granulomatose de Wegener
SLE : sclérodermie
ACR : American College of Rheumatology
ARA : American Rheumatism Association
Atrophie
dysfonction
musculaire
Vascularites
Lésions
vasculaires
Ischémie
Connectivites
Troubles de
la motricité
PAN
SLE
Figure 1. Physiopathologie des maladies systémiques.
Ta b l e a u 1 .Fréquence des manifestations digestives au cours des
vascularites et connectivites. D’après Müller-Ladner modifié [3]
Type de la vascularite Fréquence de la localisation digestive
A. Vascularites primitives
PAN 30-50 %
Syndrome de Churg-Strauss 25-50 %
Maladie de Behçet Jusqu’à 30 %
Artérite de Takayasu Jusqu’à 15 %
Granulomatose de Wegener 5-10 %
Granulomatose
lymphomateuse
1,5 %
Maladie de Horton 1 %
Purpura de Henoch-Schönlein 50-90 %
B. Vascularites secondaires
Lupus systémique
érythémateux
Jusqu’à 50 %
Polyarthrite rhumatoïde Jusqu’à 10 %
C. Connectivites
Sclérodermies 75-90 %
Lupus (en dehors des
manifestations de vascularite)
25 %
Mise au point
mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007
172
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Explorations complémentaires
Les points-clés des examens biologiques
Les examens biologiques de routine comportent un
hémogramme (recherche d’une éosinophilie, d’une neu-
tropénie), des tests inflammatoires (VS, PCR), le dépistage
d’une protéinurie et d’une hématurie, sans oublier le
dosage des CPK. Une infection sera éliminée par une
uroculture, des hémocultures en cas de fièvre ; des séro-
logies compléteront le bilan pour détecter une hépatite B
et C, HIV et, en fonction du contexte clinique, une mala-
die de Lyme ou encore une bacillose.
Un premier bilan immunologique recherchera une
anomalie des protéines, du complément (C3, C4, CH 50),
une cryoglobulinémie, la présence du facteur rhumatoïde
et des anticorps antipeptide citrulliné. Leurs perturbations
ne sont cependant pas spécifiques.
Apport nouveau de ces dix dernières années, la recher-
che d’anticorps anti-cytoplasmes de polynucléaires neu-
trophiles (ANCA) en immunofluorescence ou par
méthode Elisa orientera vers une vascularite spécifique
(Wegener, Churg et Strauss...). On distinguera les ANCA
donnant une fluorescence cytoplasmique (cANCA) dont
la cible est presque toujours une sérine protéine de 29
Kda, la protéinase 3 (PR3), des pANCA à fluorescence
périnucléaire dont la cible est la myéloperoxydase, mais
aussi d’autres enzymes (élastase, lactoferrine). Les ANCA
doivent être dosés en même temps que les anticorps
antinucléaires (AAN), avec lesquels ils peuvent être
confondus. Les ANCA accompagnent le plus souvent la
maladie de Wegener, la polyangéite microscopique, le
syndrome de Churg et Strauss et la glomérulonéphrite
nécrosante focale sans dépôt d’immunoglobulines, défi-
nissant le groupe des vascularites ANCA-positives.
Quoique discuté, leur intérêt dans le suivi évolutif est
certain [5].
Des AAN dirigés contre des antigènes nucléaires solu-
bles (anti-ENA-extractible nuclear antigen) sont spécifi-
ques de la sclérodermie, anticentromère dans les formes
limitées (Crest syndrome), anti-topoisomérase ou anti scl
70 dans les formes diffuses. Les anti-DNA sont associés au
lupus systémique (anti DNA natif, test de FARR).
Les points-clés et nouveaux des examens
morphologiques
Investigations radiologiques
Elles se résument actuellement à trois grands groupes,
les opacifications barytées n’ayant plus qu’une place mar-
ginale face aux performances de l’imagerie moderne :
examens morphologiques par ultrasons, examens scanno-
graphiques, angioscanner ou par résonance magnétique
nucléaire (IRM), angio-IRM. L’artériographie garde une
place dans l’exploration des hémorragies par rupture
d’anévrisme si elle est associée à une procédure interven-
tionnelle, l’angioscanner étant l’examen privilégié lors de
l’étape diagnostique. Les examens seront hiérarchisés en
fonction des renseignements recherchés, en particulier
dans les vascularites :
–angioscanner ou angioIRM, doppler, artériographie
permettant de visualiser les modifications endoluminales
des vaisseaux (sténoses, thromboses...) ;
–scanner et IRM, artériographie pour les modifica-
tions pariétales (anévrisme...) ;
–le scanner en urgence est l’examen-clé des compli-
cations des vascularites digestives : perforations, isché-
mie, hémorragies (figure 2).
Endoscopies digestives
L’œsogastroduodénoscopie et l’iléocolonoscopie
explorent de façon performante les lumières digestives et
visualisent, en urgence ou de manière différée, les consé-
quences endoluminales des vascularites ou des connecti-
vites, ainsi que leurs complications. La nouveauté vient de
la possibilité d’explorer l’intestin grêle, souvent mis en
cause dans les vascularites ou les maladies systémiques
grâce à l’introduction dans les années 2000 de la capsule
vidéoendoscopique (VCE) [6] puis de l’entéroscopie dou-
ble ballon plus près de nous en 2004 [7]. Ces examens
permettent une étude complète de l’intestin grêle. Les
lésions élémentaires retrouvées tout le long du tractus
digestif associent saignement digestif aigu ou chronique,
Tableau 2.Symptômes cliniques, lésions sous-jacentes, maladie la plus
fréquemment concernée. D’après [4] modifié
Douleurs
abdominales
Ischémie. Perforation du grêle PAN
Cholécystite aiguë PAN
Pancréatite vasculaire PAN, Wegener
Appendicite inflammatoire
et par ischémie
PAN
Infarctus hépatiques,
spléniques, rénaux
PR
Ulcérations gastriques
iatrogènes (AINS...)
Diarrhées Malabsorption PAN
Entéropathie exsudative PR
Ischémie mésentérique
Hémorragies
digestives
(hématémèse,
mélaena)
Ulcères de stress Toutes vascularites
Lésion iatrogène
Ischémie. Rupture de
microanévrismes sous-
muqueux
Hémopéritoine Rupture d’anévrismes
sur les vaisseaux
hiliaires hépatiques,
spléniques, rénaux
PAN
Hémorragies
rétropéritonéales
Churg et Strauss
Hématomes
intraparenchymateux
ou sous-capsulaires
Infarctus parenchymateux PAN
Rupture de microanévrismes Churg et Strauss
Wegener
mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 173
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

conséquences de rupture d’anévrisme ou de phénomènes
ischémiques, des ulcérations secondaires à des phénomè-
nes ischémiques ou à des processus iatrogènes, des
aspects de faux polypes ou encore de sténoses pourront
être également retrouvées. Ces manifestations, en particu-
lier les saignements digestifs chroniques, seront surtout
rencontrées dans des vascularites responsables d’ulcéra-
tions segmentaires et d’ischémies, en particulier purpura
de Henoch-Schönlein et maladie de Churg et Strauss
(figure 3).
Intérêt et limites de l’histologie
Pratiquement toutes les localisations des maladies sys-
témiques sont accessibles à la biopsie per-endoscopique
ou guidée à l’aiguille fine lors d’un examen scanographi-
que ou échographique : peau, reins, foie, poumons, artè-
res ou tractus gastrointestinal (figure 4). Plus aléatoire est
le rendement diagnostique car les biopsies n’intéressent
par voie endoscopique que le versant muqueux et peuvent
être négatives ou non contributives. Elles ne sont pas
toujours obligatoires pour affirmer un diagnostic, compte
tenu des avancées de l’immunologie dans nombre de
critères diagnostiques, et ne doivent pas retarder une
thérapeutique en cas de péril vital.
Manifestations digestives
des vascularites primitives :
les aspects spécifiques
De l’utilité des classifications
Les vascularites primitives ont fait l’objet de nombreu-
ses classifications, les plus récentes intégrant les acquis de
l’immunologie. La classification de Lie [1] et la nomencla-
ture de Chapel Hill [2] sont les plus utilisées et les plus
pertinentes actuellement pour le clinicien (tableau 3). Ces
classifications utilisent essentiellement des critères histo-
logiques (calibre des vaisseaux, nature de l’atteinte vascu-
laire, présence d’un granulome), cliniques et étiologiques.
Il faut actuellement ajouter les critères immunologiques
pour les vascularites touchant les vaisseaux de petit et
moyen calibre, avec la présence ou non d’anticorps anti-
cytoplasmes de polynucléaires neutrophiles (ANCA)
(figure 5) [8].
Elles ont cependant leurs limites et, si elles donnent au
médecin une trame diagnostique et permettent un langage
commun pour les études d’efficacité thérapeutique, elles
ne doivent pas être utilisées de manière aveugle pour faire
un diagnostic. Un malade donné peut échapper à toute
classification avec toutefois des éléments caractéristiques
le rattachant à tel ou tel syndrome, ceci en particulier dans
le domaine digestif. Enfin, les atteintes veineuses sont
difficiles à classer, notamment la maladie de Behçet dont
l’expression digestive est fréquente (entéro-Behçet).
Enfin rappelons que face à un tableau évoquant une
vascularite, il est important d’éliminer une vascularite
secondaire (infection, affection maligne, prises médica-
menteuses...) ou une affection simulant une vascularite :
syndrome des antiphospholipides, embolies de cholesté-
rol par exemple.
Figure 2. Investigations morphologiques. Première ligne : scanner
IRM, angioscanner, angio-IRM. Deuxième ligne : Echo + Doppler,
Echocardiographie. Troisième ligne : Artériographie.
Figure 3. A) Purpura rhumatoïde : ischémie de la paroi intestinale
avec ulcérations et hémorragie en entéroscopie. B) Maladie de
Churg et Strauss atrophie, lésions purpuriques témoignant d’un
processus ischémique au niveau du jéjunum en vidéocapsule
endoscopique.
Figure 4. Les biopsies peuvent être réalisés sur différents orga-
nes : peau, rein, poumon, foie, tractus digestif, artères.
Mise au point
mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007
174
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Vascularites des vaisseaux de gros calibre
Maladie de Takayasu
Vascularite granulomateuse touchant l’aorte, ses bran-
ches de division et les artères pulmonaires, elle affecte les
femmes de moins de 40 ans. Elle est responsable de sté-
noses et occlusions entraînant le classique syndrome de la
femme sans pouls, mais également la constitution d’ané-
vrismes. Le diagnostic est clinique et radiologique [9].
L’atteinte de l’aorte abdominale, isolée ou associée à
l’atteinte de la crosse et de ses branches, type 2 et 3, se
caractérise par un épaississement adventiciel fibreux res-
ponsable de sténoses étagées et d’ischémie, d’anévris-
mes ; la thrombose complète et la rupture anévrismale
demeurent rares. L’atteinte cœliaque et mésentérique est
constatée dans 6,5 à 18 % des cas. À côté des manifesta-
tions d’angor abdominal, des cas de malabsorption et de
fibrose rétropéritonéale ont été décrits [10]. L’angio-IRM a
supplanté l’artériographie pour le diagnostic précoce,
visualisant les altérations des parois artérielles : sténoses,
occlusions et anévrismes. Le traitement repose sur les
anticoagulants et les antiagrégants, la corticothérapie et
les immunosuppresseurs (méthotrexate) à la phase aiguë.
L’angioplastie se discutera sur les sténoses symptomati-
ques à la phase séquellaire.
Maladie de Horton
Deuxième variété d’artérite granulomateuse touchant
l’aorte et ses branches de divisions, elle atteint préféren-
tiellement les femmes de plus de 60 ans, avec une prédi-
lection pour le réseau carotidien externe et l’artère tempo-
rale. Outre les céphalées, la baisse de l’état général, la
fièvre et la palpation d’une induration temporale, la
nécrose de langue est une manifestation digestive évoca-
Tableau 3.Classification des vascularites. D’après [1] et [2] modifiées
Vascularites primitives :
Vaisseaux de gros, moyen et petit calibre :
– Maladie de Takayasu
– Maladie de Horton
– Artérite granulomateuse du système nerveux central
Vaisseaux de moyen et petit calibre :
– Périartérite noueuse
– Syndrome de Churg et Strauss
– Granulomatose de Wegener
Vaisseaux de petit calibre :
– Polyangéite microscopique
– Purpura rhumatoïde
– Vascularites leucocytoclasiques cutanées
Autres vascularites primitives :
– Maladie de Buerger
– Syndrome de Cogan
– Syndrome de Kawasaki
Vascularites secondaires :
Infections, médicaments, affections malignes, transplantés.
Cryoglobulinémie mixte essentielle ou liée au virus de l’hépatite C.
Vascularites associées aux connectivites.
Déficits en complément.
Affections simulant une vascularite :
Malformations aortiques (coarctation...).
Syndrome des antiphospholipides.
Embolies de cholestérol.
Embolies du myxome de l’oreillette.
Ergotisme.
Neurofibromatose.
Maladie d’Ehlers-Danlos.
Calcifications artérielles idiopathiques.
Small-Vessel Vasculitis
(e.g., microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis)
Medium-Sized-Vessel Vasculitis
(e.g., polyarteritis nodosa, Kawasaki's disease)
Large-Vessel Vasculitis
(e.g., giant-cell arteritis, Takayasu's arteritis)
Aorta
Arteries
Arteriole
Capillary
Venule
Goodpasture's syndrome
Isolated cutaneous LCA
Henoch-Schönlein purpura and cryoglobulinemic vasculitis
Microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis, and Churg-Strauss syndrome
Vein
ANCA -
ANCA +
Figure 5. Profil immunologique des vascularites primitives, modifiée d’après la référence [8].
mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 175
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%