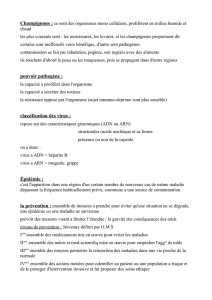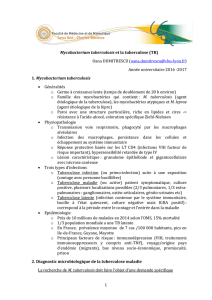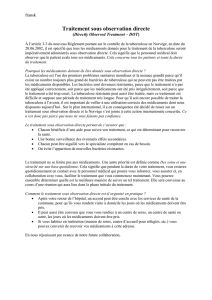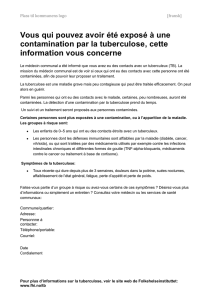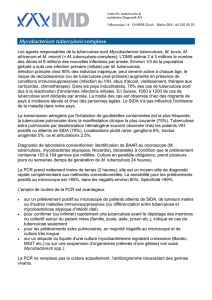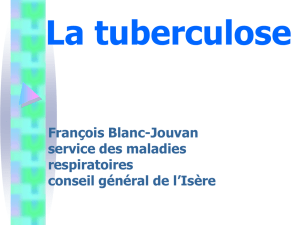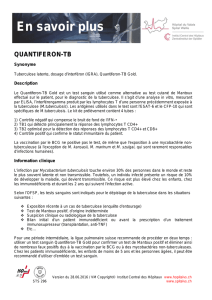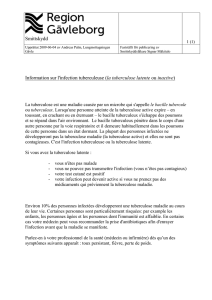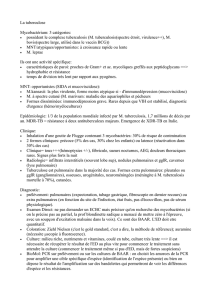Tuberculose uro-génitale

La tuberculose uro-génitale est, comme toutes les autres formes de
tuberculose, secondaire à une infestation par une bactérie du genre
mycobacterium. L’espèce la plus fréquente est mycobactérium
tuberculosis mais mycobactérium bovis, agent de la tuberculose
bovine, peut aussi être virulent chez l’homme (environ 5% des cas
de tuberculose humaine). Enfin des lésions rénales tuberculeuses
ont aussi été rapportées après instillations intravésicales de bacille
de Calmette-Guérin. Les bactéries du complexe mycobactérium
tuberculosis sont toutes pathogènes et doivent être différenciées des
autres espèces de mycobactérium dites atypiques et que l’on retro-
uve dans la nature, en particulier dans l’eau, qui sont saprophytes
mais qui, dans certains cas peuvent, chez les sujets immuno-dépri-
més en particulier, être pathogènes chez l’homme. Ces souches non
pathogènes pour l’homme sont retrouvées dans l’eau et pour certai-
nes chez l’animal (mycobactérium avium chez les oiseaux et
volailles). Elles peuvent contaminer l’urèthre et les organes géni-
taux externes. Elles sont de ce fait souvent isolées dans des échan-
tillons urinaires.
La tuberculose est une maladie fréquente, en augmentation crois-
sante, en particulier du fait de l’infection à VIH. On estime à 8 à 10
millions par an les nouveaux cas de tuberculose dans le monde [2].
Le plus souvent, il s’agit d’une forme pulmonaire. Parmi les attein-
tes non pulmonaires, la tuberculose uro-génitale est la plus fré-
quente, responsable de 14 à 41% des atteintes extra-pulmonaires.
MODE DE DISSEMINATION
La tuberculose urogénitale peut faire partie d’une infection dissé-
minée ou être localisée uniquement au tractus urogénital.
Le rein est très souvent infecté lors d’une tuberculose miliaire, le
plus souvent au niveau du cortex rénal.
En cas de tuberculose localisée au tractus urogénital, le rein est en
règle infecté par voie hématogène à partir d’une infection pulmo-
naire. Le plus souvent, lors du diagnostic de la lésion urogénitale, il
n’y a plus de symptôme de tuberculose pulmonaire active, bien que
dans un tiers des cas on puisse mettre en évidence des lésions radio-
logiques témoignant d’une infection ancienne. Cela suggère que
l’infection rénale résulte de la réactivation d’une tuberculose quies-
cente. Cliniquement les lésions sont très souvent unilatérales mais
les études post-mortem ont montré la grande fréquence de lésions
bilatérales. Au niveau du rein, elles sont préférentiellement situées
dans la médullaire ou elles vont produire des granulomes épithé-
lioïdes avec une nécrose caséeuse aboutissant à une destruction tis-
sulaire. L’atteinte des cavités pyélocalicielles est à l’origine d’une
pyélonéphrite tuberculeuse qui peut aboutir à une lésion pyoné-
phrotique avec destruction du rein qui prend un aspect mastic. Dans
25% des cas il existe des calcifications au sein de ce rein mastic.
L’infection se propage par voie rétrograde dans les uretères puis la
vessie avec des lésions granulomateuses muqueuses et musculaires
aboutissant à des cicatrices fibreuses. Au niveau de l’uretère cela
aboutit à des sténoses irrégulières avec des dilatations sus-jacentes
pouvant aboutir à une destruction secondaire du rein. Les trois
quarts des tuberculoses vésicales sont associées à une infection
rénale bien que dans quelques cas elles puissent être secondaires à
la dissémination d’une lésion génitale.
Après instillation locale intravésicale de BCG, une cystite aiguë
mycobactérienne est très fréquente. Parfois, on peut avoir une dis-
sémination et des atteintes urétérales ont été observées dans 0,3%
des cas d’une large série [4]. L’atteinte rénale est plus rare, estimée
à0,1% sur cette série de 2602 patients. Elle est probablement plus
en rapport avec une infection ascendante qu’une dissémination
hématogène. Histologiquement les lésions secondaires au BCG ne
sont pas différenciables de celles observées lors d’une tuberculose
classique et il peut exister du caséum au sein de la lésion.
Enfin, rappelons que 10% des cas de tuberculoses dans le monde en
1999 sont survenus chez des patients infectés par le V.I.H. Dans les
régions d’endémie, ce pourcentage peut atteindre 60%. La tubercu-
lose était à l’origine du décès de 30% des 3 millions de patients
morts du SIDA en 1999.
DIAGNOSTIC D’UNE TUBERCULOSE UROGENITALE
Outre des symptômes liés à la distension rénale en cas d’atteinte
urétérale, le plus souvent la tuberculose va se présenter clinique-
ment sous la forme d’une cystite banale. Le diagnostic est évoqué
devant une pyurie sans germe. En cas de lésion génitale, les lésions
touchent fréquemment l’épididyme se traduisant par une épididy-
mite. Environ 50 à 75% des hommes avec une atteinte génitale ont
des anomalies radiologiques au niveau de l’appareil urinaire.Un
bilan radiologique de tout l’appareil urinaire (uro-scanner) est tou-
jours indiqué ainsi qu’une radiographie du thorax à la recherche
d’une localisation pulmonaire [7].
DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE
Il est fait par isolement de la bactérie dans les urines ou sur une
biopsie. Des bacilles acido-alcoolo-résistants peuvent être re-
trouvés. S’il existe peu de mycobactéries, il faut éliminer une infec-
tion par des mycobactéries atypiques non pathogènes ayant conta-
miné l’urèthre distal.
Des techniques d’amplification nucléaire par PCR peuvent être uti-
lisées pour mettre en évidence l’ADN mycobactérien.Elles sont
◆
LEPOINT SUR... Progrès en Urologie (2005), 15, 602-603
Tuberculose uro-génitale
Jad WATFA, Frédéric MICHEL
Service de Chirurgie Urologique-Andrologie, Hôpital du Bocage, Dijon, France
602
Manuscrit reçu : juillet 2005, accepté : juillet 2005
Adresse pour correspondance : Dr. F. Michel, Service de Chirurgie Urologique-Androlo-
gie, Hôpital du Bocage, 21079 Dijon Cedex.
e-mail : [email protected]
Ref : WATFA J., MICHEL F. Prog. Urol., 2005, 15, 602-603

moins sensibles que la culture mais très spécifiques. Il existe des
sondes pour identifier les colonies.[1]
TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE URO-GENITALE
Les traitements actuels de la tuberculose sont efficaces dans toutes
les formes cliniques de la tuberculose. Ils reposent sur un traitement
initial de deux mois, intensif, utilisant quatre drogues (RIFAMPI-
CINE, ISONIAZIDE (INH), PYRAZINAMIDE et ETHAMBU-
TOL). Ce traitement est suivi par quatre mois de traitement allégé
necomportant plus que RIFAMPICINE et ISONIAZIDE, dans le
but d’éliminer les bacilles “dormants” intracellulaires [2]. Il est
important que le traitement soit suivi sérieusement, sans aucune
interruption, la principale cause d’échec étant une mauvaise obser-
vance. :Les formes associées : Rifater®(rifampicine + pyrazinami-
de + INH) et Rinifah®(rifampicine + INH) facilitent cette obser-
vance. La durée du traitement sera supérieure à 6 mois en l’absen-
ce de pyrazinamide (9 mois) ou en cas de résistance,d’intolérance
ou de mauvaise observance [3] (supérieur ou égal à 1 an de traite-
ment après négativation des cultures).
Il existe une augmentation importante du nombre de bacilles multi-
résistants à la RIFAMPICINE et à l’ISONIAZIDE avec ou non, une
résistance aux autres drogues. Dans ces cas le traitement nécessite
l’utilisation d’un minimum de quatre drogues choisies en fonction
de l’antibiogramme qui est systématique. On peut, selon le résultat
de cet antibiogramme utiliser des quinolones, (Ofloxacine®,Spar-
floxacine®, Moxifloxacine®)de nouveaux macrolides (Clarithromy-
cine), l’acide Para-Amino-Salicylique, des aminosides (Streptomy-
cine,Amikacyne), la Cyclosérine, la Capreomycine, l’Ethionamide
la Thiacétazone. Elles sont moins efficaces et souvent plus toxiques
que les traitements de première intention. La durée du traitement
repose sur la réponse bactériologique. Il peut être de 18 mois ou
plus après la négativation des cultures. La sélection de mutants
résistants est toujours secondaire à des monothérapies intempesti-
ves, consécutives d’une mauvaise prise en charge (mauvaise obser-
vance, rupture de stock, combinaisons inappropriées)
En cas d’insuffisance rénale la streptomycine et les autres aminosi-
des doivent être évités si possible.
L
’encéphalopathie est une complication peu fréquente de l’Isoniazi-
de. Elle en règle prévenue par la prescription de Pyridoxine.
La Rifampicine accroît le métabolisme d’un grand nombre de dro-
gues, en particulier les corticoïdes, le ketoconazole, la cyclosporine
et le tacrolimus qui sont souvent prescrits chez les transplantés. Il
faut alors surveiller régulièrement les concentration de cyclospori-
nes et de tacrolimus. Elle expose au risque d’inhibition des contra-
ceptifs oraux. Chez les patients H.I.V. positifs, le traitement anti-
rétro-viral interfère parfois avec la rifampicine. Il est recommandé
de donner plutôt de la Rifabutine et la durée du traitement doit être
allongée à 9 mois.
Sur le plan chirurgical, une intervention est indiquée en cas de
lésion unilatérale avancée cliniquement symptomatique ou en cas
de petite vessie scléreuse nécessitant une plastie d’agrandissement.
L
’ablation d’un rein non fonctionnel asymptomatique ou d’une
lésion caséeuse dans un rein partiellement fonctionnel reste contro-
versée. Par contre, il est préconisé de lever une obstruction urétéra-
lepar une sonde JJ ou une néphrostomie per-cutanée si le rein est
fonctionnel avec une épaisseur corticale correcte et une clairance de
la créatinine supérieure à 15 ml/mn [5, 6]. L’adjonction de corticoi-
des les premières semaines du traitement est également controver-
sée. La Rifampicine réduisant fortement leur biodisponibilité de
fortes doses sont nécessaires.
Le traitement de la tuberculose secondaire à des mycobactéries
environnementaux n’est nécessaire que chez un sujet immuno-
déprimé . Il dépend de la sensibilité in vitro du germe.
Rappelons que la tuberculose est une maladie à déclaration obliga-
toire auprès de la DDASS, qui doit être signalée au Conseil Géné-
ral (chargé de l’enquête dans l’entourage) et qui est prise en charge
à100%. L’isolement n’est nécessaire avec port de masque pour le
malade et le personnel soignant les 15 premiers jours du traitement
que si le patient est bacillifère (examen direct positif des crachats)
L’entourage doit être dépisté et la recherche d’une infection par le
VIH systématique (tuberculose et VIH = SIDA).
REFERENCES
1. EICHBAUM Q., RUBIN E.J. : Tuberculosis. Advances in labatory diagnosis
and drug susceptibility testing. Am. J. Clin. Pathol., 2002 ; 118 : S3-17.
2. FRIEDEN T.R., STERLING R., MUNSIFF S., WATT C.J., DYE C. : Tuber-
culosis. The Lancet, 2003 ; 362 : 887-899.
3. GOKCE G., KILICARSLAN H., AYAN S., TAS F., AKAR R., KAYA K.,
GULTEKIN E.Y : Genito urinary tuberculosis : a review of 174 cases.
Scand. J. Infect. Dis., 2002 ; 34 : 338-340.
4. LAMM D.L. : Complications of Bacille-Guerin immunotherapy. Urol. Clin.
North. Am., 1992 ; 19 : 565-572.
5. RAMANATHAN R., KUMAR A., KAPOOR R., BHANDARI M. : Relief
of urinary tract obstruction in tuberculosis to improve renal function. Analy-
sis of predictive factors. Br. J. Urol., 1998 ; 81 : 199-205.
6. SHIN K.Y., PARK H.J., LEE J.J., PARK H.Y., WOO Y.N., LEE T.Y : Role of
earlyendourologic management of tuberculous ureteral strictures. J. Endo-
urol., 2002 ; 16 : 755-758.
7. WANG L.J., WU C.F., WONG Y.C., CHUANG C.K., CHU S.H., CHEN C.J.
: Imaging findings of urinary tuberculosis on excretory urography and com-
puterized tomography. J. Urol., 2003 ; 169 : 524-528.
Jad Watfa et Frédéric Michel, Progrès en Urologie (2005), 15, 602-603
603
____________________
1
/
2
100%