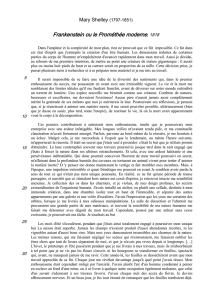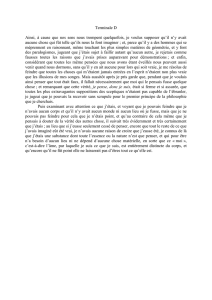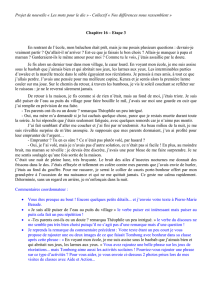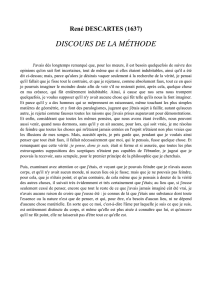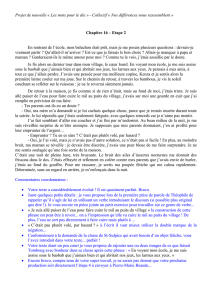Cazaudebat Valentin Passé décomposé Encore une fois, je venais

Cazaudebat
Valentin
Passé décomposé
Encore une fois, je venais de me piquer. La substance fluide se répandait dans mon sang
bouillant et je sentais l’apaisement se répandre au fur et à mesure que je décrochais de cette réalité
nauséabonde. Le monde était devenu gris depuis cet instant. Chaque jour, que je me trouve dans ces
dédales de béton brut ou dans cette nature déchirée, je me sentais isolé, las de survivre. Les gens me
tournaient le dos, leur regard se distanciait de ce vieux débris d’un autre temps que j’étais devenu,
mal rasé, coiffé à l’arrachée, vestige d’un passé mal géré, conséquence de cet événement qui m’avait
fait perdre pied petit à petit au gré de mes consommations. Plus rien ne me rattachais à ce que je
désignais par « ça ». Les jeunes qui erraient sans but dans les rues, vénérant Mark Zuckerberg, cet
homme qui leur avait offert une seconde vie dénuée de corporéité matérielle faisant d’eux des dieux
à temps partiel. En retour, il les aimait comme Staline aimait son peuple autrefois. Maintenant,
l’amour durait trois mois, couples désassortis singeant la passion enflammée pour une idylle en CDD
avant de revendre son alliance bon marché pour acheter le dernier album à la mode d’un artiste aux
sonorités électroniques insignifiantes qui faisait tout pour ressembler à son voisin. Pendant ce temps,
le peuple se foutait sur la gueule pour choisir une royauté anémique, menteuse et voleuse à assoir
sur le trône de notre démocratie dictatoriale. Les gens, au mieux s’ignoraient, au pire se flinguaient
pour une couleur de peau, de maillot, élire le plus beau du gay ou de l’hétéro ou d’autres vagues
idéaux. J’étais spectateur de ce foutoir indémêlable qui ressemblait de plus en plus à une publicité
déguisée pour le suicide assisté.
Revenons-en à ce shoot que je savoure qui augmente l’attention et fait tomber la pression. Je
ferme les yeux et rêve, revois, revis ce temps où insouciant, je connaissais le bonheur et la liberté
toute relative qui m’habitait. Mes souvenirs se teintent de couleurs inodores, un monde indolore où
la haine et la peine s’évaporent. J’aperçois cette tour dans laquelle je logeais paisiblement. Je me
rappelle de ce temps passé à découper et coller des bandes de cassettes pour faire des montages
sonores que j’écoutais en regardant la télé à laquelle j’avais ôté le son et je me marrais. Avec elle. Le
mot-clé est « elle ». Depuis le lycée, nos seize ans ou à peu près, on faisait la paire, on vivait empris
d’une conscience inaltérée de notre existence vouée à s’avouer nos secrets, à savourer les potions
secrètes que nos corps sécrètent. Puis un jour, sans que j’en connaisse la raison, elle m’avait invité
sur cette falaise au bord de l’eau. J’avais amené le pique-nique et le temps que je retourne chercher
à la voiture la gnole qui enivrerait notre après-midi, elle ne représentait plus qu’un point rouge au
milieu de l’étendue aquatique où elle était allée se noyer volontairement. C’est à ce moment-là que
j’avais perdu la couleur, ma vie s’était ternie, souillée par ces cinquante nuances de gris qui
m’avaient enlevé mon paradis. Je m’étais tatoué son portrait, sa forme sur mon bras à l’aide d’une
aiguille et d’un peu d’encre mais ce vague dessin ne suffisait pas à la ramener. Alors, depuis, j’avais
trouvé ce moyen : je me piquais, l’encre en moins et je revivais, l’espace de quelques instants,
subrepticement, cette liaison interrompue teintée de bleu, de vert, de toutes les couleurs de
l’univers.
1
/
1
100%