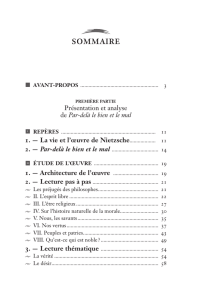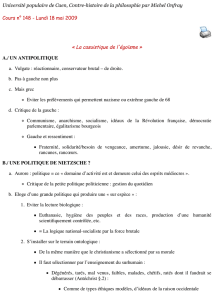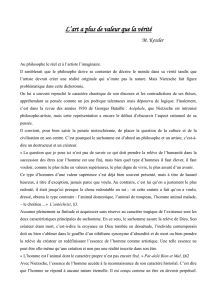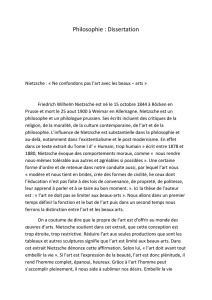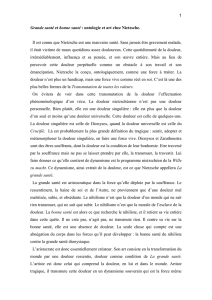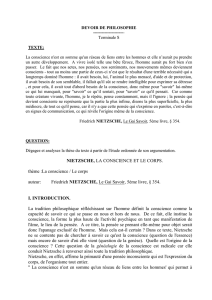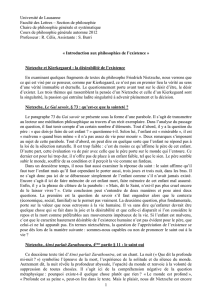La gaya scienza - Hotel Silberstein


Friedrich Nietzsche
Œeuvres
Préface
par Patrick Wotling
Le Gai Savoir
Traduction par Patrick Wotling
Ainsi parlait Zarathoustra
Traduction par Geneviève Bianquis, revue par Paul Mathias
Par-delà bien et mal
Traduction par Patrick Wotling
Généalogie de la morale
Traduction par Éric Blondel, Ole Hansen-Løve, Théo Leydenbach et Pierre Pénisson
Le Cas Wagner
Traduction par Henri Albert
Le Crépuscule des idoles
Traduction par Henri Albert
L'Antéchrist
Traduction par Éric Blondel
Ecce Homo
Traduction par Éric Blondel
Nietzsche contre Wagner
Traduction par Éric Blondel

Le Gai Savoir, © Flammarion, 1997.
Ainsi parlait Zarathoustra, © Aubier, 1969, Flammarion, 1996.
Par-delà bien et mal, © Flammarion, 2000.
Généalogie de la morale, © Flammarion, 1996.
L'Antéchrist, © Flammarion, 1994.
Ecce Homo, © Flammarion, 1992.
Nietzsche contre Wagner, © Flammarion, 1992.
ISBN : 2082125424

Table de matières

Préface
« Ce que je raconte est l’histoire des deux siècles prochains. Je décris ce qui vient, ce qui ne peut plus
venir d’une autre manière : l’avènement du nihilisme. »
Fragments posthumes, tome XIII, 11 [411].
La carrière intellectuelle de Nietzsche est toute de paradoxes : philologue de formation, venu à la
philosophie après avoir rompu avec la philologie ; professeur prenant rapidement ses distances à
l’égard de l’enseignement ; philosophe allemand en rupture de ban avec sa patrie, répétant
inlassablement son regret d’écrire en allemand à une époque où ses compatriotes se détournent du
monde de la pensée pour s’adonner à un débordement de passion politique qu’il condamne ; penseur
substituant l’écriture aphoristique à la logique discursive ou systématique, modes d’organisation que
privilégie traditionnellement le discours philosophique… tels sont quelques-uns des traits qui rendent
son parcours atypique ; le destin de sa pensée et celui de ses textes ne seront pas moins singuliers.
Ainsi qu’on vient de l’indiquer, Nietzsche est d’abord philologue, c’est-à-dire spécialiste des
langues et des littératures grecque et latine ; dès l’époque de ses études à l’université de Leipzig, ses
travaux philologiques sont remarqués et jugés si prometteurs qu’il se voit offrir la chaire de philologie
classique de l’université de Bâle sans avoir encore soutenu de thèse, promotion spectaculaire qui ne
manquera pas de susciter des rancœurs.
Puis survient le coup d’éclat de son entrée en scène philosophique : la publication en 1872 de La
Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique : texte incompris, interprété par la plupart
des lecteurs comme un manifeste wagnérien, texte dont il semblera se détacher les années suivantes,
mais auquel, en réalité, il reviendra constamment pour l’éclaircir, en particulier dans une préface
ajoutée en 1886 à cette première œuvre, et jusque dans ses dernières notes posthumes de 1888…
Ce geste inaugural est à lui seul très révélateur de ce que sera l’exigence intellectuelle de
Nietzsche : car il exprime, plutôt qu’un simple désintérêt, une profonde insatisfaction face au travail
philologique où pourtant Nietzsche excelle, mais dans lequel il voit de plus en plus une activité
aveugle, technicienne, qui néglige de s’interroger sur l’essentiel, à savoir le sens : le sens de la culture
grecque, en d’autres termes ce qui fait que les Grecs constituent un modèle ; mais sitôt passé au
domaine de la réflexion fondamentale, il éprouve une égale insatisfaction à l’égard de la démarche
philosophique et ressent la nécessité d’une réforme profonde de ses modes d’investigation —
exigence qui se déploie dans tous ses textes ultérieurs. Certes, l’« état de guerre » n’est pas une
nouveauté chez les philosophes : la tradition philosophique tout entière vit de ces contestations et de
ces reprises réformantes ; mais celle que Nietzsche s’apprête à instaurer, et qui se laisse deviner dès
La Naissance de la tragédie, se caractérisera par son extraordinaire radicalité. Sans doute n’y a-t-il
guère que Hegel qui ait tenté de réformer aussi profondément le mode de pensée propre à l’activité
philosophique, selon une direction et des objectifs, il est vrai, tout à fait autres que ceux de Nietzsche.
L’une des grandes originalités de la situation de Nietzsche tient donc à cette constitution de sa
pensée à partir d’un terrain qui n’est pas celui de la tradition philosophique ni de son enseignement :
Nietzsche n’est pas un technicien de l’histoire de la philosophie — les commentateurs ont eu beau jeu
de signaler depuis longtemps la fragilité de sa connaissance des textes philosophiques, modernes en
particulier ; mais cela même traduit pour une part l’originalité de son approche : c’est d’emblée dans
une réflexion sur la culture, au sens large, que s’enracine sa pensée, ce qui explique que cette réflexion
se nourrisse aussi bien de la méditation sur les événements contemporains — la guerre franco-
prussienne et les effets entraînés sur la vie intellectuelle en Allemagne par la victoire de la Prusse et
l’unification politique, par exemple ; ou l’orientation prise par l’enseignement universitaire et,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%