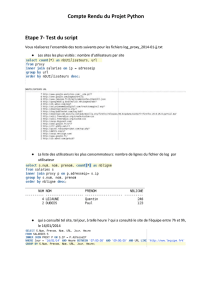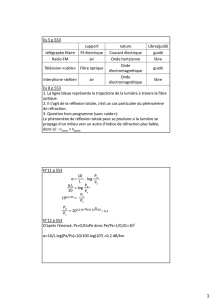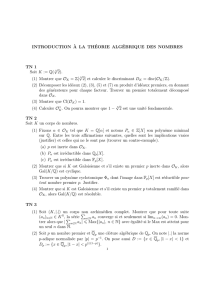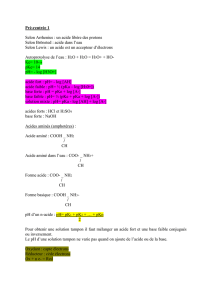Économie publique/Public economics

public economics
économiepublique
Revue de l’Institut d’Économie Publique
Deux numéros par an
no6– 2000/2


économiepublique sur internet : www.economie-publique.fr
©Institut d’économie publique – IDEP
Centre de la Vieille-Charité
2, rue de la Charité – F-13002 Marseille
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment
par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans
une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et
de quelque manière que ce soit.
La revue économiepublique bénéficie du soutien du Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur
ISSN 1373-8496

IDEP
INSTITUT D'ECONOMIE PUBLIQUE
Capital humain
et croissance : la littérature
empirique à un tournant ?
Marc Gurgand∗
Centre d’études de l’emploi et Crest (Insee)∗∗
1 Introduction
Il semblait acquis depuis les années 1960, mais sur la base d’exer-
cices essentiellement comptables, que la croissance du capital humain
était une composante importante de la croissance économique et que
celui-ci avait par conséquent une place légitime dans la fonction de pro-
duction agrégée. Ce résultat, pourtant conforme à l’intuition, semble
remis en cause par un ensemble de contributions empiriques récentes.
L’examen du rôle du capital humain dans la croissance est en effet re-
venu à l’ordre du jour à l’occasion du débat sur la convergence des
économies. Le modèle de Solow, dans lequel le moteur de la croissance
est le progrès technique, commun à toutes les économies, prédit une
convergence internationale des revenus par tête. Or cette prédiction
est peu conforme aux faits, ce qui légitimerait les modèles, en quelque
sorte concurrents, de croissance endogène. En 1992, Mankiw, Romer
et Weil montrent pourtant qu’il est possible d’amender le modèle clas-
sique de Solow en introduisant le capital humain aux cotés du capital
physique : cette version du modèle semble alors compatible avec les
données.
Par cette voie, le capital humain est donc redevenu un élément clef
et un enjeu important de la littérature sur la croissance économique.
Des efforts ont été développés pour constituer des bases de données
∗L’auteur tient a` remercier Jules Nyssen, Pierre Granier et un rapporteur anonyme pour leurs
commentaires sur une version ante´rieure de ce texte.
∗∗ Centre d’e´tudes de l’emploi et Crest. Adresse : 29, promenade Michel Simon, 93166 Noisy-le-
Grand cedex; [email protected].
2000 / 2 Économie publique 71

Marc Gurgand
internationales de stock de capital humain. Surtout, un ensemble d’au-
teurs ont estiméde nombreuses spécifications avec diverses méthodes,
pour tester la robustesse des résultats de Mankiw, Romer et Weil. On
cherchera ici àdémêler cette littérature et àclarifier autant que pos-
sible le débat en distinguant les classes de modèles et les types de
méthodes économétriques utilisés par les uns et les autres et en com-
parant et discutant les hypothèses retenues dans les différentes ap-
proches. Nous montrerons que cette littérature, qui se donne pour ob-
jectif d’estimer un effet de l’éducation sur la croissance commun àtous
les pays, est incapable de démontrer empiriquement l’existence d’une
relation positive. Quelques auteurs suggèrent toutefois que les ren-
dements de l’éducation sont probablement trèshétérogènes; ils sont
peu nombreux, mais leurs résultats sont prometteurs. Ils alimentent
l’idée selon laquelle la productivitédu capital humain est, plus que
celle d’un autre facteur, sensible àl’environnement économique. Il y
alànon seulement un enjeu théorique –puisqu’il est important de
pouvoir démontrer que le capital humain peut avoir des effets sur la
croissance –mais aussi un enjeu considérable de politique économi-
que:l’investissement en capital humain ne serait vraiment rentable
que dans certaines circonstances.
Nous nous limitons ici àla présentation des recherches les plus
significatives : il ne s’agit pas de proposer une bibliographie complète
mais de mettre en lumière les principaux arguments. Pour la clartéde
la présentation, il nous arrivera également de fragmenter les contribu-
tions d’un même article lorsque celui-ci procède par étapes en utilisant
tour àtour différentes spécifications. Enfin, il est entendu que le terme
de capital humain recouvre en général d’autre notions que la seule sco-
larisation (l’expérience, la formation continue ou encore la santé). Dans
la littérature macroéconomique, cependant, il désigne principalement
l’éducation (plus rarement la santé), aussi retiendrons-nous ce terme
de manière conventionnelle.
Nous rappelons d’abord la structure du modèle néoclassique de
croissance (section 2) avant de présenter les différentes spécifications
qui ont étéutilisées dans la littérature et les résultats empiriques
qu’elles ont permis d’obtenir (section 3). Nous discutons ensuite les
problèmes strictement économétriques soulevés par ces estimations
(section 4) puis nous présentons les quelques travaux qui permettent
peut-être de sortir de l’impasse oùse trouve la littérature (section5)
avant de conclure (section 6).
72 Économie publique 2000 / 2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%