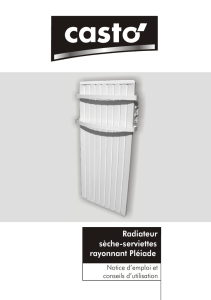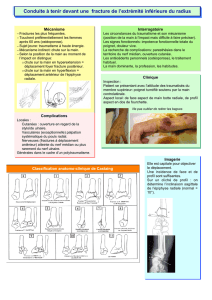AK1987_14_3_109-114

Ann. Kinésithér., 1987, t. 14, nO 3, pp. 109-114
©Masson, Paris, 1987 CONDUITE A TENIR DEVANT ...
\
[
Kinésithérapie après fixation externe suivant Hoffmann
A. JOSZ
Licenciée en kinésithérapie. Service d'Orthopédie Traumatologie (Prof F. Burny) Cliniques Universitaires de Bruxelles, Hôpital Erasme,
Bruxelles
Notre but est de présenter les possibilités
kinésithérapiques offertes après traitement par
fixateur externe et de proposer un schéma de
rééducation pour les lésions des membres
supérieurs et inférieurs.
La fixation externe consiste àréaliser la
contention d'une fracture, d'une arthrodèse ou
d'une articulation luxée, en prenant appui sur
l'os par des fichespercutanées ancrées àdistance
du foyer lésé. La solidarisation des fiches (ou
groupes de fiches) est assurée par une ou
plusieurs barres, extérieures aux téguments
(fig. 1).
Le fixateur de Hoffmann est constitué de
fiches, d'étaux et de barres droites ou coudées
(fig. 2). La fixation «élastique» est adaptée à
la lésion, ce qui autorise une mobilité' interfrag-
mentaire relative (Burny et al., 1978). Ceci
explique les micromouvements et les craque-
ments parfois perçus lors de la mobilisation. La
stabilité mécanique du montage adapté àla
configuration de la fracture permet la mobilisa-
tion immédiate de toutes les articulations, le
lever précoce et éventuellement, la mise en
charge. Ces trois éléments favorisent la préven-
tion des troubles trophiques, de l'ankylose
articulaire et de l'atrophie musculaire.
Le matériel permet la suspension du membre
pour diminuer l'œdème, faciliter le retour
veineux et la résorption de l'hématome. La (les)
barre(s) rend(ent) la manipulation du membre
aisée.
Tirés à part: A. Josz, 44, av. Kamerdelle, 1180 Bruxelles.
1. Rééducation
La rééducation a pour but de récupérer la
mobilité articulaire et la souplesse du membre.
Le conflit entre fiches et masses musculaires est
parfois responsable d'une relative limitation des
mouvements.
Nous envisageons un traitement en deux
phases : rééducation immédiate et rééducation
secondaire.
1.1. RÉÉDUCA nON IMMÉDIATE
La rééducation immédiate vise àrécupérer et
àentretenir le contrôle segmentaire et global du
membre, àle réintégrer dans sa fonction de
stabilité et de locomotion pour le membre
inférieur, dans sa fonction de préhension pour
le membre supérieur. Elle consiste en une
mobilisation passive (ou active aidée) des arti-
culations voisines de la lésion et en «l'entre-
tien » musculaire de tout le membre.
La rééducation immédiate doit être atraumati-
que, non agressive, mais toujours conduite avec
fermeté, ayant pour but la mobilisation sponta-
née du membre.
1.2. RÉÉDUCA nON SECONDAIRE
Nous appelons rééducation secondaire, la
mobilisation d'une articulation après son pon-
tage par fixateur externe.
Les conséquences de l'immobilisation arti-
culaire prolongée sont:

110 /. ,no Kin ésithér. ,1987, t. 14, n° 3
FIG. 1. - Fixation externe d'une fracture de tibia.
- une dégénérescence cartilagineuse suite à
l'absence de glissement des surfaces, facteur de
«nutrition» du cartilage, à la réduction des
variations de contraintes et à l'insuffisance de
brassage de la synovie;
- une ostéoporose due à la diminution de
sollicitation mécanique du support osseux;
- une rétraction et un accolement des plans
capsulo-ligamentaires et synoviaux;
- une atrophie musculaire (perte du volume, de
la souplesse, de l'élasticité, de la vitesse de
contraction) due à l'absence de stimulation
nerveuse et à la stase vasculaire;
- une réduction_ de la vascularisation de
l'articulation;
- une diminution de la proprioceptivité (Sohier,
1982).
Dès l'accord du chirurgien, nous procédons
quotidiennement à la libération de l'articula-
tion : après desserrage des étaux et enlèvement
de la barre de fixation (fiches en place), nous
commençons la mobilisation de l'articulation.
En fin de séance, la contention est rétablie par
serrage de la barre. 'La position d'immobilisation
FIG. 2. - Matériel de Hoff.mann.
de l'articulation variera en fonction du gain
d'amplitude, lors de chaque séance de kinésithé-
rapie. Après accord du chirurgien, l'articulation
sera totalement libérée.
Le traitement débute par une phase de
mobilisation passive qui vise à récupérer les
amplitudes articulaires et rétablit la sensation
de mobilité.
- La mobilisation passive consiste en :
CI massage péri-articulaire et musculaire des
différentes structures, à visée circulatoire et
assouplissante, sous forme de décollements,
d'étirations transversales, de ponçages et de
massages à la glace, si nécessaire;
CI décoaptation articulaire par manœuvres de
dégagement de l'interligne (tractions longitudi-
nales douces, lentes, rythmées et répétées) ;
• mouvements sous traction, de petite ampli-
tude;
• techniques de facilitation neuromusculaire
pour lutter contre les tensions musculaires
(Kabat).
La mobilisation passive doit être indolente,
ne pas déclencher de contractures réflexes. Le
contrôle visuel de la mobilisation passive fait
prendre conscience au patient de ses possibilités
et facilite sa collaboration.
- La mobilisation active, seconde phase du
traitement, entretient l'amplitude récupérée et
redonne au patient la sensation de travail et de
relâchement musculaire.

- La dernière phase concerne le renforcement
des différents groupes musculaires stabilisateurs
des articulations.
- La progression du traitement est adaptée à
chaque patient.
2. Kinésithérapie adaptée à la lésion
Nous proposons un schéma de traitement
suivant la localisation anatomique des lésions,
tout en citant les complications possibles.
2.1. MEMBRE INFÉRIEUR
, 2.1.1. Le fémur
Le montage recommandé dépend de la locali-
sation de la lésion. En principe, le demi-cadre
est à rejeter, sauf chez les enfants.
Lors du montage en triangle, les fiches
proximales sont placées au travers des muscles
crural et droit antérieur, les fiches distales
transfixient les condyles (fig. 3).
Lors d'un montage en cadre, les fiches
proximales transfixient les muscles vaste interne,
vaste externe et le fascia lata, les fiches distales
traversent les condyles. Le chirurgien terminera
l'intervention par une flexion extension du genou
pour dilacérer les muscles transfixiés, dans le
sens des fibres, et ainsi créer un plan de
mouvement.
La kinésithérapie commence par une mobili-
sation passive:
fi massage périarticulaire des structures cap-
sulo-ligamentaires et tendineuses;
• massage de décollement et d'étirations trans-
versales du quadriceps;
• mobilisation de la rotule;
• mouvements de flexion-extension sous trac-
tion pour dégager les surfaces articulaires et
faciliter les mouvements de roulement glisse-
ment entre le fémur et les ménisques.
Un travail sur attelle électrique complète le
traitement en permettant une triple flexion pas-
sive du membre. Le patient conduit et contrôle
à la demande la flexion-extension du genou.
Ann. Kin ésithér. ,1987, t. 14, n° 3 111
FIG. 3. - Montage en triangle pour fracture du fémur distal.
Nous poursuivons la revalidation par une
mobilisation active de la hanche, du genou et
de la cheville et nous terminons par la muscula-
tion visant à une récupération du quadriceps et
un entretien global du membre. La possibilité
de verrouillage du genou autorise la technique
de musculation suivant Delorme.
L'absence de récupération de la flexion du
genou est la principale complication rencontrée
et nécessite parfois une mobilisation sous nar-
cose. Plus qu'à la transfixion des muscles par
les fiches, il semble que le traumatisme initial
soit le plus souvent responsable de la raideur
articulaire (Van Roye, 1983).
2.1.2. Le tibia
Les broches du fixateur externe sont placées
à la face antéro-interne du tibia; il n'y a en
principe pas d'obstacle anatomique majeur à leur
mise en place (Burny et al., 1979).
La mobilisation passive vise à maintenir la
souplesse de toutes les articulations du pied par
des étirations transversales et longitudinales du
tendon d'Achille, des manœuvres de désimpac-
tion de la cheville, la mobilisation du pied et
de l'avant-pied.
La mobilisation active intéresse le genou, la
cheville (inversion-éversion) et les orteils.
La musculation de la cheville est un travail
global axé sur la récupération de la flexion
dorsale, la contraction synergique des extenseurs
des orteils, du jambier antérieur et de l'extenseur

112 Ann. Kinésithér., 1987, t. 14, n° 3
FIG. 4. - Semelle anti-équin.
propre du gros orteil. C'est aussi un travail
analytique stimulant le jambier antérieur et les
péroniers latéraux. La contraction élective per-
met d'interroger chaque muscle de la cheville.
La déformation du pied en équin et la
limitation du mouvement de flexion dorsale de
la cheville sont les complications rencontrées.
Une semelle plâtrée est utilisée pour y remédier
(fig. 4). Dès l'appui autorisé, nous travaillons
le déroulement du pied lors de la marche (El
Banna, 1980).
2.1.3. La cheville
Les indications de fixateur pontant la cheville
sont:
- les fractures ouvertes du pilon tibial
- les pseudarthroses infectées
- les arthrodèses
Les broches proximales sont placées dans le
tiers inférieur du tibia, les broches distales
transfixient le calcanéum (fig. 5).
Nous réalisons une mobilisation passive de
l'avant-pied et des orteils,. une mobilisation
active du genou et des orteils, une musculation
des extenseurs des orteils, de l'extenseur du gros
FIG. 5. - Fixateur externe d'une fracture de cheville.
orteil et un entretien global du membre. La
rétraction des fléchisseurs des orteils avec
affaissement de l'avant-pied doit absolument être
évitée.
Quelle que soit la lésion du membre inférieur
le lever du patient, avec ou sans appui, se fait
suivant avis médical et dépend souvent de
l'évolution radiologique.
2.2. MEMBRE SUPÉRIEUR
2.2.1. L'humérus
Les indications du fixateur externe au niveau
de l'humérus sont (fig. 6) :
- les fractures diaphysaires;
- certaines fractures du col chirurgical;
- les pseudarthroses infectées ou non.
Les fiches proximales sont externes, trans-
deltoïdiennes, les broches distales sont posté-
rieures, transtricipitales. Comme pour le genou,
le chirurgien réalise une flexion-extension du
coude en fin d'intervention pour faciliter la
mobilisation. Dans une fracture de la palette
humérale (où une fixation interne est souvent
associée) ou pour une luxation du coude,
l'immobilisation se réalise ~.lr fixation huméro-
cubitale, les mouvements de pro-supination sont
autorisés.
La mobilisation passive débute par un travail
de désimpaction et par des mouvements pendu-

FIG. 6. - Fixateur externe d'une fracture d'humérus.
laires de l'épaule pour dégager l'articulation.
Nous réalisons des étirements lents, progressifs
et répétitifs des structures péri-articulaires, et
des mouvements de glissement des surfaces
articulaires l'une par rapport àl'autre.
La mobilisation active de l'épaule ne débute
que lorsque l'amplitude de «passage »située
entre 80 et 120 degrés est récupérée. Nous
contrôlons la mobilité du coude, du poignet et
de la main.
La musculation viseà l'entretien de la ceinture
scapulaire, et intéresse tous les muscles travail-
lant dans les mouvements de l'épaule.
Un déficit de l'extension du coude et l'affaisse-
ment accompagné d'un enroulement de l'épaule
sont àsurveiller.
Le déficit de mobilité a été précisé par Burny
et al. (1980, 1984) et Hinsenkamp et al. (1984).
2.2.2. L'avant-bras
L'attitude du service, basée sur une étude de
plus de 100 cas, est de traiter systématiquement
Ann. Kinésith ér., 1987, t. 14, n° 3 113
FIG. 7. - Contraintes anatomiques
au niveau de l'avant-bras proximal.
les fractures d'avant-bras par fixateur externe
par Van Poelvoorde (1983) et Andrianne et al.
(1984).
Lors d'une fracture de radius, les broches
proximales transfixient les muscles épi-
condyliens (fig. 7), lesbroches distales respectent
les espaces intermusculaires et tendineux. Làrs
d'une fracture de cubitus, il n'y a pas d'obstacle
anatomique, l'os étant sous-cutané sur toute la
longueur.
La mobilisation passive est réalisée par des
désimpactions du poignet, des tractions axiales
et translations antéropostérieures au niveau des
articulations radiocarpienne et médiocarpienne
et une mobilisation radiocubitale inférieure.
Nous demandons une mobilisation active
globale du membre. La musculation consiste
surtout àtravailler la force de préhension.
Les fonctions les plus atteintes sont l'inclinai-
son radiale et la prosupination (Tableau 1).
Lors d'une fracture des deux os de l'avant·
bras, une barre anti-rotatoire entre le fixateur
du radius et du cubitus améliore la stabilité du
montage au cours du premier mois : les
mouvements de prospination ne sont pas permis.
 6
6
1
/
6
100%



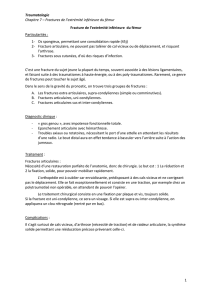
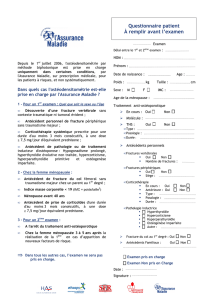


![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)