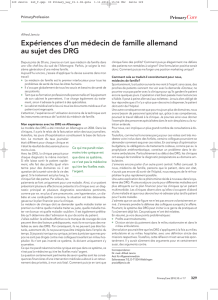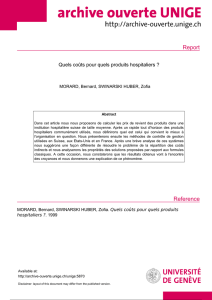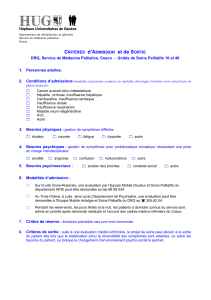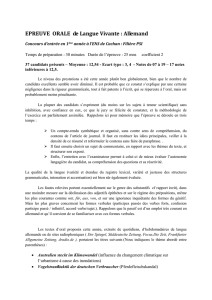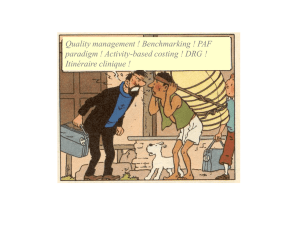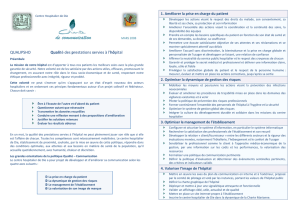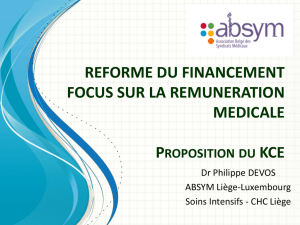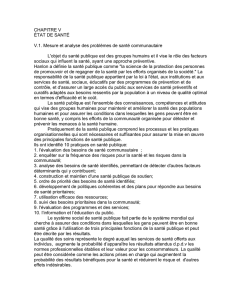Quels coûts pour quels produits hospitaliers?

L’Expert-comptable suisse 1-2/00 41
PRATIQUE COMPTABLE
Dans cet article, nous nous proposons de calculer les
prix de revient des produits dans une institution hos-
pitalière suisse de taille moyenne. Après un rapide tour
d’horizon des produits hospitaliers communément
utilisés, nous définirons quel est celui qui convient le
mieux à l’organisation en question. Nous présenterons
ensuite les méthodes de contrôle de gestion utilisées en
Suisse, aux Etats-Unis et en France. Après une brève
analyse de ces systèmes, nous suggérerons une façon
différente de résoudre le problème de la répartition des
coûts indirects et nous analyserons les propriétés des
solutions proposées par rapport aux formules classi-
ques. A cette occasion, nous constaterons que les ré-
sultats obtenus vont à l’encontre des croyances et nous
donnerons une explication de ce phénomène.
Bernard Morard, Zofia Swinarski Huber
Quels coûts pour quels produits
hospitaliers?
Le secteur de la santé face au besoin d’information en matière de coûts
Introduction
Nous vivons à une époque où plus per-
sonne n’échappe à la compétition et à
la recherche de la rentabilité. Baisse
des coûts, efficacité, qualité sont des
mots d’ordre qui unissent les préoccu-
pations des dirigeants des entreprises
de tout secteur. Le secteur de la santé
et tout particulièrement les établisse-
ments hospitaliers n’échappent pas à
ces impératifs. Face à la raréfaction des
ressources affectées au secteur de la
santé, le gestionnaire doit introduire
des contraintes de gestion; or, la nature
de l’activité médicale rend sa tâche bien
complexe. Pour commencer, il faut dé-
finir le produit final qui sort de la
«chaîne de production» de l’hôpital. La
deuxième difficulté consiste à intro-
duire un modèle de contrôle de gestion
approprié à ce type d’activité. En effet,
dans le cas de l’hôpital, il s’agit d’une
activité de services où complexité des
processus, politisation de l’organisa-
tion, cloisonnement des unités, concen-
tration des pouvoirs au centre opéra-
tionnel et standardisation des qualifica-
tions rendent quasiment impossible
l’introduction d’une forme de contrôle
(Halgand 1995). Les nombreux mo-
dèles en application sont des modèles
formels de contrôle de type classique –
axés sur une comptabilité analytique
alimentant un système budgétaire –,
conçus à l’origine pour le secteur indus-
triel marchand, transposés au domaine
non marchand des services de santé
(Halgand 1998).
Si nous dépassons les aspects éthi-
ques du problème, demeure la définition
des prestations hospitalières qui nous
conduit tout naturellement vers le pro-
blème du coût de ces prestations. Dans
la première partie de notre analyse, nous
traiterons la question de la définition
du produit et dans la seconde partie,
nous aborderons la question du coût de
ce produit. Pour éviter les généralités
sur la question, nous appliquerons les
résultats de notre analyse au cas d’un
hôpital suisse de taille moyenne.
1. La notion de produits
hospitaliers
1.1 Mesures possibles du produit
hospitalier
Près de la moitié des dépenses de santé
concerne l’activité hospitalière (Phar-
ma Information 1998); il paraît donc
naturel de modéliser l’output dans ce
secteur en premier.
Il existe différentes mesures possi-
bles de l’activité hospitalière:
– nombre de journées d’hospitalisa-
tion par patient;
– nombre de lits (ou de lits occupés)
d’un établissement hospitalier;
Bernard Morard, Professeur ordinaire
en Contrôle de gestion, HEC, Université
de Genève, Genève

– nombre d’admissions, de sorties ou
de transferts;
– nombre d’actes médicaux produits;
– somme de tous les services rendus au
patient;
– l’ensemble des pathologies ou des
cas traités.
A ces indicateurs de production hos-
pitalière, couramment utilisés dans le
secteur de la santé, on peut encore
ajouter la distinction entre les patients
hospitalisés et ambulatoires. On remar-
que toutefois que ces mesures, prises sé-
parément, ne rendent que peu compte
des prestations médicales réalisées au
profit des patients. Cependant, leur usa-
ge demeure très répandu – les organes
payeurs en Europe les utilisent couram-
ment pour rembourser les hôpitaux – car
l’accès à l’information reste assez facile.
Certains auteurs estiment que, pour
bien décrire l’activité d’un hôpital, il
faut considérer plusieurs paramètres à
la fois: le nombre de cas pour traduire
l’activité médicale, le nombre de jours/
patients pour traduire l’activité des ser-
vices infirmiers et des services hôteliers
de l’hôpital et le nombre de lits, en guise
de paramètre pour décrire l’investisse-
ment en capital (Breyer 1986). Pour-
tant, si le but final de la recherche du
produit hospitalier est d’exprimer la
«production» de l’hôpital en termes de
produits, générateurs des coûts et des
recettes, il est nécessaire de se mettre
d’accord sur un paramètre unique. Ce
choix se fera de manière consensuelle,
en fonction des intérêts des partis con-
cernés (l’intérêt des gestionnaires pour
des produits de type DRG) et/ou en
fonction des impératifs du système en
vigueur (remboursement des hôpitaux
par des forfaits journaliers).
Par la suite, nous développerons da-
vantage le produit nommé DRG, qui
connaît actuellement une extraordi-
naire popularité dans les milieux hospi-
taliers.
1.2 Diagnosis Related Group
(DRG ou groupes homogènes
de malades)
Les DRG représentent une classifica-
tion faisant appel à la pathologie que
présente le patient. Cette approche a
été formalisée dans les années 1980
avec les travaux de Fetter qui cherchait
à constituer des groupes homogènes de
malades. La démarche de la constitu-
tion de ces groupes homogènes est la
suivante:
1. Les dossiers médicaux des patients
sont répartis entre les MDC (Major
Diagnosis Categories). Un MDC
regroupe toutes les pathologies qui
sont diagnostiquées et traitées de la
même manière et par le même type
de spécialistes. Chacune de ces caté-
gories est construite de manière à
correspondre à un organe ou un sys-
tème, se rapprochant ainsi des dif-
férentes spécialités cliniques (Ma-
nuel APDRG 1998). On attribuera
un MDC à chaque personne quittant
l’hôpital, selon son diagnostic princi-
pal. Si un patient a subi différentes in-
terventions, on lui attribuera le MDC
de la pathologie la plus importante
(supposée la plus coûteuse). Un se-
cond diagnostic est posé si le séjour
d’hospitalisation du patient est pro-
longé par des complications ou une
comorbidité.
2. Après la division en MDC, on seg-
mente selon qu’il y ait eu ou non une
procédure chirurgicale.
3. Pour chaque catégorie, un algorithme
de segmentation distingue des grou-
pes dont les consommations de res-
sources sont significativement diffé-
rentes (moyennes de durée de sé-
jour). Ces groupes sont retenus s’ils
ont une certaine pertinence clinique.
4. On établit des valeurs relatives (cost
weights) pour chaque DRG, en divi-
sant le coût moyen de chaque DRG
par le coût moyen de l’ensemble des
cas, ceci pour une région ou un
groupe d’hôpitaux.
5. Quand on veut obtenir les coûts des
DRG pour un hôpital particulier, on
applique les cost weights sur les dé-
penses d’exploitation relatives aux
patients hospitalisés.
L’objectif des travaux de Fetter ap-
paraît clairement: standardiser les pro-
duits et prestations hospitalières pour
construire sur ces derniers une norme
de consommation de ressources. En
1984, il affirmera dans la revue Clinical
Research: «bien que chaque patient
soit unique, tant son diagnostic que son
traitement a des attributs ou des fac-
teurs communs avec d’autres patients»
(Fetter, Rubin et Rabkin 1984). Dans le
tableau 1, nous présentons les cinq sys-
tèmes DRG qui existent à l’heure ac-
tuelle.
La dernière variante (APR DRG) in-
troduit le concept de complexité des
soins et sévérité de la pathologie, ce qui
contribue à améliorer l’explication de
la variation de la consommation de res-
sources mais porte le nombre de caté-
gories à 1530, tandis que dans le con-
cept de départ, Fetter ne voulait pas
dépasser 500 catégories.
Les DRG représentent des profils de
patients ayant reçu des soins relative-
ment homogènes du double point de
vue clinique et économique. Cette
double approche médico-économique
constitue une passerelle entre les deux
mondes qui ont habituellement de la
peine à communiquer. Le DRG crée
un langage commun entre les profes-
sionnels (médecins, corps infirmier,
techniciens, etc) et les gestionnaires et
les aide à mettre en œuvre une poli-
tique cohérente pour l’avenir de l’hôpi-
tal. Toutefois, comme pour tout con-
sensus, ni les uns ni les autres ne sont
entièrement satisfaits de cette défini-
tion du produit hospitalier. Les intérêts
professionnels des médecins les inci-
tent à affiner la définition clinique des
produits impliquant une multiplication
des DRG, ce qui se heurte à l’impératif
d’exploitation des données économi-
ques par le contrôleur (Halgand 1998).
L’Expert-comptable suisse 1-2/00
42
PRATIQUE COMPTABLE
Bernard Morard, Zofia Swinarski Huber, Quels coûts pour quels produits hospitaliers?
Zofia Swinarski Huber, Licenciée en
Gestion d’entreprise, MBA, Assistante-
doctorante en Contrôle de gestion, HEC,
Université de Genève, Genève

Les concepteurs du modèle DRG
prétendent son applicabilité univer-
selle. Ils supposent ainsi que les spécifi-
cités des systèmes de santé nationaux,
celles liées à l’organisation interne de
l’hôpital, ou des pratiques des soins,
n’influencent pas la consommation des
ressources. Le DRG a toutefois fait
l’objet de nombreuses critiques. En
effet, on observe des durées de séjour
différentes pour des cas semblables
dans des pays différents, ce qui nous
amène à penser que les catégories
DRG américaines ne correspondent
que dans une faible mesure aux caté-
gories recensées dans d’autres pays.
Parmi d’autres critiques, c’est le carac-
tère subjectif du choix de l’algorithme
de regroupement qui est mis en cause
(Escaffre, Gervais et Thenet 1993). On
conteste aussi l’importance accordée à
la variable «durée de séjour» comme
facteur déterminant la consommation
des ressources. Le modèle DRG oc-
culte aussi complètement le travail in-
firmier en le réduisant à l’exécution des
décisions médicales. Halgand (1997)
pense qu’en définissant le DRG comme
produit hospitalier, on assimile l’hôpi-
tal public à une entreprise du secteur
privé et que le système comptable re-
posant sur le modèle des DRG peut
être analysé comme une tentative de
conquête de pouvoir émanant de la
technostructure aux dépens du corps
médical. Escaffre, Gervais et Thenet
(1993) arrivent à la conclusion que les
objectifs de l’introduction du contrôle
de gestion et du mode de paiement
basés sur la catégorisation DRG sont
d’abolir le principe de solidarité et de
relativiser le pouvoir des médecins qui
détiennent pour l’instant le monopole
de l’information sur les patients. Re-
gnard (1998), pour sa part, met en doute
l’utilisation d’une clé de répartition
unique (le temps), et conteste la seule
prise en compte de la pathologie pour
expliquer le coût de prise en charge.
1.3 Relations entre le produit
hospitalier et la forme
du remboursement
Afin de choisir un paramètre qui re-
flète correctement l’activité d’un hôpi-
tal, nous proposons que le produit hos-
pitalier corresponde au système de
remboursement pratiqué par l’organe
payeur. En effet, pour qu’un hôpital
puisse être géré correctement, il faut
pouvoir juxtaposer les coûts et les re-
cettes de tous les produits et, dans la
mesure du possible, éliminer les pro-
duits déficitaires.
1.3.1 Le produit hospitalier, objet
de coûts et source de recettes
Si l’hôpital est remboursé en fonction
de la durée de séjour et du contrat
d’assurance du patient (chambre com-
mune, semi-privée, privée), le produit
qui s’impose intuitivement sera le jour
d’hospitalisation par type de contrat
d’assurance. Si, en revanche, on décide
de calculer les coûts par DRG, le per-
sonnel médical, à qui incomberont les
diverses tâches administratives sup-
plémentaires (p. ex. la codification des
actes), ne suivra pas volontiers les nou-
velles consignes. Il verra même dans le
DRG un moyen d’ingérence et de con-
trôle de la part du gestionnaire. Pour
qu’il soit pleinement opérationnel,
l’outil de contrôle de gestion choisi doit
obtenir l’aval du personnel médical.
1.3.2 Le choix du produit en fonction
de l’information disponible
Malgré les systèmes d’information de
plus en plus sophistiqués, le problème
majeur des petites structures hospita-
lières est le manque d’information re-
lative à la consommation des ressour-
ces par patient (médicaments, prothè-
ses, produits sanguins, matériel mé-
dical, etc.). Certains hôpitaux, en vou-
lant maximiser l’information sur la con-
sommation de ressources par patient,
attribuent des points aux examens de
laboratoire et aux actes techniques.
Toutefois, cette méthode qui utilise la
règle de trois pour tout fondement
scientifique (pour une période donnée,
le total des coûts du laboratoire est di-
visé par le total des points qu’il «pro-
duit» et multiplié par le nombre de
points «consommés» par le patient), ne
peut pas fournir une information fiable
L’Expert-comptable suisse 1-2/00 43
PRATIQUE COMPTABLE
Bernard Morard, Zofia Swinarski Huber, Quels coûts pour quels produits hospitaliers?
Tableau 1
Différents types de DRG
(Averill, Muldoon, Vertrees et Goldfield, 1998)
Nom Nombre Spécificité
Medicare DRG 492 Décrit tous les cas de patients dans une
institution de soins aigus; une attention
particulière et portée aux problèmes de
personnes âgées.
Refined DRG 1170 Introduction du concept de complication
et comorbidité sur la base du diagnostic
secondaire et création d’un DRG pour
chaque MDC médical pour des patients
décédés dans l’établissement hospitalier.
All Patient DRG 641 Conçu à l’instigation de l’Etat de New
York dans le cadre de la création du
système de paiement prospectif pour
tous les patients non-Medicare. Nouvel-
les catégories pour les patients atteints
du virus HIV et les patients souffrant de
traumatisme multiple. Adaptation de
certains DRG aux patients en pédiatrie.
Severity DRG 652 Réévaluation de l’usage de complica-
tions et comorbidités dans le cadre des
Medicare DRG.
All Patient Refined 1530 Classification créée sur la base des
DRG AP-DRG. Introduction des sous-groupes
décrivant la sévérité de la maladie et des
sous-groupes décrivant le risque de
mortalité.

quant aux ressources véritablement
consommées par le patient.
1.3.3 Le choix du produit en fonction
de la taille des établissements
hospitaliers
Pour des petits hôpitaux qui ne dépas-
sent pas 150 lits et 5000 cas traités par
an, la catégorisation des patients en
plus de 500 groupes DRG ne donnerait
pas de résultats statistiquement fiables.
Une catégorisation en quelques grou-
pes distincts, tels que le type d’inter-
vention, paraît plus appropriée aux pe-
tits hôpitaux.
1.3.4 Application pratique
Nous avons appliqué nos réflexions
théoriques à un cas pratique d’un hôpi-
tal suisse de taille moyenne, dont nous
tairons le nom pour cause de confiden-
tialité. Il s’agit d’un hôpital privé, dis-
posant de plus de 150 lits, dont l’occu-
pation oscille autour de 65%, qui traite
des cas d’hospitalisation de court sé-
jour (médecine, chirurgie et obstétri-
que) dont la durée moyenne est com-
prise entre cinq et huit jours. La facture
du patient est établie en fonction du
type de son contrat d’assurance (cham-
bre privée, semi-privée, commune) et
du nombre de jours de séjour hospita-
lier. Le tableau 2 résume l’occupation et
les coûts de l’hôpital pendant les trois
dernières années.
On observe un net abandon des con-
trats d’assurance privée au profit des
contrats d’assurance en chambre com-
mune, ce qui réduit de façon substan-
tielle les recettes de l’hôpital, le prix
journalier variant de CHF 1000 entre
les deux catégories. La durée moyenne
de séjour par pathologie a baissé, mais
comme le nombre d’admissions a aug-
menté, le taux d’occupation de l’hôpi-
tal est resté le même. Il n’y a pas eu de
variations notoires dans le coût moyen
par jour; on observe par contre une
nette baisse du coût moyen par cas.
Nous constatons qu’il existe une forte
corrélation entre les jours d’hospitali-
sation et la charge. Compte tenu de nos
conclusions précédentes, nous propo-
sons pour cet hôpital l’emploi conjugué
de deux types de produit hospitalier:
• correspondant au type de rembour-
sement pratiqué par l’organe payeur:
contrat d’assurance privée, semi-pri-
vée et chambre commune;
• correspondant au type d’intervention:
chirurgie, médecine et obstétrique.
2. Le problème de
l’estimation des coûts
Nous allons à présent aborder la ques-
tion du calcul des coûts des produits
hospitaliers. Tout d’abord nous décri-
rons brièvement les méthodes utilisées
en Suisse, aux Etats-Unis et en France,
ensuite nous aborderons la probléma-
tique des objectifs poursuivis par dif-
férentes méthodes de calcul des prix de
revient.
2.1 Calcul des coûts hospitaliers
en Suisse
A l’heure actuelle en Suisse, peu nom-
breux sont les hôpitaux qui calculent le
coût de leurs prestations. Toutefois, on
observe que cette préoccupation gagne
du terrain, du fait des nouvelles obliga-
tions réglementaires. La santé est une
préoccupation du ressort des cantons,
ce qui résulte en une situation législa-
tive très inégale à travers le pays. La
nouvelle Loi sur l’assurance maladie
(LAMal) veut uniformiser cette situa-
tion, pour, entre autres, rendre possi-
bles des comparaisons entre les hôpi-
taux et entre les cantons. Depuis 1996,
tous les hôpitaux suisses ont l’obliga-
tion de tenir une comptabilité analy-
tique par centre de charges (comptabi-
lité analytique VESKA) et de commu-
niquer leurs résultats à l’Office fédéral
L’Expert-comptable suisse 1-2/00
44
PRATIQUE COMPTABLE
Bernard Morard, Zofia Swinarski Huber, Quels coûts pour quels produits hospitaliers?
Tableau 2
Résumé de la fréquentation de l’hôpital (nombre de cas, nombre de jours, durée moyenne
de séjour sur la période 1996–1998)
Médecine Chirurgie Obstétrique Total Charge totale Coût moyen
Cas 96 96 2032 616 2744 13 069 765 4763,03
Jours 96 1089 12 196 4611 17 896 730,32
DMS 96 11,34 6,00 7,49
Cas 97 159 2101 683 2943 12 463 051 4234,81
Jours 97 1412 10 524 4202 16 138 772,28
DMS 97 8,88 5,01 6,15
Cas 98 175 2237 716 3128 12 211 303 3903,87
Jours 98 1262 11 129 4331 16 722 730,25
DMS 98 7,21 4,97 6,05
«Afin de choisir un paramètre qui reflète correctement
l’activité d’un hôpital, nous proposons que
le produit hospitalier corresponde au système
de remboursement pratiqué par l’organe payeur.»

L’Expert-comptable suisse 1-2/00
46
PRATIQUE COMPTABLE
Bernard Morard, Zofia Swinarski Huber, Quels coûts pour quels produits hospitaliers?
de la statistique. A la fin de l’année
1999, le Conseil fédéral décidera quelle
sera l’unité finale d’imputation de l’a-
venir: centre de charge, cas, APDRG?
Certains hôpitaux font œuvre de
pionniers, misant soit sur un type de
produit particulier (DRG), ou sur une
méthode de contrôle de gestion (ABC),
mais la majorité attend la décision du
gouvernement avant d’investir dans
une structure particulière.
2.2 Calcul des coûts hospitaliers
aux USA
Aux Etats-Unis, la question a été tran-
chée en théorie depuis l’institution en
1965 de Medicare, le plus large pro-
gramme d’assurance maladie qui cou-
vre 37 millions de personnes âgées.
Dans cette organisation, le rembourse-
ment se fait sur deux modes selon l’hos-
pitalisation ou non du patient. Dans
l’hypothèse d’un patient ambulatoire,
le remboursement se fait sur la base du
coût présenté par l’institution. Dans le
cas d’une hospitalisation, il se fait sur la
base d’un coût standard par DRG.
Les deux méthodes de calcul du coût
hospitalier couramment utilisées aux
Etats-Unis sont le RCC (Ratio of Cost
to Charges) et la méthode des unités de
valeur relatives (Relative Value Unit).
Le RCC est basé sur le principe suivant:
on calcule le ratio coûts/recettes d’une
unité de soins; ce ratio est ensuite ap-
pliqué au prix de chaque acte accompli
par cette unité pour en trouver le coût.
Cette méthode, utilisée par Medicare,
considère que la proportion coût/prix
reste la même pour tous les actes d’une
unité de soins. On qualifie cette mé-
thode de «top-down» parce qu’elle part
de l’ensemble de dépenses et recettes
de l’unité de soins pour aboutir au coût
d’un acte. La méthode RVU mesure la
valeur relative des ressources consom-
mées par chaque acte. Plus l’acte est
complexe, plus son RVU sera élevé.
Cette approche est qualifiée de «bottom-
up» parce qu’elle prend origine au ni-
veau de l’acte et remonte vers l’unité de
soins (Baker 1998).
Pour estimer les autres éléments de
coût imputables au patient, les hôpi-
taux disposent d’une base d’allocation
recommandée par le HCFA (Health
Care Financing Administration), (cf.
tableau 3).
En faisant la somme de tous les coûts
des ressources consommées par le pa-
tient, on arrive au coût de son séjour.
2.3 Calcul des coûts hospitaliers
en France
En France, la méthode de calcul des
coûts utilisée dans les hôpitaux est
la méthode des sections homogènes.
Cette méthode découpe l’organisation
en sections homogènes, répartit ensuite
la charge sur ces sections en fonction
des unités d’œuvre. L’unité d’œuvre
doit traduire l’activité de la section et
permettre la mesure de sa perfor-
mance. De ce fait, une unité d’œuvre
pourrait être représentée par une con-
sommation de charge ou la réalisation
de produits de la section. Toutefois, la
complexité des soins ne permet pas
d’identifier spontanément des centres
d’analyse homogènes. Quelques sug-
gestions faites aux hôpitaux publics
français en matière de mode de répar-
tition des charges sont représentées au
tableau 4.
«La structure des coûts hospitaliers
français, qui se traduit par une très forte
proportion d’éléments indirects cal-
culés à partir de la clé de répartition
«durée de séjour», et qui s’explique par
la faiblesse des moyens information-
nels des établissements – incapables de
saisir les coûts «en direct» – a pour
conséquence de réduire le coût total à
la durée de séjour, lorsque le modèle
[DRG] est utilisé dans un hôpital
français» (Halgand 1998). En effet, les
coûts indirects, représentant plus de
70% des coûts totaux, sont d’abord cal-
culés à partir de la clé de répartition
«durée de séjour» et ensuite imputés au
prorata de la durée de séjour aux pro-
duits.
2.4 Problème de l’imputation
des charges indirectes
Comme nous venons de le voir, l’infor-
mation recueillie au niveau du patient
reste très faible (montant des charges
Tableau 3
Règles de répartition suggérées par le HFCA
(Eldenburg et Kallapur 1997)
Département ou postes Base de répartition
1 Dépréciation: bâtiments et installations fixes Surface
2 Dépréciation: équipements mobiles Francs ou surface
3 Frais du personnel médical Salaires bruts
4 Administration générale Coût direct
5 Maintenance, réparation et gestion opérationnelle Surface
6 Blanchisserie Poids du linge
7 Ménage Heures
8 Cuisine et cafétéria Nombre de repas
9 Administration infirmière Heures de service
10 Services centraux, achat et pharmacie Coût des biens acquis
11 Accueil et gestion de dossiers médicaux Temps passé
Tableau 4
Règles de répartition (Frutiger et Fessler 1991)
Charges par nature Base de répartition
– Actes d’investigation et de traitement Lettres-clés ou indices de complexité
– Actes des professions paramédicales relative
– Médicaments, produits et dérivés Imputés directement au patient si
sanguins, prothèses et implants l’identification du patient est disponible
– Transport médical
– Charges de personnel soignant et Nombre de journées pondérées par
médical un index de charge de travail relatif
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%