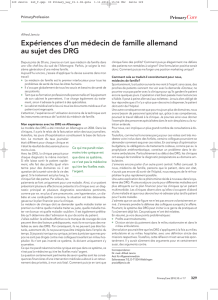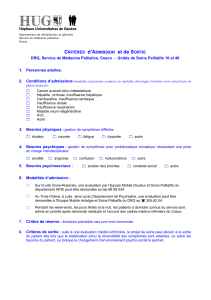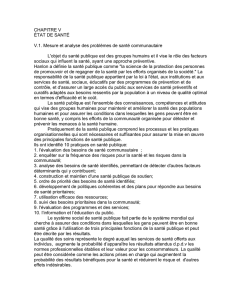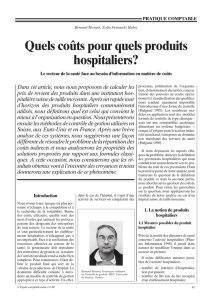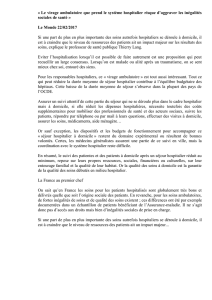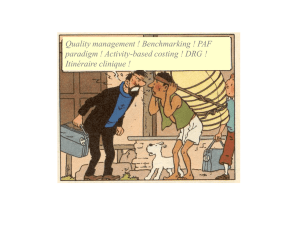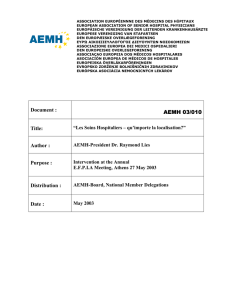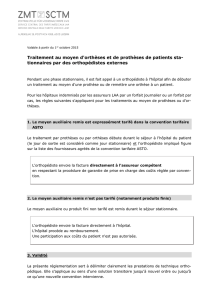Report (Published version) - Archive ouverte UNIGE

Report
Reference
Quels coûts pour quels produits hospitaliers ?
MORARD, Bernard, SWINARSKI HUBER, Zofia
Abstract
Dans cet article nous nous proposons de calculer les prix de revient des produits dans une
institution hospitalière suisse de taille moyenne. Après un rapide tout d'horizon des produits
hospitaliers communément utilisés, nous définirons quel est celui qui convient le mieux à
l'organisation en question. Nous présenterons ensuite les méthodes de contrôle de gestion
utilisées en Suisse, aux Etats-Unis et en France. Après une brève analyse de ces systèmes
nous suggérons une façon différente de résoudre le problème de la répartition des coûts
indirects et nous analyserons les propriétés des solutions proposées par.rapport aux formules
classiques. A cette occasion, nous constaterons que les résultats obtenus vont à l'encontre
des croyances et nous donnerons une explication de ce phénomène.
MORARD, Bernard, SWINARSKI HUBER, Zofia. Quels coûts pour quels produits
hospitaliers ?. 1999
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5870
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
1 / 1

Page 1
Bernard Morard
Professeur Ordinaire en Contrôle de Gestion, Président de la Section HEC
HEC, Université de Genève
40, boulevard Pont d’Arve
CH-1211 Genève 4
Tél. +4122/ 705 81 30
Fax +4122/ 705 81 04
E-Mail : [email protected]
Zofia Swinarski Huber
Licence en Gestion d’Entreprise, MBA, Assistante-doctorante en Contrôle de Gestion
HEC, Université de Genève
40, boulevard Pont d’Arve
CH-1211 Genève 4
Tél. +4122/ 705 81 20
Fax +4122/ 705 81 04
E-Mail : [email protected]
QUELS COÛTS POUR QUELS PRODUITS HOSPITALIERS ?
Mots clés : produit hospitalier, DRG, imputation des charges indirectes, calcul du prix
de revient, allocation optimale
RÉSUMÉ
Dans cet article nous nous proposons de calculer les prix de revient des produits dans
une institution hospitalière suisse de taille moyenne. Après un rapide tour d’horizon des
produits hospitaliers communément utilisés, nous définirons quel est celui qui convient le
mieux à l’organisation en question. Nous présenterons ensuite les méthodes de contrôle
de gestion utilisées en Suisse, aux Etats-Unis et en France. Après une brève analyse de
ces systèmes nous suggérerons une façon différente de résoudre le problème de la
répartition des coûts indirects et nous analyserons les propriétés des solutions proposées
par rapport aux formules classiques. A cette occasion, nous constaterons que les
résultats obtenus vont à l’encontre des croyances et nous donnerons une explication de
ce phénomène.

Page 2
INTRODUCTION
De nos jours plus personne n’échappe à la compétition et à la recherche de la rentabilité.
Baisse des coûts, efficacité, qualité sont des mots d’ordre qui unissent les
préoccupations des dirigeants des entreprises de tout secteur. Le secteur de la santé, et
tout particulièrement les établissements hospitaliers, n’échappent pas à ces impératifs.
Face à la raréfaction des ressources affectées au secteur de la santé, le gestionnaire doit
introduire des contraintes de gestion, or la nature de l’activité médicale rend sa tâche
bien complexe. Pour commencer, il faut définir quel est le produit final qui sort de la
« chaîne de production » de l’hôpital. La deuxième difficulté consiste à introduire un
modèle de contrôle de gestion approprié à ce type d’activité. En effet, dans le cas de
l’hôpital, il s’agit d’une activité de services, où complexité des processus, politisation de
l’organisation, cloisonnement des unités, concentration des pouvoirs au centre
opérationnel et standardisation des qualifications rendent quasiment impossible
l’introduction d’une forme de contrôle (Halgand 1995). Les nombreux modèles en
application sont des modèles formels de contrôle de type classique - axés sur une
comptabilité analytique alimentant un système budgétaire -, conçus à l’origine pour le
secteur industriel marchand, transposés au domaine non marchand des services de
santé (Halgand 1998).
Si nous dépassons les aspects éthiques du problème, demeure la définition des
prestations hospitalières qui nous conduit tout naturellement vers le problème du coût de
ces prestations. Dans la première partie de notre analyse, nous traiterons de la question
de la définition du produit et dans la seconde partie nous aborderons la question du coût
de ce produit. Pour éviter les généralités sur la question, nous appliquerons les résultats
de notre analyse au cas d’un hôpital suisse de taille moyenne.
SECTION 1 : La notion de produits hospitaliers

Page 3
1.1 Mesures possibles du produit hospitalier
Près de la moitié des dépenses de santé concerne l’activité hospitalière (Suisse 1995 :
50%, Pharma Information 1998), il paraît donc naturel de modéliser l’output dans ce
secteur en premier.
Il existe différentes mesures possibles de l’activité hospitalière :
- Nombre de journées d’hospitalisation par patient
- Nombre de lits (ou de lits occupés) d’un établissement hospitalier
- Nombre d’admissions, de sorties ou de transferts
- Nombre d’actes médicaux produits
- Somme de tous les services rendus au patient
- L’ensemble des pathologies ou des cas traités
A ces indicateurs de production hospitalière, couramment utilisés dans le secteur de la
santé, on peut encore ajouter la distinction entre les patients hospitalisés et ambulatoires.
On remarque toutefois que ces mesures, prises séparément, ne rendent que peu compte
des prestations médicales réalisées au profit des patients. Cependant, leur usage demeure
très répandu - les organes payeurs en Europe les utilisent couramment pour rembourser
les hôpitaux - car l’accès à l’information reste assez facile.
Certains auteurs estiment que, pour bien décrire l’activité d’un hôpital, il faut considérer
plusieurs paramètres à la fois : le nombre de cas pour traduire l’activité médicale, le
nombre de jours/patients pour traduire l’activité des services infirmiers et des services
hôteliers de l’hôpital et le nombre de lits, en guise de paramètre pour décrire
l’investissement en capital (Breyer 1986). Pourtant, si le but final de la recherche du
produit hospitalier est d’exprimer la « production » de l’hôpital en termes de produits,
générateurs des coûts et des recettes, il est nécessaire de se mettre d’accord sur un
paramètre unique. Ce choix se fera de manière consensuelle, en fonction des intérêts des
partis concernés (l’intérêt des gestionnaires pour des produits de type DRG) et/ou en
fonction des impératifs du système en vigueur (remboursement des hôpitaux par des
forfaits journaliers).

Page 4
Dans une optique d’élargissement de la politique de santé, on abandonne des objectifs de
productivité des soins intra-muros pour les objectifs d’un état de santé de la population.
Cette vision plus large devrait aussi trouver un reflet dans les indicateurs de productivité
des institutions de la santé. En effet, on pourrait envisager des produits tels que:
- L’amélioration de l’état de santé du malade imputable à son séjour hospitalier, ou
- L’amélioration de l’état de santé des habitants d’une région.
Toutefois, considérant la difficulté de les mesurer, ces deux derniers produits semblent
être difficilement applicables dans une problématique de calcul des coûts hospitaliers.
Par la suite, nous développerons davantage le produit nommé DRG, qui connaît
actuellement une extraordinaire popularité dans les milieux hospitaliers.
1.2 Diagnosis Related Group (DRG ou groupes homogènes de malades)
Les DRG représentent une classification faisant appel à la pathologie que présente le
patient. Cette approche a été formalisée dans les années 1980 avec les travaux de Fetter
qui cherchait à constituer des groupes homogènes de malades. La démarche de la
constitution de ces groupes homogènes est la suivante :
1. Les dossiers médicaux des patients sont répartis entre les MDC (Major Diagnosis
Categories). Un MDC regroupe toutes les pathologies qui sont diagnostiquées et
traitées de la même manière et par le même type de spécialistes. Chacune de ces
catégories est construite de manière à correspondre à un organe ou un système, se
rapprochant ainsi des différentes spécialités cliniques (Manuel APDRG 1998). On
attribuera un MDC à chaque personne quittant l’hôpital, selon son diagnostic
principal. Si un patient a subi différentes interventions, on lui attribuera le MDC de
la pathologie la plus importante (supposée la plus coûteuse). Un second diagnostic
est posé si le séjour d’hospitalisation du patient est prolongé par des complications
ou une comorbidité.
2. Après la division en MDC, on segmente selon qu’il y ait eu ou non une procédure
chirurgicale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%