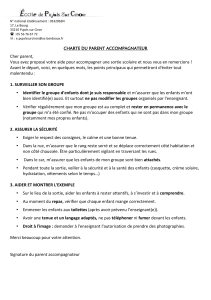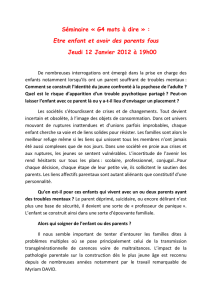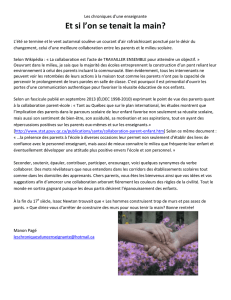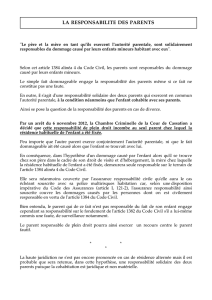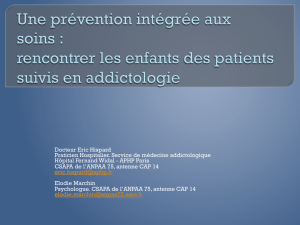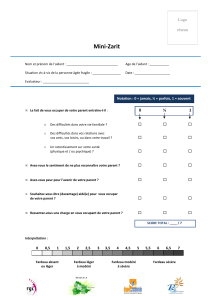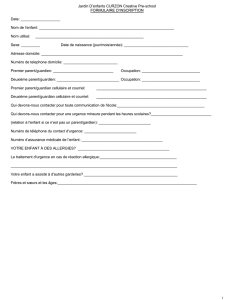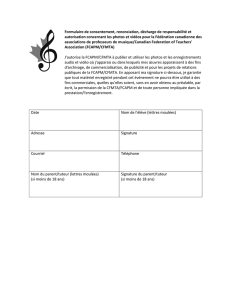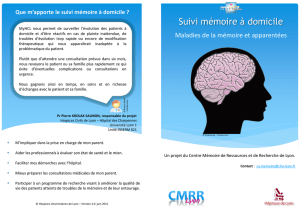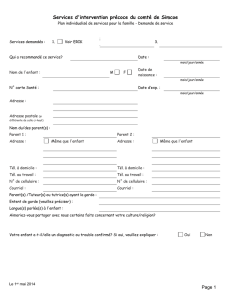maladie et competence parentale - La systémique appliquée aux

MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE
Extrait du Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique
http://www.systemique.be/spip/article.php3?id_article=82
MALADIE ET COMPETENCE
PARENTALE
- SAVOIR THÉORIQUE - Échanges à partir d'articles , bibliothèque, dictionnaire et concepts de la systémique - Article donné par son auteur
pour stimuler des échanges -
Date de mise en ligne : samedi 20 juin 2009
Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 1/16

MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE
Chapitre 16. Du livre« malades et familles » édité en 1997 avec Mme Celis-Gennart par les éditions Médecine et
Hygiène, avec l'autorisation expresse des auteurs .
MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE.
1. Introduction.
En choisissant de développer le problème de la relation entre la maladie et la fonction parentale, nous nous
proposons d'éclairer les deux questions suivantes :
1) En quel sens l'événement que constitue la maladie est-il à même de transformer le patient dans les différents
aspects de son existence psychologiques, relationnels, sociaux... - et comment se répercute-t-il, tout
particulièrement, sur l'attitude et les compétences du patient exerçant une fonction parentale ?
2) Comment la maladie d'un parent agit-elle sur l'existence de l'enfant ? En quel sens peut-elle influencer sa
sensibilité et modifier son comportement ?
Pour permettre au lecteur d'apercevoir d'emblée l'enjeu de telles questions, nous commencerons par présenter un
cas clinique, dont nous commenterons les moments les plus significatifs dans la suite de notre exposé. Le cas
auquel nous allons nous référer, celui de Madame Rossini, illustre la difficulté qu'il y a à gérer son rôle de parent tout
en étant atteint d'une maladie grave. Ce cas montre également comment la réorganisation des relations
intrafamiliales que la maladie induit peut entraver le mouvement par lequel les patients, une fois guéris, s'efforcent
de reprendre la place qui leur revient dans la famille ainsi que le rôle que la maladie les a empêchés d'assumer
pendant un certain temps.
2. Exemple clinique.
2.1. Situation familiale et motif de la thérapie.
La famille Rossini, d'origine italienne, a été envoyée dans notre Centre par son médecin traitant. C'est un collègue
avec qui nous eûmes souvent l'occasion de collaborer efficacement. Ce médecin connaissait la famille depuis de
nombreuses années. Le médecin et le couple étaient même devenus amis, surtout après que le praticien se fût
engagé avec sollicitude, compétence et abnégation à soigner Madame Rossini, dès le moment où elle eût reçu le
diagnostic d'une affection tumorale qui, d'ordinaire, réagit bien au traitement chimiothérapique, si elle est
diagnostiquée et traitée dans sa phase précoce. On considère qu'en cas d'absence de récidive après 5 ans, les
patients sont guéris.
Lorsque nous avons pris en charge la famille Rossini, Madame était considérée comme guérie depuis quelques
années. La demande de son médecin était motivée par la répétition de problèmes comportementaux présentés par
les enfants : Elisa, 18 ans, et Claudio, 15 ans. La situation de ce dernier était devenue problématique ; il fumait du
hachisch et voulait abandonner sa formation professionnelle en raison de résultats très décevants. Elisa, elle aussi,
se trouvait en difficulté dans une carrière scolaire médiocre. De plus, comme sa mère s'en était aperçue, elle volait
de l'argent de son porte-monnaie et volait aussi de temps en temps en dehors de la maison. Nous avons engagé
avec la famille Rossini un traitement familial, répondant en cela à la demande du médecin qui, après avoir soigné la
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 2/16

MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE
mère, souhaitait voir la famille heureuse.
2.2. Les familles d'origine.
L'équilibre, dans la famille d'origine de la mère, avait été rompu à la suite de graves problèmes sociaux et financiers.
Le père était alcoolique. Il avait été riche, mais avait perdu sa fortune. Les parents ont divorcés quand Madame
Rossini était encore enfant. La mère de Madame Rossini était dure de caractère, tant elle était prise d'une rancoeur
subtile à l'égard de son ex-mari. Elle s'était mariée en rêvant d'une vie luxueuse, mais elle avait dû renoncer à ses
rêves. L'enfance de Madame Rossini n'a pas été très heureuse. Sa mère était très exigeante à son égard et tenait sa
fille pour responsable de sa destinée malheureuse. A l'âge de 18 ans, Madame Rossini partit de la maison et garda
dans la suite des relations sporadiques avec sa mère et des contacts encore plus sporadiques avec son père.
La famille du père fut par contre décrite comme étant très unie et comme présentant des signes de dépendance
réciproque. Cependant, la famille paternelle habitant loin du couple, elle ne venait jamais en visite.
2.3. Le couple pendant la maladie.
Durant le traitement, les parents ont transmis aux thérapeutes le sentiment qu'ils avaient d'avoir dû affronter seuls,
sans le soutien de leurs familles d'origine, l'anxiété et la peur liées au cancer de Madame. L'aide apportée par le
médecin et par un cercle restreint d'amis n'a pas soulagé la mère dans la tâche difficile qui consistait à éduquer et à
élever deux petits enfants tout en étant gravement malade. Madame Rossini était complètement absorbée par son
épuisante lutte contre la maladie, à laquelle elle fit face en se montrant animée d'une forte volonté de vivre. La
maladie, par sa gravité, a perturbé la relation du couple. La malade a dû vivre une relation émotionnelle si exclusive
avec son Hodgkin qu'elle s'est détachée affectivement du mari. La situation rappelle la formule « un et un font quatre
» de Ph. Caillé (cf. chap. 2). Voulant bien faire, et pour favoriser cette lutte, le mari avait pourtant peu à peu pris sur
lui la tâche de soulager sa femme de toutes ses responsabilités. Ainsi, il avait pris en charge toutes les décisions
concernant les vacances, les études, la vie quotidienne, et il chargeait Elisa de leur exécution. Madame Rossini prit
rapidement conscience que son mari lui soutirait son rôle de mère et qu'il le déléguait en partie à sa fille, et elle
devint incapable d'apprécier leur soutien.
La situation que la famille connut à cette époque montre que le père a assumé un rôle réparateur pour compenser,
en premier lieu, la carence maternelle induite par la maladie. Entrepreneur dynamique ayant un sens aigu de
l'organisation, il a fait face à son profond vécu d'inquiétude et à sa détresse par une activité étonnante qui lui
permettait en fait d'échapper à ses propres angoisses liées à la crainte d'une mort éventuelle de son épouse. Le
souci d'être efficace a fini par le rendre moins attentif aux besoins réels des enfants. Ainsi, la tendance de la mère à
ne plus être capable de remplir son rôle maternel témoigne de l'excès de zèle que le père a manifesté, et par lequel il
en est arrivé à soutirer à son épouse sa fonction et à endosser lui-même un rôle de père-mère.
Dans une perspective trigénérationnelle, il faut encore considérer que la mère n'avait pas bénéficié, dans sa relation
avec sa propre mère, de comportements de soin, d'attention et de soutien, même dans les moments d'adversité, et
n'avait donc pas été initiée à de telles conduites. La solitude dans laquelle sa mère l'avait laissée à cette époque a
été acceptée par la malade comme une confirmation de l'idée que, des parents, il ne faut rien attendre. Mais dans sa
détresse, elle ne pouvait que réclamer auprès de ses propres enfants ce que elle aurait souhaité recevoir de sa mère
: appui, consolation, apaisement de la tempête émotionnelle qui la traversait. Peut-on dès lors, dans l'après-coup,
comprendre la violence qu'elle exerça à l'égard de son fils Claudio (cf. infra) comme résultant de l'échec de cette
attente impossible et comme étant l'expression d'une révolte rageuse ?
2.4. La situation des enfants pendant la maladie.
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 3/16

MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE
Elisa fut vite renseignée sur la gravité de la maladie de sa mère. Claudio, en revanche, n'en fut averti qu'après plus
d'une année. Il voyait sa mère s'éloigner et il savait vaguement qu'elle était hospitalisée, ou il voyait le médecin
suivre très tôt sa mère à domicile et lui administrer des perfusions. Il voyait celle-ci perdre ses cheveux, voyait son
père s'agiter et sa soeur pleurer, mais tous se retenaient devant lui. Leur devoir était de ne pas donner trop de soucis
à Claudio avec des histoires qu'il ne pouvait comprendre. La seule chose que le garçon comprenait, c'était que sa
mère était devenue mauvaise parce qu'elle le tapait pour rien. Il se demandait alors si tout ce qui survenait dans sa
famille n'était pas de sa faute à lui. Après coup, le père affirma qu'il ne s'était aperçu de rien. Or, la mère prenait
souvent un tape-tapis et poursuivait son fils à travers la maison. Claudio, lors des entretiens, se rappelait
parfaitement le sentiment de terreur et en même temps de haine qu'un tel comportement avait suscité en lui. On peut
supposer que cette tendance à donner des corrections physiques à l'enfant fut un moyen pour la mère de se
réapproprier sa fonction parentale. En frappant son fils, Madame Rossini voulait en effet moins le punir ou rétablir sur
lui son autorité que réintégrer son rôle de mère. Mais la stérilité d'un tel comportement est évidente, et le fait que la
mère frappât son fils n'augmenta que l'anxiété, le dégoût de soi et la perte de toute estime que la maladie était déjà
en elle-même propre à alimenter. Quant au fils lui-même, une telle attitude ne pouvait que le consterner. Il fut
surprenant d'entendre avec quelle lucidité Claudio pouvait relater les crises de violence de sa mère, qui était
poussée à bout par le désespoir. Claudio a appris à contrôler ses émotions. Il n'attendait de consolation et de
réassurance ni de la part de sa mère, ni de celle de son père. Il affirma par contre ne pas avoir été troublé par
l'absence de diagnostic clair, comme s'il ne voulait pas connaître la vérité.
2.5. Les relations familiales après la guérison.
Après plus de cinq ans de lutte et de soins, Madame Rossini fut complètement guérie. Mais à ce moment, elle se
rendit compte que la guérison pour laquelle elle avait tant lutté et dans laquelle elle avait mis tant d'espoirs ne la
réhabilitait pas automatiquement dans son rôle de femme et de mère. Elle était bien sûr guérie, mais elle vivait en
marge de la famille, pleine d'envie à l'égard de sa fille et incapable de faire apprécier à son mari son rôle de femme
et de mère. Le mari continuait en effet à déconsidérer son épouse. (Dans le cours des séances, au demeurant,
lorsque celle-ci prenait la parole, il levait piteusement les yeux comme pour s'excuser face au thérapeute.) A cette
époque, Madame Rossini commença à travailler pour trouver un espace propre, avec la conviction qu'elle ne pourrait
que très difficilement rompre l'alliance très forte que sa maladie avait créée entre son mari et sa fille.
La guérison, étant donné le contexte dans lequel elle advint, entretint donc l'agressivité et la violence verbale de
Madame Rossini à l'égard de ses enfants. Et son comportement, en retour, ne cessait de l'isoler toujours plus. A
certains moments, ses enfants lui faisaient comprendre qu'elle n'avait rien à dire dans leur éducation et qu'ils
préféraient résoudre leurs problèmes avec leur père, qui était plus permissif et plus gentil. Elisa se considérait en
effet toujours comme une interlocutrice privilégiée de son père, qui la consultait pour certaines décisions importantes
sans en avertir la mère, qui réagissait avec haine et aigreur. Les conflits mère-fille explosaient de façon dramatique.
Un jour, Elisa vola sur le lieu de travail de sa mère et se fit surprendre. En arrivant sur ses 18 ans, la jeune fille
commença à vouloir vivre seule, mais chaque velléité de départ était marquée par des conflits et des bagarres, en
sorte que son projet échouait régulièrement.
L'évolution à long terme d'Elisa se caractérisa par des troubles comportementaux prolongés et sérieux. L'évolution
de Claudio, elle, fut ponctuée par l'échec scolaire, la petite délinquance et la marginalisation.
2.6. La signification paradigmatique du cas.
La question tout à fait centrale à laquelle ce cas clinique nous confronte est celle de savoir s'il existe un lien causal
entre la maladie de la mère et l'évolution problématique des deux enfants. Pour répondre à une telle question, il
importe d'adopter une perspective qui soit appropriée à la complexité du phénomène et qui tienne notamment
compte des deux points suivants. En premier lieu, il est nécessaire de considérer, dans sa globalité, la réorganisation
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 4/16

MALADIE ET COMPETENCE PARENTALE
des liens familiaux qui s'est amorcée avec la survenue de la maladie et qui s'est poursuivie après la guérison. En
deuxième lieu, il importe de cerner, dans la redistribution des relations et des rôles à l'intérieur de la famille, ce qui
relève d'une réponse aux exigences que la maladie génère et ce qui est de l'ordre de la dérive, de l'exagération ou
de la rigidification dysfonctionnelle. Il arrive au demeurant que certaines modalités relationnelles qui, en soi ou à une
période donnée, ne sont pas forcément pathologiques, se transforment, du fait de leur persistance indéfinie ou de
leur accentuation, en comportements rigides et destructeurs. Ainsi, dans la famille Rossini, le mouvement par lequel
le mari a « marginalisé » sa femme en lui soustrayant la plus grande part de ses responsabilités familiales, s'il se
justifiait en partie pendant la maladie, a eu tendance à virer, après la guérison, en un acte de vengeance par lequel il
faisait payer à son épouse les sacrifices et les privations subis pendant la période où elle luttait pour se soigner et
guérir.
Lorsque nous nous interrogeons sur le rapport entre la maladie de Madame Rossini et le développement ultérieur de
ses deux enfants, ils nous faut donc reconnaître d'une part que les transformations de la vie familiale, que
l'émergence de la maladie a rendues nécessaires, ont certainement permis à la mère de lutter efficacement contre
son mal. Il n'en reste pas moins, d'autre part, que le prix payé par les enfants fut considérable. Quels sont les
processus qui se sont avérés dommageables pour ceux-ci ? C'est ce que nous mettrons en évidence dans la suite,
au fur et à mesure que nous développerons les deux thèmes directeurs de cet exposé, qui mettront respectivement
en jeu l'attitude du parent malade et la réponse des enfants à la maladie du parent.
3. La transformation du parent malade. La maladie, nous le savons, n'est jamais un processus partiel et purement
local ; elle constitue non seulement une atteinte globale de la personne, mais elle suscite en outre chez celui qui en
est atteint l'émergence d'un comportement nouveau. Ce comportement présente des caractéristiques typiques : il
réside d'une part dans des attitudes actives de recherche de soin et, d'autre part, dans des attitudes passives de
retrait et de renoncement aux pratiques et aux fonctions habituelles. Les symptômes et la douleur physique
favorisent en effet la tendance à l'abandon passif et mènent souvent à la régression.
Sur le plan psychologique, la maladie (pensons par exemple à une pneumonie ou à un ulcère gastrique) activent
chez le patient des peurs qui sont liées au sentiment de perdre son intégrité corporelle et, du même coup, sa
possibilité d'agir et de vivre de façon autonome. La peur de mourir est elle aussi souvent présente. L'atteinte
corporelle alimente chez le sujet un sentiment de fragilité et de vulnérabilité qui, associé à la modification effective de
son insertion ou de son statut social, représente une menace pour son équilibre psychologique. Ces différents
facteurs concourent à produire, chez le patient, une altération de l'idée de soi et une blessure narcissique profonde.
La survenue de la maladie se répercute enfin, à différents niveaux, sur la vie relationnelle du sujet. Elle pousse
celui-ci à restreindre ses activités sociales et à limiter ou suspendre son engagement professionnel. A l'intérieur de la
famille, et comme l'a illustré la situation clinique présentée plus haut, la maladie vient perturber la relation du couple
et, surtout si elle persiste dans le temps, exiger de la part des conjoints une définition renouvelée de leur lien. Elle
agit enfin -et c'est de cet aspect que nous traiterons ici de façon privilégiée -sur la relation du parent malade à ses
enfants, le risque majeur étant que l'altération de l'état de santé provoquée par la maladie porte atteinte aux
compétences parentales du patient en limitant son aptitude à éduquer et à protéger les enfants mineurs, tout comme
sa disponibilité à aimer ceux-ci et à leur porter l'affection dont ils ont besoin. La nécessité de penser à sa propre
santé et la peur de la mort peuvent en effet rendre le parent distant, peu attentif aux exigences des enfants et même
parfois, comme nous le commenterons dans la suite, négligent, hostile ou violent.
Il importe bien sûr de distinguer les réactions normales à la maladie physique et les réactions pathologiques, qui
signent éventuellement la coexistence d'un trouble de la personnalité ou d'une affection psychiatrique. Ainsi, le fait
que la maladie, qui engendre fréquemment une situation de détresse et de grand besoin chez le sujet qui en est
atteint, tende à augmenter les attentes de ce dernier à l'égard de son entourage et à lui faire adopter une position
passive de « demandeur » n'est pas en soi pathologique. Ces tendances ont même une fonction positive dans la
mesure où elles permettent au patient de recevoir les soins dont il a besoin et de limiter à juste titre ses activités ou
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 5/16
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%