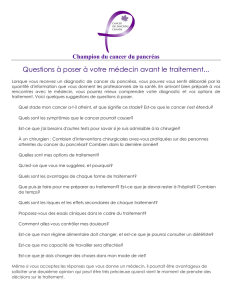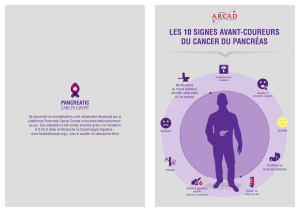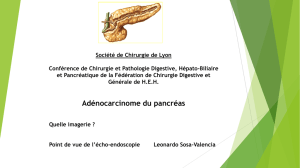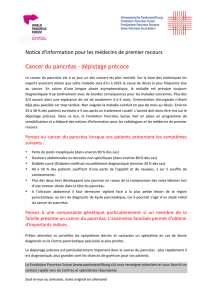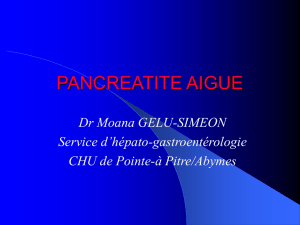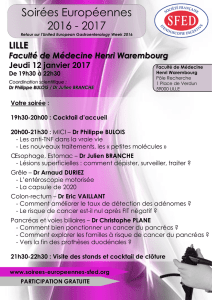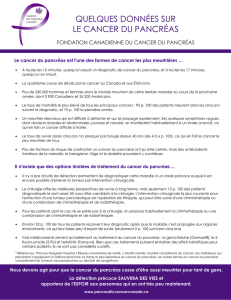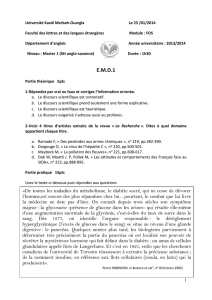imagerie radiologique (o. ernst) - Chirurgie

IMAGERIE RADIOLOGIQUE (O. ERNST)
IMAGERIE RADIOLOGIQUE DU CANCER DU PANCREAS
Olivier ERNST
Radiologie, hôpital Huriez, CHRU de Lille, 59037 LILLE Cedex
Ces dernières années, les techniques d'imagerie radiologique ont nettement évolué. Dans un premier temps, les différentes
techniques d'imagerie radiologique applicables au pancréas seront présentées, puis un arbre décisionnel concernant
l'emploi de ces différentes techniques dans le diagnostic du cancer du pancréas et dans le bilan de résequabilité sera
proposé.
I - TECHNIQUES D'IMAGERIE
1- Echographie
L'échographie est une technique ayant maintenant plus de 20 ans. Lorsque le pancréas est bien visualisé, elle est capable
d'étudier le parenchyme pancréatique et de visualiser le Wirsung normal non dilaté. L'échographie peut donc parfois
détecter des tumeurs du pancréas d'un centimètre de diamètre. Toutefois, les résultats sont extrêmement inconstants. En
effet, le pancréas ne peut être étudié correctement que par voie antérieure, le rachis empêchant une étude postérieure. De
ce fait, les structures digestives (estomac, anses grêles, colon transverse) s'interposent souvent entre la sonde et le
pancréas. L'air contenu dans ces structures digestives reflète les ultra-sons et empêche l'étude du pancréas. La zone la plus
difficile à étudier par échographie correspond au corps et à la queue du pancréas.
Au total l'échographie est une technique simple permettant parfois de visualiser finement des petites lésions, mais dont le
caractère peu reproductible rend les résultats très inconstants.
2- Scanner
Actuellement, la totalité du parc scanographique avancé est constituée d'appareils à acquisition hélicoïdale ou spiralée. Avec
ce type d'appareils, le tube tourne en permanence autour du patient durant un déplacement de table continu. Le volume
comprenant la partie haute de l'abdomen supérieur peut ainsi être étudié en moins de 20 secondes. De ce fait, il est
parfaitement possible d'obtenir d'une étude de la totalité de la glande et du foie durant le même bolus vasculaire.
Avant injection, l'adénocarcinome du pancréas présente le plus souvent une densité identique à celle de la glande normale,
et ne peut donc être visualisé que par ces signes indirects (dilatation des voies biliaires, dilatation du Wirsung, déformation
des contours du pancréas). Par contre, après injection, la tumeur se rehausse nettement moins durant la phase vasculaire
que le parenchyme sain, l'adénocarcinome du pancréas étant une tumeur hypovasculaire. Le scanner spiralé (hélicoïdal) est
donc nettement plus sensible que les scanners de génération antérieure (séquentiels) pour visualiser les petites tumeurs du
pancréas. Un scanner pancréatique doit donc être obligatoirement injecté avec un produit de contraste iodé.
Depuis 1999, sont apparus les scanners multi-barrettes, multi-coupes. Ce type d'appareil permet de réaliser plusieurs
coupes simultanément. Par rapport à un scanner spiralé conventionnel, le temps d'acquisition du volume sera donc divisé
par le nombre de coupes réalisées simultanément. La totalité du foie et du pancréas peut donc être étudiée en moins de 10
secondes. Après injection d'un produit de contraste au pli du coude, il est ainsi possible de réaliser une acquisition durant la
phase artérielle du bolus, puis durant la phase veineuse. De ce fait, outre l'étude parenchymateuse, ces appareils
permettent d'obtenir une excellente étude vasculaire, artérielle et veineuse.
Quelle que soit la technique employée, le scanner réalisé pour une tumeur du pancréas, doit systématiquement comporter
une étude de la totalité du foie.
Le scanner est donc un examen relativement disponible, qui permet avec une reproductibilité correcte une étude du
parenchyme pancréatique, des axes vasculaires, et du parenchyme hépatique. Le scanner est moins performant pour
l'étude des adénopathies et des carcinoses péritonéales.
3-
IRM
L'IRM est un examen qui peut être extrêmement performant, associant l'étude du parenchyme pancréatique en pondération
T1 et en T2, une étude canalaire par la cholangio-Wirsungographie par IRM, et une étude de la vascularisation par une
injection d'un produit de contraste de Gadolinium.
A l'état normal le pancréas présente un signal similaire à celui du foie en T1 comme en T2. Toute baisse du signal
pancréatique en T1 est pathologique. La richesse en contraste de l'IRM permet donc de dépister les tumeurs du pancréas
avant l'injection de Gadolinium, à la différence du scanner. A noter que cette baisse du signal pancréatique n'est pas
spécifique d'une anomalie tumorale mais peut aussi correspondre à une anomalie inflammatoire. La cholangiographie par
IRM permet de voir le retentissement sur les voies biliaires et le canal de Wirsung ; après injection il est possible d'obtenir

une étude vasculaire.
Si l'IRM est séduisante dans le bilan des cancers pancréatiques par sa grande richesse en contraste et sa visualisation du
Wirsung ainsi que des voies biliaires, la durée du temps d'acquisition supérieure à celle du scanner, et la moindre résolution
spatiale, rendent les résultats de l'IRM moins constants que ceux du scanner.
II -
CONDUITE A TENIR
1- Diagnostic
a-Détection d'un cancer du pancréas
En cas de signe clinique orientant nettement vers un cancer du pancréas, le scanner apparaît être l'examen de première
intention. En effet, il s'agit de la technique la plus diffusée, permettant une étude reproductible. Toutefois, en cas d'ictère, le
premier examen à réaliser est une échographie qui permettra rapidement de confirmer le niveau de l'obstruction.
L'une des principales difficultés pour la détection du cancer du pancréas, est que les premiers signes sont peu spécifiques.
Devant de tels signes peu spécifiques, le premier examen demandé est souvent une échographie, dont le résultat est
inconstant du fait des interpositions digestives, mais aussi du fait du caractère opérateur dépendant de la technique. Cet
examen est donc insuffisant pour mettre en évidence une petite tumeur du pancréas avec une valeur prédictive négative
suffisante. Le scanner est probablement plus sensible, mais il faut que la technique de réalisation soit stricte, avec une
étude pancréatique spécifique. Un scanner "abdominal" standard ne permettra pas de dépister une tumeur de petit
diamètre.
Pour dépister un cancer du pancréas avec espoir d'un traitement curatif, il faut diagnostiquer des petites tumeurs.
L'échographie percutanée apparaît insuffisante pour ce type de diagnostic. Il faut donc réaliser un scanner pancréatique.
Toutefois, cela impose d'avoir des signes cliniques qui orientent nettement vers une tumeur du pancréas. Or ses signes sont
habituellement tardifs, apparaissant à un stade où la tumeur ne peut plus avoir une exérèse curative. Cette problématique
explique le mauvais pronostic du cancer du pancréas.
b- caractérisation d'une masse du pancréas
Toute masse du pancréas doit avoir un scanner. Le scanner apparaît toutefois peu performant pour caractériser une masse
pancréatique. En cas de doute sur la nature d'une lésion, une IRM ou une écho-endoscopie peuvent être indiquées. L'IRM
permet de parfaitement analyser les structures liquidiennes. Le signal en T1 et la prise de contraste peuvent orienter
parfois vers la nature de la masse.
Il est possible d'individualiser plusieurs tableaux cliniques :
❍Tableau clinique évocateur de tumeurs malignes, associées à une masse solide hypovasculaire en scanner : diagnostic
d'adénocarcinome extrêmement probable.
❍
Tableau clinique n'évoquant pas une tumeur maligne, masse du pancréas ayant une composante liquidienne : intérêt d'une IRM et
d'une écho-endoscopie pour mieux approcher la caractérisation de la masse.
❍Tableau clinique en faveur d'un premier épisode de pancréatite associé à une masse du pancréas : le diagnostic différentiel entre
une tumeur du pancréas ayant entraîné une pancréatite, et une pancréatite focale est extrêmement difficile. L'IRM et l'écho-
endoscopie peuvent aider à ce diagnostic difficile.
❍Suspicion de dégénérescence sur pancréatite chronique : les remaniements du pancréas sont tels, que le diagnostic de cancer du
pancréas en cas de pancréatite chronique ne peut être réalisé que de façon extrêmement retardée par l'imagerie radiologique
(échographie, scanner, IRM). Le diagnostic positif de cancer sur pancréatite chronique, à un moment où un traitement curatif serait
encore envisageable avec ces méthodes d'imagerie, apparaît illusoire.
2- Bilan de réséquabilité
L'examen primordial de première intention est le scanner. Le radiologue doit impérativement indiquer la taille de la lésion,
l'extension en dehors du pancréas, en particulier aux axes vasculaires, et la présence ou non de métastases hépatiques. Le
scanner apparaît par contre peu performant pour les adénopathies. En cas de doute sur la réséquabilité, une écho-
endoscopie peut être réalisée. Pour le bilan de réséquabilité, l'IRM n'apparaît pas actuellement comme un examen utilisable

AFC
Siège social : 122, rue de Rennes
75006 Paris
tél : +33 (0) 1 45 44 96 77
en routine.
CONCLUSION
L'espoir de traiter de façon curative un cancer du pancréas impose la découverte d'une tumeur de petite taille, sans
extension à distance. L'examen le plus efficace, du point de vue de la disponibilité, de la reproductibilité de ses résultats et
de sa sensibilité, est le scanner spiralé. La faible reproductibilité et l'aspect opérateur dépendant de l'échographie rendent
son résultat aléatoire. Les résultats de l'IRM semblent prometteurs, mais ceux-ci ne sont pas encore validés et restent à
confirmer dans le futur.
●Anatomo pathologie (J. François Fléjou)
●Tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses (C. Partenski)
●Techniques d'éxerèse (J. Chipponi)
●Prévention des complications liées
●Petr Scan (A. Barrier)
●Les limites ganglionnaires de la DPC (J. Baulieu)
●L'écho endoscopie (M. Giovannini)
●Quel bilan nécessaire et suffisant (A. Sauvanet)
●Radiothérapie (P. Maingon)
●Les DPC palliatives (M. Huguier)
●Epidémiologie
1
/
3
100%