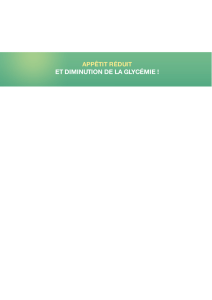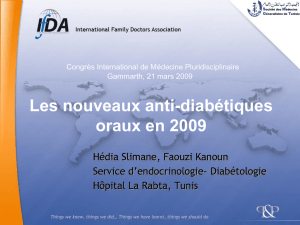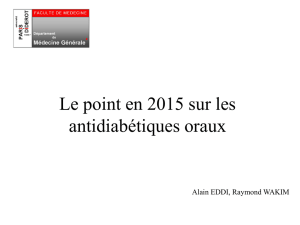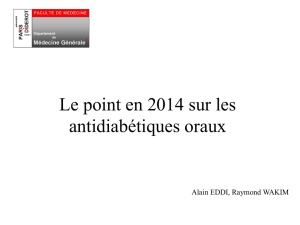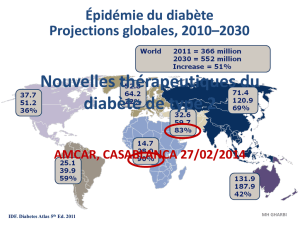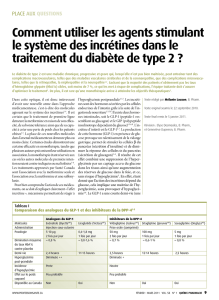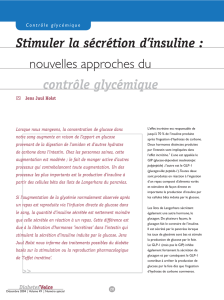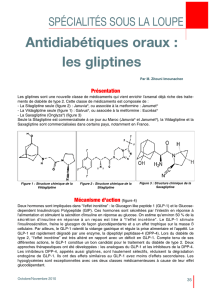GLP-1 et homéostasie glucidique : implication du système nerveux

20
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n° 1, janvier-février 2008
thématique
Dossier
L
e tractus gastro-intestinal
constitue l’organe endocrine
le plus vaste de l’organisme.
En effet, il est à l’origine de près de
vingt peptides hormonaux capables
d’influencer un nombre important
de processus physiologiques impli-
quant des tissus aussi différents que
les glandes exocrines, les muscles
lisses et le système nerveux périphé-
rique. Parmi ces peptides, les gluco-
incrétines, et plus particulièrement
le glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
sont à l’origine de molécules qui
vont représenter au cours de l’an-
née 2008 une véritable innovation
thérapeutique dans le domaine de la
diabétologie. Le principal avantage
de ces classes thérapeutiques est de
stimuler la sécrétion d’insuline de
façon adaptée en fonction du taux
glycémique. Comme nous le verrons
ici, les effets métaboliques du GLP-1
ne se résument cependant pas à une
action directe sur la cellule bêta-pan-
créatique mais font intervenir le sys-
tème nerveux autonome, qui contri-
bue donc à l’intégrité de la réponse
physiologique pancréatique.
Effet incrétine ou
démonstration du rôle
crucial de l’intestin
Il y a déjà plus d’un siècle, et 20 ans
avant la découverte de l’insuline
par Banting et Best (1922), Bayliss
et Starling (1902) puis Moore et
al. (1906) ont établi que l’injection
d’un extrait intestinal permettait de
contrôler l’hyperglycémie induite
chez des animaux de laboratoire.
À l’époque, ils conclurent que cet
effet était dépendant de l’intégrité
du pancréas et pourrait être utile au
traitement du diabète. L’effet incré-
tine a été décrit bien plus tard au
cours d’une expérience montrant
que l’insulinémie d’un sujet ayant
absorbé du glucose par voie orale
était nettement supérieure à celle
d’un sujet ayant reçu une injection
intraveineuse de glucose (1). Les
glycémies étant similaires dans les
deux circonstances, cette observation
suggérait qu’un message d’origine
intestinale était capable de favoriser
la sécrétion d’insuline en réponse au
glucose (figure 1). Parmi les peptides
intestinaux impliqués, le GLP-1 fut
identifié. Celui-ci est issu du clivage
d’une prohormone, le proglucagon,
GLP-1 et homéostasie glucidique :
implication du système nerveux
GLP-1 and glucose homeostasis: involvement of the nervous system
Rémy Burcelin*
* Inserm U858 (équipe 2), Institut de médecine
moléculaire de Rangueil, université Toulouse-III
Paul-Sabatier, IFR31, Toulouse.
Aucune donnée expérimentale ou clinique ne permet d’affirmer que
l’action directe du GLP-1 sur les cellules bêta-pancréatiques est responsable
de la globalité de l’effet stimulant de l’hormone sur l’insulinosécrétion.
Le système nerveux autonome (ou végétatif) est l’un des principaux
régulateurs intégrés des fonctions pancréatiques endocrines.
Le GLP-1 et son récepteur jouent un rôle clé dans la détection des
concentrations circulantes de glucose au niveau de la veine hépatoportale,
relayée par le système nerveux autonome pour contrôler le métabolisme
énergétique.
Le récepteur au GLP-1 est exprimé dans le cerveau où il participe direc-
tement au contrôle de la prise alimentaire et, au moins chez la souris, de
l’insulinosécrétion.
Chez la souris, l’action cérébrale du GLP-1 influence les flux métaboli-
ques en détournant le glucose utilisé par les muscles au profit du foie.
Le GLP-1 est considéré comme un neurotransmetteur, que l’on retrouve
impliqué dans le contrôle de nombreuses fonctions cérébrales telles que
les réactions émotionnelles, la mémoire et la neuroprotection.
Mots-clés : Glucagon-like peptide-1 – Cerveau – Système nerveux
végétatif – Insuline – Glucagon.
Keywords: Glucagon-like peptide-1 – Brain – Autonomic nervous
system – Insulin – Glucagon.
▲
▲
▲
▲
▲
▲
points FORTS

21
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n° 1, janvier-février 2008
Dossier
thématique
Figure 1. Le GLP-1 intestinal agit sur le système nerveux central pour contrôler les fonctions
périphériques.
Le glucose est absorbé par l’intestin, puis détecté par les senseurs de glucose de la veine hépato-
portale (1). Un signal est envoyé au cerveau via le nerf vague (2), puis redirigé vers les tissus
périphériques : vers le pancréas pour le contrôle de la sécrétion de glucagon et d’insuline, et
vers le muscle et le foie pour le contrôle de l’utilisation du glucose (3). En vert les effets positifs,
en rouge, les effets négatifs. NTS : noyau du tractus solitaire.
Hypotalamus/tronc cérébral
Muscle
Pancréas
Glucose
Détecteur entérique
1
2
3
GLP-1R
NTS
Insuline
Glucagon
synthétisée par les cellules L au
niveau de l’iléon et du côlon (2, 3).
Le GLP-1 natif subi une série de
modifications post-traductionnelles
donnant lieu à l’hormone biologique-
ment active : le GLP-1(7-36 amide).
Dans les modèles expérimentaux
comme chez l’homme, il est parfaite-
ment établi que le GLP-1 stimule la
sécrétion d’insuline par les cellules
bêta-pancréatiques (4). De plus, un
des effets remarquables du GLP-1
est d’exercer son action insulino-
sécrétrice uniquement en situation
d’hyperglycémie. Le GLP-1 serait
ainsi responsable de plus de 60 % de
la sécrétion d’insuline en réponse à
une charge orale en glucose. Au fur
et à mesure de la normalisation de la
glycémie, l’action du GLP-1 sur la
sécrétion d’insuline s’évanouit, ce qui
évite de facto l’hypoglycémie secon-
daire à l’hyperinsulinisme. De la
sorte, l’administration sous-cutanée
ou intraveineuse de GLP-1 majore la
sécrétion d’insuline uniquement chez
des patients diabétiques de type 2
présentant une glycémie élevée (5).
L’implication du récepteur au GLP-1,
qui est particulièrement exprimé par
les cellules bêta des îlots de Lange-
rhans, dans les effets pancréatiques
de ce peptide intestinal a pu être
affirmée à l’aide de souris transgé-
niques n’exprimant pas ce récepteur
(6). Comme détaillé dans ce dossier
par M. Dolz (lire p. 12), l’activa-
tion spécifique par le GLP-1 de son
récepteur à la surface des cellules
bêta-pancréatiques induit des méca-
nismes intracellulaires favorisant la
synthèse et la sécrétion d’insuline
(7, 8). Cependant, à ce jour, aucune
donnée expérimentale ou clinique ne
permet d’affirmer que cette action
directe du GLP-1 sur les cellules
bêta-pancréatiques est responsable
de la globalité de l’effet stimulant de
l’hormone sur l’insulinosécrétion.
Expérimentalement, seule une délé-
tion génique spécifique du récepteur
au GLP-1 dans les cellules bêta-
pancréatiques permettrait de déter-
miner si les effets thérapeutiques de
la molécule dépendent entièrement
de ses effets pancréatiques directs.
Contrôle des fonctions
pancréatiques
endocrines
par le système nerveux
autonome
La modulation des fonctions
pancréatiques endocrines ne se
résume pas à la détection directe des
taux glycémiques par les cellules des
îlots de Langerhans, mais implique
un système biologique intégré encore
plus complexe (figure 1) [9, 10].
Ainsi, le système neuro-végétatif
est l’un des principaux régulateurs
intégrés de la fonction pancréatique.
Les récepteurs adrénergiques, choli-
nergiques et spécifiques d’autres
neuropeptides sont exprimés par les
cellules pancréatiques, et leur impli-
cation dans la sécrétion d’insuline et
de glucagon a été établie (11, 12).
Par conséquent, le GLP-1 pourrait
contrôler la sécrétion des hormones
pancréatiques, au moins en partie par
une action sur le système nerveux.
Second argument, le GLP-1 est
synthétisé au niveau du tractus
digestif, puis collecté par les capil-
laires veineux mésentériques et la

22
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n° 1, janvier-février 2008
thématique
Dossier
Figure 2. Organisation du système nerveux entérique.
Les cellules épithéliales intestinales sont directement connectées aux neurones préganglion-
naires et postganglionnaires, dont les origines sont sympathique et parasympathique. Des
cellules du système immunitaire sont également présentes entre les plexi myentérique et sous-
muqueux.
Tronc cérébral
Système ortho-
sympathique
Système para-
sympathique
Neurones
préganglioniques
Neurones
postganglioniques
Plexus
myentérique
Plexus
sous-muqueux
Cellules
immunitaires
Entérocytes
Neurones
afférents
veine porte jusqu’au foie, donc très
loin de son site d’action insulaire. Le
troisième argument est que la demi-
vie du GLP-1 s’avère très courte,
inférieure à une minute, du fait de sa
dégradation par la dipeptidyl-pepti-
dase IV (DPP-IV), enzyme présente
dès le site de production intestinal et
dans les capillaires mésentériques.
La concentration en forme active du
peptide est donc fortement réduite
lors de son arrivée dans le sang arté-
riel de l’îlot de Langerhans (13, 14),
ce qui suggère l’importance du rôle
local de cette hormone, près de son
site de production. Le GLP-1 pourrait
agir notamment sur les terminaisons
nerveuses de la veine hépatoportale,
ou plus généralement sur le système
nerveux entérique, qui se caractérise
par un nombre de neurones équi-
valent à celui du système nerveux
central (figure 2). Du fait de sa confi-
guration, ce système nerveux spéci-
fique est très rapidement en contact
avec les nutriments hydro solubles
tels que le glucose, les acides aminés
et autres carbohydrates.
Effets du GLP-1
sur le système nerveux
Le récepteur au GLP-1 est exprimé
dans le cerveau où il participe direc-
tement au contrôle de la prise alimen-
taire. D’autre part, le GLP-1 ralentit
la motilité et la vidange gastrique,
contribuant à diminuer la quantité
d’aliments ingérés. Cet effet est pure-
ment dépendant du système nerveux
autonome, car il est totalement aboli
par une simple vagotomie (15, 16,
17-22), qui altère également l’action
du GLP-1 sur l’homéostasie gluci-
dique et sur la sécrétion d’insuline.
Notre groupe a récemment mis en
évidence le rôle du GLP-1 dans les
mécanismes de détection des concen-
trations glycémiques au niveau de
la veine hépatoportale. En effet, les
variations du taux de glucose dans
l’organisme sont détectées par des
senseurs au glucose (ou glucose
sensors) localisés au niveau de la
veine porte (23, 24), des cellules bêta
-
pancréatiques (12), des corps caro-
tidiens et des neurones entériques et
hypothalamiques (25). Ces senseurs
vont transmettre des informations
nerveuses et hormonales aux tissus
périphériques, qui adaptent immé-
diatement leur comportement vis-à-
vis de l’utilisation du glucose. Ainsi,
lorsque le glucose est absorbé par
l’intestin, un ensemble de signaux
d’origine endocrine et nerveuse est
mis en jeu (26). Le GLP-1 joue un
rôle crucial dans cette interaction
neurohormonale. Lors de l’absorption
intestinale du glucose, il est sécrété
très rapidement et stimule par une
action paracrine le système nerveux
entérique localisé dans la muqueuse
intestinale et la veine hépatoportale.
Le message issu de cette activation
est véhiculé par la branche ascen-
dante du nerf vague jusqu’au cerveau,
et en particulier jusqu’au plancher du
nœud vagal du tronc cérébral (26).
Dans le système nerveux central, le
GLP-1 a notamment été identifié dans
les corps cellulaires de neurones du
noyau du tractus solitaire (NTS) et
dans le bulbe olfactif (27). Les fibres
de ces neurones se projettent vers
de nombreuses régions cérébrales,
parmi lesquelles l’hypothalamus, où
a été localisée l’expression d’ARNm
codant pour son récepteur. Au niveau
cérébral, l’action du GLP-1 permet de
modifier l’activité du système nerveux
autonome et/ou de cellules neuro-
endocrines, ce qui aboutit notamment
à la diminution de la prise alimentaire
(28-30). Ainsi, le GLP-1 est considéré
comme un neurotransmetteur que l’on
retrouve impliqué dans le contrôle de
nombreuses fonctions cérébrales telles
que les réactions émotionnelles, la
mémoire et la neuroprotection (21).
Système nerveux
et contrôle des sécrétions
pancréatiques par le GLP-1
La régulation par le GLP-1 de la
sécrétion de glucagon pourrait en
particulier impliquer le système

23
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n° 1, janvier-février 2008
Dossier
thématique
nerveux autonome, d’autant que la
présence de récepteurs au GLP-1
sur les cellules alpha du pancréas
est actuellement très discutée. Il est
admis que la sécrétion du glucagon
est sous le contrôle du système
nerveux central (31-33). Ainsi, il est
concevable que la réduction des taux
circulants de glucagon par le GLP-1
chez le diabétique de type 2, origi-
nalité des traitements fondant leur
stratégie sur le concept des gluco-
incrétines (34, 35), puisse s’expli-
quer par un mécanisme indirect
impliquant son action sur le cerveau
(figure 1).
Concernant le contrôle de la sécré-
tion d’insuline, la contribution
relative de l’action indirecte du
GLP-1 via le cerveau et de son
action directe sur le pancréas n’est
pas connue chez l’homme. Cepen-
dant, les travaux récents de notre
laboratoire montrent que les effets
centraux du GLP-1 tiennent une
place prépondérante dans l’aug-
mentation de la sécrétion d’insuline
en réponse à l’administration intes-
tinale de glucose chez le rongeur
(36). En effet, chez des souris rece-
vant une charge glucosée intravei-
neuse, la sécrétion d’insuline était
majorée de plus de quatre fois
lorsqu’un analogue du GLP-1 était
simultanément administré dans
le cerveau. Inversement, bloquer
l’action centrale du GLP-1 par
l’administration cérébrale d’un
antagoniste du récepteur au GLP-1
inhibait l’effet incrétine, caractérisé
par la réponse insulinosécrétoire à
une charge orale en glucose. Bien
que la validation de ces données
semble difficilement envisageable
en recherche clinique, ces obser-
vations expérimentales démontrent
que plusieurs routes sont emprun-
tées par le GLP-1 pour le contrôle
de l’homéostasie glucidique.
Dans d’autres expériences menées
chez la souris, nous avons pu montrer
que l’action cérébrale du GLP-1
influençait les flux métaboliques
en détournant le glucose utilisé par
les muscles au profit du foie (36).
Ainsi, dans des conditions d’hyper-
insulinémie et d’hyperglycémie,
l’action simultanée du GLP-1 dans
le cerveau diminue l’utilisation du
glucose par les muscles, aboutissant
à renforcer très significativement la
synthèse de glycogène par le foie. Ce
mécanisme fait intervenir le système
nerveux autonome en tant que relais
du système nerveux central.
D’autres travaux ont révélé le rôle
clé du GLP-1 et de son récepteur
dans la détection des concentrations
circulantes de glucose au niveau de
la veine hépatoportale, relayée par
le système nerveux autonome pour
contrôler le métabolisme énergé-
tique. L’administration de perfusions
de glucose dans la veine hépatorpor-
tale de souris, destinée à activer le
détecteur correspondant au glucose,
augmente l’utilisation musculaire du
glucose par des mécanismes mettant
en jeu les systèmes nerveux auto-
nome et central, indépendamment de
la sécrétion d’insuline (13, 23). Or,
l’effet du glucose dans la veine hépa-
toportale n’était pas observé chez des
souris n’exprimant pas le récepteur
au GLP-1. Similairement, la perfu-
sion d’un antagoniste du récepteur
au GLP-1 directement dans la veine
porte de souris saines prévenait l’ac-
tivation du détecteur du glucose de
la veine hépatoportale. Ces résultats
montrent clairement l’importance du
GLP-1 entérique dans le contrôle de
l’homéostasie glucidique (37).
De manière intéressante, l’action du
GLP-1 sur le système nerveux pour-
rait également concerner la sécrétion
de GLP-1 lui-même. En effet, nos
travaux récents montrent que la délé-
tion du gène codant pour le récep-
teur au GLP-1 affecte la sécrétion du
peptide chez la souris. Cette action
pourrait être d’ordre autocrine, mais
l’expression du récepteur au GLP-1
par les cellules L n’a pas été montrée
à ce jour. En revanche, il est conce-
vable que l’action du GLP-1 sur le
système nerveux puisse contribuer
à sa propre sécrétion via un méca-
nisme indirect impliquant le nerf
vague.
Conclusion
L’avènement de nouvelles classes
médicamenteuses inspirées par les
effets pancréatiques du GLP-1 va
considérablement enrichir l’arsenal
thérapeutique destiné aux diabéti-
ques de type 2. La perspective d’une
régulation plus physiologique de
la sécrétion d’insuline, adaptée au
contexte glycémique concomitant,
et l’impact spécifique sur l’hyper-
glucagonémie, sont particulière-
ment enthousiasmants. Cependant,
les deux stratégies qui visent à
augmenter pharmacologiquement la
concentration circulante de GLP-1,
soit via l’injection d’agonistes du
récepteur, soit via l’inhibition de
sa dégradation en bloquant l’action
de la DPP-IV, pourraient diverger
concernant certains de leurs effets.
Effectivement, les agonistes ne
peuvent restaurer le gradient de
concentration en GLP-1 entre la
région mésentérique/portale et la
périphérie, alors que les inhibiteurs
favorisent la production de GLP-1
sur le site de synthèse. Cette dernière
approche devrait permettre au GLP-
1 endogène de maintenir son action
sur les détecteurs hépatoportaux et
de transmettre un effet nerveux qui
contribue certainement en grande
partie aux effets métaboliques des
gluco-incrétines. ■
Références bibliographiques
1.
Perley M, Kpnis D. Plasma insulin responses to
oral and intravenous glucose: studies in normal and
diabetic subjects. J Clin Invest 1967;46:1954-62.
2.
Mojsov S, Kopczynski MG, Habener JF. Both
amidated and nonamidated forms of glucagon-
like peptide-1 are synthesized in the rat intestine
and the pancreas. Journal of Biological Chemistry
1990;265:8001-8.
3.
Mojsov S, Weir GC, Habener JF. Insulinotropin:
glucagon-like peptide-1 (7-37) co-encoded in the
glucagon gene is a potent stimulator of insulin
release in the perfused rat pancreas. J Clin Invest
1987;79:616-9.
4.
Holst JJ. The physiology of glucagon-like pep-
tide-1. Physiol Rev 2007;87:1409-39.
5.
Nauck MA, Wollschlager D, Werner J, Holst
JJ et al. Effects of subcutaneous glucagon-like
peptide-1 (GLP-1 [7-36 amide]) in patients with
NIDDM. Diabetologia 1996;39:1546-53.

24
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n° 1, janvier-février 2008
thématique
Dossier
6.
Scrocchi LA, Brown TJ, MaClusky N et al. Glu-
cose intolerance but normal satiety in mice with a
null mutation in the glucagon-like peptide-1 recep-
tor gene. Nature Medicine 1996;2:1254-8.
7.
Thorens B. Expression cloning of the pancreatic
beta cell receptor for the gluco-incretin hormone
glucagon-like peptide-1. Proc Natl Acad Sci USA
1992;89:8641-5.
8.
Weir GC, Mojsov S, Hendrick GK, Habener JF.
Glucagon-like peptide-1 (7-37) actions on endo-
crine pancreas. Diabetes 1989;38:338-42.
9.
Burcelin R, Thorens B. Pancreatic beta-cell glu-
cokinase, insulin secretion, and glucose homeosta-
sis. Curr Op Endocrinol Diab 1997;4:256-61.
10.
Matschinsky FM. Regulation of pancreatic
beta-cell glucokinase: from basics to therapeutics.
Diabetes 2002;51(Suppl.3):S394-404.
11.
Schuit FC. Factors determining the glucose
sensitivity and glucose responsiveness of pancreatic
beta-cells. Hormone Research 1996;46:99-106.
12.
Schuit FC, Huypens P, Heimberg H, Pipeleers
DG. Glucose sensing in pancreatic beta-cells:
a model for the study of other glucose-regulated
cells in gut, pancreas, and hypothalamus. Diabetes
2001;50:1-11.
13.
Burcelin R, Cani PD, Knauf C. Glucagon-
like peptide-1 and energy homeostasis. J Nutr
2007;137:2534S-2538S.
14.
Deacon CF. Circulation and degradation of
GIP and GLP-1. Horm Metab Res 2004;36:761-5.
15.
Jin SL, Han VK, Simmons JG et al. Distribu-
tion of glucagonlike peptide-1 (GLP-1), glucagon,
and glicentin in the rat brain: an immunocytoche-
mical study. Journal of Comparative Neurology
1988;271:519-32.
16.
Yamamoto H, Lee CE, Marcus JN et al.
Glucagon-like peptide-1 receptor stimulation
increases blood pressure and heart rate and acti-
vates autonomic regulatory neurons. J Clin Invest
2002;110:43-52.
17.
Alvarez E, Roncero I, Chowen JA, Thorens B,
Blazquez E. Expression of the glucagon-like pep-
tide-1 receptor gene in rat brain. Journal of Neu-
rochemistry 1996;66:920-7.
18.
Goke R, Larsen PJ, Mikkelsen JD, Sheikh
SP. Distribution of GLP-1 binding sites in the rat
brain: evidence that exendin-4 is a ligand of brain
GLP-1 binding sites. European Journal of Neuros-
cience 1995;7:2294-300.
19.
Shimizu I, Hirota M, Ohboshi C, Shima K.
Identification and localization of glucagon-like
peptide-1 and its receptor in rat brain. Endocrino-
logy 1987;121:1076-82.
20.
Larsen PJ, Tang-Christensen M, Holst JJ,
Orskov C. Distribution of glucagon-like peptide-1
and other preproglucagon-derived peptides in the
rat hypothalamus and brainstem. Neuroscience
1997;77:257-70.
21.
During M, Cao L, Zuzga D et al. Glucagon-
like peptide-1 receptor is involved in learning and
neuroprotection. Nat Med 2003;9:1173-9.
22.
Goke R, Larsen PJ, Mikkelsen JD, Sheikh SP.
Identification of specific binding sites for gluca-
gon-like peptide-1 on the posterior lobe of the rat
pituitary. Neuroendocrinology 1995;62:130-4.
23.
Burcelin R, Da Costa A, Drucker D, Thorens B.
Glucose competence of the hepatoportal vein sen-
sor requires the presence of an activated glucagon-
like peptide-1 receptor. Diabetes 2001;50:1720-8.
24.
Burcelin R, Dolci W, Thorens B. Portal glucose
infusion in the mouse induces hypoglycemia. Evi-
dence that the hepatoportal glucose sensor stimula-
tes glucose utilization. Diabetes 2000;49:1635-42.
25.
Levin BE, Routh VH, Kang L, Sanders NM,
Dunn-Meynell AA. Neuronal glucosensing: what do
we know after 50 years? Diabetes 2004;53:2521-8.
26.
Adachi A. Electrophysilogical study of hepa-
tic vagal projection to the medulla. Neurosci Lett
1981;24:19-23.
27.
Shughrue PJ, Lane MV, Merchenthaler I.
Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP1-R)
mRNA in the rat hypothalamus. Endocrinology
1996;137:5159-62.
28.
Turton MD, O’Shea D, Gunn I et al. A role for
glucagon-like peptide-1 in the central regulation of
feeding. Nature 1996;379:69-72.
29.
Tang-Christensen M, Larsen PJ, Goke R et al.
Central administration of GLP-1-(7-36 amide)
inhibits food and water intake in rats. Am J Physiol
1996;271:R848-856.
30.
Tang-Christensen M, Vrang N, Larsen PJ.
Glucagon-like peptide containing pathways in the
regulation of feeding behaviour. Int J Obes Relat
Metab Disord 2001;25(Suppl.5):S42-47.
31.
Unger RH. Glucagon physiology and patho-
physiology in the light of new advances. Diabeto-
logia 1985;28:574-8.
32.
Cryer P. Glucose counterregulation in man.
Diabetes 1981;30:261-4.
33.
Burcelin R, Thorens B. Evidence that extrapan-
creatic GLUT2-dependent glucose sensors control
glucagon secretion. Diabetes 2001;50:1282-9.
34.
Ahren B. GLP-1 and extra-islet effects. Horm
Metab Res 2004;36:842-5.
35.
Gallwitz B. Exenatide in type 2 diabetes: treat-
ment effects in clinical studies and animal study
data. Int J Clin Pract 2006;60:1654-61.
36.
Knauf C, Cani P, Perrin C et al. Brain gluca-
gon-like peptide-1 increases insulin secretion and
muscle insulin resistance to favor hepatic glycogen
storage. J Clin Invest 2005;115:3554-63.
37.
Preitner F, Ibberson M, Franklin I et al. Gluco-
incretins control insulin secretion at multiple levels
as revealed in mice lacking GLP-1 and GIP recep-
tors. J Clin Invest 2004;113:635-45.
Un supplément (AHA 2007) de 8 pages est routé avec ce numéro.
Les articles publiés dans “Métabolismes-Hormones-Diabètes et Nutrition” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© octobre 1997 - DaTeBe SAS
Imprimé en France - Axiom Graphic SAS - 95830 Cormeilles-en-Vexin - Dépôt légal à parution
1
/
5
100%