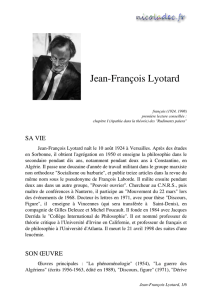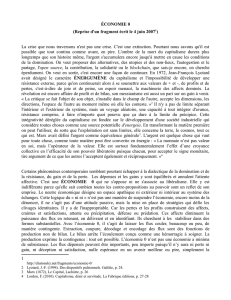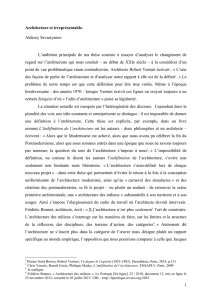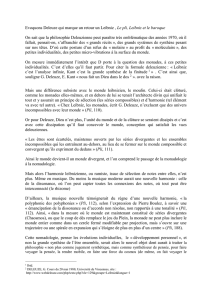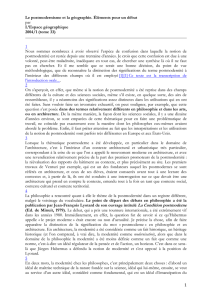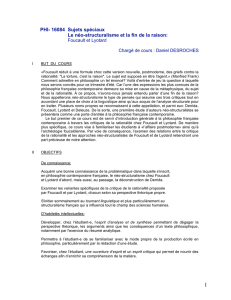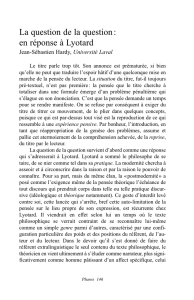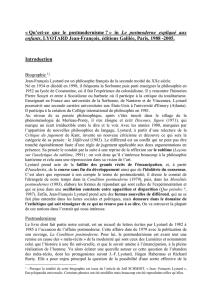Lyotard, le postmodernisme et le problème du sujet

Lyotard, le postmodernisme et le problème du
sujet1
Anne Elisabeth Sejten
Le seul nom de Lyotard suffit pour nous faire signe d’une méfiance
profonde à l’égard de ce qu’on nomme habituellement – mais cer-
tainement avec bien trop de conformisme – la philosophie du sujet. Avec
d’autres noms prestigieux de la pensée française, celui de Lyotard
s’inscrit dans une recherche de tout ce qui peut déstabiliser le sujet,
l’altérer, le déposséder, le hanter (que ce soit dans son sein même); bref,
toujours est-il qu’il faut récuser le sujet dans l’usage trop sûr qu’il peut
faire de lui-même. D'où cette mobilisation d’instances capables de faire
basculer le sujet sous des forces supérieures, que ce soient celles du
« figural », du « désir », de « l’autre » ou quel ait été le terme pour
désigner une puissance dont plutôt dériverait le sujet qu’il en serait le
maître.
Ce même nom de Lyotard signale également une réflexion sur ce
qu’il a lui-même appelé la condition postmoderne, si bien que «le
postmodernisme » est l’étiquette qu’on colle souvent à sa pensée, comme
on le fait en général à une partie plus ou moins déterminée de la pensée
française, mais là aussi avec trop de conformisme, car qu’est-ce que ça
veut dire, au fond, « postmodernisme », « postmodernité » ou, ce qui est sans
doute plus conforme avec l’usage dont fait Lyotard, « le postmoderne » ?
En effet, on sait combien la valeur des étiquettes est toute relative, et
pourtant, cela ne fait aucun doute que le thème du postmoderne coïncide
1Texte d’une conférence donnée au Département de littérature comparée à
l’Université de Montréal, organisée par Wladimir Krysinski, en mai 2000. Il
reprend certains éléments d’une autre conférence, ”De l’esthétique au politique :
quel sujet”, prononcée au Colloque ”Lyotard, art et Kosova. Le Différend :
implications en esthétique et en éthique” à l’Académie Royale des Beaux-arts de
Copenhague, organisé sur l’initiative de Carsten Juhl par l’Ambassade de France
au Danemark et l’Académie Royale des Beaux-Arts, en février 2000.

34 ANNE ELISABETH SEJTEN
avec une critique virulente de cette philosophie de l’histoire, qui pose
l’homme comme sujet de l’histoire.
Dans La Condition postmoderne (1979),qui est peut-être celui des
livres de Lyotard qui est le plus connu (ayant fait le plus de bruits), mais
qui en est aussi le moins représentatif, Lyotard avance effectivement sa
thèse, quelque peu provocatrice, sur le déclin des grands récits. Les
discours du savoir, de Hegel à Marx, sont des grands récits, dit-il, parce
qu’ils véhiculent en réalité, dans leur sein même, une structure narrative;
ils racontent une histoire, par exemple celle du progrès de l’humanité
vers le mieux. Donc, ilyaeneux, un telos caché qui ne peut être validé
en termes de sciences. Et non seulement les philosophies de l’histoire
confondent science et idéalité, mais, ce qui devient de plus en plus
intolérable, l’histoire réelle, histoire atrocement réelle, ne fait que les
contredire par les crimes qu’elle n’a cessé de faire contre l’humanité.
Or ce qui a provoqué, voire aggravé, dans un contexte spécifi-
quement postmoderne, la crise de légitimation dans laquelle peut se
trouver la philosophie de l’histoire, ce n’est pas seulement le démenti par
la réalité, mais le ”nouveau” savoir technologique. La philosophie de
l’histoire est récusée sur un autre front aussi, dans la mesure où le
développement technologique et les sciences elles-mêmes semblent
participer activement à sa destitution. Les ”techno-sciences” et leur
capacité inédite de mémoriser un nombre toujours plus élevé de données
portent atteinte aux notions d’histoire, de mémoire et de temps, sur
lesquelles s’appuie toute philosophie du sujet. Ne nous attardons
cependant pas trop à ces idées – quelque peu révolues – sur le postmo-
derne; ce qui nous intéresse par contre, c’est que l’irruption dans l’œuvre
de Lyotard d’une problématique postmoderne semble coïncider avec
l’émergence d’un problème jusque là plutôt écarté – écarté surtout par la
radicalité de sa pensée libidinale antérieure, et ce problème, c’est celui du
sujet.
Même l’analyse du marxisme comme exemple d’un grand récit
(récitant la victoire du prolétariat et la société sans classes à venir) ne
justifie ni l’indifférence, ni l’insouciance, ni la désillusion totales, comme
si, désormais, il n’y avait plus rien à penser. Lorsque Lyotard lance le défi

Lyotard, le postmodernisme et le problème du sujet 35
postmoderne, il ne s’agit pas simplement d’un règlement de comptes avec
la philosophie du sujet et de l’histoire, règlement de comptes qui plutôt
précèderait son œuvre entière. Il s’agit de beaucoup plus, mais ce qui est
difficile à comprendre, c’est que ce plus est plutôt un moins, un presque
rien. Ainsi, sur le plan philosophique plus implicite du postmoderne,
Lyotard lance un défi à la pensée d’être sensible – et cela dans un sens
presque auditif - en prêtant oreille à quelque chose qui plus que jamais
est réduit au silence par et dans la réalité dite postmoderne, réalité qui
justement neutralise ce qui est réel, qui tue l’événement. Et c’est ici que
le problème du sujet se pose, car quelle serait, plus précisément, l’instance
subjective capable de relever un tel défi ?
En tout cas, il est certain que le postmoderne a causé bien plus de
difficultés à Lyotard qu’il lui a facilité la vie. On s’étonne parfois de ce
qu’il ne s’en soit pas complètement débarrassé, mais on voit bien qu’il lui
importe de sauver la question du postmoderne, bien que le terme se soit
vite médiatisé et investi par toute sorte d’idéologie. Or si le problème
postmoderne lui tient à cœur, c’est précisément parce qu’il y demeure
quelque chose à penser. D’où les maintes tentatives de la part de Lyotard
pour s’expliquer que ce soit de façon implicite, par l’orientation philoso-
phique nouvelle que va prendre son œuvre avec et à partir du Différend,
ce livre majeur qui parut en 1984 – ou que ce soit de façon explicite, par
les nombreux articles consacrés au thème du postmoderne, et dont les
plus premiers sont réunis dans Le postmoderne expliqué aux enfants, paru
en 1986. Se joignent, à cet empressement autour du postmoderne, d’autres
articles avec la publication plus tard de L’inhumain (1988) et de Moralités
postmodernes (1993).
Or chaque fois que Lyotard s’explique, le problème du sujet
s’annonce, de loin ou de près, même si c’est de façon souterraine,
négative. Je voudrais donc relever ici trois moments dans lesquels une
telle pensée autre du sujet ose s’exposer : d’abord dans la conception que
Lyotard se fait du politique dans Le Différend, ensuite dans l’intérêt qu’il
porte, chez Freud, à l’affect inconscient et au refoulement primaire, et
enfin, et surtout, dans sa réécriture du sensus communis kantien.

36 ANNE ELISABETH SEJTEN
I
Voici donc une première hypothèse, associée au Différend : la pensée du
différend, qui succède à celle de l’économie libidinale, ferait appel, en
fonction même du problème du différend qu’elle pose, à une méditation
profonde sur le sujet. Bien sûr, il est vrai que ce livre si dense de Lyotard
obéit, lui aussi, au refus du sujet. Lyotard, en tout cas, y fait de son
mieux pour ne pas parler des facultés de Kant dont il s’inspire, parce que,
précisément, les facultés présupposent le sujet, ce sujet-esprit qui fait
usage de la raison, qui se sert souverainement des possibilités à connaître,
à vouloir, à juger qu’il trouve en lui. C’est pourquoi Lyotard substitue
aux facultés kantiennes toute une philosophie de langage, cette philoso-
phie assez compliquée des phrases qui n’accepte qu’un seul présupposé,
qui n’est pas celui du sujet, mais celui-ci : il y a du langage, et c’est tout;
il y a des phrases qui arrivent, et il faut faire avec. Enchaîner, dit-il. Au
lieu des facultés, Lyotard préfère donc parler de genres de discours qui
plutôt que de le présupposer produiraient le sujet, le poseraient dans une
situation langagière déjà orientée, déjà structurée.
Il n’empêche que la problématique du différend elle-même
– comment enchaîner des phrases en l’absence d’un genre de discours
universel ? – amène Lyotard à évoquer un sujet double. Si le différend,
en général, renvoie à un conflit structurel entre deux individus qui ne
parlent pas le même langage, ce conflit se trouve aussi à l’intérieur du
sujet lui-même. Il y a dans le sujet deux sujets distincts : un sujet qui sent
et un sujet qui parle, et entre les deux il y a tension, différend. Le sujet qui
sent reçoit des phrases dont l’autre, le sujet qui parle, ignore le des-
tinateur. Il ne peut donc pas être sûr qu’il s’agit là de son idiome à lui.
La situation est celle-ci : « quelque chose semble affecter le “sujet” qui ne
procède pas de lui »2. Voilà pourquoi le sujet est une « unité toujours
menacée »3, car dès que le sujet qui sent est pris en charge par le sujet
qui parle, celui-ci court le risque de parler dans son idiome de quelque
2Le différend, Paris, Minuit, 1983, p. 101.
3Ibid.

Lyotard, le postmodernisme et le problème du sujet 37
chose qui n’est pas venu au sujet sous la même forme idiomatique.
Autrement dit, comment s’assurer de ce que la phrase-langage ne fasse
pas tort à la phrase sentimentale, à la phrase matière ? C’est là l’un des
gros problèmes du différend.
Or, il y a un champ traité par Lyotard dans Le différend qui fait
preuve d’une attitude favorable au sujet sensible. C’est le cas de la
politique. En effet ce qui frappe, c’est la place exceptionnelle que Lyotard
semble accorder à la politique. La politique, grande surprise, n’est pas un
genre de discours.4Rappelons que le genre de discours se définit par une
finalité interne qui oriente toutes les manifestations du discours (que
Lyotard donc nomme phrases) vers une fin à réaliser. C’est pourquoi
l’enchaînement des phrases n’est pas libre, mais motivé par l’omniprésen-
ce d’une fin plus ou moins précise. Or, rien de tel dans la politique. Bien
au contraire, face à la relative stabilité des genres de discours spéculatif,
narratif et éthique, chacun poursuivant le but qui est le leur, Lyotard
insiste sur l’éclatement de la politique. Bien sûr, la politique existe aussi
sous forme des genres de discours, à savoir en tant qu’idéologies et
institutions politiques, mais ce n’est pas là l’essentiel de son enjeu. La
politique, c’est « la multiplicité des genres, la diversité des fins, et par
excellence la question de l’enchaînement »5. C’est dire que le champ de
la politique se situe entre les genres de discours, dans les intervalles qui
d’un genre à l’autre sont bourrés de différends. D’où son caractère
problématique : l’enchaînement des phrases n’est pas donné par avance,
mais encore indéterminé et ouvert. Face à la programmation en quelque
sorte interne des genres, la politique est, en toute évidence, le lieu de
l’incertitude, « la menace du différend ».6
S’il est vrai que la politique est la question de l’enchaînement par
excellence, c’est-à-dire qu’elle s’autorise à partir d’une incertitude franche
4Pour une étude plus approfondie, voir mon article « Politique négative, Lyotard,
les déplacements philosophiques » (éd. Brügger et Frandsen), Bruxelles, De Boeck,
1993, pp. 55-58.
5Le différend, op. cit., § 190, 200.
6Ibid.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%