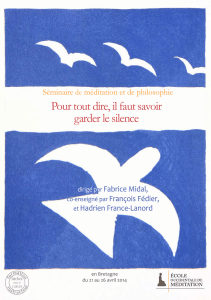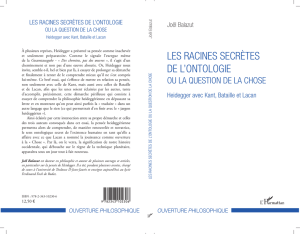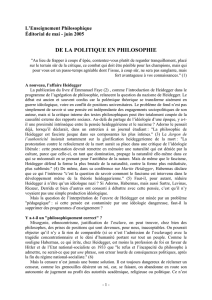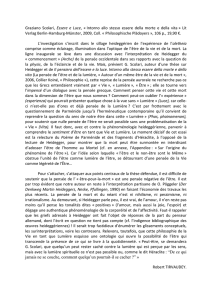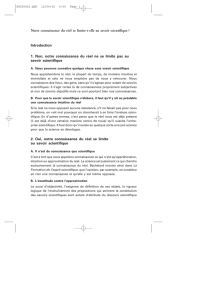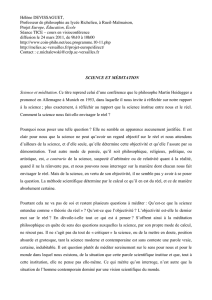Heidegger en dialogue

LE MONDE ANIMAL : HEIDEGGER ET VON UEXKÜLL
Mystère de la vie, qui est sa simplicité 1.
Dans Les concepts fondamentaux de la métaphysique, la question de
l’être de l’animalité est abordée par Heidegger dans un dialogue constant,
bien qu’assez souvent implicite, avec la biologie de son temps et tout
particulièrement avec l’œuvre de Jakob von Uexküll. Les allusions à celle-
ci, nombreuses tout au long du texte, ne sont nullement extérieures à son
propos ; bien des thèses de Heidegger ne peuvent être mises à l’épreuve et
discutées si l’on n’aperçoit pas d’abord en quel point elles se démarquent
d’une biologie et d’une zoologie qui sont déjà elles-mêmes d’inspiration
phénoménologique.
Le centre de gravité du cours de 1929-30, comme Heidegger y insiste,
réside dans ses développements sur l’essence de l’animalité 2. Pourtant, les
Grundbegriffe s’ouvrent par une vaste et minutieuse analyse de l’ennui.
Quel est exactement le lien entre ces deux thématiques apparemment hété-
rogènes ? Qu’est-ce qui assure l’unité même de la problématique du cours ?
Il s’agit, pour Heidegger, d’introduire à la métaphysique au sens tout à fait
spécifique qu’il accorde à ce terme au tournant des années trente, non pas
celui d’une discipline scolaire, historiquement attestée, mais celui d’une
manière fondamentale de questionner qui s’enracine dans la constitution
ontologique du Dasein comme transcendance. Les trois questions de la
métaphysique (Qu’est-ce que le monde ? Qu’est-ce que la finitude ? Qu’est-
ce que la solitude ?) ne peuvent être posées dans toute leur radicalité que si
1. H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Hermeneutik, I, Wahrheit und Methode,
Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990, p. 34 ; trad. fr. P. Fruchon, J. Grondin et
G. Merlio, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p. 45.
2. M. Heidegger, Ga., 29/30, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Francfort,
Klostermann, 1992, p. 268 ; trad. D. Panis, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique,
Paris, Gallimard, 1992, p. 272. Cette traduction sera parfois modifiée.

256 CLAUDE ROMANO
s’éveille dans le Dasein une disposition affective (Stimmung) en vertu de
laquelle lui-même est impliqué dans les questions qu’il pose ; donc si le
Dasein se trouve en quelque sorte replacé, au moyen d’une Stimmung
fondamentale, devant l’appartenance de la métaphysique à son essence.
Car la métaphysique n’est nullement étrangère à son être, comme le
signalait déjà « Qu’est-ce que la métaphysique ? » : « Le Dasein humain ne
peut se rapporter à de l’étant que s’il se tient instant dans le rien. Le passage
au-delà de l’étant advient dans l’essence du Dasein. Mais ce passage au-
delà est la métaphysique même. D’où il découle ceci : la métaphysique
appartient à la “nature de l’homme” […]Elle est le Dasein lui-même » 1.
Mais alors, pourquoi privilégier ainsi la disposition affective de l’ennui,
et non pas l’angoisse, par exemple, qui était seule à mériter dans Sein und
Zeit le titre de Grundbefindlichkeit, d’affection fondamentale ? On ne peut
répondre à cette question que si l’on comprend le lien qui existe, dans ce
cours, entre l’ennui et le problème de l’animalité. Ce qui caractérise
l’ennui, notamment dans sa forme la plus profonde, que Heidegger
rapproche de la mélancolie, c’est une forme d’envoûtement (Gebanntheit)
par l’étant en totalité qui, pourtant, dans le même temps, se retire et se
refuse, quelque chose comme une hébétude, une fascination, une stupeur.
Dans l’ennui, écrit Heidegger, « nous sommes pris (hingenommen) par les
choses, si ce n’est perdus (verloren) en elles, souvent même hébétés
(benommen) par elles » 2. Songeons au regard absent du personnage de la
célèbre gravure de Dürer « Mélancolie I » : ce regard perdu dans le vide, qui
ne se pose sur rien et que rien ne parvient à retenir. Telle est la stupeur
mélancolique qu’Aristote déjà caractérisait par la môrôsis, l’hébétude :
ceux qui sont affectés d’un excès de bile noire, écrit-il, « sont en proie à la
torpeur et à l’hébétude (nôthroi kai môroi) » 3. Cette torpeur, cette stupeur
sont exprimées en Allemand par ce qui va constituer, à bien des égards, la
notion-pivot de tout le cours : la Benommenheit. C’est au moyen de ce
terme que sera déterminée, en effet, l’essence de l’animalité. Dès lors,
la problématique d’ensemble du cours peut être dégagée de la manière
suivante : « Ce qui apparaîtra est la façon dont cette disposition affective
fondamentale [l’ennui] et tout ce qu’elle implique doit se détacher par
contraste sur ce que nous avons prétendu être l’essence de l’animalité, à
savoir l’hébétude (Benommenheit). Ce contraste deviendra pour nous
1. M. Heidegger, Was ist Metaphysik ?, Ga., 9, Wegmarken, F.-W. von Herrmann (éd.),
Francfort, Klostermann, 21996, p. 122 ; trad. fr. R. Munier (modifiée) in Martin Heidegger,
Paris, L’Herne, 1983, p. 56.
2. M. Heidegger, Ga. 29/30, p. 153 ; trad. cit., p. 158.
3. Aristote, Problemata, XXX, 954 a 31.

LE MONDE ANIMAL : HEIDEGGER ET VON UEXKÜLL 257
d’autant plus décisif que l’essence de l’animalité, l’hébétude, viendra en
apparence dans le plus immédiat voisinage de ce que nous avons défini
comme étant une caractéristique de l’ennui profond, et que nous avons
appelé l’envoûtement (Gebanntheit) du Dasein au sein de l’étant en entier.
Il apparaîtra en fait que ce voisinage le plus immédiat des deux consti-
tutions d’être n’est qu’une tromperie, qu’il y a entre elles un abîme
qu’aucune médiation ne peut, en quelque sens que ce soit, permettre de
franchir » 1.
Tout le questionnement du cours repose sur cette proximité apparente et
même « trompeuse » de l’homme et de l’animal. Livré à l’ennui profond et
sans bornes, l’homme, à l’instar de l’animal, paraît frappé d’une espèce de
stupeur. Ils sont donc au plus près. Et pourtant, justement en vertu de cette
proximité, il sont en réalité au plus loin. Car cette proximité est justement ce
qui fait ressortir la distance abyssale qui les sépare, et qui sépare par consé-
quent deux sens possibles de l’hébétude. L’accaparement (Benommenheit)
de l’animal par ce qui aimante ses pulsions n’a rien à voir (et pourtant il
ressemble) avec l’envoûtement dans lequel l’ennui sans fond plonge le
Dasein. C’est dans la proximité la plus grande que se révèle aussi la
différence la plus profonde.
Cette différence est d’abord la différence entre deux acceptions
irréductibles du « monde ». L’environnement animal n’est pas le monde
humain. Voilà ce qu’il s’agit de montrer. Plus précisément, le mouvement
d’ensemble du texte est un mouvement en forme de chiasme : il s’agit
d’établir dans un premier temps que la détermination traditionnelle
de l’homme comme animal rationnel est insuffisante pour comprendre
l’essence de la disposition affective, par exemple de l’ennui, et, à travers
elle, pour déterminer l’être du Dasein comme tel : « Cette conception de
l’homme comme être vivant qui est ensuite doté d’une raison a conduit
à une entière méconnaissance de l’essence de la disposition affective » 2.
Ainsi, l’analyse de la « disposition fondamentale » de l’ennui va pro-
curer un éclaircissement préliminaire sur la constitution ontologique
de l’homme, c’est-à-dire sur le Dasein. Selon un mouvement symétrique,
cette nouvelle détermination de l’essence de l’homme va rejaillir en
direction d’une nouvelle détermination de l’essence de l’animalité, donc
d’une compréhension entièrement renouvelée des rapports entre la simple
« vie » et l’existence.
1. M. Heidegger, Ga., 29/30, p. 409 ; trad. cit., p. 409.
2. Ibid., p. 93 ; trad. cit., p. 101.

258 CLAUDE ROMANO
L’ORIGINALITÉ DES GRUNDBEGRIFFE DANS L’ITINÉRAIRE DE HEIDEGGER
L’originalité du cours de 1929-30 réside en premier lieu dans sa thèse
bien connue selon laquelle « l’animal est pauvre en monde ». Mais que
signifie cette thèse ? Comment la comprendre ? Et qu’est-ce qui fait sa
spécificité, non seulement par rapport à la thèse de von Uexküll selon
laquelle l’animal possède un monde ambiant (Umwelt), que par rapport à
l’anthropologie traditionnelle qui distingue l’homme de l’animal au moyen
d’une différence spécifique, le logos, la politique, l’esprit ou la liberté ? Il
n’est pas possible de commencer de répondre à ces questions si l’on
n’aperçoit pas d’abord la singularité des Grundbegriffe dans l’itinéraire de
pensée de Heidegger. Au regard de cet itinéraire, son affirmation centrale
constitue, en effet, un hapax. Elle n’a à proprement parler d’équivalent ni
dans les textes antérieurs ni dans l’œuvre ultérieure du philosophe. Cette
originalité se manifeste sur deux plans, d’ailleurs étroitement liés : celui du
statut du « monde » animal, celui des rapports entre philosophie et biologie.
Il suffit à cet égard de rapprocher les formulations des Concepts
fondamentaux de celles que l’on trouve, par exemple, dans les Conférences
de Cassel de 1925. Heidegger y apparaît beaucoup plus enclin qu’il ne le
sera par la suite à rapprocher, plutôt qu’à séparer, le monde humain de celui
de l’animal, employant d’ailleurs le même terme pour les caractériser tous
deux, celui de « Welt » :
Tout être vivant a son monde ambiant (seine Umwelt) non comme quelque
chose de subsistant (vorhanden) à côté de lui, mais [comme quelque chose]
qui lui est ouvert, qui est là, à découvert (für ihn erschlossen, aufgedekt da
ist). Ce monde (Welt) peut être simple (einfach) (pour un animal primitif).
Mais la vie et son monde ne sont jamais deux choses juxtaposées comme
deux chaises côte à côte, la vie « a » au contraire son monde. Cette connais-
sance commence aussi à pénétrer progressivement la biologie. On réfléchit
sur la structure fondamentale de l’animal. Mais l’essentiel est manqué si
je ne vois pas que l’animal a un monde (das Tier eine Welt hat). De même,
nous sommes également toujours dans un monde, de telle sorte qu’il nous
est ouvert. Un objet, par exemple une chaise, est simplement disponible
(vorhanden). Mais toute vie est là de telle sorte qu’un monde est également
là pour elle 1.
Non seulement Heidegger, dans ce texte, n’hésite pas à attribuer un
monde à l’animal, mais il prête à ce dernier une ouverture (Erschlossenheit)
au monde dans un lexique qu’il réservera plus tard, dans Sein und Zeit, à la
1. M. Heidegger, Conférences de Cassel, éd. bilingue, trad. fr. J-Cl. Gens, Paris, Vrin,
2003, p. 178-179.

LE MONDE ANIMAL : HEIDEGGER ET VON UEXKÜLL 259
vérité dans son sens le plus originaire, en tant qu’elle rend possible l’être-à-
découvert (Entdecktheit) de l’étant. Dans ce contexte, Heidegger stipule
une différence entre le monde des animaux « primitifs », qu’il qualifie de
« simple » (einfach) – mais nullement de « pauvre » – et celui des animaux
supérieurs. Enfin, il mentionne en termes laudatifs la biologie de son
époque, derrière laquelle pointe déjà la figure de von Uexküll, celui qui, le
premier, a interrogé la nature des rapports de l’animal à son Umwelt.
Aucune de ces affirmations ne sera maintenue à la lettre dans les textes
suivants. Dès Sein und Zeit, en effet, on assiste à une radicalisation de
l’opposition entre le Dasein et l’animal qui va de pair avec la formulation
cette fois tout à fait explicite du problème ontologique de la vie dans sa
distinction d’avec l’existence en tant que mode d’être original du Dasein :
« L’ontologie de la vie s’accomplit sur la voie d’une interprétation
privative ; elle détermine ce qui doit être pour que puisse être quelque chose
qui ne serait “plus que vie” » 1. Le mode d’être de l’animal, du vivant, doit
être déterminé à partir des existentiaux du Dasein au moyen d’une via
privationis qui ne laisse à la vie que le statut d’une infra-existence, d’une
existence dépouillée de certains de ses caractères ontologiques essentiels.
Du même coup, le bénéfice des découvertes biologiques positives se voit
sévèrement limité, puisque la biologie, comme toute science ontique, est
aveugle aux caractères ontologiques de son domaine de recherche, qu’il
revient à la philosophie (sous la forme d’une ontologie fondamentale), et à
elle seule, de déterminer. Aussi, Heidegger insiste-t-il cette fois moins sur
les avancées de la biologie contemporaine, que sur son « insuffisance » de
principe :
Le propos ontiquement trivial : « avoir un environnement » pose un
problème ontologique. Le résoudre ne réclame rien d’autre que de déter-
miner d’abord l’être du Dasein de manière ontologiquement satisfaisante.
Que la biologie – surtout à nouveau depuis K. E. v. Baer – fasse usage de
cette constitution d’être, cela n’autorise pas à taxer son usage philo-
sophique de « biologisme ». Car la biologie, en tant que science positive,
n’est pas capable elle non plus de découvrir et de déterminer cette structure
– elle est obligée de la présupposer et d’en faire constamment usage 2.
Seule l’interprétation ontologico-fondamentale de l’être du Dasein
fournit à l’investigation sur l’être de la vie son « sol » et son point de départ,
en même temps qu’elle soustrait la recherche existentiale à toute espèce de
1. M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 16 e éd., 1986, § 10, p. 49 ;
trad. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985, p. 59.
2. Ibid., § 12, p. 58 ; trad. cit., p. 64.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%