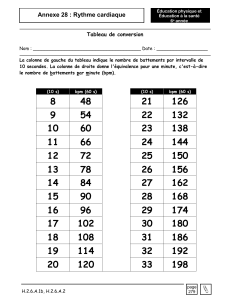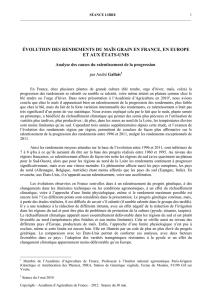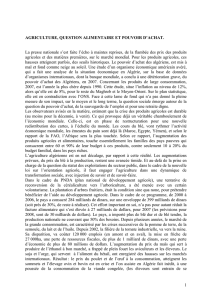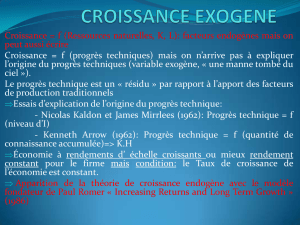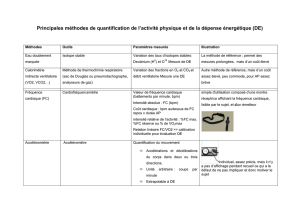LES ORIGINES SUPPOSÉES DU PLAFONNEMENT

SOURCE (http://www.agriculture-environnement.fr)
LES ORIGINES SUPPOSÉES DU PLAFONNEMENT
DES RENDEMENTS DE BLÉ
La stagnation des rendements de blé en France est-elle la conséquence d’un changement climatique ? Cette
hypothèse, certes convaincante, est moins évidente qu’il n’y paraît.
En dehors de la récolte exceptionnelle de 2009, le blé tendre d’hiver accuse depuis une quinzaine d’années un
net ralentissement, voire une stagnation de ses rendements. Ce constat vaut également pour le blé dur, le colza
et l’orge – comme l’avait déjà relevé, graphiques à l’appui,Agriculture & Environnement en mai 2006. Lors des
rencontres de l’Inra organisées au Salon de l’Agriculture en février 2009, Gilles Charmet, de l’Inra Clermont-
Ferrand, et Philippe Gate, de l’Institut du végétal-Arvalis, ont tenté d’expliquer les origines de ce plafonnement,
dont ils attribuent la cause principale au changement climatique. Une hypothèse largement reprise dans un récent
rapport cosigné par le Pr André Gallais, Philippe Gate et François-Xavier Oury, qui a fait l’objet d’une
présentation à l’Académie d’Agriculture le 5 mai dernier.
Cette explication comporte de très nombreux avantages . En effet, elle exclut toute stagnation du progrès
génétique (c’est-à-dire le travail des sélectionneurs et de l’Inra) et elle minimise le rôle des itinéraires
agronomiques (donc de l’orientation de la politique agricole et des itinéraires techniques proposés depuis le
milieu des années 90). Mieux encore, elle se base sur des données chiffrées de Météo France a priori
incontestables [1], et sur des observations réelles des effets de la hausse des températures. Enfin, elle explique
pourquoi ce phénomène affecte certaines cultures (blé d’hiver et colza d’hiver) et pas d’autres (maïs, betterave),
ces dernières profitant au contraire du changement climatique.
À l’instar d’Agatha Christie, l’auteur du fameux roman policier Dix petits nègres, l’équipe Gallais-Gate a procédé à
une élimination méthodique de toutes les causes possibles, pour au final en retenir une principale : le climat.
Les suspects
Premier suspect examiné : le progrès génétique. Selon un rapport réalisé en septembre 2004 par le Groupe
d’étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves), rien à signaler à ce sujet.Christian Leclerc,
secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS), se veut pour sa
part rassurant : « Dans l’ensemble de nos essais, nous n’avons pas observé de stagnation, ni avant, ni après
2000 ». Selon le Pr Gallais, le progrès génétique engendrerait une augmentation de rendement de 0,9 q/ha/an en
conditions intensives traitées (avec fongicides) et de 1,4 q/ha/ an en conditions intensives non traitées, signe que
la résistance aux maladies est l’un des facteurs pris en compte dans la sélection des variétés modernes.
L’agronome émet toutefois quelques réserves : « Les expérimentations Geves démontrent que le progrès
génétique continue, mais ne permettent pas une assez grande précision pour conclure s’il y a ralentissement du
progrès ».
TECHNIQUE AGRICOLE – Info Technique BLE (13/05/11)

Le rapport de l’Académie aurait également pu noter le rôle de l’orientation de la sélection variétale du blé. En
effet, alors qu’au début des années 90, la surface en blés de panification supérieure (BPS) représentait 31 % des
surfaces de blé françaises, elle est passée à 80 % en 2007-2008. Une amélioration aussi significative de la
qualité des blés n’a sans doute pas été sans conséquences sur le rendement. D’autant plus que le blé accumule
des difficultés d’ordre physiologique, qui rendent difficile l’application de la sélection à de nombreux caractères à
la fois (surtout lorsque ceux-ci sont antinomiques – comme la teneur en protéines, qui s’oppose au rendement).
Se pose ensuite la question du transfert du progrès génétique sur le terrain. Car en France, l’auto-
approvisionnement en semences concerne presque 50 % des surfaces cultivées en blé. Ce qui explique que
l’âge moyen des variétés de blé cultivées soit de sept ans, c’est-à-dire quasiment le double que pour le maïs,
dont le taux de renouvellement s’est même accéléré ces dernières années (5,7 ans en 1989 contre 4 ans en
2007). Il en découle pour le blé un considérable ralentissement du transfert du progrès génétique par rapport au
maïs. En outre, le choix des semences de ferme (moins onéreuses que des semences certifiées) se traduit par
une plus faible protection sanitaire, correspondant à un souci de rentabilité plus qu’à un souci de rendement.
Face à ces arguments, le Pr Gallais et Philippe Gate rétorquent que ce taux d’auto-approvisionnement ne devrait
pas influencer la courbe des rendements du blé dans la mesure où il n’a pas changé depuis vingt ans. Il n’en
reste pas moins que la réponse au progrès génétique est beaucoup plus lente avec le blé qu’avec le maïs ou la
betterave, dont les rendements continuent à progresser. Il est vrai que les producteurs de maïs bénéficient de la
recherche de puissants établissements de sélection, situés aux États- Unis comme en France (Limagrain, Ragt,
Euralis, Maïsadour, Monsanto, etc.). Selon le Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé, l’effort
consacré au blé est quatre fois plus faible que celui consacré au maïs (400 millions de dollars pour le blé contre 1
500 millions pour le maïs). Ce qui s’explique partiellement par le fait que les variétés hybrides permettent un
rapide retour sur investissement.
L’azote
Deuxième suspect étudié : les apports azotés. Si Philippe Gate admet qu’une diminution a bien eu lieu depuis
1995, « cette évolution, qui met en jeu effectivement 20 unités d’azote, est tout à fait marginale en termes
d’impact sur le rendement, probablement inférieur à un quintal », relativise-t-il. « Depuis les années soixante-dix,
il n’y a pas eu d’évolution moyenne de la masse sèche produite à la floraison (environ 12,5 t/ha) », poursuit
l’expert. Ce qui signifie que les quantités d’azote disponibles correspondent bien aux besoins de la plante. Une
analyse confirmée parPhilippe Éveillard, responsable environnement de l’Union des industries de la fertilisation
(Unifa), qui estime que cette baisse (de 10 à 20 %) s’est effectivement accompagnée d’un gain d’efficacité sur les
apports (fractionnement, ajustement grâce aux outils de pilotage, etc.). Le maintien au-delà de 11 % de la teneur
en protéines – qui n’aurait pas été possible si la plante avait manqué d’azote – en est une autre preuve. En
revanche, la baisse notable des apports en phosphore et en potassium n’est peut-être pas étrangère à la
stagnation des rendements dans certaines parcelles, notamment là où le potentiel de fertilité est limité. L’effet
d’une diminution de la fertilisation – qui reste un élément essentiel lié aux rendements – demande donc à être
approfondi. Quoi qu’il en soit, le rapport de l’Académie estime à un quintal la perte maximale due à une
fertilisation globale inadéquate.
La protection sanitaire
Troisième suspect : la protection des plantes. Sur ce point, le raisonnement de Philippe Gate se base
essentiellement sur l’observation d’une absence de corrélation entre rendement national et nuisibilité. Rappelant
qu’en France, la nuisibilité moyenne est de 17 q/ha (avec des variations interannuelles allant de 10 à 30 q/ha),
l’expert d’Arvalis note que l’année 2003 a connu de très faibles rendements nationaux alors que la nuisibilité était
faible, suite aux différents facteurs limitants (gel, sécheresse puis canicule). À l’inverse, certaines années de très

forte nuisibilité (comme 2004 et 2008) sont paradoxalement des années qui affichent de très bons
rendements.« De surcroît, c’est dans les régions à plus fortes nuisibilités que l’on rencontre les rendements les
plus élevés », précise l’agronome, qui en déduit que les agriculteurs répondent correctement à la pression des
ravageurs.
Quoi qu’il en soit, il est important de noter que l’essentiel de la nuisibilité due au parasitisme – notamment à la
septoriose, maladie dominante du feuillage dans les régions nord – s’exprime surtout par temps humide, c’est-à-
dire un temps favorable à une croissance végétative du blé, et donc aux rendements. Dans ce cas, une bonne
protection fongicide permet de mieux exprimer le potentiel de la plante. Mais rien ne prouve que l’agriculteur vise
le rendement optimum : il peut tout aussi bien se contenter d’un rendement estimé suffisant.
Ce constat démontre surtout l’importance de l’utilisation des fongicides ! Dans le passé, on observait en effet que
les années humides étaient précisément les plus mauvaises en termes de rendement. Aujourd’hui, grâce à la
protection des plantes apportée par la chimie, c’est le contraire qui se produit. C’est pourquoi dans les zones nord
en particulier, là où le cycle végétatif est le plus long, les années humides voient se développer des maladies très
virulentes qui font s’effondrer les rendements des blés bio, alors que le haut niveau de performance des cultures
conventionnelles est préservé grâce aux fongicides anti-septoriose. Or, depuis le milieu des années 90, l’usage
des produits phytosanitaires a baissé : en dix ans, l’indice de fréquence de traitement (IFT) a diminué en
moyenne de 25 % ! Un chiffre loin d’être insignifiant.
Ce n’est pas l’avis de Philippe Gate, qui est convaincu que cette baisse n’a eu que très peu d’incidence sur les
rendements ; en tout cas, une incidence « inférieure à 2 q/ha ». Additionnés au quintal perdu faute d’une
fertilisation suffisante, ces deux quintaux perdus par manque de protection sanitaire représentent un total de 3 à 4
quintaux maximum. Or, pour le blé, « les rendements d’aujourd’hui sont de 14,1 q/ha inférieurs à ceux que l’on
aurait pu attendre sur la base des progrès réalisés de 1955 à 1989 », indique le rapport de l’Académie. « L’effet
majeur apparaît être celui de l’augmentation des températures et ce qui peut lui être associé : il pourrait expliquer
à lui seul une réduction de 8-9 q/ha », concluent ses auteurs.
Une hypothèse attrayante
L’idée est séduisante. Encore faut-il pouvoir la démontrer ! Car si l’impact du climat sur la variation des
rendements est indéniable, l’existence d’une corrélation entre le réchauffement climatique, c’est-àdire
l’augmentation progressive des températures, et un plafonnement des rendements, reste encore à prouver.
Afin d’étayer son hypothèse, Philippe Gate avance deux phénomènes distincts : l’échaudage thermique et le
déficit hydrique. Certes, ce dernier constitue un facteur limitant, mais il est davantage lié à la pluviométrie qu’à la
température. La dynamique des nuages étant encore une grande source d’incertitudes en matière d’évolution
climatique, on peut difficilement corréler la pluviométrie à un réchauffement de la température. L’année 2009,
considérée par Météo France comme l’une des plus chaudes, a été une excellente année pour l’ensemble des
cultures, y compris pour le blé, qui a bénéficié – en tout cas dans une majorité de départements – de conditions
climatiques très favorables, même en ce qui concerne la disponibilité en eau. Néanmoins, il reste vrai que les
conditions d’apport en eau depuis une vingtaine d’années ont été pénalisantes pour toutes les grandes cultures.
Ce qui n’a pas empêché les rendements de maïs de continuer à progresser...
La piste de l’échaudage
La question de l’échaudage (c’est-à-dire le remplissage du grain, qui a lieu pour le blé d’hiver entre mi-mai et fin
juillet) semble en revanche très pertinente. L’analyse des températures moyennes montre en effet une
augmentation de 0,073° C par an (chiffres observés à la station de l’Inra-Versailles), soit environ 2 degrés depuis

25 ans. Toutefois, ce n’est pas tant la légère augmentation de la température à un stade particulier de la plante
qui est en cause que le dépassement d’un seuil critique. Sachant qu’au-delà d’environ 25° C, les céréales à paille
entrent en sénescence et que le remplissage du grain est interrompu, Philippe Gate a retenu le nombre de jours
où la température avait dépassé le seuil critique des 25° C. Ensuite, il a vérifié si depuis 1995, l’effet seuil s’était
manifesté de façon accrue. Il a relevé – en tout cas pour les stations de Châlons, Nîmes et Toulouse – une
augmentation du nombre de jours accusant des températures supérieures à 25° C. Avec 30° C presque partout
en France dès la fin du mois de mai en 2003, 2005 et 2006, l’hypothèse du rôle négatif du climat sur le
remplissage du grain tient la route.
Observations sur le terrain
Peut-on pour autant écarter aussi catégoriquement toutes les autres pistes, presque réduites à des
épiphénomènes ? Car sur le terrain, des écarts de rendements très importants sont observés, alors qu’ils ne sont
clairement pas attribuables au réchauffement climatique. Le cas deGuillaume Hache, un céréalier installé en
Gaec avec son frère dans une exploitation de 166 hectares située dans le Nord, confirme une hétérogénéité des
rendements bien supérieure aux 10 à 14 q/ha manquants relevés par l’Académie d’Agriculture. « Le rendement
moyen de blé obtenu sur les 60 ha atteint 109 q/ha, avec des extrêmes qui s’échelonnent de 70 q/ha dans le cas
de blé sur blé à 130 q/ha », note Guillaume Hache, qui fait partie des agriculteurs qui établissent leur programme
de fertilisation annuel sur des analyses de sol précises, effectuées tous les quatre ou cinq ans aux mêmes
endroits grâce au positionnement GPS. Or, depuis les années 80, le pourcentage des rotations où le blé a
succédé à une légumineuse n’a cessé de régresser, alors que ce type de rotations entraîne à lui seul une
augmentation de rendement pouvant facilement atteindre 3 à 4 q/ha (Brisson et al., 2010). C’est ce
qu’observe Didier Le Ray, un agriculteur éleveur installé dans la région d’Angers. « Dans l’une de mes parcelles
de blé, j’ai obtenu 110 q/ha en 2009, mais il est vrai que les conditions étaient idéales : rotation de blé sur de la
féverole, permettant une disponibilité en azote tout au long du cycle végétatif, et précipitations au moment
adéquat », témoigne-t-il.
Même constat de la part de Richard Dambrine, ingénieur agronome et consultant dans le nord de la
France : « En 2008, les agriculteurs qui avaient fini la moisson avant le 6 août ont eu des rendement meilleurs
qu’en 2009. En revanche, ceux qui ont moissonné parfois jusqu’à fin septembre ont eu des pertes de rendements
de l’ordre de 25 % par rapport à leurs meilleures parcelles, et ont seulement eu un rendement normal. » Sur les
parcelles de ses clients, Richard Dambrine observe des écarts de rendement de 35 q/ha selon les pratiques
individuelles (de 85 q/ ha à 120 q/ha, avec des moyennes allant de 90 à 95 q/ha). « En 2009, ces écarts ont été
plus restreints : de l’ordre de 15 q/ha, d’où des résultats plus élevés et des moyennes au-dessus de 115 q/ha.
Même les terres plus délicates ont eu des rendements aux alentours de 100 q/ha en moyenne, en hausse de 12
q/ha par rapport à 2007 et 2008 », poursuit l’agronome. Ces excellents résultats sont le fruit de l’extrême attention
portée par ces agriculteurs aux traitements phytosanitaires : « Qu’ils soient en labour ou en TCS, mes clients
n’ont pas abandonné une fertilisation P, K, Mg plus élevée et régulière que la moyenne des agriculteurs ! Mais
leurs résultats économiques sont aussi plus élevés, la plupart ayant des résultats situés dans le quart supérieur,
et souvent avec une marge meilleure que ceux qui fertilisent moins ou pas du tout. En revanche, leur utilisation
de fongicides est généralement raisonnée, avec 1,35 intervention fongique depuis dix ans (sauf pour les années
1997 et 2008, où ils avaient une moyenne de 1,65 intervention). »
Bien entendu, il serait aventureux d’extrapoler ces quelques exemples de terrain pour obtenir des tendances
nationales de fond. Tout comme il est facile de faire disparaître les spécificités locales dans des moyennes
nationales, comme le font l’essentiel des modèles mathématiques. Toutefois, ces exemples témoignent bien de
l’importance de l’agronomie et des pratiques agricoles dans les rendements.
Une évolution logique

Par ailleurs, il n’est pas anodin de constater une certaine cohérence entre la stagnation des rendements de blé et
de colza et l’évolution de la politique agricole française. Le début du ralentissement observé correspond en effet à
la mise en oeuvre de la « nouvelle PAC », marquée par l’ouverture du marché européen. Ce virage a entraîné
une modification des pratiques agricoles. Lancé à partir des instituts techniques, le nouveau mot d’ordre a été
non pas de viser de hauts rendements, mais de meilleures marges. D’où le retour à des semis plus tardifs, à des
rotations de cultures avec des cultures d’opportunité plus rentables, et le début des stratégies de réduction des
doses de fongicides, assurément utiles pour optimiser les marges. Les années 90 marquent aussi le début de la
chasse aux nitrates dans l’eau et de l’optimisation des plans de fumure. Les apports d’engrais, qui avaient baissé
pour des raisons économiques liées à la « nouvelle PAC », n’ont plus jamais remonté la pente, en raison des
contraintes environnementales acceptées in fine par les agriculteurs. Enfin, en 1995 a commencé la période où le
travail simplifié (TCS ou Sans Labour) s’est étendu aux céréales des régions productives du centre et de l’est de
la France. L’objectif étant ici aussi de limiter les coûts de production, quitte à obtenir des rendements légèrement
moins élevés. Et tout cela fonctionne ! Depuis, le travail simplifié s’est beaucoup développé, et la plupart de ses
utilisateurs travaillent dans une optique d’optimum économique, sans rechercher le rendement maximum comme
c’était le cas auparavant.
Une conjonction de facteurs
Intervenus durant les quinze-vingt dernières années, ces changements n’ont-ils pas provoqué une dissociation du
potentiel du progrès génétique et de la volonté du cultivateur d’utiliser pleinement celui-ci ? La question mérite
d’être posée. D’autant plus que les solutions disponibles en termes de protection des plantes sont devenues au fil
du temps moins performantes en raison des résistances vis-àvis de certaines matières actives. Enfin, le
découplage production/soutien et les mesures environnementales ont réorienté le monde agricole vers une
désintensification des cultures. Conjugués à la hausse des prix des intrants et aux faibles cours des céréales, ces
facteurs ont bouleversé les calculs d’optimum économique, qui ne correspondent plus nécessairement à
l’optimum des rendements. Finalement, la stagnation des rendements ne reflète-t-elle pas la conjonction de ces
multiples paramètres ? « L ’ensemble des facteurs “itinéraires techniques“ connus explique une perte de 7 q/ha,
voire 8 q/ ha », reconnaît le Pr Gallais, qui demeure toutefois convaincu que le reste (soit entre 4 et 9 q/ha)
s’explique par l’effet de la température. D’où son insistance vis-à-vis des semenciers pour que ces derniers
mettent au point des variétés qui prennent bien en compte ce facteur. Un atout dans certains cas « Encore faut-il
que l’effet du réchauffement climatique soit bien confirmé et, surtout, que son action sur les rendements soit
correctement identifiée », tempère Bernard Le Buanec, membre de l’Académie d’Agriculture, en conclusion de la
séance du 5 mai. Une recommandation d’autant plus sage que ce qui se présente comme un inconvénient dans
certaines régions peut s’avérer être un atout dans d’autres ! « L’augmentation de l’éclairement, qui va de pair
avec plus de jours ensoleillés, permettra aux cultures du nord de la Seine d’avoir les mêmes caractéristiques
(matière sèche et taux de protéines) qu’aujourd’hui, mais avec 10 à 15 % d’intrants en moins, car le “rendement”
de transformation des plantes, quelles qu’elles soient (blé, orge, colza, maïs et betterave), sera plus efficient »,
prédit Richard Dambrine, qui s’appuie pour ce faire sur l’exemple de l’excellente récolte de 2009, où
l’exceptionnel éclairement enregistré de janvier à mi-octobre, les périodes de pluie idéalement réparties lors des
mois critiques de mai, juin et début juillet, et l’absence d’excès de températures lors de ces trois mois, ont permis
un mûrissement des grains lent et efficace. Par rapport à 1998, le potentiel génétique de la plante – qui a
progressé – a pu être mieux exploité. Or, ce potentiel génétique est loin d’être épuisé, la limite physiologique du
blé étant estimée à près de 150 q/ha pour la France.
[1] Cette hausse se traduit notamment par une précocité des semis au printemps (3 à 4 semaines), des vendanges en Côtes-du-Rhône
(4 semaines) et des débourrements d’arbres fruitiers.
Gil Rivière-Wekstein
1
/
5
100%