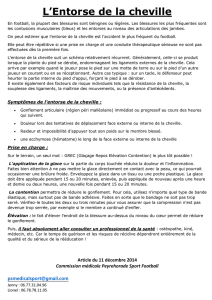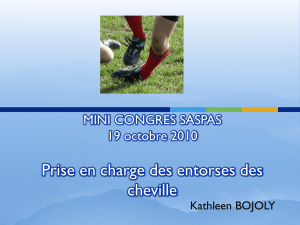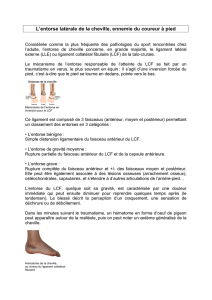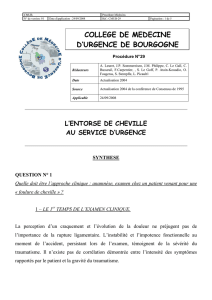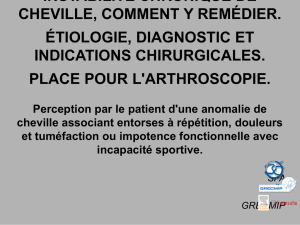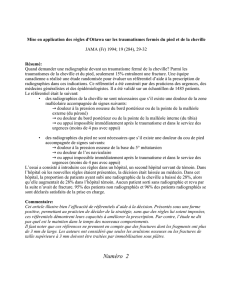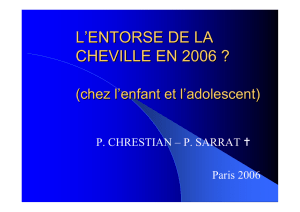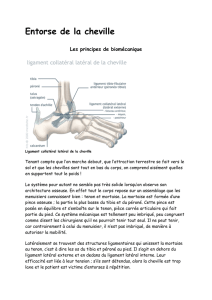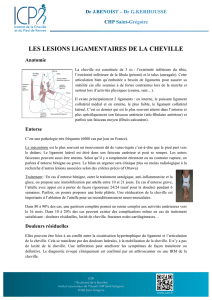l`entorse de cheville au service d`accueil et d`urgence

CONFÉRENCE DE CONSENSUS EN MÉDECINE D’URGENCE
L'ENTORSE
DE CHEVILLE
AU SERVICE D’ACCUEIL ET D’URGENCE
introduction
La fréquence et le coût de l’entorse de cheville sont
un problème de santé publique. L’incidence serait,
en France, de
6
000 cas par jour, et de 5 000 cas en
Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis, elle représente-
rait 24 000 cas par jour entraînant 5 millions d’exa-
mens radiologiques annuels avec un coût global de
500 millions de dollars. Les séquelles fonctionnelles
représentent environ 5
p.
100 des patients quel qu’en
soit le traitement.
Nombre de publications récentes remettent en
cause la prise en charge classique des entorses de
cheville. Un examen clinique précis pourrait limiter
les indications de l’exploration radiologique. Les cri-
tères d’appréciation de la gravité de l’entorse, ainsi
que les indications thérapeutiques sont remis en
cause par la littérature récente. Les recommanda-
tions classiques concernaient des milieux spécialisés
:
chirurgie orthopédique ou médecine du sport, elles
n’étaient pas toujours adaptées aux services d’accueil
et d’urgence (SAU).
Ces considérations ont conduit à l’organisation de
la
Ve
Conférence de Consensus de la Société Fran-
cophone des Urgences Médicales qui s’est tenue à
Roanne le 28 avril 1995. Elle concernait l’entorse de
cheville au SAU.
Correspondance
:
Dr B. Vermeulen, CHCE
-
Hôpital Cantonal
de Genève, 24, rue Micheli du Crest, 1211 Genève 4.
• Quelle doit être l’approche clinique
:
anamnèse, examen chez un patient
venant pour une
«
foulure
»
de cheville ?
Introduction
Devant un malade présentant un traumatisme de
la cheville, le diagnostic d’une entorse impose d’éli-
miner les lésions autres que celles atteignant les liga-
ments de la cheville. Ces lésions peuvent être autant
de diagnostics différentiels que de lésions associées
à une entorse de cheville. Elles réclament une démar-
che diagnostique spécifique.
Les lésions à envisager sont
:
-
fractures des malléoles (interne, externe, pos-
térieure), du pilon tibia1
;
-
fractures du calcanéum, de l’astragale (dont
la fracture du tubercule de l’astragale), d’un méta-
tarsien (base du
5e
métatarsien, le plus souvent)
;
-
luxation des tendons des péroniers latéraux
;
-
lésions de la syndesmose péronéo-tibiale, de
la membrane interosseuse, fractures associées du
péroné
;
-
lésions de l’articulation médiotarsienne
;
-
lésions du tendon d’Achille.
Approche clinique
Elle repose initialement sur l’anamnèse et une
analyse précise de la sémiologie. La cheville est une
Réan.
Urg.
1995, 4 (4 ter), 491-501

-
492
-
Ve
Conférence
de Consensus en Médecine d’urgence
articulation superficielle aisément palpable, son exa-
men clinique précis guide le diagnostic et précède et
oriente les examens radiologiques éventuels, ceci en
fonction des
«
règles d’Ottawa
)),
règles qui seront
explicitées au cours du texte.
Interrogatoire
-
Circonstances de survenue
Quatre éléments sont à rechercher à l’interroga-
toire du patient
:
les circonstances de survenue, la
violence du traumatisme, le délai entre le trauma-
tisme et la prise en charge aux urgences et le méca-
nisme lésionnel. Le mécanisme lésionnel exact est
souvent difficile
à
faire préciser. Sa connaissance
oriente vers certains types de lésions. Le plus sou-
vent le mécanisme est un
varus-inversion
qui entraîne
des lésions du ligament latéral. Tout autre méca-
nisme doit faire suspecter d’autres lésions.
-
Signes fonctionnels
La perception d’un craquement et l’évolution de la
douleur sont des signes classiquement évocateurs de
gravité. En fait, ils ne préjugent pas de l’importance
de la rupture ligamentaire.
L’instabilité et l’impotence fonctionnelle, au
moment de l’accident et persistant lors de l’examen,
témoignent de la sévérité du traumatisme.
-
Le terrain
L’âge modifie la nature des lésions.
l Avant 12 ans l’entorse de cheville est excep-
tionnelle (décollement épiphysaire le plus souvent).
l Après 55 ans, la fragilité osseuse est accrue
et la sémiologie moins typique.
Il est important de se renseigner sur les antécé-
dents traumatiques des chevilles, les antécédents
généraux marquants (en particulier thrombose vei-
neuse), les habitudes sportives, la profession et les
activités de loisirs.
Examen
clinique
L’examen clinique se déroule en deux temps.
l Le premier temps évalue cliniquement la pro-
babilité d’une fracture ou de complications associées.
l Le deuxième temps apprécie l’importance des
lésions ligamentaires.
Premier temps de lexamen clinique
L’inspection de la cheville recherche des épanche-
ments sanguins. La simple ecchymose n’a pas de
signification particulière à l’inverse de l’hématome.
Réan.
Urg.,
1995,
4(4
ter),
491-501
L’hématome
"
en uf
de
pigeon
"
correspond
à une
rupture d’une branche de l’artère
péronière
anté-
rieure qui
accompagne
une rupture du
ligament talo-
fibulaire antérieur. Il est considéré comme un signe
de rupture ligamentaire. Un
hématome
à la face
interne du talon oriente vers une lésion du ligament
média1 ou une fracture de la malléole interne. Un
hématome ou un œdème importants sont classique-
ment reconnus comme évocateurs d’une rupture
liga-
mentaire ou osseuse. L’œdème est retrouvé dans
66
p.
100 des traumatismes de cheville.
La palpation esf un temps essentiel
Pour palper le pied et la cheville le patient sera
assis sur le bord de la table avec les jambes pendan-
tes. Dans cette position il est relativement facile
de manipuler le pied dans des positions variées. Les
trajets ligamentaires, les repères osseux et le péroné
sur toute sa longueur seront systématiquement
étudiés
:
-
la palpation débute à distance de la zone dou-
loureuse pour rassurer le patient
;
-
les zones clefs de la sensibilité osseuse sont
également palpées
:
l parties postérieures des malléoles interne et
externe sur 6 cm de hauteur, au moins,
l pointe des malléoles interne et externe,
l scaphoïde tarsien,
l tête du
5e
métatarsien.
Les conclusions de l’examen clinique, à ce stade,
permettent de discuter de la nécessité d’une
exploration radiographique. En effet, les règles
d’Ottawa récemment proposées optimisent cette
démarche (Fig. 1).
Ces critères ne sont pas validés pour les patients
d’âge inférieur à 18 ans, supérieur à 55 ans, les fem-
mes enceintes et les conditions d’examen clinique-
ment ininterprétable pour des raisons locales ou
générales (lésions cutanées, traumatisé crânien, le
polytraumatisé, troubles de la perception).
L’utilisation des critères d’Ottawa a les avantages
suivants
:
-
très bonne sensibilité de ces critères (sensi-
bilité
=
1,0)
;
-
plus grande sécurité
:
si l’un des critères
est positif, le praticien s’abstient dans l’immédiat
de toute
manoeuvre
pouvant aggraver les
lésions
;
-
réduction des temps d’attente et de séjour au
sein du SAU pour les patients
;
-
réduction des coûts de santé. L’application
des critères d’Ottawa a permis une diminution de
30 p. 100 des demandes de radiographies, sans inci-
dence sur la qualité des soins.

Ve
Conférence de Consensus en Médecine d’urgence
-
493
-
Règles d’Ottawa
La radiographie est justifiée pour tout patient pré-
sentant une douleur de la région malléolaire
et/ou
du tarse s’il présente l’un des critères suivants
:
-
Pour la cheville
:
existence d’une douleur de
la région malléolaire associée à
:
-
une incapacité de se mettre en appui immédia-
tement et au SAU (impossibilité de faire 4 pas),
ou
-
une sensibilité à la palpation osseuse du bord pos-
térieur ou de la pointe de l’une des deux malléoles.
-
Pour le tarse
:
existence d’une douleur de la
région du tarse associée à
:
-
une incapacité de se mettre en appui immé-
diatement et au SAU (impossibilité de faire
4 pas)
ou
-
une sensibilité à la palpation osseuse du
sca-
phoïde ou de la base du
5e
métatarsien.
-
Être âgé de plus de 55 ans
A) bord postérieur
ou pointe de la
malléole
externe zone
malléolaire
B) bord
postérieur
ou pointe de la
malléole
interne
C) base du
5e
métatarsien
Vue latérale
D) scaphoïde
tarsien
(naviculaire)
Vue médiale
Une radiographie de la cheville n’est indiquée qu’en présence d’une douleur dans la zone malléolaire ainsi qu’une
:
1
douleur osseuse
à
la palpation
:
zone A
2. douleur osseuse
à”la
palpation
:
zone B
ou
3. incapacité de marche
:
juste après l’événement et lors de l’examen médical
Une radiographie du pied n’est indiquée qu’en présence d’une douleur dans la partie moyenne
du pied ainsi qu’une
:
1. douleur osseuse à la palpation
:
zone C
ou
2. douleur osseuse à la palpation
:
zone D
ou
3. incapacité de marche
:
juste après l’événement et lors de l’examen médical
(Selon
Strell et coll.
-
JAMA,
16 mars 1994, vol. 277, n°
1
1
et avec /‘autorisation de /‘éditeur)
Fig. 1
-
Règle d’Ottawa.
ciée écarté. Ce temps de l’examen est consacré à la
Second temps de lexamen clinique
Il n’est réalisé qu’une fois le risque de fracture
asso-
li
recherche des ruptures ou laxités ligamentaires. Il
s’effectue dans les deux plans frontal et sagittal.
Dans le plan frontal
:
Dans le plan sagittal
:
-
recherche du choc astragalien témoin d’une
atteinte grave de la syndesmose.
-
recherche d’un bâillement tibio-astragalien en
varus témoin de la laxité de la cheville
;
-
recherche d’un sillon péronéo-astragalien
antérieur (signe de Clayton) témoin de la rupture
antérieure de la capsule
;
-
recherche d’un tiroir antérieur.
La négativité de la recherche des signes de laxité,
dans une situation post-traumatique aiguë, n’exclut
pas la rupture ligamentaire car elle peut être due à
la douleur, un œdème ou une contracture musculaire.
A ce
stade de lexamen, les indications thé-
rapeutiques initiales peuvent être posées,
mais en aucun cas définitivement figées.
Réan.
1995, 4

-
494
-
Ve
Conférence de Consensus en Médecine d'Urgence
En fait, les données de la littérature ne permettent
pas d’attribuer à l’intensité des signes cliniques notés
à l’examen initial, les notions classiques de gravité.
Car il n’y a pas de relation cliniquement évidente
entre les données de l’examen clinique pratiqué dans
le cadre de l’urgence et les lésions anatomiques.
L’évaluation précise de ces lésions anatomiques
devrait faire appel à des techniques paracliniques qui
ne sont pas réalisables, en pratique, dans le cadre de
l’urgence (en particulier arthrographie, imagerie spé-
cialisée et arthroscopie).
De ce fait, seul un nouvel
examen
pratiqué
entre le
3e
et le
5e
jour permettra dapprécier
la sévérité effective et de réajuster éventuel-
lement le choix thérapeutique initial.
Quelle est la place de la radiologie
conventionnelle ou plus spécialisée
devant une entorse de cheville ?
La prescription systématique de clichés radiogra-
phiques dans l’entorse aiguë de la cheville est actuel-
lement discutée.
Les travaux canadiens récents (règles d’Ottawa, cf.
question
n°
1) incitent fortement à ne demander des
examens radiologiques de la cheville ou du pied qu’en
fonction de critères cliniques précis.
Le but de ces clichés est d’identifier d’éventuelles
fractures.
Si des radiographies sont indiquées
dans le cadre de l’urgence,
elles comporteront des clichés simples
Pou7 la
cheville
Les deux incidences suivantes apparaissent les plus
importantes
:
-
Profil.
-
Face en rotation interne de 20”.
Ces clichés permettent de déceler les fractures
mal-
léolaires interne et externe, de la marge postérieure
du tibia.
Pour identifier les petits arrachements
ostéo-
périostés, il faut des clichés de qualité permettant une
analyse minutieuse.
L’incidence de face en rotation interne dégage
l’angle supéro-externe de l’astragale, et l’interligne
péronéo-astragalien. Elle facilite la recherche d’une
fracture impaction de la partie externe du dôme
astra-
galien, parfois méconnue sur un cliché de face strict
du fait des superpositions osseuses.
Pour le pied
L’examen clinique orienté par les règles d’Ottawa
(douleur du cou de pied, accompagnée d’une douleur
à la pression d’un os du tarse) peut laisser suspecter
une lésion associée à l’entorse.
Des radiographies, centrées sur le pied, devront
alors être réalisées. Les incidences sont variables en
fonction des points d’appel cliniques
;
on peut pro-
poser certains clichés standards représentés par
:
face, profil, oblique externe, oblique interne du pied.
L’arrachement de la styloïde du
5e
métatarsien, frac-
ture fréquemment rencontrée en cas de mécanisme
d’entorse de cheville, est bien mise en évidence par
l’incidence en oblique interne du tarse (ou déroulé
du pied).
Les autres examens radiographiques
L’indication de ces clichés ne devrait être posée
que par un spécialiste, en fonction des choix théra-
peutiques ultérieurs et/ou des autres possibilités
d’imageries.
Les
clichés dynamiques
La pratique de clichés dynamiques (tiroir antérieur,
varus forcé) vise à mettre en évidence, de façon indi-
recte, l’importance de la rupture ligamentaire.
Leur réalisation, leur interprétation et leur exploi-
tation sont limitées par
:
-
la nécessité de conditions techniques parfai-
tes (tel le profil strict pour la recherche d’un tiroir
antérieur)
;
-
les choix de la méthode de réalisation
(manuelle, mécanique ?)
;
-
les douleurs, la contracture musculaire, qui
influent sur le résultat
;
-
le risque d’aggravation des lésions ligamen-
taires.
La sensibilité de ces épreuves est extrêmement
variable selon les auteurs.
Leur intérêt diagnostique en urgence est difficile
à évaluer rigoureusement, et paraît sans conséquence
thérapeutique immédiate.
Les autres
investigations
D’autres méthodes d’imagerie prescrite par un spé-
cialiste peuvent contribuer à apprécier la nature et
l’importance des lésions. Ainsi, le scanner permet une
bonne étude des lésions osseuses et de leur éventuel
déplacement. Les atteintes ligamentaires sont explo-
rées de façon précise par I’arthrographie et
l'arthro-
scanner et, de manière plus récente, par
l'IRM.
L’échographie paraît être une technique assez inté-
ressante pour l’analyse des ligaments, mais peu d’étu-
des ont été publiées actuellement et cette méthode
est très dépendante de l’opérateur.
Ces investigations nécessitent un équipement spé-
cifique et des radiologues entraînés. Elles ne sont pas
validées dans le contexte de l’urgence, et sont du res-
sort du spécialiste en seconde intention.
Réan.
Urg.,
1995,
4(4
ter),
491-501

Ve
Conférence de
Consensus en Médecine durgence
-
495
-
6 Quelles sont les attitudes
et les indications thérapeutiques
:
traitement conservateur,
traitement opératoire, réadaptation,
pour une entorse de cheville ?
Introduction
Les modalités thérapeutiques des entorses du liga-
ment latéral de la cheville ont évolué ces dernières
années, particulièrement depuis dix ans. La tendance
essentielle pourrait se résumer en une augmentation
des indications du traitement fonctionnel au détri-
ment de celles du traitement chirurgical. Le traite-
ment fonctionnel, privilégiant la mobilité et l’appui
précoce est admis dans les entorses peu ou modéré-
ment symptomatiques.
Quand il existe une rupture ligamentaire franche
avec laxité ligamentaire importante (habituellement et
classiquement dénommée entorse grave), la littérature
est désormais en faveur du traitement fonctionnel.
De nombreuses publications récentes d’études
ran-
domisées comparent les trois méthodes les plus
employées (traitement chirurgical initial suivi d’un
plâtre
;
traitement orthopédique par plâtre seul
;
trai-
tement fonctionnel). Il apparaît à la lecture de ces tra-
vaux que le traitement fonctionnel est supérieur au
traitement orthopédique et/ou chirurgical en terme
de délais de récupération fonctionnelle, de reprise des
activités physiques et professionnelles et de risque
iatrogène. Restent discutés les résultats sur la stabi-
lité ultérieure de la cheville, le risque de voir appa-
raître à long terme des lésions articulaires
dégénératives. Les résultats du traitement chirurgi-
cal ultérieur des éventuelles instabilités ligamentai-
res séquellaires sont aussi bons que ceux d’un
traitement chirurgical primaire. L’aspect économique
de cette orientation thérapeutique n’est pas encore
précisément évalué, mais paraît favorable. De ce fait
le traitement chirurgical apparaît désormais devoir
être réservé aux cas particuliers des lésions les plus
graves survenant chez les sportifs de haut niveau
ainsi qu’à certaines entorses associées à des lésions
osseuses.
Principes généraux des différents traitements
Traitement fonctionnel
Le but du traitement fonctionnel est de limiter
l’immobilisation et la décharge au strict nécessaire.
Dès les premières heures, et pendant les premiers
jours, le traitement fonctionnel est habituellement
précédé d’un traitement symptomatique qui a pour
but de lutter contre les phénomènes hémorragiques,
œdémateux, inflammatoires et douloureux, en utili-
sant de façon diversement associés le repos, la
cryo-
thérapie, la compression, les postures déclives et les
médicaments.
Dès que les phénomènes initiaux ont cédé, le trai-
tement fonctionnel se propose d’introduire un appui
partiel ou total, ainsi qu’une mobilisation protégée
de façon à favoriser les activités métaboliques
cir-
culatoires et cicatricielles. L’immobilisation
partielle
pendant les trois premières semaines environ protège
les processus cicatriciels constitués par la proliféra-
tion fibroblastique dans la zone ligamentaire trauma-
tisée, suivie par la formation de collagène. Dans le
même temps, elle évite les inconvénients d’une
immobilisation plus stricte, tant sur le plan trophi-
que (décalcification, amyotrophie), que vasculaire
(phlébite), iatrogène (anticoagulant), et
socio-
économique (délai de récupération et de reprise
d’activité physique et sportive).
Au-delà de la troisième semaine, l’augmentation
progressive de la mobilisation et de l’activité, d’autant
plus contrôlée que les signes cliniques initiaux étaient
sévères, accompagnent la maturation du collagène et
la formation du tissu cicatriciel définitif.
Limmobilisation stricte
Le traitement orthopédique non opératoire par
immobilisation complète, qu’il s’agisse
d'une
botte
plâtrée, ou de son équivalent en résine rigide, a pour
but la cicatrisation des lésions ligamentaires en posi-
tion courte, la consolidation des fractures non dépla-
cées et éventuellement opérées, le contrôle des
douleurs importantes et invalidantes. L’immobilisa-
tion complète introduit à l’évidence un risque inhé-
rent notamment vasculaire, trophique, cutané,
neurologique périphérique. Ces risques particuliers
nécessitent une technique de confection rigoureuse,
un traitement médicamenteux et une surveillance
appropriée.
Le traitement chirurgical
Le principe du traitement chirurgical d’une rupture
ligamentaire est de guider la cicatrisation en réali-
sant une simple suture du ligament rompu. Il ne dis-
pense pas de l’immobilisation plâtrée. Il permet
l’évacuation et le drainage de l’hémarthrose, le " net-
toyage articulaire " et l’ablation d’éventuels frag-
ments chondraux libérés. Il permet le traitement des
fractures associées de l’arrière pied. Il introduit un
risque iatrogène bien évalué dans la littérature du fait
de l’anesthésie, du garrot pneumatique et de l’ouver-
ture articulaire.
Moyens thérapeutiques non chirurgicaux
et non médicamenteux
Le traitement symptomatique
Le traitement symptomatique initial repose sur
l’application des principes popularisés sous le terme
de
"
RICE
" (Rest, Ice, Compression, Elevation) pro-
posé par Ryan. Ce traitement comporte plusieurs
éléments
:
-
Le repos, la diminution ou l’arrêt de la mise
en charge de l’articulation au stade initial sont
main-
Réan.
Urg.,
1995, 4 (4
ter),
491-501
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%